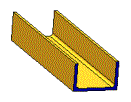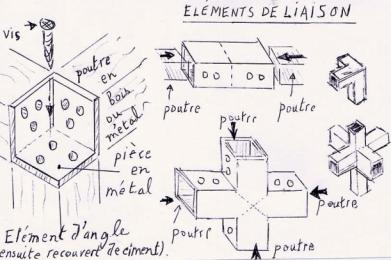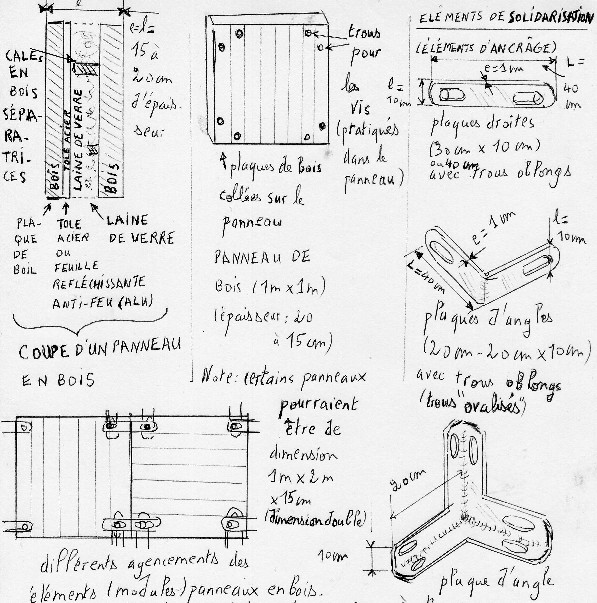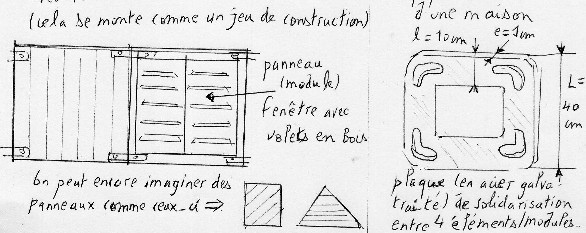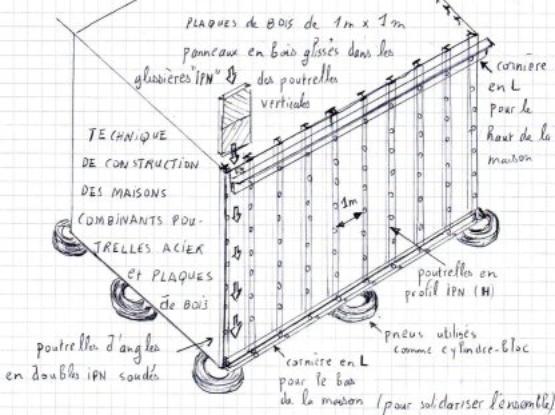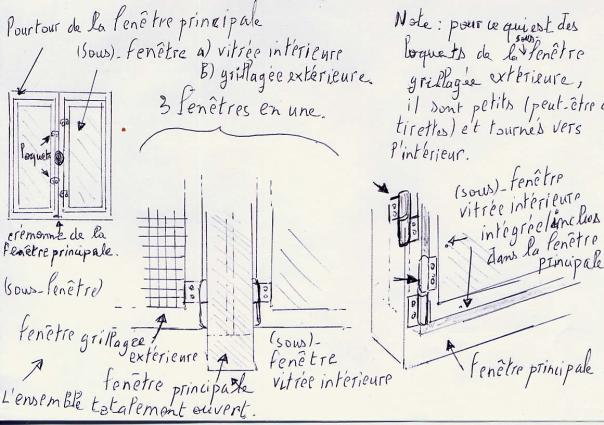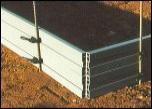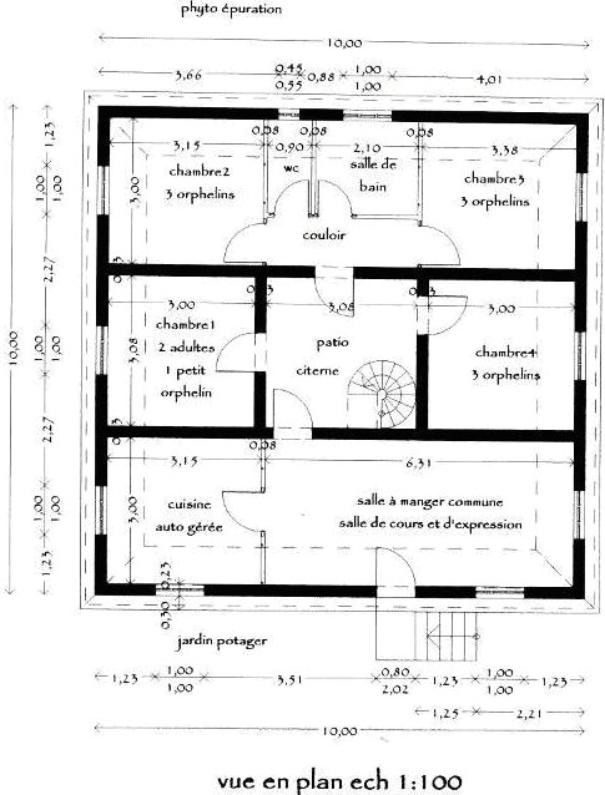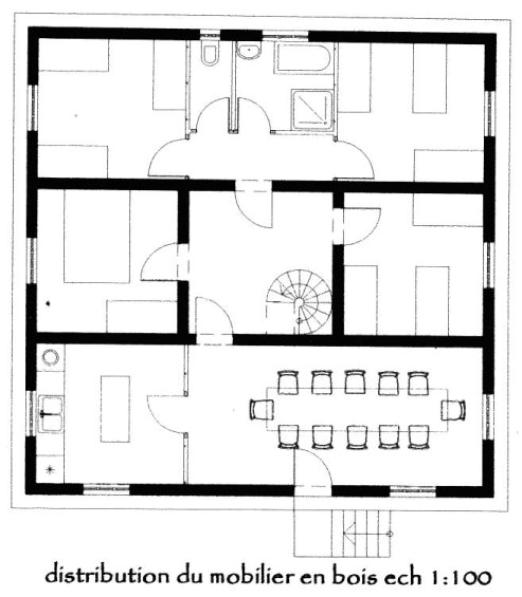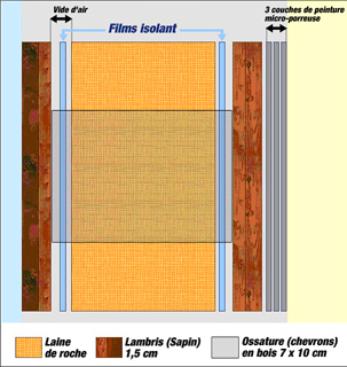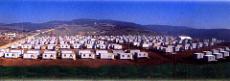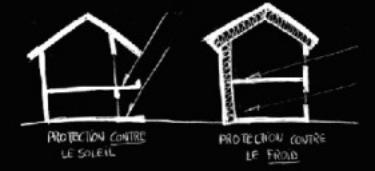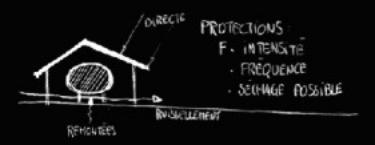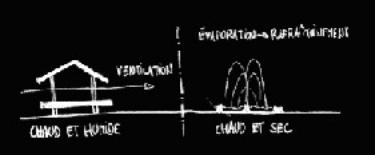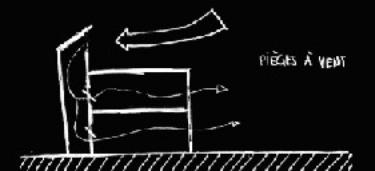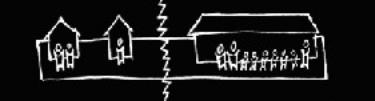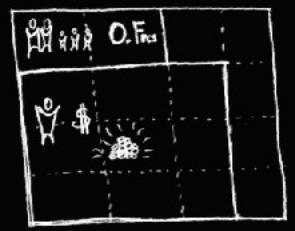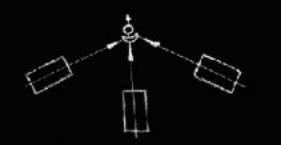Projet
« Un toit pour tous (dans le monde) »
Projet
« Un toit pour tous (dans le monde) »

Présenté, le 20 mars 2005, par Benjamin LISAN
Ingénieur, Président de l’Association Transhimalayenne
(+)
Dossier en construction  .
.
Pré-projet de reconstruction des
maisons détruites par le Tsunami du 26/12/04 en Asie du Sud – Aspects
techniques et aspects humains. V1.2.2 – maj.25/5/05

© Auroville Tsunami Relief
(+) La Transhimalayenne,
c/o B. Lisan, 16 rue de la Fontaine du But, 75018 PARIS - France
Tél :
(+33) (0)1.42.62.49.65 / (+33)(0)6.16.55.09.84, e-mail : benjamin.lisan@free.fr
La
dernière version de ce document est disponible sur les sites :
a) http://perso.wanadoo.fr/jardin.secret
b) http://transhimalayenne.free.fr
dans la page « Solidarité et humanitaire - Solidarity »
Nombre de
pages de ce document : 1
Note : Ce texte est en diffusion libre, cela afin d’aider au maximum les
victimes du tsunami.
Mais
nous appelons malgré tout que les personnes diffusant ce document doivent alors
(sont tenus d’) indiquer, lors de sa diffusion, qui sont les auteurs de telles
ou telles idées et de telles ou telles photos, images, plans, tableaux, études
contenus dans ce document et qui est l’auteur de ce document ...
Merci
de respecter cette règle préalable. Vous pouvez aussi traduire ce document, à
condition de respecter aussi ces règles et son contenu.
1 Résumé
du projet 4
2 Avant-propos. 4
3 Définition
du projet 5
4 Cadre
d’actions. 5
5 Mission. 5
6 Cahier
des charges (C.d.C.) 6
6.1 Cahier
des charges au niveau Transport 6
6.2 Cahier
des charges au niveau Montage. 7
6.3 Cahier
des charges au niveau Utilisation. 8
6.4 Cahier
des charges au niveau Fin de Vie. 10
7 Introduction
sur la justification de ce projet 11
8 Les
grands axes du projet « Un toit pour tous ». 11
9 Les
données techniques. 15
9.1 Plans
de la maison. 15
9.2 Les
éléments préfabriqués prévus. 17
9.3 Les
outils possibles à disposer sur place, pour le montage. 18
9.4 Le
toit, la terrasse (et/ou véranda) 19
9.5 La
citerne. 19
9.6 Pompe
à main (ou solaire) 20
9.7 Le
puit de captation d’eau pour l’alimentation humaine. 20
9.8 Le
puisard. 20
9.9 Le
WC sec et/ou les Feuillées Techniques + fosse sceptique. 20
9.10 Bassin
de rétention d’eau. 22
9.11 Les
panneaux solaires et chauffes-eau solaires. 22
9.11.1 Panneaux
solaires. 22
9.11.2 chauffes-eau
solaires. 23
9.12 Précautions
et normes anti-sismiques. 24
10 Précautions
sur le chantier, concernant les enfants, vols. 25
11 Autres
éléments de réflexion. 26
12 Sauver
des vies. 32
13 Tests
de faisabilité des différentes solutions. 34
14 Partenaires
commerciaux. 34
15 Partenaires
techniques envisagés pour étudier le projet 34
16 Suivi
du projet, entretien équipements des maisons. 35
17 Etapes
et développements du projet 37
17.1 Etapes : 37
17.2 Implication
des populations locales. 37
17.3 Bénévoles,
volontaires, mission ce reconnaissance, équipe « permanente ». 38
17.4 Finances,
Comptabilité …... 38
17.5 Relations
avec les investisseurs, donateurs. 38
17.6 Communications
et réunions en Europe (ou en Occident) 38
17.7 Création
d’un site Web (suite du sujet sur la communication) 39
17.8 Autres
questions. 39
17.9 Communication
locale et internationale. 40
17.10 Formations
et autres considérations humaines. 40
18 Lieu
proposé pour le projet pilote. 41
19 Prolongements
possibles de ce projet (futur + lointain) 41
20 Budget,
discussions sur les différents type de constructions. 43
21 Conclusion. 50
21.1 Rester
ouvert aux idées. 50
21.2 Créer
une « dynamique » , tenant compte des spécificités locales. 51
21.3 Maison
simple, peu coûteuse. 51
22 Annexe :
Construire sa citerne d'eau de pluie. 52
22.1 Conception
de la citerne. 52
22.2 Construction
de la citerne. 52
22.3 Où
placer la citerne ?. 52
22.4 Les
accessoires de la citerne. 52
22.4.1 Le
groupe hydrophore (pompe) 52
22.4.2 Les
filtres. 52
22.4.3 L'aérateur 53
22.5 Entretien
et difficultés. 53
22.5.1 Coût 53
22.6 Potabilisation
de l’eau de pluie. 53
22.7 Pour
être indépendant de l’eau de distribution ?. 53
22.8 Plus
d’information. 53
Annexe : constructions de
feuillées provisoires. 53
23 Annexe :
puisard (annexe provisoire) 55
24 Autre
piste : constructeurs de bungalows préfabriqués. 62
25 Autres
pistes : maisons en rondin ou « fuste ». 63
26 Autres
idées et pistes : La maison à colombage en kit 68
27 Autre
idée : Maisons en bambous et/ou toit en palme. 68
28 Autres
pistes : maison en caissons d’aluminium remplis. 68
29 Les
maisons de l’architecte Jean Prouvé. 69
30 Les
maisons « Domobiles ». 70
31 Solution
de maisons préfabriqués en bois. 72
31.1 Contraintes. 72
31.2 Solutions
avec éléments préfabriqués en bois et métal 75
31.2.1 Présentation
de la technique de construction. 75
31.2.2 Triple
fenêtre, incluant des fenêtres secondaires. 79
31.2.3 Annexe
sur les solutions maisons modulaire en bois / métal 80
32 Syflex :
système de coffrage flexible. 82
33 Maisons
en matériaux de récupération. 83
34 Prix
des maisons en kit ou en rondin. 85
35 Quelques
prix indicatifs dans les régions sinistrées. 90
36 Annexe :
Facteurs influençant la construction d’une maison. 90
36.1 Le
climat 91
36.1.1 Rayonnement
solaire, température. 91
36.1.2 Précipitations. 91
36.1.3 Humidité. 91
36.1.4 Vent 92
36.2 Environnement 92
36.2.1 Relief 92
36.2.2 Végétation. 92
36.2.3 Environnement
et écologie. 93
36.2.4 Nature
du sol et utilisation. 93
36.3 Matériaux
et techniques. 93
36.3.1 Nature
des matériaux. 93
36.3.2 Disponibilité
des matériaux. 93
36.3.3 Niveau
de développement technique et technologique. 94
36.3.4 Développement
économique. 94
36.3.5 Disponibilité
de la technique. 94
36.3.6 Autres
raisons pratiques. 94
36.4 La
culture et la société. 94
36.4.1 La
famille. 94
36.4.2 Propriété
et régime juridique. 95
36.4.3 Religion
ou philosophie. 95
36.4.4 Autres
influences (a priori culturelles …) 96
37 Annexe :
constructeurs de citerne en plastique (en PVC) 96
38 Fabricants
de charbon actif (active Carbon) 98
39 Annexe :
Ambassades à contacter en France. 99
40 Annexe :
n° utiles dans les monde pour le tsunami 99
41 Annexe :
associations partenaires tournées vers l’Asie. 100
42 Annexe :
associations, institutions du 18° Paris. 101
43 Annexe :
associations, institutions régionales, nationales, européennes. 101
44 Annexe :
associations, institutions, partenaires privés …... 101
45 Annexe :
contact médiatisation du projet 101
46 Annexe :
réfugiés, sinistrés du tsunami sans toit en Inde. 102
47 Bibliographie
générale. 102
48 Proposer
ma candidature. 102
49 Annexe
sur le projet de réseau informatique mondial 103
L'échange rapide d'info
entre tous les acteurs, est le 1er concept de ce projets. Des maisons
préfabriquées et modulaires _en poutrelles métalliques, panneaux de bois, ou
panneaux de béton _, est le 2° concept de ce projet.
L'idée est que le
concept et la construction de la maison soit très simples, rapide, pas cher et
esthétique (malgré tout) (poutrelles et plaques etc. ).
Ayant quelques expériences de terrain en Inde et au
Maroc, l’auteur va tenter d’expliquer ses motivations et les vraies
raisons de cette initiative toute personnelle, dans la rédaction de ce
dossier pour les victimes du tsunami, nommé « Un toit pour tous ».
En effet :
La plupart des ONG mondiales ne s'associent pas,
ne se concerte pas. Chacune fait son projet, dans son coin (par exemple,
un projet pour les victimes du tsunami ou autres projets ...).
Beaucoup d'ONG, dans l'urgence, construisent des maisons en
parpaings couvertes de toit en tôles ondulées, maisons qui dès le prochain raz
de marée cyclonique, seront affouillée à la base, risquant
de nouveau de s'écrouler, et dont les tôles ondulées deviendront des
projectiles meurtriers.
Pour l'instant, l’auteur constate qu'il n'y aucune
coordination, et réflexion de haut niveau, au niveau international,
réunissant toutes les ONG internationales, et les institutions internationales,
pour prévenir d'autres urgences et pour imaginer un système de construction de
maison, à la chaîne, rapide, à très bas coûts, de
maisons déjà prêtes, afin que la reconstruction, en cas
d'une catastrophe (à venir), soit "immédiate" (ainsi, il n'y aurait
plus de délais, de "cafouillages éventuels", d'attente de finances de
la part de partenaires, avec risque d'avoir à attendre un an, avant que
tout le projet soit lancé, avec la garantie de disposer à
l'avance des finances suffisantes (ce qui n'est
d'ailleurs pas toujours le cas dans la réalité) …
Mais ce ne sont que des vues toutes personnelles. L’idée du projet :
1)
est que les ONG se concertent, s'entraident, s'échangent des
idées, afin d’être plus efficaces, en pouvant alors choisir les
meilleures solutions techniques, dans un panier ou fond
commun d'idées proposées et échangées entre ONG et les populations locales (le
projet doit toujours tenir compte de leurs désirs).
2)
Que des projets retenus, après ces échanges et concertation,
par ces échanges soient développées au niveau international, avec l’accord des
populations locales.
Ce dossier pour l’instant reste un jet d’idées non encore
parfaitement structurées.
La philosophie de ce projet va dans le même sens que celle
de :
L’association française, grenobloise « Un toit pour
tous » (http://www.untoitpourtous.org
)
L’association Emmaüs de l’Abbé Pierre (www.emmaus-france.org ).
Voire celle de la Fondation canadienne « Un toit
pour tous » (http://www.royallepage.ca
),
c’est à dire la volonté ferme d'aider les êtres
les plus vulnérables, partout dans le monde, à trouver un toit durable.
L’objet du projet est de concevoir
des modules d’habitation pour zones sinistrées. Ces modules serviront à reloger
les populations sinistrées dans les délais les plus brefs, et dans des
conditions de vie minimales.
Les enjeux techniques sont de
réaliser des modules qui devront pouvoir être assemblés rapidement, simplement,
et sans outils. De plus, l’encombrement de ceux-ci, lors du transport, devra
être minimum.
La priorité principale du projet
est de tenir les délais, de respecter le planning, et de bien cerner et
respecter le cahier des charges fonctionnel.
Les livrables seront de natures
diverses : un dossier (activité projet, dossier technique, …), des plans
(CAO et papier), une notice de montage, une plaquette commerciale, et une
maquette modèle réduit.
Notre projet s’inscrit dans un contexte de catastrophe
naturelle, ou de guerre. Il s’agit de reloger des personnes démunies se
trouvant sur une zone dévastée.
Pour mener à bien le projet, nous
disposons de personnes « motivées », de moyens d’informations modernes
(Internet, bibliothèque, …), de contacts avec les ONG et les partenaires.
Nous devrons tenir compte de quelques contraintes : le
transport des modules, le coût d’un module, les normes en vigueurs, les brevets
déposés, le délais imposé.
Dans le cahier des charges initial, certains points sont
négociables : la notion de « confort minimal », le coût, les plaques en
format standard.
Le chef de projet a pour responsabilités de diffuser
l’information au sein d’une équipe, de s’occuper du suivi du planning.
Un point sur l’avancement du projet sera effectué toutes les
semaines au niveau du groupe.
L’avancement du projet sera suivi avec un logiciel de
gestion de projet.
|
Fonctions / Qualités
|
Critères de performance
|
Niveaux de performance
|
Flex.
|
Commentaires
|
|
F1. Etre facilement
|
- Adaptation aux dimensions normalisées
|
- Rentrer dans le plus
|
F0
|
- Devra rentrer dans un
|
|
stockable / transportable
|
(plans, container, camions).
|
petit container avion.
|
|
pick up et dans le plus petit
|
|
|
- Volume mort
|
- 20 % du volume total.
|
F2
|
container d’avion
|
|
|
- Respect des normes de transport en ce
|
|
F0
|
- les attaches peuvent être
|
|
|
qui
concerne les attaches.
|
|
|
prévues sur le
conditionnement
|
|
F2. Résister aux agressions
|
- Chocs
|
- Choc à 10 km/h
|
F2
|
- exemple : mauvaise
|
|
extérieures
|
|
contre un mur
|
|
manœuvre en Fenwick
|
|
|
- Température
|
- Jusqu’à 60°C
|
F2
|
- ces critères peuvent être
|
|
|
- Humidité
|
- 100%
|
F2
|
vérifiés par le
|
|
|
- Salinité
|
- Eau de mer (mer
|
F2
|
conditionnement
|
|
|
|
morte)
|
|
conception de celui-ci.
|
|
|
- Exposition solaire
|
- Totale durant 2 x 12 h.
|
F2
|
|
|
F3. Être empilable
|
- Nombre
d’empilements possible
|
- Autant que le permet
le plus grand container
|
F1
|
|
|
|
- Géométrie
|
- Parallélépipédique
|
F2
|
|
|
|
- Blocage
possible
|
- Jeu entre modules
pliés< 7 cm une fois en
place
|
F1
|
|
|
F4. Être déchargable par
|
- Poids
|
- < 100
Kg
|
F1
|
|
|
des
Hommes
|
-
Dimensions
|
- < 3 m pour la plus
grande dimension
|
F1
|
|
|
|
- Nombre de prises disponibles
|
- Pour 4 hommes maxi
|
F0
|
|
En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise
Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière
de l'Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon (ECAM, 40 montée
St Barthélemy 69005 Lyon), pour ces idées contenues dans ce tableau
précédent.
|
Fonctions
|
Critère de performance
|
Niveau de performance
|
Flex.
|
Commentaires
|
|
F5. Être montable sur
surface
non plane
|
- Inclinaison maximum
- Rugosité
-
Enfoncement du sol
|
- 25 %
- hmax = 25 cm
- < 10 cm sous la
maison
|
F2
F2
F2
|
|
|
F6. Être facilement
montable
|
- Temps de montage à la main
- Force maximale
- Hauteur maximale de travail
- Nombres d’outils utilisés
- Nombre de personnes nécessaires
pour
garantir le temps de montage
|
- < 1 heure pour 4
personnes
- Charge unitaire
<25kg
- < 2 m
- 0
- 4
|
F0
F0
F1
F1
F0
|
- on peut fournir des outils
simples
avec le module
|
|
F7. Résister aux
intempéries
|
- cf. la
phase d’utilisations
|
Les même qu’en
phase
d’utilisation
|
Cf. phase
d’utilisation
|
- dans cette phase, la
fonction peut être assurée
par le
conditionnement.
|
|
F8. Expliquer le
montage
|
- Indications
- Compréhension quelque soit la
population
- Temps de compréhension
- Impossible de confondre la
chronologie
|
- Uniquement dessins
- Symboles universels
- Rapide < 10min
- Chronologie
universelle (de haut en
bas ?)
|
F0
F0
F1
F0
|
Notice compréhensible
par des personnes de
n’importe quel pays et
qu’elles soient ou non
lettrées.
|
En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise
Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière
de l'Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon (ECAM), pour ces
idées contenues dans ce tableau précédent (et pour ce tableau précédent).
|
Fonctions
|
Critère de performance
|
Niveau de performance
|
Flex.
|
Commentaires
|
|
F9. Loger les utilisateurs
|
- Nombre de personnes
|
- 2
|
F0
|
|
|
|
- Flux d’air minimum
|
- 15 L/min
|
F0
|
|
|
|
- Surface minimale
|
- 2 m² par personne
|
F1
|
|
|
|
- Température maximale
|
- 35 °
|
F2
|
|
|
|
- Température minimale
|
- 5 °
|
F2
|
|
|
|
-
Luminosité minimal
|
- pouvoir faire un test
de vu n’importe où
dans le module en
plein jour
|
F2
|
|
|
|
- Hauteur
|
- 2 m
|
F2
|
|
|
F10.
Récupérer les eaux
|
-
capacité maximale de stockage
|
- 20 L
|
F2
|
|
|
F11. Assurer la réalisation d’un
|
- présence et dimension d’une zone où
|
- 20 cm de rayon
|
F3
|
- vraiment superflu vu le
|
|
repas simple
|
poser une
gamelle.
|
|
|
niveau de nécessité des
sinistré.
|
|
F 12. Être stable
|
- pente maximum
|
- 25 %
|
F 1
|
|
|
|
- rugosité maximale
|
- 25 cm
|
F 1
|
- doit pouvoir servir sur un
|
|
|
- Enfoncement dans le sol
|
- < 10 cm sous la
|
F2
|
terrain fortement
|
|
|
|
maison
|
|
accidenté
|
|
F13. Protéger des intempéries
|
- Force supportée sur les plaques
|
- Vent de 80 Km/h
|
F2
|
|
|
|
- Durée en plein soleil
|
- 6 mois
|
F1
|
- en zone désertique
|
|
|
- Poids maxi sur toit
|
- 20 Kg /
m²
|
F2
|
|
|
|
-
Dilatation maximale admissible
|
- ne doit pas créer de
jour vers l’extérieur ni
|
F1
|
|
|
|
|
abîmer les zones de
|
F1
|
|
|
|
|
jointure.
|
F0
|
|
|
|
- humidité
|
- 100 % pendant 6 mois
|
F2
|
|
|
|
- Débit
rentrant d’eau
|
- 0
|
|
|
|
F14.
Protéger des regards
|
- nombre
d’ouverture non occultables
|
- 0
|
F2
|
- Ne sont pas prises en
compte les ouvertures
placées hors du champ de
vision d’un passant (si elles
|
|
|
-
possibilité de compartimenter l’intérieur
|
-
oui
|
F3
|
sont placées sur le toit par
exemple)
|
|
F15. Résister au feu
|
- Critère d’inflammabilité
|
- M2 et S2
|
F1
|
- selon la norme NF P 92‑
|
|
|
- Dégagements toxiques
|
- aucun
|
F 1
|
507 : difficilement
|
|
|
- Dégagements matières polluantes
|
- aucune
|
F2
|
inflammable
|
|
|
|
- S2
|
|
|
|
F16. Résister au sel
|
- durée sous la salinité sur les bords de la
|
- 6 mois
|
F1
|
|
|
|
mer morte
|
|
|
|
|
F 17. Résister aux efforts
|
- Percussion maximale
|
- chocs d’un projectile
|
F2
|
- valeurs précédentes
|
|
mécaniques
|
|
lancé à 20 km
|
|
obtenue avec le petit bout
|
|
|
- Pression maximale
|
- 50 bars
|
F2
|
d’un marteau.
|
|
|
- force supportée par un système de
|
- équivalente à celle
|
F2
|
- pour le haubanage
|
|
|
haubanage
|
d’un vent de 120 km/H
|
|
|
|
F 18. Protéger des insectes, de
|
- Jeu maximal
|
- nul
|
F 1
|
|
|
la faune, flore…
|
- Dimensions maximales des ouvertures
|
- 1 mm
|
F1
|
|
|
|
permanentes.
- Durée de vie sous agression de la faune
|
- 6 mois
|
F0
|
|
|
|
(termite)
- Durée de vie sous agression de la flore
|
- 6 mois
|
F0
|
|
|
|
(champignons, moisissures =
développement sous une humidité de
100%)
|
|
|
|
|
F 19. être facilement lavable
|
- temps de nettoyage.
|
- moins de 30 min
|
F2
|
|
|
à
l’intérieur
|
- moyens
de nettoyage.
|
-
branches sèches, eau
|
F2
|
|
En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise
Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière
de l'Ecole Catholique des Arts et Métiers de Lyon (ECAM), pour ces
idées contenues dans ce tableau précédent.
|
Fonctions
|
Critère de performance
|
Niveau de
performance
|
Flex.
|
Commentaires
|
|
F20. Respecter l’environnement
|
Le module
doit respecter:
Normes
antipollution
Utiliser
matériaux biodégradables
|
Être
réutilisable
Aucun produit
toxique
|
F0
F2
|
80% de matériaux
réutilisables.
Le module ne
doit absolument pas détériorer son environnement
après utilisation nominale. Il peut remplir une autre fonction ou bien
les populations doivent pouvoir utiliser
les différents matériaux qui le constituent.
|
|
F21. Permettre
la récupération des matériaux
|
On se
borne à limiter
altération des
performances des matériaux
|
démontage
possible
et sans risque de blessures majeures
pas de risque
sécuritaire pour les ré-utilisateurs
|
F0
|
On se borne à limiter l’impact négatif sur son environnement après la phase
d’utilisation ; la possibilité d’une seconde utilisation (en cas de recyclage de la maison) ne fait pas partie de
nos considérations.
|
En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise
Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière
de l'Ecole Catholique des Arts et Métiers de Lyon (ECAM), pour ces
idées contenues dans ce tableau précédent.
Nous espérons malgré tout trouver des solutions permettant
de réaliser des constructions aussi
pérennes que possible,
Si
possible des maisons pouvant, par exemple, durer 50 à 100 ans.
Nous
rajouterons dans ce cahier des charges, la protection de la maison contre le risque de vol
(dans certains pays, on protège la
maison par des volets, par des portes fermées à clés, voire des barreaux sur
les fenêtres).
Se reporter aussi à l’annexe 33 « Facteurs
influençant la construction des maisons ».
Le Secrétaire général d’ONU,
Kofi Annan, a confirmé, le 18 janvier 2005,
qu'il allait nommer un Envoyé spécial, pour facilier les efforts de reconstruction
des régions dévastées par le tsunami, en Asie du Sud, du 26 décembre dernier.
Celui-ci devra encourager la communauté internationale à rester engagée. Il
sera en relation avec les associations humanitaires et les donateurs ayant fait
confiance dans l’ONU.
Dans ce cadre, est prévu, en
particulier, la reconstruction des maisons détruites.
Déjà, l’UNHCR prépare
l’envoi dans la zone d’Aceh, en Indonésie, de quelque 250 préfabriqués offert
par le Rotary International, arrivés par un convoi de 8 camions jeudi au bureau
de répartition de Meulaboh. Chaque préfabriqué est prévu pour 10 personnes et
contient des couvertures, une lampe, des tablettes pour purifier l’eau, des
containers de cuisine et d’eau potable.
Source : http://www.action-refugies.org/actualite/tsunami280105.htm
Dans ce document nous
présentons donc un pré-projets proposant une série d’idée pour faciliter et
accélérer la reconstruction de nouvelles maisons plus solides, pouvant résister
aux catastrophes naturelles _ cyclones, tsunami, semblable par son effet à une
crue catastrophique … (imaginer des maisons en tout cas plus solides que les
maisons en briques, briques crues, pisés, bois … _ en général non en béton ferraillé
_, précédemment utilisées et détruites).
Dans ce projet, nous avons
connu des maisons réalistes, peu coûteuses, durables.
Ce projet est soumis d’abord
des architectes expert (ASF, voir plus loin) et à des architectes locaux, lors
de séances de brainstorming, destinées à créer la maison la plus réaliste
possible, facile à réaliser, livrer, monter, peu coûteuse, durable, fiable,
aussi autonomes et hygiénique que possible
… (voir page 37).
Une approche écologique ne
sera jamais exempte de ce projet.
Eventuellement, faire jouer
la concurrence et faire coexister plusieurs projets.
Résumé de ce chapitre :
Matériaux de la maison :
béton armé précontraint moulé en usine ou sur place.
Mode de transport : camion
(ou réalisation sur place).
outils : voir outils au
paragraphe 4.3
Moyens humains : personnes
locales, plus chef de chantier expert
moyens financier : programmes
du PNUD, cotisation associations …
L’idée principale développée
par ce projet est de fabriquer des maisons en kit ou préfabriqués, destiné aux victimes du
Tsunami, facile à monter, comme des « meubles IKEA », très solides,
capables de résister à un nouveau Tsunami et d’entretien facile (voire si
possible sans entretien). L’idée existe déjà et a été développé par le PNUD
pour un projet de relogement à Port-aux-Princes à Haïti (source : Apprendre à travailler le bois,
constructions, transformations des aliments, métaux etc. .., 7 cassettes vidéo,
Ramigé Film Produktion, UNESCO, 1997).
.
Nous verrons que pour le
gros œuvre, le prix d’une maison sera d’environ 2000 € à 3000 €, en Inde, pour
une maison de 60 m2 (voir plus loin, chapitre budget).
On estime à 5 millions de
déplacés, ayant tout perdu, soit peut-être 200 000 habitations détruites à reconstruire, au moins,
pour reloger ces personnes.
La construction à la chaîne
à TRES grande échelle, de ces maisons, devraient en réduire leur(s) coût(s).
La
seconde idée, c'est que ces maisons, en éléments préfabriquées, ou présentées
en kit comme les meubles Ikéa (ou comme des pièces d’un Legos ou d’un grand
puzzle) soient livrées avec plan de montage, et soient fabriquées en très
grand nombres dans de très grands usines, situées dans les pays concernés.
Mais
facilement transportables dans des petits conteneurs 20 pieds ou des camions indiens, et faciles à monter sur place à
la main à plusieurs, ou avec une petite grue.
La
3° idée serait qu’elles ne coûtent 5000 euros par « unité
d’habitation familiale », or nous verrons que nous pouvons descendre
jusqu’à 3000 € (pour le gros œuvre).
La
4° idée est qu’elles seraient construites sous l'égide de l'ONU, du
PNUD et le partenariat d’un grand nombre d’ONG locales ou internationales.
La
5° idée de ce projet serait que tous le monde, dans les régions sinistrées
(Indonésie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Maldives, Somalie …), puisse bénéficier
de ces "unités d'habitation". Ces maisons seraient en béton
armé ou en bois, de plein pied (comportant juste un rez-de-chaussée).
Elles
comporteraient toutes :
des
fenêtres, simples, simple battant ou doubles battants, munies des volets
métalliques, solides, galvanisés et peints, ou en bois massif, comportant une
plaque métallique anti-effraction _ idem pour les portes (pouvant résister aux
cyclones et tsunamis et aux effractions et vols, suffisamment jointives quand
fermées, pour que les ouvertures soient totalement closes _ pas d’insertion
d’un pied de biche possible entre le montant de la fenêtre et le volet),
une
porte d’entrée (voire une porte à l’arrière pour la cuisine), avec une bouche
d’aération (ou de ventilation) au-dessus des portes,
plusieurs
pièces,
une
cuisine, avec évier, un coin réchaud à gaz (ou à bois) et pompe à main,
une
salle de bain, avec un lavabo et une douche et une pompe à main,
un
puisard avec charbon actif et sable,
un WC
rudimentaire, sec (avec une fosse sceptique, voire au charbon actif),
un
grand réservoir ou citerne d'eau sur le toit (avec un filtre au charbon
actif),
une
collecte des eaux de pluie, vers la
citerne du toit, alimentant la douche et le robinet de la cuisine une petite
pompe à main, avec puit, s'il y a une nappe phréatique potable, en dessous
Plus
éventuellement, un panneau solaire avec régulateur et batterie, d’une
marque solide, de prix réduit (+).
(+)
comme, ceux par exemple, de la marque Tata (construits en Inde), pour alimenter
une, 2 ou 3 ampoules lumineuses, 12 ou 24 V dans la maison et sur la
terrasse. Il y aurait une ampoule 40 W
par pièce. Prévoir aussi une ampoule, au dessus de chaque porte, à l’extérieur
de la maison, chaque ampoule étant protégée par un globe en plastique.
L’équipement Tata est normalement de peu d’entretien.
Précautions :
1) en Inde, la plupart des
maisons sont équipés de citerne en PVC assez inesthétiques, sur leur(s)
toit(s), mais peu coûteuses. On pourrait alors prévoir ces citernes en couleur
claire ou blanche (il en existe en blanc en Inde).
2) Même si au départ, elles
seraient toutes identiques, comme les habitations de certains lieux
reconstruits (Arménie, Turquie …), cela serait déjà une avancée humaine et
sociale (selon l’humble avis de l’auteur).
3) Si elles étaient en bois,
il serait important qu'elles soient faciles à monter comme une cabane de
trappeur ou une maison de jardin.
4) Si elles étaient
construites en régions sismiques, ou de tsunamis, elles devraient être en béton
armé, renforcées tout autour, par des câbles en acier ou en nylon glissées
dans des tuyaux en PVC ou noyés dans le béton (ce type de câblage existe dans
certains maisons californiennes et japonaises), rendant la maison monobloc et
solidaire, résistante aux inondations, cyclones, tsunamis et tremblements de
terre.
5) Grâce à tout le
câblage, la maisons doit pouvoir tenir toute seule, sans se casser. Elle doit
pouvoir reposer sur 3 ou 4 points, 3 ou 4 rochers ou 3 ou
4 pare-peints solides, sans problèmes. Elle ne doit pas pouvoir se briser
même, si elle déplacée, par exemple, poussée par la force de la vague d’un
tsunami (force colossale, comme la crue furieuse d’une rivière).
6) On pourrait prévoir une forme profilée de la maison, en étrave de
bateau et renforcer l’épaisseur du mur, côté océan (voir dessin du plan de la
maison). La face de la maison en forme de V, côté océan, pourrait comporter 2
petites fenêtres fermées par des volets (en fer ( ?)).
7) D'une seule tenant, la
maison doit pouvoir être remise en place sur ses fondations, juste à l'aide de
patins placés sous la maison, tirée par une grue ou un bulldozer.
8) Des anneaux pour la tirer ou la soulever doivent être noyés dans
le béton au 4 coins de la maison).
9) Il faudra prévoir une
colonne centrale unique dans la maison ou passent les tuyaux d'eau venant
de la citerne, des eaux usées vers le puisard, le tuyau PVC, vers la fosse
sceptique et les câbles électriques.
10) Il faudrait dans la
maison (dans la cuisine et salle de bain) des compartiments rangement en béton
ou en bois.
11) Dans les pays chauds, les
volets pourraient se transformer un store en bois. Ou bien il faudrait que le
toit s'avance suffisamment pour former une véranda rafraîchissante.
12) Les vitres pourraient
être en verre ou en film plastique entièrement transparent en mylar / Tedlar /
kevlar.
13) On souhaiterait mettre
1/2 maisons en kit, dans un camion indien 20 tonnes (type TATA Novus truk
(à vérifier)).
14) Ce qui conduirait à ce
qu’une maison en kit complète, avec tous ses éléments, nedevrait pas
dépasser 40 tonnes au total. Peut-être faudrait prévoir des murs creux ou
introduire d’autres matériaux plus légers (bois …) ? Mais cet objectif
reste peu évident à atteindre (voir, plus loin, le poids de 22.5 tonnes, de la maison du projet AUM de « Auroville Earth Institute », à la surface au
sol faible : 23 m2).
15) Après qu'un puisard, une
fosse sceptique et les fondations aient été construites (grâce à une
bordure en pare-peint à la taille de la maison pour les fondation), une maison
doit / devrait être construite en moins de 2 jours, par tous les
villageois, sous la supervision, d'un technicien local qui sait comment
construire la maison.
16) Pour la partie, fondation
et soubassement, il faudrait maximum 1 semaine pour construire cette partie.
17) Tout ce qui a besoin sur
place pour monter la maison, de la main d’œuvre locale, des clés anglaises pour
visser les clavettes entre les plaques de bétons (comme les clavettes existants
sur certains meubles Ikéa), 1 ou 2 sac de ciments et/ou du bitume pour
former des joints d'étanchéités pour les raccords des plaques de bétons.
Voire une grue ou des échafaudages spéciaux (en bois ou métal) et un
treuil à main, pour monter les murs et le toit.
18) Echafaudages spéciaux et
matériels spéciaux (treuil a main, tire-câbles ...) démontées et transportés
vers le chantier suivant (matériels surveillés pour éviter les
vols).
19) On «armerait » les
plaques de béton de ferraillage à béton et de grillage.
Pour
la fosse septique, il faudrait qu'il y a déjà du compost et des feuilles au
fond, pour diminuer les odeurs, une trappe d'accès pour vider le compost formé
à la longue. Compost qui alimenterait le jardin.
20) Il faudrait que le béton
soit de très bonne qualité (qu’il ne se fissure pas). En effet, l’auteur a pu
observer que la rouille de parties en acier, laissées à l’air libre (à cause
d’une fissure), de maisons situées en bord de mer, ayant plus d’un siècle, à
Grand Lahou en côte d’Ivoire avait foisonné. Et s’il y a une fissure, qu’on la
rebouche alors avec par exemple du bitume.
Sur
le trou des WC, il faudrait un clapet pour éviter la remontée des odeurs, et
prévoir un écoulement d'eau limité provenant de la citerne, d'une 1/2
litre, pour vider les crottes vers le trou.
Autres
idées : Il faudrait :
a)
faire que les volets, portes, et fenêtres closes, puissent résister à la
surpression des vents violents des cyclones dans les régions cycloniques.
b)
des fenêtres, sans vitre, mais avec grillages métalliques, jouant le rôle
de moustiquaires, dans les régions très chaudes ou règne le paludisme
(Inde, Sri Lanka, Indonésie).
c)
voire, des murs avec un gaufrage, d'une structure nid d'abeille en béton, pour
diminuer le poids de la maison, mais aussi pour maintenir sa
résistance aux forces des cyclones et à l'énergie d'un tsunami (types
bétons enduits de très bonne qualité).
Surface :
40, 60 à 80 m2. Mais la maison standard serait de 60 M2 habitable au sol.
Le
toit de la maison est porté par 12 piliers porteurs, en béton ferraillé et par
des poutres maîtresses porteuses, ferraillées, sur tout le haut et pourtour des
murs de la maison. Il y a aussi une poutre maîtresse traversant le haut de la
pièce longitudinalement. Toutes ces poutres reposent de bout en bout sur les
piliers porteurs. Il y a :
- Une pièce principale,
avec 1 porte principale, sur le devant, se formant par une porte
grillagée, et une seconde porte blindée en tôle (voir un petite fenêtre en
dessous du réservoir commun à la douche, le lavabo de la salle de bain, à
l’évier de la cuisine, au robinet de la cuisine, et au robinet extérieur).
- Deux chambres,
symétriques, de chaque côté de la pièce principale.
- Une salle de bain avec
douche et lavabo (2 robinets),
- Un cuisine avec une
porte donnant sur l’extérieur, avec un évier, 2 robinets dans la cuisines
et un robinet donnant sur l’extérieur.
On
prévoit soit :
- Soit un WC (sec) dans
la salle de bain,
- Soit à l’extérieur à
la maison (dans une construction en béton dans le « jardin »).
Les
murs sont composés d’un sandwichs de plaques vérticales de bétons ferraillées,
collées entre elles, de façon décalée (collées par du béton ou du bitume), chaque plaque dépassant d’un côté de la plaque voisine de 10 cm.
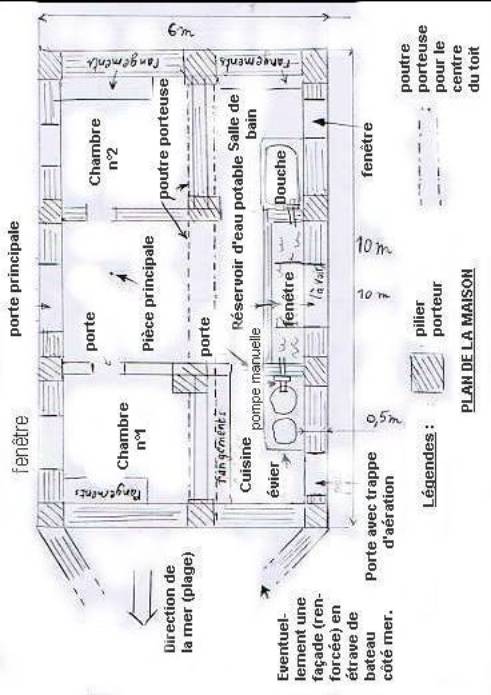
© Benjamin LISAN
Chaque
plaque fait 2,5 m de long, de 50 cm de large, et 10 cm d’épaisseur.
Chaque
mur est composé d’un sandwich de 5 plaques collées (ce qui fait une épaisseur
des murs de 50 cm ( !)). L’idée est de renforcer la solidité des murs par
feuilletages des murs (comme avec un pare-brise feuilleté).
Les
piliers porteurs verticaux, font 3 m de long, sur 20 - 30 cm x 20- 30 cm de
côté. Ils sont « cannelurés » avec des cannelures de 10 cm de côté et
de profondeurs, afin que puisse s’y emboîter facilement les grandes plaques.
Les
poutres porteuses horizontales, du plafond et du sol, devraient avoir les mêmes
dimension que les piliers porteurs verticaux (3m x 20 - 30 cm x 20- 30 cm).
Les
fenêtres, montants, pourtours des fenêtres seraient préfabriqués, déjà montés
et apportés aussi. Tout cela serait soulevé par une petite grue manuelle ou à
moteur diesel (Voir schéma du plan _ 1ère ébauche _ de la maison,
page suivante).
Sur
le sol, et le toit seraient disposé les même plaques allongées (2,5 x 50 cm de
large x 10 cm), recouvertes d’une petite couche de ciment hydraulique pour le
lessivage et nettoyage (sur le toit, la couche aurait un plan incliné pour
amener l’eau de pluie vers une canalisation, l’amenant, à un filtre bactérien
débouchant dans le réservoir). La dalle
de sol devrait d’être un seul tenant (formant un bloc solidaire).
1.
De nombreuses plaques planes (2,5 m x 50 cm x 10 cm).
2.
Douze poteaux porteurs en béton, « cannelurés » (3
m x 30 cm x 30 cm)
- Des poutres faîtières porteurs (même
dimensions),
- Des portes et fenêtres livrées préfabriquées, et
déjà montés dans leurs montants (prendre les mesures standards locales,
par exemple, taille porte : 183x 113, taille fenêtre : 113 x 86
… à voir et étudier).
5. voire, une
dalle sanitaire préfabriquée ( ?) etc. …
6. tous les
tuyaux sont en PCV.
Note : pour le
dessin ci-dessous, on pourrait imaginer une trappe d’évacuation, sur le toit
(fermée par une plaque de tôle fermée à clé), accessible par un escabeau placé
dans la pièce principale. Aperçu grossier de la maison construite et de
quelques éléments de construction.
La maison telle que
présentée page suivante n’est pas très jolie, mais les habitants pourront
peut-être proposer d’autres formes, voire des motifs et dessins moulés dans le
béton des panneaux, voire des frises entourant le pourtour du toit etc …
Voir
si les avancées du toit, sont utiles (pour la pluviométrie, le soleil, à la
demande des habitants) et techniquement faciles à réaliser (sans risque de
chute de bloc de béton). S’il ne faut pas une avancée, juste au dessus des
portes contre la pluie (sinon « why not », une marquise en plastique
Plexiglas, amovible en cas de cyclone).
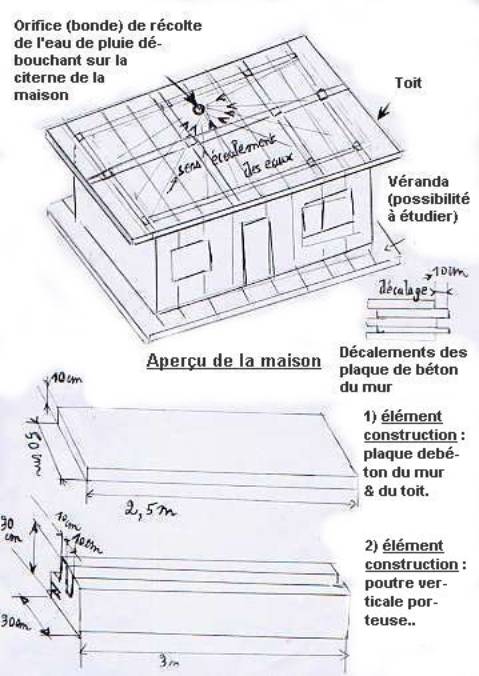
© Benjamin LISAN
Ces
outils seront amenés sur place, avec l’arrivée des éléments de la maison.
On
veillera à ce qu’ils ne soient pas volé (obligation d’une garde de nuits).
Ces
outils sont transportés d’un chantier à l’autre.
|
·
Une petite grue,
|
·
Une bétonnière à main,
|
|
·
Des clés anglaises,
|
·
Des treuils à mains,
|
|
·
Des échelles et échafaudages.
|
·
Fils, fil à plomb,
|
|
·
Niveaux à bulle,
|
·
tournevis,
|
|
·
Sceaux (pour l’eau, le ciment …),
|
·
Masses, marteaux, burins,
|
|
·
Pelles, pioches …
|
·
Une série de tournevis
|
|
·
Un poste à souder (s’il y a l’électricité …)
|
·
Pinceau pour étaler l’huile
|
|
·
Bâche pour protéger les blocs moulés
|
·
Pinces coupantes
|
|
·
Truelle, bac pour mélanger le ciment
|
·
Voire un poste à souder (pour le ferraillage)
|
|
·
Voire un groupe électrogène … (pour le poste à souder)
|
·
Etc …
|
60, 80, à 100 m2. Un toit de
100m2 permet de récolter annuellement 80 à 120m3 d'eau, en France (bien
plus en Thaïlande, Sri Lanka, Indonésie).
Une citerne de récupération des eaux de
pluie, qui servira pour alimenter les besoins pour le jardin ou le potager,
s'il y en a un plus tard, et un réseau secondaire alimenté par l'eau de pluie
(filtrée) pour tout ce qui ne nécessite pas d'eau potable dans la maison : WC,
douches, laver le linge, vaisselle ... Citerne de 12 à 14 m3 de volume utile
(3mx2mx2m), préfabriquée en béton, divisée en 2 compartiments, le plus petit
(10 à 20% du volume total) servant de décanteur avant déversement dans le grand
compartiment, à l’intérieur de la maison pour protéger et rafraîchir l’eau. Une
pompe à main (Tyga corp, LiftRite Ergolift/Ergonomic3000 …) puisera l'eau dans
le fond du grand compartiment. La citerne devra être munie d'une ouverture
suffisamment grande pour permettre d'y pénétrer (trou d'homme/chambre de
visite). Un trop plein doit permettre d'évacuer l'eau excédentaire. Il faudrait
prévoir une aération de l'eau. La pompe est munie d'un réservoir tampon (20 à
300 litres). Les filtres sont intégrés à la pompe qui injecte l'eau de la
citerne. Un filtre « dit primaire » avant l'entrée de l'eau dans la
citerne afin d'éviter que des feuilles ou de petits animaux tels que rats,
souris, grenouilles, ne tombent dans la citerne. A la sortie de la pompe, un
filtre d'au moins 20 micromètres pour retenir les particules fines. Attention,
de nettoyer régulièrement les filtres.
Précautions :
- La citerne en béton se
fissurera si la préparation du sol est mal faite . Il faut insister
là-dessus. Avec une variation de poids de 12 à 13 tonnes, le sol peut
s’enfoncer à des endroits préférentiels, sous cette surcharge. De plus le béton
n'est pas souple .
(Voir annexe 11 – Construire sa citerne d’eau de pluie).
On peut aussi imaginer une citerne en plastique (voir chapitre des
fabricants de citernes plastiques en Inde).
La trappe d’accès
(cadenassée) à la citerne (en béton) se situera peut-être sur le toit.
Il
faudra étudier l’opportunité d’une jaune pour mesurer la quantité d’eau
restante dans la citerne ( ?).
Citerne d’eau 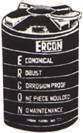 ©
ERCON (Inde)
©
ERCON (Inde)
Placer avec un filtre bactérien (par
exemple un flitre Waterloo Biofilter™).
Une pompe solaire est plus coûteux
Le puit pourrait être un
puit de 4 mètres de profondeur, constitué de 120 blocs de bétons
hémi-circulaires (arrondis), non bétonnés ( ?) (source PNUD). En raison du
coût du puit, 4 maisons + 1 pompe pourraient s’y raccorder (Buse, tuyau en
béton .. techniques connues là-bas).
Note : il se peut que
la nappe phréatique ne soit pas potable (car saumâtre). L’eau de la nappe
servirait alors à la lessive, vaisselle ( ?), toilette.
Voir si l’eau pluviale
récoltée sera suffisante (hors période de mousson) _ pour cela, il faudrait
connaître les statistiques locales _, avec la surface de toit prévue (toit avec
ses avancées en béton, type véranda).
Puisard désodorisé par un filtre à charbon actif (« charcoal »
ou « active carbon »), composé de deux systèmes combinés de filtration
lente sur sable et d’adsorption sur charbon actif.
Sous la forme d’un trou circulaire, composé d’une succession de
couches de sable et de charbon actif, filtrant les eaux usés de la lessive …
Le débouché du puisard doit être loin du puit d’eau potable, pour
des questions d’hygiènes.
(Sinon, Voir l’annexe 14 sur la construction de différents modèles
de puisards).
Fosse
sceptique, avec si possible le même modèle que la citerne (afin, de diminuer
les coûts de construction).
WC
sec artisanal. Prévoir un sceau rempli de feuilles odoriférantes (pétales de roses,
feuilles d’eucalyptus …).
Exemple :
|
Eau, osmoseur, WC sec
|
SEPARETT TORRDASS 30 WC
sec de jardin
|
110.00 €
|
|

|
le Separett le plus simple
et le meilleur marché. Il se compose
d'une lunette en plastique isolant avec un couvercle, dessous
le système du Separett qui sépare l'urine des matières fécales.
La contrainte de ce système est l’obligation de vider le
seau (nous conseillons une capacité de 15 à 20 litres) sur le carré à compost
du jardin quand il est rempli.
|
Site : http://www.maison-ecolo.com/boutic/bou_list.cgi?codefam=eau&codesfam=wcs&lang=
Bibliographie : Water
sans eaux, Béatrice Trélaün, Ed. Alternatives.
Autre solution : les
toilettes sèches :
Sanisette à Lombric
(« lombricompostage ») :
Les
matières fécales et les papiers sont transformés en terreau par des lombrics
(vers de terre), l’évacuation du terreau étant à réaliser tous les 5 à 10 ans.
Des toilettes publiques, assez fortement fréquentées, génèrent de l’ordre de
1,3 mètres de matières fécales et papiers toilettes “foisonnés” par an,
lesquels donnent naissance après compostage à environ 100 litres de terreau
“bien stabilisé”.
Epandage
des urines : Tranchée 4 à 8 mètres linéaires suivant technique classique de
l’assainissement non collectif ou dans cuve étanche enterrée de 3000 litres,
vidée une fois par an si très forte fréquentation, et sinon tous les deux ou
trois ans.
Entretien : Pour Sanisette à
Lombricompostage, retrait du terreau tous les 5 à 10 ans en fonction de la
fréquentation. Le fond de la sanisette doit être directement en contact avec le
terreau de la terre.
Une suggestion : Un
clapet actionnable par une poignée, obturant le trou du WC (entouré par la
lunette des Wc) _ évitant la remontée des odeurs, est actionnée à la main, en
fin de défection, pour vider dans la fosse, l’urine et les crottes.
Dans les toilettes, 1) un
sceau rempli d’eau, toujours à proximité dans le local WC, permet de laver le
WC, 2) un seau rempli d’herbes odorantes, pour jeter dans le trou, après chaque
défécation, 3) du papier toilette (ou broc d’eau, fréquent chez les indiens et
musulmans).
Source : http://www.saniverte.fr/fr/produits.php
Les latrines pourraient être
aussi un puit de 4 mètres de profondeur, puit constitué de 120 blocs de bétons hémi-circulaire (source PNUD).
Dans les latrines, une trappe d’accès, au fond du compost (water sec), ou bien
un système de couches de sables.
La plaque de béton moulée
(voir sa technique de fabrication par moule, plus haut dans ce document),
couvrant la fosse sceptique, comporterait un trou, sur lequel serait posé la
cuvette des WC (cuvettes en béton, voir plus loin).
(Note : le trou dans la
plaque de béton aura été créé par le culot d’une bouteille enfoncée dans le
béton, encore frais, de la plaque sanitaire, au moment où elle est en train
d’être moulée dans son moule en acier).
… Ou bien constituée d’une fosse sceptique préfabriquée, et avec
l’abris de protection des latrines, constituée d’une fosse sceptique inversées
(disposant d’une porte).
Les WC, pour des questions
d’hygiène et d’odeur, seront situés à distance de la maison (tant pis si l’on
doit s’y rendre sous la pluie battante de la mousson).
|
Modèle
|
Avantages
|
Inconvénients
|
Coût (en France)
|
|
SEPARETT TORRDASS 30 WC
|
le Separett le plus simple et le meilleur marché. Il se
compose
d'une lunette en plastique isolant avec un couvercle, dessous
le système du Separett qui sépare l'urine des matières fécales
|
La contrainte de ce système est l’obligation de vider le
seau (nous conseillons une capacité de 15 à 20 litres) sur le carré à compost
du jardin quand il est rempli.
|
110 €
|
|
Sanisette à Lombric (« lombricompostage »)
|
|
l’évacuation du terreau étant à
réaliser tous les 5 à 10 ans, en fonction de la
fréquentation. Pour l’épandage des urines, il
faut creuser une tranchée 4 à 8 mètres linéaires.
|
Coût inconnu pour l’instant
(certainement plus élevée que la solution précédente).
|
Voir le schéma de puit
sanitaire, ci-après dans le document (voir paragraphe 11 : autres éléments
de réflexions).
Selon le PNUD, 2 à 3 litres
d’eau dans un broc, suffirait à nettoyer la cuvette des WC (en l’absence de
système de chasse d’eau). Les toilettes suggérées par le PNUD seraient vidées
de leurs matières fécales, une fois par an.
(source : Apprendre à
travailler le bois, constructions, transformations des aliments, métaux etc.
.., 7 cassettes vidéo, Ramigé Film Produktion, UNESCO, 1997).
(Chapitre en construction.
Une solution déjà : une grande bâche plastique ( ?)).
Cette solution, ce plus, ne
peut être envisagé, que si on en a les moyens (car augmente considérable le
budget de la maison). Nous suggérons ceux de la marque Tata (TATA BP Solar Limited India ), fabriqués en Inde : http://www.tatabpsolar.com/
Un kit
Solaire Tata, avec panneau solaire à fixer sur le toit, batteries, et
régulateur électronique (pour alimenter 1 à 3 ampoules 12 V, la nuit dans la
maison) est vendu en Inde, pour moins de 150 €.
Modules Solaires
Fiable, empaqueté et disponible dans un grand choix de
modèle - jusqu'à 170 watts
Haute performance, Fiabilité Maximale et Maintenance Minima
Résistant à eau, abrasion et impact.
Poids-léger anodisé, encadrement d'aluminium avec bordure en
mastic autour du cadre alu.
Connecté en série à des Cellules Cristallines Solaires en
Silicium
Verre Durci (trempé).
Acétate de Vinyle d'Éthyle ENCAPSULANT.
La boîte de jonction à l’épreuve de la météorologie, avec le
couvercle à charnières et des vis captives, 3 point câble l'entrée avec des
« glands de câble », appropriées, et pour série et la connectivité
parallèle.
Approprié pour l'Éclairage Domestique(intérieur),
l'Éclairage de Rue, le Réseau de puissance Domestique, la Réfrigération
Médicale, les Lanternes Solaires, le pompage solaire. …
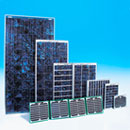 © Tata BP Solar
© Tata BP Solar
Modèle de Kits d'Éclairage Solaire Domestique : JUGNU
Systèmes 12 V
Empaqueté
Kit de Utilisation prêt avec Module Solaire, Batterie(pile),
Régulateur, Électronique et Luminaires
Autonomie du Système
Disponible dans un grand choix de modèles
Plusieurs milliers d'installé en Inde et dans le
Sous-continent
 © Tata BP Solar
© Tata BP Solar
Modèle de
Systèmes de chauffage Solaire Domestique(intérieur) D'eau : VAJRA
Grand choix
: 100, 200, 300 et 500 LPD
Réservoir
Isolé D'acier Inoxydable.
Facile
d'installer : tuyauterie minima externe
Compact et
Léger, Dur et Durable
Travaille
efficacement même dans conditions extrêmes
Esthétiquement
conçu. (voir page suivante).
Note : On pourrait aussi concevoir
des chauffe-eaux solaires, avec un bidons de pétrole neuf, peint en noir mat,
relié à des tuyaux PVC noirs (mais attention, au risque de prolifération
bactéries. L’eau chaude sera non potable).
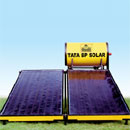 © Tata BP Solar
© Tata BP Solar
1)
Nous avons déjà exposé l’idée d’un maillages de câbles, entourant
totalement la maison, tendus par des treuils à main (une sorte de
« pré-contrainte »). Une autre idée étant celle du cerclage d’acier
de la maison,
2)
Pour la 1ère idée, nous imaginons la maison entourée de 8
câbles _ une maison empaquetée / ficelée par ses câbles, comme un paquet cadeau
(voir schéma ci-dessous). Les câbles passent sous et sur la maison et sont
tirés tout autour de celle-ci, d’abord à la main, puis avec un treuil à main
(voire, on pourrait imaginer / inventer, un système à cliquer comme pour les
sangles de voitures. Le Ø du câble d’acier serait de 8 mm ( ?) (à calculer
en fonction des contraintes). S’il était en nylon, son Ø serait de 10 mm
( ?). (ou le câble d’acier serait plus ou moins plat, comme une sangle de
voiture).
3)
Le câble glisserait le long d’un « rigole » (d’un creux
rectiligne à section en U) courant le long des façades et sur le toit. Le câble
acier serait noyé dans du ciment (ou le câble de nylon dans du bitume),
remplissant / comblant le creux de la « rigole » (ciment déposé par
une personne avec une truelle).
4)
Lorsque le câble est arrivé à la bonne tension (comment la déterminer),
on coupe l’excès de câble (on éviter d’en perdre trop), avec une pince
coupante. L’épissure est ensuite noyée dans le ciment ou le bitume. Cette phase
de tension du câble étant dangereuse, elle se fera très progressivement et tous
les autres travailleurs seront éloignés à plus de 50 m de la maison (l’ouvrier
devrait presque porter des vêtements de cuirs épais comme le tablier d’un
maréchal-ferrant et un casque de moto).
5)
La
« rigole », courant sur les plaques de béton plates (où se loge
le/les câble(s)), et sur l’angle extérieur des piliers porteurs au 4 angles de
la maison, s’obtient en posant en enfonçant dans le béton coulé dans les
moules, un tube de PCV, enduit d’huile de vidange (ou mieux de « l’huile
de coffrage » ou simplement une émulsion d’eau et d’huile végétale _ huile
de palme … _ voir http://www.fnr.de ) puis posé avec un certain angle, par rapport l’axe du moule (cas du
moule des plaques planes), sur le béton frais, ou bien posé au fond du moule
(cas du moules des piliers d’angles).
L’huile serait déposée sur la face de l’élément, constituant le mur
extérieur de la maison (elle peut couvrir jusqu’à 100 m²/litre). L’huile serait « nettoyée » avec du
sable, sable récoltée et placé dans le sable du puisard (voir plus loin).
L’avantage d’utiliser une émulsion d’eau et d’huile végétale est qu’elle est
plus facile à éliminer par de l’eau.
6)
L’application d’huile de coffrage, pour obtenir des surfaces régulières
et lisses, requiert des précautions particulières. On veillera à ce qu’elle
soit répartie partout de manière uniforme; il faut aussi l’appliquer le plus
tard possible, afin d’éviter qu’elle soit absorbée par les coffrages. Enfin,
une quantité excessive d’huile nuit à la qualité de la surface du béton
(Note : 1 L d’huile coûte en France de l’ordre de 2 € HT).
7)
Les plaques de bétons
posées sur le sol, seront séchées au soleil (voire sous une serre en film
plastique de serre, en cas de pluie, mousson …).
8)
L’angle de la
« rainure », sera déterminé de la façon suivante : on fera un
plan sur le sol (échelle 1, dessin avec un bâton sur le sable) de la
disposition des plaques planes du toit et de celui des câbles courant sur le
toit. Et l’angle du tube de PVC enfoncé dans le béton du moule, se déduira de
lui-même.
9)
La rainure sera
suffisamment profonde, pour que le câble ne dépasse pas et n’empêche pas
l’écoulement de l’eau pluviale sur le toit, vers la bonde de la citerne.
10) pas de plafond en dur sans treillis métallique
interne (Armature, grillage): en cas de tremblement de terre la nuit, le
plafont peut alors tomber sur les occupants. Les Californiens emploient du
placo ou du bois pour les plafonds. L’idée de disposer des plaques de bétons et
des poutres maîtresses pour le plafond est donc à étudier dans cette optique.
On évitera les murs intérieurs en Placoplâtres (peu utilisés là-bas et fragiles
face aux séismes). Le grillage a pour but d’éviter que de gros blocs de bétons
tombent sur les habitants, en cas de séismes, dans le cas où le béton serait de
mauvaise qualité (en général, un béton comportant trop de sable. Note :
bonnes proportions : 2 à 3 mesures de sable pour une mesure de ciment.
Pour faire du béton : sable blanc, gros sable, ciment. Le mélange ne doit
pas être trop fluide).
11) Le ferraille du béton est important (et ce dernier
pourrait peut-être expliquer pourquoi certains bâtiments à Banda Aché
(Indonésie), dont la mosquée ont résisté à la puissance du tsunami).
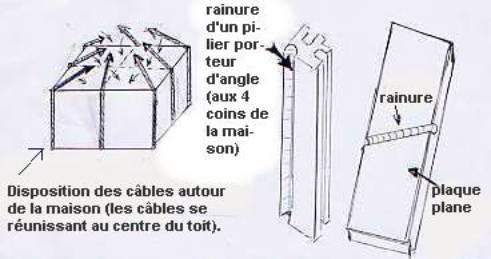 ©
B.Lisan.
©
B.Lisan.
Ces câbles (qu’on pourrait
préfabriqués en usine à la bonne dimension, muni d’un système à cliquet d’un
côté, et d’une épissure soudée, de l’autre) sont-ils utiles ? à étudier
avec ASF _ Architectes sans Frontières (voir plus loin) ?
On casse les angles vifs,
avec un marteau, ou une petite masselotte (ou une bouchardes à 8 dents
(talot) et à tête mobile, un outil de tailleur de pierre), pour éviter que
les enfants se blessent sur ces angles.
Toutes les trappes d’accès
(au puit, à la fosse sceptique, à la citerne) sont cadenassées (pour éviter que
les enfants tombent dedans).
Les adultes sont fermes avec les
enfants (ils n’ont rien à faire sur le chantier, ni à toucher les outils). (Une
idée : un fil entoure le chantier à ne pas franchir, par ex.).
La loi indienne impose d’avoir une
crèche, à côté du chantier, pour les ouvriers itinérants (si ce cas arrive que
faire ? )
Concernant les vols :
Une personne sera responsable des
outils sur le chantier et de la façon de les attribuer à chaque travailleurs
(voire une liste des prêts sera tenu à jour). Les outils seront numérotés. Un
appentis, fermant à clé, sera construit pour stocker les outils la nuit (ou
bien entreposé chez quelqu’un, dont la maison ou le local est bien clos et
fermant à clé). On y stockera aussi les moules (Note : à réfléchir combien
de moules par maisons, à fournir à chaque village).
1) On aurait pu encore
(aussi) imaginer les éléments de construction (sorte de blocs de parpaings),
sous la forme d’éléments de base de la forme suivantes :
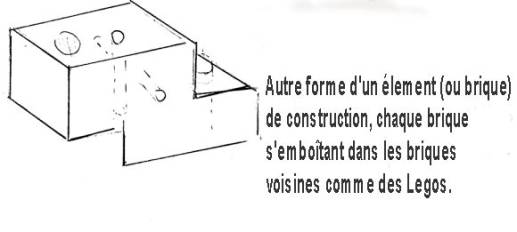 ©
B. Lisan.
©
B. Lisan.
On pourrait demander aux
créatifs de Lego et Fishertechnik, de participer au projet et de proposer leurs
solutions.
2) ou comme des Legos en
béton, comme ci-après :
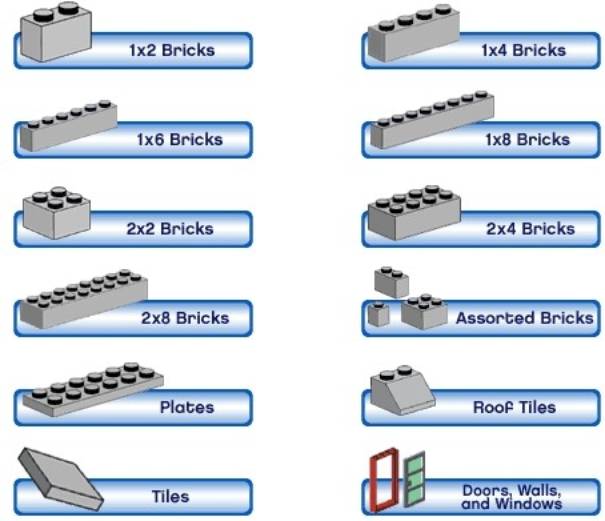
© Lego
Note : le type actuel
de montage de la maison, s’inspire plutôt des éléments de construction des jeux
« FisherTechnik » :http://www.fischertechnik.tm.fr/
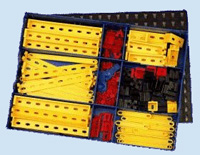

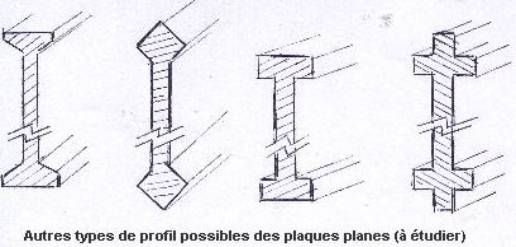 © B. Lisan
© B. Lisan
Autres idées pour
imaginer une maison écologique et économique si possible (suite) :
Certaines plaques de bétons
pourraient être gaufrées ou en nid d’abeille, pour gagner du poids (sans que la
résistance des mur en souffre, normalement).
Sinon, au lieu d’un toit plat, on
pourrait imaginer un toit, en tuiles vibrées (réalisées à base de sable fin, de
gros sable et de ciment) _ ou par ex. en forme de tuile canal. Pour faire ces
tuiles vibrées, il faut un moules en forme de ces tuiles, un film plastique
solide et fin (kevlar ( ?)) et un vibreur. La feuille de plastique est
posée sur la surface lisse du moule puis le béton sur la surface lisse et en contact avec la feuille de plastique.
Pour que ces tuiles soient
colorées en rouge, on met dans l’eau pour le béton, avec un colorant rouge.
Puis les tuiles sont immergées dans un bassin, rempli de la/des couleur(s).
Puis on les protège et les fait sécher durant une semaine.
Si on ne peut pas créer d’usine de
béton et de préfabriqués, dans chaque pays (par manque de moyens), on pourrait
alors faire réaliser chaque élément préfabriqué par les villageois locaux. On
peut alors imaginer leurs apporter des moules en acier (sorte de gabarits), de
plus ou moins grande taille, munis de poignées, « adapté »
(correspondant) à la forme de chaque élément de construction : briques,
plaques de bétons à fabriquer, poutres de bétons, briques de bétons hémi-circulaires,
linteaux de porte … (voir schéma de ce moule, page suivante).
Avant de couler le béton dans le
moule, avec son ferraillage, on huile le fond du moule, avec de l’huile de
vidange, afin que le béton ne colle pas .
On utiliserait un très gros pinceau, pour étaler l’huile au fond du monde
(autre but : économiser l’huile. Note : huile protection contre
moisissure ?).
Une autre bâche ou film plastique de serre permet aux
éléments préfabriqués de ciments moulés de continuer de sécher en cas de pluie.
Pour augmenter l’efficacité et le
raccourcissement des délais de réalisation de chaque maison, des systèmes
d’incitation des villageois, participants aux reconstruction, seraient mis en
place : repas gratuits (apporté par le gouvernement, les ONG ou la région)
offerts aux travailleurs pendant les travaux, fêtes (style
« barbecue » ( ?)) à chaque échéance tenue, cérémonie de la
levée du drapeau (de l’ONG, du pays),
des couleurs etc. …
Toute une organisation nationale _
structure pyramidale à mettre en place : niveau national (ONG + état),
régional ( ?), local …, mais ne dépendant pas nécessairement directement
du gouvernement _ serait mise en place, pour permettre l’optimisation de chaque
étape du grand projet national : mis en place d’un recrutement, recrutement
personnel motivé, acquisition locaux et matériel _ matériels de chantier,
matériel informatique et logiciels. Par exemple, logiciel d’optimisation du
trajet des camions … _, bureau
d’étude et de test ( ?), prévention des accidents de chantier et de
transport …
Un système « Cours des
comptes » avec experts comptable, doit être mis en place, pour vérifier
les comptes.
Des inspecteurs des travaux
parcouront le pays, pour vérifier l’argent investi.
Si la maison était en bois,
s’inspirer alors de l’expérience de la construction bungalows préfabriqués sur
roues, dont son expérience en menuiserie, comme celle de son constructeur naval
Bénéteau et sa filiale O’Hara.
Voir dans le cas où la maisons
serait livrées achevées, sur roue, au départ usine, voir si les dimensions de
la maison permettraient son passage dans les rues étroites dans les grandes
villes du pays (voir chapitre sur les bungalows).
Si la maison était en bois, elle
serait normalement plus « écologique », plus légères à transporter.
Les maisons en bois, anti-sismiques sont en général plus résistance aux séismes
que les maisons en structure en béton équivalentes. Elles sont, par contre,
plus vulnérables au feu (à étudier).
Etudier, si l’on peut envisager,
une certaine flottabilité de la maison en cas de tsunami (par
« étanchéification » des issues), plus facile pour les maisons en
bois (et peut-être possible pour les maisons en bétons avec des murs creux,
structure alvéolaire « nid d’abeille » (mais attention à la solidité
aux cyclones).
S’il y a plusieurs constructeurs
de maisons, retenus dans la pays, les mettre en concurrence (primes si
objectifs & délais tenus, ou si avance sur
délais).
Il faudrait que le prix négocié de
chaque maison avec le constructeur, soit fixe (si c’est 10 000 €, alors c’est
10 000 €, et pas un Euro de plus).
Un plan de montage, sur feuillets
A4, version complète est fournie au chef du village, et un version
« light » (allégée) fournie à chaque propriétaire (ou habitant, chef
de famille).
(On pourrait ( ?) aussi
s’inspirer des idées et concepts pour l’aménagement intérieur de l’habitation,
de celle des « unités d’habitation » de l’architecte Le Corbusier,
pour son projet de « Cités Radieuses » de Briey-en-Forêt, de
Marseille etc… (France) : largeur 366 cm, hauteur 226 cm etc. …).
Mais il reste quand même plus
important de s’inspirer de ce que désirent réellement les gens sur place, sur
l’aménagement intérieur de la maison ( !).
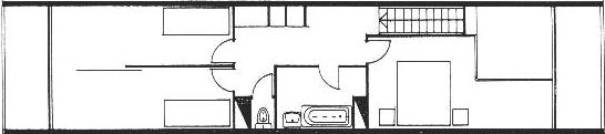
Plan d’une « unité
d’habitation » de Le Corbusier, dans la Cité Radieuse.
Des trous circulaires seront pratiqués
dans les plaques de béton, au quatre extrémité du toit, pour permettre d’un
planter de petits drapeaux (de prière etc. …).
Eventuellement, si cela ne coûte pas
trop cher, à moitié enterrer dans le jardin, verticalement un petit
tuyau en béton (L = 1 m, ø = 20-30 cm),
dans le quel serait planté un mât, pour un drapeau (national etc. …).
Eventuellement, dans les maison,
pourrait être prévu un emplacement (ou une niche), pour un culte religieux
domestique (« hôtel des Dieux » hindouiste, bouddhiste etc. …).
Prévoir dans la cuisine, un
garde-manger grillagé ou, si le propriétaire est plus riche, un emplacement
pour un réfrigérateur 12 V (si présence de panneaux solaires sur le toit) ou un
réfrigérateur à gaz (avec une bombonne de gaz).
Un problème esthétique, à
résoudre, dans les pays tropicaux chauds et humides, les traces sales (ou
auréoles) noirâtres laissées sur les murs, par les moisissures. Pour éviter
cela, il faudrait au départ, chauler les murs (ou mélanger dans le béton frais
un produit anti moisissure ( ?)). Mais souvent les gens sont tellement
pauvres, qu’ils ne chaulent leurs maisons, qu’une fois dans leur vie, à la
construction, puis ils laissent se dégrader l’apparence extérieure des murs
& maison. Donc réfléchir à ce problème …
Une grande fête est organisée dans
le village dès que toutes les maisons de celui-ci sont reconstruite.
Puis une grande fête nationale est
organisée dans le tous le pays, quand tout l’ensemble du projet est achevé,
avec feux d’artifice, commémoration télévision, radio (durant laquelle, l’on
n’oubliera pas les disparus).
Voire est organisée une grande
marche pour la paix mondiale, dans le pays, peut-être sur le modèle (en
plus grand), de la marche Transhimalayenne, organisée par l’auteur de ce
projet, en Inde, en 2002 (voir dossier de cette marche et de son organisation
sur le site : http://transhimalayenne.free.fr
).
Si le toit est en tuile, pour des
spécificités régionales, on pourrait imaginer des fermes métalliques, portant
des tuiles grandes et lourdes (10 kg) collées entre elles par du ciment, pour
résister aux cyclones (comme dans les constructions modernes thaïs)
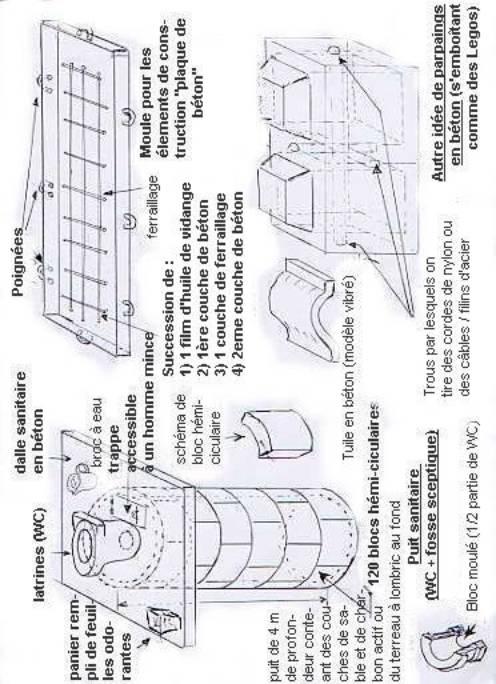
Moules pour les éléments préfabriqués,
éléments sanitaires et tuiles vibrés © B. LISAN
Notes : petites
corrections à faire, sur le dessin précédent, ci-dessus :
a) la base du ½ bloc de la partie water, serait
renforcée, à la base, pour éviter les fissures.
b) La trappe technique de la dalle sanitaire serait clos
par un cadenas, pour éviter que les enfants puissent tomber dans le puit
sanitaire.
c) Les parties et vides sanitaires doivent être
parfaitement sellées pour éviter les remontées d’humidité source de moisissures
et de termites.
A la fin du projet, on pourrait
espérer que tous les pays reconstruits (Inde etc. …) pourraient offrir, à leur
tour, leur savoir-faire, à d’autres pays sinistrés (par exemple à l’Iran,
éprouvé, lors du séisme de la ville de Bam, le 26/12/03).
Il serait important que tous soit
prévu dans le moindre détail. Par exemple, que les éléments de construction
puissent être transportés dans des conteneurs ou palettes, eux être pouvant
être convoyés par des petits cargos, caboteurs, pour joindre les petites îles
dévastées (Andaman, Nicobar …). Tout est prévu dans le moindre détail, jusqu’à
au bois des palettes etc …
Il est alors important d’impulser,
si possible, l’esprit de rigueur, au personnel.
Il faudrait que soit mise en place
rapidement, un système de surveillance et d’alerte, par sirène ou mégaphone, en
cas de tsunami, comme il en existe sur le pourtour Pacifique, afin que les
habitants puissent se réfugier sur les éminces surélevées ou sur des
plate-formes surélevées, pouvant héberger une centaine d’habitants. Celles-ci à
plus de 10 m de haut au dessus du sol, comme à Hawaï ou à l’exemple des
plate-formes de la chaussée submersible, du Gois, de l’île de Noirmoutier
(celles du Gois est un exemple en modèle réduit de ce genre de plate-forme qui
pourrait exister, en plus grand pour des centaines de personnes le long des côtes
asiatiques de l’océan indien. Voir photo page suivante).
Voir si on peut les construire en bois ? Au cas où, entre la plate-forme et
la mer, une protection en forme d'étrave de bateau ou de pont, de redent, avec
la pointe du V dirigée (pointée) vers la mer, pour casser la force de la vague
du tsunami) pourrait être construite devant la plateforme. Cette construction
en étrave, pourrait être en palplanches, en acier, trouées (pour laisser passer
l’eau mais casser l’énergie de la vague), avec des pieux très profonds,
protégées de l’oxydation par des lingots d’aluminium. Le problème serait une
vague de 15 m de haut. La plate-forme pourrait-elle résister ? Le
principal serait de sauver des vie. Ces suggestions de précautions sont-elles
excessives ?
Normalement, la maison risquerait
d’être détruite, à cause de l’énergie du tsunami, mais en la construisant
suffisamment solide, et la rendant flottante comme une « houseboad »,
comme sur la photo ci-après (ou celles décrites dans la revue « houseboad
magazine », ou celles de Srinagar au Cachemire).
On pourrait juste transformer les maisons en houseboats, en
les plaçant sur une série de flotteurs très solides (tels que des bidons de
pétrole, très solides). (à étudier et tester).
Celles-ci permettraient de remplacer
les maisons flottantes, détruites, des peuples vivant déjà sur des maisons
flottantes dans l’Océan Indien.
|

Exemple
de plate-forme surélevée, répartie régulièrement le long de la chaussée
submersible du Gois, à Noirmoutier.
|

|

Exemple de
maison flottante très fréquentes aux USA, sur les lacs, lacs de barrages ...
© Islander Houseboats
http://www.islanderhouseboats.com/id10.html
“L’ogive de survie“ de M.
Michel Rosell :
C’est une embarcation,
réalisée avec une armature en fer, en forme d’œuf (ou d’ogive), montée sur une
partie flottant (ici une chambre à air de pneu de camion), embarcation de
survie qui serait posé sur le toit de toutes les habitations, des régions à
risque. Voyant arriver un tsunami, 3 ou 4 personnes iront se réfugier dans
« l’ogive de survie », en en refermant les ouvertures derrière eux.
« L’ogive » étant elle-même
reliée à la maison, par une corde d’environ une vingtaine de mètres.
Elle est pré-équipée de systèmes de survie (bouteille d’eau, bac de spiruline,
casserole, couteau, torche à huile …).
Reste la question de la
solidité de l’ogive, face à des très fortes vagues (puisqu’il y a différents
types de tsunamis). L’inconvénient du système est qu’il faut regonfler
régulièrement la bouée (peut-être faudrait-il la remplacer par un flotteur
torique en bois traité contre les champignons et les insectes ou par un
flotteur en forme d’anneaux réalisée avec 2 demi tores en résine époxy
renforcée de fibre de verre).
Source sur l’ogive de
survie : http://ecosocial.free.fr/tsunami.htm


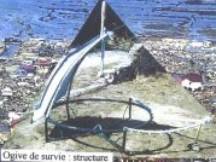
Images de l’Ogive de survie de M.
Michel Rosell @ Michel Rosell
Il
faudra disposer dans le pays, d’un lieu, un ou plusieurs terrains, sur place,
pour tester … les différents prototypes de maisons (et d’éléments
préfabriqués).
Autres
idées (coûteuses et peut-être peu réalistes) :
1)
pour tester sa résistance aux cyclones, la tester dans un
tunnel climatique.
2)
pour tester sa résistance aux tremblement de terre, le ban
de test sismique (CEA …).
Avant,
réaliser une maquette en balsa ou DAO/CAO, pour valider les dimensions et
agencement des différents éléments préfabriqués (voir avec « Architectes
sans F. »).
Autre
piste : Tester la pose d’une maison sur des pneus de camions, posés
eux-même sur des blocs en béton (servant de fondation), face aux tremblements
de terre.
Source sur
la solidité de certaines maisons en bois face aux tremblements : www.forintek.ca/public/pdf/fact%20sheets/EarthquakeFrench20sept02.pdf
Il faudrait faire soumettre
le projet, avec le soutien d’organismes internationaux apportant la crédibilité
au projet (PNUD, ONU … _ voir annexe 27), aux principales sociétés de TP
mondiales (Bouygues, Effage etc ...), voire de bétons, briques,
parpaings (Lafarge, Monomur _ www.monomur.com/
_ Saint-Gobain-Lapeyre ... _ ), des sociétés de construction de
maisons en bois ou de bungalows (Gitotel, Bénéteau ( ?), …), ou si
possibles des sociétés locales (Tata etc …).
Chapitre
à développer. Architectes français et surtout architectes locaux.
a) Architectes Sans Frontière :
Contacts : Edouard Mollard (le Web master), Stéphane Plisson
Site Internet : www.asffrance.org (ou http://asffrance.org
)
Adresse : INSA Strasbourg, 24 bld de la Victoire, 67084
STRASBOURG
e-mail : info@asffrance.org
, asfasso@free.fr , zionbus@gmail.com
Télécopie: 03 88 37 96 21 (BdE INSA)
Infos diverses : pas de permanence. Normalement,
il va bientôt y avoir un siège ASF Paris.
b) Architecture et Développement :
Contacts : Délégué Général : Ludovic JONARD, architecte,
enseignant a l’EAPLV
Administrateur : Thomas CLEDE, Responsable de programmes : Céline MERESSE,
Gestion des antennes, Programme d’échanges. Siège à Paris : 144,
Rue de Flandre - 75019 - Paris
Tél./ Fax : +33 1 44652379, e-mail : archidev@archidev.org
Site: http://www.archidev.org/index.php
(Informations diverses : ils ont aussi un
siège en Inde).
b) Architectes de l'Urgence :
Contacts : Dominique Alet, Vice Président des Architectes de
l’urgence
Corine MOYAL, Chargée de mission des Architectes de
l’urgence
Adresse : 9 rue Borromée 75015 Paris France
Tél. 1 : +33 (0)1 56 58 67 27 / Tél. 2 : +33 (0)3 22 80 00 60 / Fax : +33 (0)3
22 72 39 44
@ : info@archi-urgent.com
Site : http://www.archi-urgent.com/fr/
L’esprit et l’éthique de ASF correspond
exactement à ceux de ce projet
(actions progressives en profondeur, à
long terme, recherche prise en charge active par les acteurs locaux, priorité
aux démunis, solidarité, démarche citoyenne …).
Ils
travaillent en relation avec « Architecture et Développement », 144, Rue de
Flandre - 75019 - Paris TeL./Fax: +33 1 44 65 23 79 : www.archidev.org
(et avec Ingénieurs sans Frontières,
146, rue de Crimée, 75019 Paris, Tél: 01 53 35 05 40, Fax: 01 53 35 05 41,
émail: courrier@isf-france.org
, www.isf-france.org , voire
avec Avocats sans frontières : http://www.asf-france.org/
).
ASF et « Architecture et développement » font
parties du réseau « ASF International » : www.asf-international.org/
Tous ces ONG se
mobilisent pour concevoir une aide appropriée aux victimes du tsunami.
Le rôle d’ASF
pourrait, dans un 1er temps, être une aide, dans les calculs
mathématiques de contraintes, de résistances, CAO, dans la déterminations de
dimensions exactes des maisons, dans la réalisation de leur plan exact et des
conseils humains (ASF a l’expérience et la compétence).
ASF est aussi en
relation avec les Architectes Français à l'Export, qui mettre en commun les
expériences et les contacts de ses membres :AFEX, 24 place des Vosges,
75003 Paris, Tél:01 42 76 08 10, Fax:01 42 76 08 18, afex@wanadoo.fr
, www.archi.fr/AFEX/
et avec l’Ordre des Architectes.
2) ANVAR
(Agence Nationale de Valorisation de l’Innovation et la de Recherche).
Délégation
régionale Ile-de-France, 15, cité Malesherbes 75009 Paris
Tél. : 01 44 53 76
00 - Fax : 01 45 26 09 68 - iledf@anvar.fr http://www.anvar.fr/
Geneviève Gelly,
déléguée régionale, est assistée par Eliane Buttung et François Léonardon,
délégués adjoints. Ce organisme permet
de valider techniquement un dossier et de le soutenir (voir aussi pour
informations : http://www.aide-subvention.com/
).
3) Architectes et
correspondants géographiques :
Inde :
INHAF (India Habitat Forum) : info@inhaf.org
…
Résumé :
Acteurs :
1) Comité de pilotage,
3)
Associations, partenaires,
4)
Villageois,
5)
ONG présentes.
Il
faudrait créer des « comités de pilotage » locaux, pour suivre
les projets (un par village _ avec les habitants locaux, un par région, avec
les autorités locales, un au niveau du pays en liaison avec les partenaires
internationaux). Celui-ci décide des évolutions futures, de la constructions
d’équipements collectifs _ écoles … _, en relation avec les dons et mécènes …
On
formera une personne du village à l’entretien de tous les équipements
techniques des maisons : pompes,
fosse à lombrics (fosse sceptique, vides sanitaires …), voire panneaux
solaires, chauffes-eau solaires … Cette personne pourrait être aussi chargée de
fournir aux villageois des feuilles d’arbres sèches pour les WC.
Une
contribution de 50 Rs indiens (ou 100 Rs indiens, en Inde) annuel de chaque
villageois pourrait rémunérer le service de cette personne.
Ce
comité de pilotage local tranche les conflits (par exemple, le problème de
latrines que les autres castes ne peuvent plus utiliser, parce que
« touchée », utilisée par un « impur » en Inde). Il sera,
éventuellement, le moteur de l’évolution des mentalités. Il impulsera ( ?)
un certain brainstorming.
Si
un observateur extérieur (d’une ONG, en général un occidental) participe à la
réunion, il est une force de proposition (et surtout pas dans l’esprit
« interventionnisme condescendant » ).
Il
faut un retour régulier, sur l’avancement (succès ou problème) de l’équipe de
terrain à la coordination du projet en Europe (comprenant les partenaires).
Importance
d’obtenir la confiance des investisseurs (un vrai projet de vaste ampleur).
(voir
chapitres suivants : 8 et 9).
Voici une succession
d’étapes possibles (proposition) :
Soit création de l’Association de
soutien et de développement du projet (statuts, déclaration en préfecture et au
J.O., élaboration d’une charte semblable à celle d’ASF …)
soit le projet serait totalement
intégré comme un projet d’ASF « parmi d’autres » (et donc, il n’y
aurait pas besoin de récréer une nouvelle association).
(Soit reprendre
l’ONG « Transhimalayenne » (dont l’auteur de ce projet est le
président) mais changer ses statuts pour élargir son action hors peuples
himalayens).
Cette ONG serait une association transversale
aux autres ONG. D’autres ONG, organismes internationaux (PNUD …), partenaires,
mécènes … pourraient y participer, en tant que personnes morales (ASF, A&D,
…).
Puis une étape de réflexion et
d’analyse sur le projet, avec l’équipe d’étude et de réflexion (Architectes,
Architectes sans Frontières, ONG oeuvrant sur place, institutions
internationales (ONU, PNUD …) _ études de faisabilité, cahiers des charges etc
… (attention, au risque de mettre en place quelque chose de lourd
administrativement. Trouver le bon coordinateurs souples pour éviter les
conflits, combats de chefs, problème « politiques » …).
Puis phase de décision.
Une 1ère « mission
d’identification » ou « mission de reconnaissance » pour
identifier sur place, des problèmes, besoins, acteurs géographiques, qui est
qui ?, responsabilité, statut de chacun, qui fera quoi ? … Elle
prendra des contact avec les acteurs (Car difficile de théoriser a priori. Note :
l’auteur se propose ses compétences en développement international, pour cette
équipe). La mission de reconnaissance repère les gens, les
producteurs de matériaux locaux et détermine les coûts locaux, le coût des
matériaux locaux etc. ...
choix de l’équipe, d’un site
pilote / expérimental, le bon village pilote. (Note : Nous avons déjà un
village, celui de Gal, au Sri Lanka à proposer),
L’envoi de l’équipe et la
réalisation, par elle, du projet (d’abord le projet pilote, puis le projet ).
Voire créer une organisation, par sous-projet (par village …)
Le suivi du projet dans sa
réalisation, avec retour régulier, par email, d’infos sur l’avancement _ sur le
positionnement local du projet de l’équipe face au contexte local, les
villageois, autorité, délais, coûts, richesse du village … _ vers la
coordination du projet en Europe.
Sur
place, se poser la question : la population a envie de quoi ?
Voir si l’aménagement de
l’espace est pratique pour ces personnes (leur convient).
Souvent, ces personnes
peuvent raisonner en terme de communauté.
Il faudra une concertation
sur tout : l’aménagement … Il faut que les habitants soient motivés.
On doit tenir compte qu’il peut y avoir plein de
bakchichs tout le temps. On doit faire avec (on n’en reste pas moins intègre).
Les actions se feront
souvent en relation avec des ONG locales ou des ONG demandeuses (cela peut être
MSF, Aide Médicale Internationale etc …), des comptoirs( ?)/entreprises de
matériaux locaux, ou en accompagnement d’ONG ( ?).
Le travail des coordinateurs
en Europe (Paris …), se ferait peut-être sur la base du bénévolat pur, tandis
que l’indemnisation de celui des personnes sur le terrain, en mission de longue
durée, se ferait sur la base du volontariat (type volontaires de l’ONU,
VDP, avec au retour l’attribution d’un petit capital pour pouvoir repartir
professionnellement, en Europe).
Note : si très gros
développement de l’ONG, alors prévoir 1 ou 2 salariés au siège, qui coordonnent
à distance (question de responsabilité, d’argent confiés par partenaires etc …
Prévoir ? souscriptions à des assurances ???
(d’architectes ???)).
Les comptes seront vérifiés
par expert comptables (si après 4 ans de fonctionnement, demande de
reconnaissance « d’utilité publique », analyse compte par cours de
compte).
On pourrait prévoir une
spécialisation des tâches, celui qui recherche les financement (exercice
difficile), fait les études, la CAO ?, qui monte les dossiers (et contrats)
souvent complexes avec partenaires, organismes (U.E. ..) _ pour lesquels il
faut de l’énergie, du temps, des compétences …_, le trésorier, le communiquant,
ceux sur le terrain. Qui fait quoi ?
Note : l’auteur se
propose (dans un 1er temps), de rechercher les financements. (réfléchir sur la stratégie partenariat).
Prévoir une charte des
financeurs, donateurs avec le projet (engagements réciproque éthique,
transparence avec donateurs _ villes, U.E. …)
Favoriser le dialogue et
l’information avec les partenaires (puis local sur place).
L’associations, les membres,
l’équipe contribuent (donne un peu de son temps) aux échanges de connaissances
(pôles d’info, doc …), participe avec tous (partenaires, gens locaux, équipes)
à la recherche des solutions, synergie avec d’autres associations (A&D,
ASF-I, ISF …), afin d’éviter le
« vase clos ».
Qui s’occupe de
l’information ? Vers quelles cibles ? Partenaires d’abord bien sûr,
puis journaux, acteurs presse, emails, institutions, puis réaliser doc,
plaquettes pub, tracts (si moyens disponibles) … (élèves d’écoles, d’écoles
d’ingénieurs, de commerce, …), lieux ? Permanence de l’association, pour
l’info, le conseil (l’audit d’un autre projet ? sur la base de
l’expérience acquise ?) …
Comment s’organise les
réunions (plan de travail), fréquence … (Quels débats et échanges par
émail ?)
diffuse librement le texte du
projet (en PDF _ libre diffusion à d’autres personnes à condition de ne pas
modifier le texte du projet sans accord de l’association, du/des auteur(s)). (à
réfléchir sur cette diffusion, risques et avantages).
crée un forum de discussion sur
les idées de maisons et de reconstructions (favorisant le brainstorming).
Des questions se
posent :
A) Que faire pour la
pérennité du projet, en cas de financement insuffisant ?
On prévoir une ouverture
large aux adhérents (à réfléchir).
B) Qui est le maître d’œuvre
(sur place) ? Cela ne se fait pas n’importe comment (il y a t’il du
personnel qualifié sur place, et travailleurs, qui travaille du matin 8 h au
soir 17 ou 18 h ?). Il faut tenir compte du contexte humain, technique qui
ne sont pas les mêmes entre les peuples, le village, la région, le pays.
(Comme nous le dirons en
conclusion, pas de dogme sur la technologie appropriée, l’ouverture d’esprit
restant la règle).
C) Qui forme-t-on ?
quel type ? Comment ? Quel temps ? La transmission ? Qui
seront ou deviendront les (futurs) aménageurs locaux ? Un « manuel
d’auto-construction » à fournir à ces aménageurs (les fondamentaux …).
D) Prévoir sur place, de
possibles conflits entre populations et administration (voire potentats locaux,
attention au risque de domination d’un comité de pilotage _ surtout régional _
par un potentat local), des problèmes de fiscalité, des blocages fonciers, dès
questions de crédibilité du projet dans la population locale (qui peut être
méfiante au départ, qui craint de se faire rouler ...), l’accaparement des 1ères maisons destinées au plus démunis, par les
personnes les plus riches, prix de l’eau sin non gratuite (si pas l’eau
pluviale suffisante, ou pas de point d’eau à proximité, ou nappe potable) …Les
membres de l’équipe et le comité de pilotage repéreront les missions locales et
tenteront de relier les efforts de solidarité locaux.
E) élection annuelle, du
comité de pilotage local ?
Les volontaires du projet
auront sûrement un rôle humain, d’intermédiaire, sûrement de médiateur
social. Donc, importance du choix avant le départ du personnel de
l’équipe qui se rendra sur place (compétences humaines et techniques, des
personnes motivées qui croient dans le projet, expérience de terrain,
caractères …). Le montage d’une équipe est délicat. La situation locale peut
être complexe. Il faut comprendre les choses en profondeurs. Il y a une façon
de construire les relations sociales et savoir écouter les spécificités
culturelles. Pas de vision manichéenne.
(les membres doivent être en bonne santé, vaccinée. Voir
recommandations santés sur le site : Santé voyage : http://www.santevoyage.info )
L’idée est déjà de créer un projet
pilote, dans un village, voire avec une maison témoin, proche d’une
route passante, que les gens peuvent visiter, commenter (pour laquelle il
peuvent donner leurs avis, commentaires) … Le long de la route, il y aurait des
panneaux publicitaires en 2 langues (locale et anglais). On essaye malgré tout
de faire participer, même si c’est de l’action d’urgence (on indique si la
modification demandée n’est pas possible).
On peut prévoir une division des
tâches dans le village : a) ceux qui fabriquent les éléments en bétons, b)
ceux qui les montent pour la maison, c) qui prépare la nourriture (repas), …
Suggestion : au niveau local,
pour tous les intervenants dans le projet, tout le monde est strictement
égal (ni locaux, ni occidentaux supérieurs les uns par rapports aux autres)
au niveau pouvoirs et droits (juridiques, moraux etc …).
Toutes les suggestions, pour cette
reconstruction, émises des personnes locales _ sinistrés demandeurs,
responsables locaux, techniciens locaux etc … _, remontent au niveau mondial,
au niveau du réseau d’échange d’informations entre tous les acteurs (réseau
informatique par exemple).
Les suggestions des décideurs,
architectes mondiaux après discussion et adoption, redescendent vers les acteurs
locaux _ sinistrés etc … _, pour avis (communication sous la forme de
catalogues de maisons _ comme dans une agence immobilière … _, vidéos,
transparents, documentation papier etc …).
Le dialogues serait un peu comme le dialogue pour les directives européennes
(on essaye de se fixer des dates butoirs). Pendant tout ce processus la
formation des populations locales se déroule en parallèle, les suggestions des
ONG, selon les désirs des populations.
Quand tout le processus de décision
a aboutit, la construction des maisons, à plus ou moins grande échelle, selon
les modèles désirés par les gens, peut commencer.
A chaque étape réussie,
« réquisition » médias locaux / internationaux, inaugurations etc …
Pour l’auteur de ce rapport, la
formation est très importante. Par sa propre expérience, il a constaté que
dans les populations analphabètes et particulièrement démunies, a) que
certaines, manquant d’esprit critiques, prennent les occidentaux comme des
« Dieux » et acceptent tout ce que dit un occidental d’Ong comme
parole d’évangile, b) qu’elles vivent souvent au jour le jour sans capacité
d’anticipation.
Il semble, à l’auteur important,
d’apprendre à : a) à avoir de l’esprit critique, savoir faire des choix (à
long terme), b) à ne plus être fataliste ou attendre la providence (ou la manne
occidentale) et d’abord à compter sur des propres forces (ici c’est un
changement de mentalité à long terme), c) que tout ici-bas est dur à obtenir et
que chaque chose coûte (y compris par un dur labeur), d) il important que des
personnes locales soient formés et que les occidentaux d’ONG qui ont donné un
coup de mains, se tire le plus tôt possible (mais dès que c’est possible).
e) C’est là où il peut être
important de mettre en place des micro-crédits.
f) Il est aussi important que les
bénéficiaires paye un petit loyer même symbolique, pour faire comprendre
que ces maisons ne tombent pas du ciel (mais qu’elles ont un coût).
g) Eviter que des ONG se fassent de
la concurrence sur le terrain (les faire se concerter).
Nous sommes aussi convaincu de l’importance
d’une bonne programmation et planification de la reconstruction qui doit se
faire dans une logique durable et d’anticipation d’autres catastrophes
ultérieures. Voire d’autres catastrophes majeures (tels que tsunamis …
même si ces dernières, dans ce cas particulier, restent très rares).
Lieu : Village de Gal, côte est du Sri Lanka
Association associée
locale : Sri Lanka Educational
Cultural and Social Association
Correspondant local : Vénérable Chandaratana.
Durée : 1 an (~ approximativement).
Durée de construction
d’une maison (gros œuvre) : ~
15 jours / par maison.
Nombres de maisons à
reconstruire : une centaine.
Nombres de villageois
dans le village : ~ 500 à 10000 personnes.
(après la reconstruction de l’Asie du Sud).
Tout
le monde ( ?) rêve que tous les gens, dans le monde, aient un toit et un
confort minimum (avec au minimum l’eau potable, un toit, l’électricité
voire un réfrigérateur). Et que plus personne ne soit à la rue.
Cela
serait une grande avancée sociale et une avancée de la modernité, dans le
monde. On pourrait prévoir de nombreuses déclinaisons au concept de base, selon
la région concernée, où le projet pourrait apporter quelque chose.
Par
exemple, dans les pays froids, il y aurait un sas d'entrée (avec une porte
extérieure et intérieure) et du double vitrage.
On pourrait aussi imaginer,
par exemple, a) des murs en bétons pré-colorés (grâce à l’emploi de bétons de
couleur. Voir par exemple, les techniques de Solprisme, Grenoble, France, Tél:
06 89 89 13 84, e-mail: batoux@cimentcolore.com
, site : http://www.cimentcolore.com/ ) b) ou /
et s’inspirer par exemple, de l’exemples des maisons colorés, des N'débélés d’Afrique du Sud (fig. 1) :
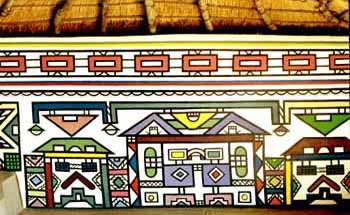
ou celles des Gourounsi, à la frontière du
Ghana, au Burkina Fasso (fig. 2, ci-après):
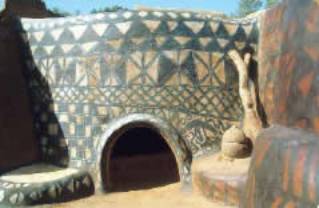
Dans certains pays musulmans
(Egypte), le pèlerin peint son pèlerinage (son haj) à La Mecque, sur le mur de
sa maison. Pourquoi, ne pas peindre ses rêves ? ses Dieux (le Bouddha etc
…). Cela pourrait être discuté en comité de pilotage (suggestion de ce dernier) ?
Dans un avenir plus lointain, on
pourrait imaginer de grandes usines « en ligne », pour construire à
la chaîne (en Europe, avec une chaîne robotisée), en très grand nombre
d’exemplaires, des centaines de milliers de maisons. Des grands porte-conteneurs
transporteraient ces maisons partout dans le monde.
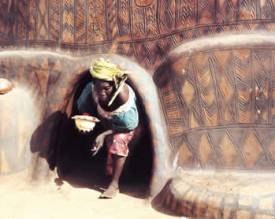
Peut-être, ces maisons
préfabriquées seraient constituées d’éléments modulaires, style Algeco,
emboîtables ou « solidarisables », permettant de reconstituer des
habitations plus grandes et faciles à transporter en conteneur.
Nous
n’avons pas encore traité le budget, à fond (ce chapitre serait encore à
étudier, développer et argumenter). Voici malgré tout une pré-étude, basée sur
les données des chapitres 1 à 18, y compris les annexes
exposant différentes solutions de maisons (voir pages suivantes) :
TABLEAU COMPARATIF DE DIFFERENTS TYPE DE
MAISONS :
|
Nom / Type
|
Description de la
technique
|
Avantages
|
Inconvénients
|
Coûts / Conclusions
|
|
1) Maison type « Un toit pour tous ».
Type Lego avec éléments préfabriqués en béton armé et moulé et Jeux
construction.
|
_ maisons en bétons, en éléments en kits préfabriqués _
est composé de: de nombreuses plaques planes, de poteaux porteurs en béton,
« cannelurés » et des poutres faîtières porteurs (ayant les mêmes
dimensions que les poteaux)
|
très solides, simples, faciles à construire à l’usine ou
sur place par les villageois.
Sur place, on prête, aux villageois, des moules en acier,
pour fabriquer les éléments préfabriqué en béton.
le prix minimum du gros œuvre de la maison au départ,
serait le prix du ciment.
Facile à transporter
|
Obtenir du sable local (comme celui d’une plage proche) si
possible gratuitement, par ententes locales (entre villageois, propriétaires
…).
Ce concept impliquerait que des firmes de serrureries
industrielles, livrent dans chaque village les moules pour construire une
vingtaine de maisons à la suite (coût à prendre en charge par le
gouvernement).
Mais il faudra encore estimer le coût « caché »
des moules.
|
2000 € pour le gros œuvre si les villageois construisent
eux-même la maison.
Concept déjà mis en œuvre par le PNUD à Haïti (voir 7
cassettes vidéo PNUD, Ramigé Film Produktions, UNESCO, 1997).
Attention : nous ne
connaissons pas encore, par contre, le prix du ciment au Sri Lanka, Thaïlande
et Indonésie.
|
|
2) Maison « CLX Conception », du béton
coulé dans des blocs de polystyrène expansé, montés ensembles comme des
Legos.
|
coulage de béton liquide dans des blocs de coffrages
isolants en polystyrène expansé (« Isohome »). Normalement,
dans la technique CLX, une centrale à béton ou un camion bétonnière, possède
une pompe propulsant, par un tuyau,
le béton frais, jusqu’à sa destination, ici les blocs de coffrage.
|
Facilité de construction.
Cette technique permet de construire une maison, tout
équipée, en un mois (et sans équipement, en ~ 14 jours ?).
En Inde, il n’est pas sûr qu’on puisse disposer de ces
engins. Dans ce cas on peut imaginer une solution plus simple : une
chaîne humaine transportera le béton frais, dans des sceaux, de la bétonnière
jusqu’en haut du mur.
|
Ce type de coffrages CLX en polystyrène (peu coûteux)
n’existe pas en Inde, mais pourraient être facilement fabriqué en Inde (voir
liste des fabricants de polystyrène expansé, dans le dossier).
Le problème restant le coût de production de ces blocs en
Inde.
Note : CLX Conception France accepte d’exporter
le concept en Inde (ce qui ne veut pas dire que cela soit faisable et
réaliste).
|
Avec le coût du concept n°1, soit 1230 €, plus environ
1000 blocs de polystyrène, par maisons, à ~ 1 € pièce (coûts indiens 10 fois
moins élevés qu’en France et proche du prix coûtant), cela ferait 2230 €.
Donc plus cher que le concept n°1 (presque le double). Par
contre, rapidité de construction.
Ces calculs restent théorique, tant qu’on ne sait pas le
prix de ces blocs en Inde.
|
|
3) « Maison AUM »
|
L'Auroville Earth Institute (Inde)
a mis au point une maison prototype carrée, de 23m2, la Maison AUM.
Elles est composée de ~ 2280 briques (ou blocs) de 30 cm x 15 cm x 15 cm.
|
Briques faciles à fabriquer sur place. Maison facile à
construire sur place. D’après leurs concepteurs, elle serait résistante aux tremblements de terre, aux cyclones et
aux inondations.
|
N’est pas prévue pour être transportée (lors d’un
transport de la maison sur 5000 km, 8 briques s’étaient fissurée). Cette
maison reste juste un prototype réalisé en 3 exemplaires. Faiblesse de la
structure au niveau de l’entrée, qui a été corrigée
|
Peu d’information sur cette maison (pourquoi, cette maison
qui pourtant à reçu un prix de l’Innovation Indien, n’a pas été construite à
plus d’exemplaire ?
|
|
4) abris d’urgence temporaires construits sur place.
|
Certaines ONG construisent déjà des abris temporaires en
parpaings et toit en tôle (sans fenêtres).
|
Cela reste la solution, la moins chère.
|
mais la plus provisoire et inconfortable : la chaleur
est extrême sous le toit en tôle et ce dernier peut facilement s’envoler,
formant un projectile meurtrier en cas de cyclone.
|
La moins chère 2000 €.
N’est pas prévu dans une philosophie de durabilité, cher à
notre projet. La plus inconfortable.
|
|
5) Type « Maisons en kit US », en
panneaux d'agglomérés (ou contreplaqué) isolés par des couches isolantes
(laine de verre etc …).
|
Solution, très utilisée aux USA et Canada. La moins chères
des maisons livrées en kit, à partir du Canada ou USA, non équipée, coûte 20
000 €. (elles bénéficient souvent, il est vrai, d’un équipement et confort
complet). Peu coûteuses pour ces pays. En Islande, on rajouter de la tôle
ondulée sur les façade pour résister aux tempêtes et fortes pluies
incessantes.
|
Facile à industrialiser et à transporter. Ce genre de
construction résiste aux séismes.
|
Ce genre de concept n’existe pas en Inde, au Sri Lanka, en
Indonésie et en Thaïlande. A cause de sa complexité, il est peu
envisageable à mettre en place, sur place. Elles ne sont pas, par contre,
prévues pour résister aux cyclones.
|
Avec le coût du transport (rajouter 50 à 100 % du prix,
par ex. 1500 € pour un conteneur 40
p. pour Sri Lanka), même en supposant avec coût de la main d’œuvre 5 à 10
fois moins élevé en Inde, qu’au Canada, on pourrait prévoir 3500 à 5000 €.
Si on l’expédie des USA, Canada => ~ 21 500 €,
ces prix restent trop élevés pour ces régions.
|
|
6)
« chalets GITOTEL », Chalets en bois et bungalows ou
mobil-home pré-fabriqués en bois, à monter comme un Lego.
|
Le modèle de chalet GITOTEL, le CLASS RESIDENCE, 8
m x 6 m (46 m2), 6 pers., 2 ch, tout équipé (avec kitchenette, four,
WC, frigo, hotte aspirante, rideau …), posé, coûte 16900 €. Il monté
en 2 jours avec 4 ou 6 techniciens, sur long green. Déjà envoyé à la Guinée,
à la Réunion.
Les Legos sont très bien agencé.
|
Ce chalet, pouvant résister aux tremblement de terre.
Très facile à monter et transporter. Ces maisons sont
faciles à monter, en 2 ou 3 jours avec un expert et 3 ou 4 personnes.
GITOTEL s’engage à livrer, en Inde, par conteneurs, des
chalets en bois, en kit, à monter sur place.
Sans équipement, GITOTEL peut la construire pour moins de
10 000 €. Jolies maisons esthétiques.
|
Elle n’est pas prévu pour résister aux cyclones.
On pourrait éventuellement, renforcer ce chalet, face aux
cyclones, par le passage de filins d’acier dans sa structure, ou l’ajout
d’une façade en étrave de bateau, face à l’océan (idées personnelles).
Mais peu de bois disponible en Inde. Eventuellement, en
important le bois (°) et en créant une usine de production sur place, on
pourrait encore en réduire son coût (la main d’œuvre étant 5 à 10 fois moins
chère en Inde et en Chine, qu’en France).
|
|
|
7)
Des sociétés comme OHARA (groupe Bénéteau) … fabriquent des
bugalows, selon la technique de fabrication des caravanes.
|
Elles sont montées en usine et livrées, par convoie
exceptionnel.
Le Modèle Mobil-home Ohara : Ophéa 734, 4 m x
7,3 m (Superficie 25 m2 plus terrasse 10 m2, totalement équipé de façon
luxueuse) coûte ~ 20300 €.
|
Immédiatement livrées. Pas de montage sur place. Jolies,
esthétiques.
|
L’idéal serait de construire ce mobil-home sur place
(bungalow pourvu d’un confort minimum pour moins de 5000 €).
Le Mobil-home ne résiste pas aux cyclones.
totalement montée (non livrable en kit), la maison
nécessite un convoi exceptionnel catégorie 4, convoi difficile à mettre en
place en Inde.
|
Cette solution reste hypothétique. Elle ne résiste pas aux
cyclones. La société Ohara n’envisage pas pour l’instant d’une implantation
(ou de livraisons) en Inde. Complexe à construire.
|
|
8)
Maisons en rondin ou « fuste » :
|
Type maison de trappeur canadien.
|
Ce type de maison, très massive, très solide, résistent
aux tremblements de terre et cyclones.
Elles sont facile à construire.
|
Mais le prix du bois en Inde et Sri Lanka est cher, elles
nécessite un volume de bois important.
Pour juste, le plancher, le toit et les murs, et les
cloisons intérieures, cela ferait une maison en Inde à 12000 € mini (au cours
du bois : 300 € le m3 de sapin x 40 m3) sans compter le fret (bois à en
général importer de loin).
|
Ne pourrait être réservé que dans les régions extrêmement
boisées en bord de mer (avec une distance de transport de la forêt au lieu de
construction minime _ moins de 100 km). Dépend du cours du bois, élevé
actuellement.
|
|
9)
Maisons en bambous (et/ou toit en tuiles de bambous ou en feuilles de
palme).
|
Construites partout en Asie et en Amérique du Sud.
|
Ce sont de maisons très peu coûteuses et faciles à
construire (d’autant que le bambou est abondant dans les pays concernés.
L’Inde et l’Indonésie en produisent). On pourrait normalement obtenir des
maisons modernes en bambous traité anti termites et xylogphages à moins de ~ 3727 € (5000 $). Certaines ont plus de
300 ans (Japon).
|
Il faudrait lancer une étude pour ce concept, afin de
rendre la maison résistante aux cyclones et tsunami, peut-être par le renforcement
du nombres de couches et d’entrelacs superposés de bambous de grandes
dimensions, renforcés par des anneaux de fils de fer, entourant les
croisillons de bambous.
|
Pour l’instant, ce ne sont que des hypothèses (étude
à réaliser au Japon, ou dans les pays ayant déjà fait ce type d’étude sur le
bambou _ Pays-bas, Equateur etc. …).
La plupart des experts (Bambouseraie d’Anduze)
estimeraient son coût entre 2500 et 4000 €.
|
|
10)
maisons en briques de terres crues, comme celles du Wardhas
Development Association en Inde
|
Construites partout dans les pays en voie de
développement.
|
Les moins coûteuses (< 1000 €). Faciles à construire.
Peu résister aux pluies. (Beaucoup d’études dessus : ASF, PNUD …)
|
fragiles face aux séismes, cyclones et tsunamis,
dangereuses en cas de catastrophes naturelles.
|
Les moins coûteuses (< 1000 €). Fragiles face aux
séismes, cyclones et tsunamis, nous ne les envisageront pas.
|
|
11) Maison en caissons d’aluminium remplis d’un matériaux
|
(nouveau
concept)
|
Très faciles à monter.
|
Coût de l’aluminium (2000 € la tonne au cours mondial)
|
Pour mention, nous ne les envisageront pas pour l’instant.
|
|
12) Maisons à colombage en kit
|
(nouveau concept)
|
: on l’a juste cité, pour mention, parce que cela fait des
maisons très solides (et cela économise en bois).
|
Il faudrait lancer une étude pour cela.
|
Concept hypothétique mais réaliste. Pour mention, nous ne
les envisageront pas pour l’instant.
|
|
13) Maisons type ALGECO
|
Cabanes en tôles gaufrées, avec sandwich d’isolants entre
les tôle. Utilisé en Arménie et Turquie pour reconstruire villages détruits
par tremblement de terre.
|
Disponibles immédiatement. Facile à transporter. Des
constructeurs existent en Inde, Turquie etc … Existe en version local
sanitaire.
|
Peu esthétique .
|
Pour mention, nous ne les envisageront pas pour l’instant.
Coût à déterminer
|
|
14) Maison en poutres métalliques ou bois et panneaux de
bois
|
En cours
d’étude
|
|
|
|
|
16) Maison en bio-matériaux de Michel Rosell
|
En cours
d’étude
|
|
|
|
Dans cette liste, nous reconnaissons que nous n’avons pas
encore étudié :
les maisons réalisées avec les coffrage « syflex »
(voir plus loin),
les maisons de l’architectes de Jean Prouvé, ou les maison sur
les concepts de ce dernier _ maisons « Domobile »,
les chalets « Terrabois ».
que nous étudierons ultérieurement.
Résumé conclusions partielles :
Lors de notre étude, nous avons retenu, pour le fait
qu’elles sont réalistes, peu coûteuses et ayant déjà été mis en œuvre avec
succès :
1)
le concept « Un toit pour tous » bois à monter
comme un Lego (>= à 2000 € et < 3000 €, construites en Haïti),
2)
la maison en bois à monter comme un Lego (type GITOTEL, avec
du bois local _ Indonésie _, ou à importer _ Inde et Sri Lanka _, et dont les
éléments préfabriqués sont construire localement. Elles ont déjà été utilisées
en Afrique, à La Réunion …),
3)
voire la maison en bambou (>= à 2000 € et < 4000 €,
nombreuses constructions en Asie),
Note : L’emploi du béton très consommateur d’énergie fossile
n’est pas très écologique, mais le
ciment indien étant particulièrement bon marché (21 € / tonne). Avec l’urgence,
la solution de l’emploi du tout béton reste normalement envisageable.
Si l’on envisage la solution tout en bois, il faut tenir
compte que la ressource bois est déjà surexploitée en Inde et au Sri Lanka. En
Indonésie, il existe des régions très boisées indonésien (et non surexploitée).
Pour l’Indonésie, une unité de production pourrait être crée en Indonésie, mais
attention de ne pas surexploiter cette ressource (qui est déjà surexploitée
dans certaines régions d’Indonésie).
Comme nous avons pu le voir,
le projet se veut ouvert aux idées (proposition d’idées principales et
ouverture aux autres idées).
Il prône l’émulation entre
les idées, et la coexistence de plusieurs technique, et la concurrence.
On peut très bien imaginer
des constructions artisanales locales, et en même temps industrielles, suivant
la région, le pays, selon certaines conditions etc …
Il y aura confrontation
d’idées entre orientaux et occidentaux. Les règles du jeux ne sont pas
nécessairement les mêmes [1].
On peut voire même imaginer
la fourniture à grande échelle, par certains pays industrialisés, de maisons et
chalets en kits, par exemple en bois (dont les producteurs sont la Finlande, la
Suède, le Canada …) livrés à plus de 6000 km.
Les techniques et les
solutions doivent être discutées. La concertation et la communication est la
règle dans ce projet. On prévoir des équipes techniques qui dialoguent, des
comités de pilotages … L’échange d’idées est la règle.
On y réfléchit, avec
conscience professionnelle, aux conséquences de chaque choix.
Tout élément du projet doit
être réfléchi, étudié, avec sérieux, rigueur, dans le moindre détail (si par
exemple, on prend tel bois pour les palettes, ne risque-t-on pas de répandre
certains insectes ravageurs ? etc …).
On pèsera les
conséquences écologiques de chaque choix du projet. Par exemple, avec l’emploi du bois, on éviter les
fournisseurs, pratiquant les coupes claires (à l’origine de fortes érosions en
montagne et de forts appauvrissement écologique du milieu, qui est encore
pratiquée en Finlande, au Canada …), les coupes minières (appauvrissant les
forêts et la diversité, surtout dans les forêts indonésiennes et toutes les
forêts équatoriales et tropicales). On privilégie ceux effectuant une bonne
gestion des ressources forestières. On étudiera quelles essences d’arbres
choisir, si choix d’arbres locaux (cryptomérias, eucalyptus_ karis … _ …). Quel
arbre est le plus adapté, le plus abondant etc … ?
On essaye de déterminer quel
chauffage, quel réchaud permet d’économiser la « ressource bois ».
On profitera de du projet,
pour faire une campagne de sensibilisation au respect de la nature, des forêts,
que les ressources sur notre planètes sont limitées et pas toujours
renouvelables, si l’on n’en prend pas suffisamment soin (prendre l’image des
provisions sur un navire, la terre étant le navire).
Chaque plan de montage ou
documentation (technique, contractuelle), donnée à chaque propriétaire, sera
accompagné d’une petite brochure ,dans la langue locale, sensibilisant au
respect à l’environnement dans la région.
Il faut créer une dynamique,
que tout le monde se tente concerné.
Les slogans d’une propagande
pour la reconstruction _ « Le tsunami est une guerre, gagnons la bataille
de la reconstruction ! »_, des petits drapeaux (comportant par
exemple, le pictogramme d’une maison en rouge, sur fond bleu) distribués à tous
les intervenants et populations bénéficiaires du projet.
Il faut aussi tenir compte
des spécificités locales, lenteurs déroutantes pour un occidental, lourdeurs
administratives (voire corruption), séparation entre castes (en Inde …),
pudeurs, coutumes inconnues de nous …
Avec la solution de panneaux
préfabriqués, s’inspirant d’un projet du PNUD à Haïti, la moins chère, nous
pouvons obtenir, on peut obtenir une maison, pour le gros-œuvre (la partie en
béton de la maison, sans l’équipement et aménagements interne) à ~ 2000 € (voir
chapitre budget).
Note : Les personnes
dans ces régions souvent ne se contentent que d’un confort très rudimentaire
(beaucoup ont des maisons, avec des murs en briques crues, un sol en terre
battues, et certains dorment sur des nattes en palme).
Donc, il n’est pas
nécessaire de fournir une maison aussi complexe (et « luxueuse »)
qu’en France.
La confrontation des idées
(le brainstorming), l’utilisation des ressources locales, les effets d’échelle
et une standardisation, pourraient éventuellement encore en réduire les coûts.
Il est certain que les
gouvernements et organismes internationaux n’ont pas attendu ce projet, pour
s’atteler à la tâche, mais ce document à pour but d’apporter des informations
et suggestions utiles pour les projets en cours.
L’auteur espère avant tout
que les habitants sinistrés retrouveront vite leur habitation, que cela soit
avec ce projet, avec un autre, avec la combinaison de plusieurs projets dont
celui-ci, sans querelles politiques (politiciennes).
Petit additif :
Ce projet est aussi de
donner des buts, des actions positives, voire des idéaux, aux sinistrés et
bénévoles.
En effet, il y a le risque
que les sinistrés, parqués dans des camps _ où règnent, le plus souvent, des
conditions sanitaires désastreuses (fréquentes épidémies de gastro-entérites …)
_, restent oisifs, attendant sans cesse, l’aide internationale.
Un but du projet est donc
aussi de les rendre très rapidement autonome, prenant l’initiative.
Ce projet pourrait aussi aider des populations très pauvres à
améliorer leurs conditions (comme celles des
intouchables, des réfugiés de toutes sortes etc …).
On trouve partout en Inde,
des personnes vivant dans des camps de tentes ou des huttes couvertes de sacs
plastiques noirs, dans des conditions de pauvreté et sanitaires inimaginables,
et le plus souvent ainsi, depuis des décennies (voir Annexe 27 : réfugiés,
sinistrés du tsunami sans toit en Inde).
[1] Business Class Inde, Les éditions d’Organisation (guide
de poche pour le marché indien), 1998.
Source : Fiche Conseil
N°83
Publication: 1-12-2000,
site : http://www.ecoconso.be/page.php?ID=83
Nous avons vu dans la fiche 73 qu'un
toit de 100m2 permet de récolter annuellement 80 à 120m3 d'eau, il faut donc
prévoir pour une telle maison une citerne de 12 à 14 m3 de volume utile
(3mx2mx2m).
Il est toujours préférable de prévoir une citerne plutôt trop grande que trop
petite...
Il est conseillé de construire la
citerne en béton, car ce dernier permet de neutraliser l'acidité naturelle de
l'eau de pluie. Une eau acide corrode les canalisations métalliques! Dans tous
les cas, éviter les citernes en plastique ou en métal. La citerne pourra être
préfabriquée (volume de 1,5 à 15 m3) ou construite sur place par coffrage. La citerne
sera autant que possible divisée en deux compartiments, le plus petit (10 à 20%
du volume total) servant de décanteur avant déversement dans le grand
compartiment. Le groupe hydrophore puisera l'eau dans le fond du grand
compartiment. La citerne devra être munie d'une ouverture suffisamment grande
pour permettre d'y pénétrer (trou d'homme/chambre de visite). Un trop plein
doit permettre d'évacuer l'eau excédentaire.
Placer de préférence la citerne à
côté de la maison, à 3 mètres des fondations ou dans une cave en veillant à la
stabilité de l'édifice.
Le groupe hydrophore pompe l'eau
hors de la citerne et l'envoie dans les canalisations. Cette pompe est munie
d'un réservoir tampon (20 à 300 litres). Dès que le réservoir est vide, la
pompe se met en marche. La puissance nécessaire pour la pompe (de 0,45 à 2,25
kW) dépendra de l'utilisation nécessaire. La pompe devra être placée à l'abri
du gel. Attention, aucun raccordement direct avec l'eau de distribution n'est
admis.
On place un filtre dit primaire
avant l'entrée de l'eau dans la citerne afin d'éviter que des feuilles ou de
petits animaux tels que rats, souris, grenouilles, ne tombent dans la citerne.
A la sortie du groupe hydrophore, on placera un filtre d'au moins 20
micromètres pour retenir les particules fines. Attention, il faut veiller à
nettoyer régulièrement les filtres.
Une aération de l'eau, à l'aide
d'un compresseur d'air pour étang, évite les éventuels problèmes d'odeurs de la
citerne! L'aération empêche la dégradation anaérobie de la matière organique.
L'intérieur de la citerne doit
être nu, sans recouvrement imperméabilisant. Le revêtement en ciment a une
durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Idéalement, la citerne sera
vidangée et nettoyée chaque année ou à tout le moins tout les 3 ou 4 ans. Les
gouttières seront nettoyées régulièrement afin de parer à l'accumulation de
feuilles ou de boue. La vidange consiste à pomper ou à laisser s'écouler l'eau
par le robinet et, si nécessaire, à faire aspirer le fond vaseux par un
camion-citerne de vidange. Surtout, ne pas désinfecter, c'est inutile et
dangereux pour la qualité de l'eau. Le(s) filtre(s) primaire(s) devra(ont) être
lavé(s) très régulièrement. Au cas où l'eau dégagerait une mauvaise odeur,
vérifier les filtres primaires, nettoyer les corniches, aérer l'eau dans la
citerne.
Le placement d'une citerne d'eau
de pluie peut coûter de 250 à 1250 €. Le groupe hydrophore coûte de 100 à 600 €
selon sa puissance et sa qualité. Le filtre de 20 micromètres revient à 750 €.
L'amortissement de cet investissement se compte tant sur l'économie d'eau de
distribution que sur l'économie éventuelle d'adoucisseur, de détergents et
savons, l'augmentation de la longévité des appareils dotés d'une résistance
chauffante (diminution de l'entartrage).
L'eau de pluie, faiblement
minéralisée, se prête à la potabilisation. Pour y arriver, il faut utiliser un
filtre soit à osmose inverse soit en céramique. L'eau ainsi obtenue sera
potable mais pas au sens de la législation. Si vous décidez d'acquérir un
système de potabilisation, renseignez-vous de façon approfondie sur les
produits commercialisés et leurs conditions d'utilisation, la qualité peut
varier.
Il faut plus de 60 m2 de surface
de toit par personne pour pouvoir prétendre se passer totalement de l'eau de
distribution. Voir aussi la fiche-conseil N°73: "Pourquoi une citerne
d'eau de pluie?" Pour plus d'informations, appelez la permanence
téléphonique du Réseau: 071/300 301 pendant les heures de bureau.
Les Amis de la Terre-Belgique, Place de la Vingeanne à 5100
Dave (Namur).
Permanences: lundi et mardi de 9h à 16h; jeudi de 9h à 18h,
Tél.: 081 40 14 78 | Fax: 081 40 23 54
Site Internet: http://www.amisdelaterre.be
Réseau Eco-consommation, Boulevard de
Fontaine, 27 à 6000 Charleroi, tél.: 071/300.301 (de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30), fax: au 071/654.879, e-mail: info@ecoconso.be
(en attendant la construction de la maison définitive).
En attendant la reconstruction dans la maison, les habitants
seront logés sous des tentes (si c’est possible), sinon sous des bâches
plastiques ou sous du film plastique pour serre (peu coûteux), soutenu par des
mâts en bois, de 2,5 m (au bout arrondi d’un côté, aiguisé comme un pieux de
l’autre). Et on leur construit des feuillées (WC provisoires).
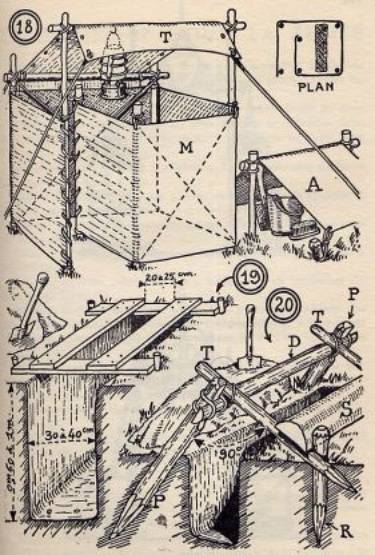
Les feuillées :
Elles doivent être a) faciles à désinfecter, b) éclairées la
nuit, c) à l'abri des regards, d) protégées de
la pluie.
Ecran
(fig. 18).
Un mur de toile de jute M est tendu sur six bâtons
suivant le plan schématique ci-contre. Un toit T fait d'un
carré de toile de tente abrite de la pluie. Une lanterne en veilleuse y est
suspendue du soir au matin.
Un petit abri A doit contenir, à proximité, les
ustensiles et ingrédients de nettoyage et de désinfection. Il est
aussi excellent de prévoir un lavabo à proximité.
Agencements
de la tranchée :
Modèle
1 (fig. 19).
Elle doit être étroite et profonde (la plus profonde
possible). On réduira encore sa largeur par un système de quatre
planches clouées ensemble et tenues
par des piquets.
Ainsi, les parois de la tranchée ne s'ébouleront pas ;
en outre, le tout pourra être lavé au savon et brossé chaque
jour. On arrose ensuite de crésyl étendu d'eau.
Mettre une pelle à portée de la main pour jeter un peu
de terre dans la tranchée après usage.
Modèle II (fig. 20).
1) Fixer un dossier D à deux solides piquets P
enfoncés très profondément et obliquement.
2) Poser sur deux traverses T un siège S maintenu à la
hauteur voulue par deux piquets de retenue R.
Le siège sera un morceau de grume refendue,
soigneusement arrondi et bien débarrassé de son écorce. Il est
indispensable que ce siège soit amovible pour être lavé chaque jour.
Extrait du livre : Mains Habiles, Albert Boekholt,
Presses d’Iles de France, 86 rue Bonaparte, 75006 PARIS, ~1950 (et La
« Vie active », 20 rue Guersant, 75017 PARIS).
|
Titre:
Puisards
|
|
|
|
Division:
|
Agriculture
et affaires rurales
|
|
Situation:
|
|
|
Rédacteur:
|
D.
Hillborn - Service du génie agricole/MAAO.
|
23.1.1.1
Table des matières
Introduction
Utilisations des puisards
Avantages
Désavantages
Types de puisards
Puisard vertical
Puisard incliné
Conception
Installation
Entretien
Assistance
technique
23.1.1.2
Introduction
Un puisard pour le drainage consiste en un système
mécanique visant à abaisser le niveau d'eau au moyen de tuyaux et à dissiper
en grande partie l'énergie produite par l'eau. Les bassins de sédimentation
en béton, les tuyaux verticaux en plastique et les ponceaux d'acier inclinés
sont tous des exemples de puisards.
Figure 1. Exemple d'un projet de démonstration d'ouvrages pour la
maîtrise de l'érosion au moyen de plusieurs types de puisards. Au premier
plan, la grille protubérante sert de puisard au tuyau central.

23.1.1.3
Utilisations des
puisards
Le puisard sert à canaliser des volumes moyens et faibles
d'eau au bas de pentes abruptes (30 %). Cet ouvrage de protection peut
accommoder des différences de niveaux de 1 mètre et plus. On utilise
couramment les puisards pour contrer le ravinement, pour acheminer les eaux
de surface vers un fossé et pour intercepter l'eau à la tête des terrasses.
23.1.1.3.1
Avantages
1.
Le
puisard retient l'eau dès qu'elle y pénètre, éliminant les problèmes
d'érosion du sol.
2.
La
plupart des puisards sont préfabriqués, ce qui permet de réduire le temps de
construction sur le chantier.
3.
La
capacité du puisard a ses limites. De ce fait, il s'adapte bien à un système
de stockage des eaux d'inondation et il peut difficilement s'auto-détruire à
cause du débit d'écoulement.
4.
Les
coûts du système installé se comparent avantageusement à ceux de systèmes
comparables, particulièrement dans les cas de faibles débits d'eau.
5.
Les
caractéristiques relatives au débit sont disponibles pour fins de conception
du puisard.
6.
Le
puisard se révèle le seul moyen efficace de prévention de l'érosion dans les
sols non cohésifs.
23.1.1.3.2
Désavantages
1.
Le
point d'entrée du puisard concentre l'écoulement de l'eau dans un canal plus
étroit. En raison de la grande vitesse de l'écoulement, le point d'entrée
peut être obstrué par des débris et il peut se produire un affouillement.
2.
L'eau
peut se creuser un canal le long des tuyaux si le puisard n'est pas bien
construit.
Normalement, le puisard fonctionne à sa pleine capacité seulement lorsque la
colonne d'eau est grande (ce qui peut nécessiter une berme d'une hauteur
excessive).
3.
La
capacité du puisard a ses limites. Lorsqu'il atteint sa pleine capacité, un
autre système est nécessaire pour emmagasiner ou évacuer les eaux
excédentaires.
4.
Les
coûts d'installation peuvent être plus élevés que ceux de systèmes
comparables faits pour des débits d'eau importants.
23.1.1.4
Types de puisards
23.1.1.4.1
Puisard vertical
Le puisard vertical avec sortie d'évacuation est composé
d'un ensemble de tuyaux : un vertical et l'autre horizontal. Le tuyau
vertical peut être de section carrée ou ronde. Il est généralement en béton,
en acier ou en plastique. Le débit maximal est fonction de la quantité d'eau
qui peut entrer par le haut du tuyau vertical et de la capacité du tuyau
horizontal.
Figure 2. Vue d'un puisard vertical avec sortie d'évacuation en
construction. Remarquez les anneaux scellants sur le tuyau horizontal.
Lorsque vous creusez une tranchée, prenez toutes les précautions nécessaires
pour éviter l'effondrement des parois latérales sur les travailleurs.

La quantité d'eau qui va entrer par le haut du tuyau
vertical dépend du diamètre du tuyau et du niveau de l'eau au-dessus du
tuyau. Autant que possible, la grille protectrice ne doit pas entraver
l'écoulement de l'eau car toute obstruction diminue le débit.
Le tuyau horizontal doit être posé à l'extrémité
inférieure du tuyau vertical. Sa capacité dépend de la hauteur de la colonne
d'eau provenant du tuyau vertical, ainsi que de la longueur et de la rugosité
du tuyau horizontal. Le diamètre du tuyau horizontal est normalement plus
petit que celui du tuyau vertical, puisque l'eau qui y circule est soumise à
une plus grande pression à cause de la hauteur de la colonne d'eau au dessus.
L'énergie cinétique de l'eau qui descend se dissipe en
trois points :
1.
L'extrémité
inférieure du tuyau vertical élimine l'énergie de chute de l'eau.
Habituellement, la sortie du tuyau horizontal est située à plusieurs
centimètres au-dessus de l'extrémité inférieure du tuyau vertical, de sorte
que l'eau accumulée absorbe et répartit l'énergie.
2.
L'énergie
est également dispersée par la friction dans le tuyau horizontal,
particulièrement lorsque le débit est maximal. Dans la plupart des cas,
l'énergie est transférée du tuyau au sol qui l'entoure par le lien de
friction entre le sol et l'extérieur du tuyau. Toutefois, si le tuyau est
incliné (comme dans les ouvrages d'une hauteur importante), l'énergie
produite par le lien de friction doit être évaluée.
3.
L'énergie
est aussi disséminée à la sortie du tuyau horizontal. Le tablier de sortie
doit pouvoir absorber cette énergie. Dans la plupart des cas, un enrochement,
des gabions-matelas ou l'équivalent feront l'affaire.
23.1.1.4.2
Puisard incliné
Cette structure ne comporte qu'un seul élément, un tuyau
incliné. La longueur et la rugosité interne du tuyau déterminent sa capacité.
L'inclinaison du tuyau n'a que peu d'effet car, dans la plupart des cas, on
dépasse l'« angle critique », c'est-à-dire l'angle pour lequel le débit
n'augmente plus suivant l'accentuation de la pente.
Puisque la colonne d'eau qui pénètre dans le tuyau n'est
pas considérable (comme c'est le cas dans le tuyau horizontal d'un puisard
vertical), cette structure possède une capacité moindre pour tuyaux de même
dimension. Elle est utilisée dans les dénivellations faibles et sert à
canaliser les débits faibles et moyens.
L'énergie cinétique de la chute d'eau est dissipée en deux
points :
1.
Par
la friction interne dans le tuyau. Dans ce cas il est également nécessaire
d'obtenir un bon lien de friction avec le sol.
2.
À la
sortie du tuyau. La zone de sortie du puisard incliné constitue un point
critique étant donné que la majeure partie de l'énergie doit être dissipée à
cet endroit.
23.1.1.5
Conception
La conception d'un puisard pour le drainage passe par les
étapes suivantes.
1.
En
premier lieu, évaluer le débit de pointe de l'eau qui pénètre dans la
structure. Cette évaluation dépend de la topographie et de la grandeur du
bassin versant, du type de sol, de la végétation, des pratiques culturales et
de la capacité de stockage de l'eau. Pour franchir cette étape, il faudra
probablement s'adresser à des spécialistes.
2.
Mesurer
la chute approximative et la distance horizontale de l'endroit où le puisard
sera installé.
3.
Vérifier
si on doit incorporer un bassin de stockage de l'eau en tenant compte des
paramètres suivants :
o
la
dimension et la forme du bassin de stockage envisagé (un bassin ayant une
pente prononcée ne retient pas beaucoup d'eau).
o
l'utilisation
d'un bassin de stockage d'eau a pour effet de diminuer la dimension et le
coût du puisard.
o
Si
vous devez installer un tuyau très long, l'incorporation d'un bassin de
stockage diminue les coûts du système.
o
la
durée du débit de pointe. Lorsque le débit de pointe survient et décroît
rapidement, inclure un bassin de stockage sera plus économique, car on pourra
réduire la dimension du tuyau.
o
l'éventualité
d'endommager les cultures. Certaines cultures ne peuvent tolérer la présence
d'eau stagnante durant 24 heures. Lorsque la période d'évacuation doit être
écourtée, il est préférable d'opter pour une autre méthode que le bassin de
stockage.
Figure 3. Graphique servant à déterminer la dimension des puisards
inclinés et verticaux selon des débits de pointe inférieurs à 0,5 m3/s.
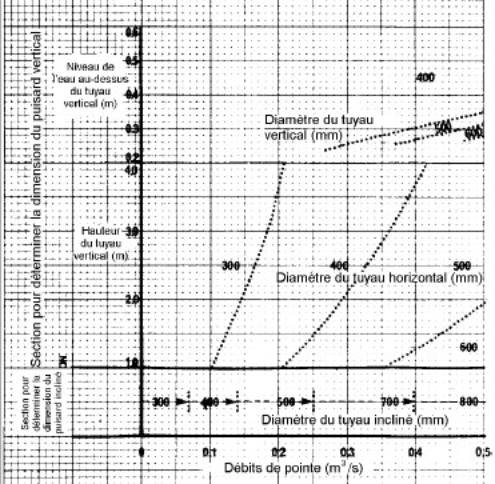
Figure 4. Graphique servant à déterminer la dimension des puisards
inclinés et verticaux selon des débits de pointe supérieurs à 0,5 m3/s.
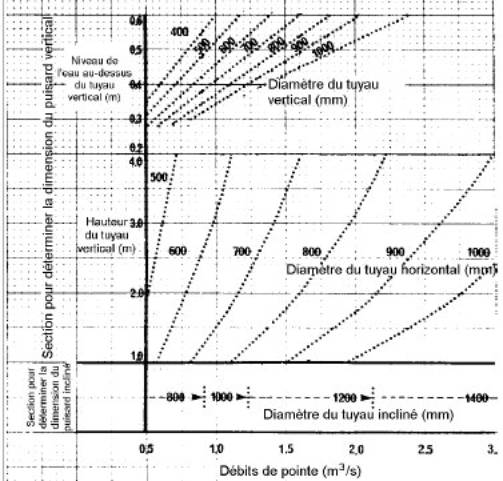
1.
Déterminer
le type et la dimension de la structure requise. Les figures 3 et 4 indiquent
la capacité de différents types de structure selon leur dimension, mais ne
comprennent pas le bassin de stockage. D'autres brochures donnent les
renseignements relatifs à la conception des bassins de stockage.
2.
Établir
la hauteur et la longueur de la berme. La hauteur de la berme dépend de la
colonne d'eau nécessaire afin que le puisard fonctionne à pleine capacité
(voir les figures 3 et 4) ou du niveau d'eau maximal de stockage désiré. La
berme devrait être relevée de 10 à 20 cm en vue de compenser le tassement et
l'affaissement de celle-ci. Un déversoir d'urgence devrait également être
installé. Souvent, ce déversoir consiste en une brèche à la partie supérieure
de la berme recouverte d'un enrochement déposé sur un tapis filtrant. Le
déversoir d'urgence sert à écouler l'eau qui dépasse la capacité du puisard
et du bassin à cause d'un gros orage ou lorsque le puisard est obstrué ou que
l'on a mal jugé les caractéristiques du bassin versant.
3.
Si
nécessaire, déterminer la vélocité de l'eau au point de sortie. Lorsque la vélocité
dépasse la capacité de résistance du canal naturel contre l'érosion, on doit
aménager un tapis de roches protecteur ou un ouvrage équivalent.
Figure 5. Schémas des puisards.
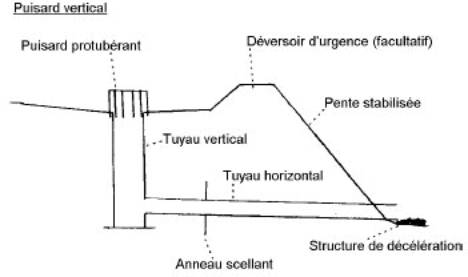
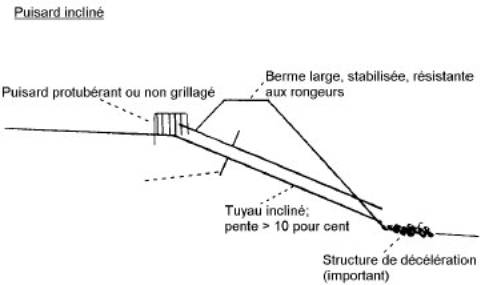
1.
Terminer
les plans de l'ouvrage incluant berme, pentes, puisards, etc. On doit
envisager des solutions aux problèmes de fuites d'eau le long du tuyau. On
peut installer des anneaux scellants en vue d'augmenter la résistance à
l'écoulement de l'eau le long des tuyaux (voir les schémas de la figure 5).
La conception de la grille du puisard constitue un autre facteur important.
La grille protège l'embouchure du puisard en empêchant l'entrée des débris
qui pourraient l'obstruer, ou même la chute de personnes et d'animaux. En
général, le puisard protubérant est recommandé car il augmente la surface de
filtration. Il serait bon d'indiquer l'emplacement du puisard au moyen d'un
poteau, surtout pour l'hiver.
Figure 6. Vue d'un puisard protubérant. La zone de filtration de
ce puisard est beaucoup plus grande que celle d'un puisard situé au niveau du
sol et réduit les risques d'obstruction.

Figure 7.Vue d'un puisard en pente situé au niveau du sol et monté
sur une base de béton. Remarquer l'enrochement autour de l'entrée. Les
risques d'obstruction de ce puisard sont plus élevés que dans le cas d'un
puisard protubérant.

1.
Intégrer
d'autres ouvrages pour la maîtrise de l'érosion en amont et en aval du
puisard en cas de mauvais fonctionnement de celui-ci. Il peut s'agir d'une
voie d'eau engazonnée, de terrasses, d'un cours d'eau bien aménagé ou de
l'utilisation de pratiques culturales de conservation.
23.1.1.6
Installation
Suivre les conseils suivants afin de construire des
ouvrages solides et stables.
2.
Engager
un entrepreneur qui possède de l'expérience dans la construction de ces
structures ou faire superviser les travaux par une personne qualifiée.
3.
Construire
en suivant un ordre logique. Bien souvent les puisards sont construits à
l'endroit approprié avant les autres ouvrages comme les voies d'eau
engazonnées.
4.
Prévoir
les affaissements de terrain ponctuels. Il est presque toujours indispensable
de retirer complètement les matières organiques du matériel de remplissage.
Élargir la tranchée dans laquelle se trouve le tuyau pour éviter qu'un vide
ne se crée sous la berme compactée. Relever les bermes afin de compenser le
tassement.
5.
Essayer
de terminer les travaux à un moment opportun de l'année, c'est-à-dire au
moment où les débits de pointe sont le moins probables et les conditions de
manutention du sol sont idéales. Par ailleurs, si on aménage une voie d'eau
engazonnée, choisir une période de l'année durant laquelle l'herbe pousse
rapidement. Ne jamais terminer les travaux pendant la période de gel ou dans
des conditions très humides.
23.1.1.7
Entretien
On doit examiner régulièrement tout ouvrage pour la
maîtrise de l'érosion afin de remédier aux points faibles et aux
effondrements éventuels. Voici les points importants à vérifier.
1.
Enlever
les débris obstruant les puisards. S'ils s'obstruent trop souvent, installer
un autre type de puisard.
2.
Surveiller
la formation de fissures sur la berme ou les assises du puisard. Si des
fissures se forment, les réparer immédiatement. Souvent, il sera nécessaire
de diminuer la pente de la berme pour empêcher les effondrements.
3.
Creuser
un passage dans la neige ou la glace juste avant que le débit de pointe
survienne.
L'inspection et l'entretien sont d'autant plus importants
au cours des deux premières années suivant l'installation des ouvrages parce
que la couverture végétale n'est pas complète et que le sol peut encore se
tasser.
23.1.1.8
Assistance technique
L'ingénieur agricole d'un bureau régional du ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut vous procurer
l'assistance technique dont vous avez besoin. Les bureaux régionaux de
l'Office de la protection de la nature et du ministère des Ressources
naturelles offrent des conseils techniques et un service de supervision de la
construction. On peut également engager un ingénieur-conseil pour concevoir
et superviser les travaux.
Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario et divers organismes
gouvernementaux peuvent fournir une aide financière. S'assurer que la
subvention est suffisante pour combler tous les besoins avant et pendant la
construction.
Nous remercions le Secrétariat d'État pour sa contribution
financière à la réalisation de la présente fiche technique.
|
pour plus de renseignements:
sans frais: 1 877 424-1300
local: (519) 826-4047
courriel: ag.info@omaf.gov.on.ca
Source / site (d‘où est extrait cet article) : http://www.gov.on.ca/OMAFRA/french/engineer/facts/90-097.htm
|
Motiver, en les associant à de grands partenaires
financiers, des constructeurs de bungalow, pour mettre en place dans les pays
concernés, des usines de fabrication de bungalows de faibles coûts simples,
fiables, solides, facile à réaliser, à livrer et à monter, cela rapidement.
Difficultés des routes dans certains pays :
Les routes indiennes sont souvent en mauvais état, bosselées, étroites. Il
reste parfois 5 cm seulement, séparant 2 bus se croisant (cela frotte parfois).
On ne peut par rouler vite (30 km). La circulation est anarchique (présence de
vaches sur la chaussée, de véhicules de front, à droite et à gauche, en face de
vous …).
Il faut en tenir compte, dans les coûts et délais de
livraison (et risque d’accident, quelle assurance choisir alors ?
Attention, il y n’a pas une gamme d’assurances aussi étendues en Inde qu’en
France).
La taille maximum au sol de la maisons totalement montées, à
livrer par la route, serait la taille moyenne au sol d’un bus indien.
Eventuellement, on pourrait accoler 2 bungalows de 35 m2,
déjà livrées, pour constituer une maison de 70 m2 (50 m2 habitable, plus 20 m2
de véranda).
Bungalows O’HARA (groupe Bénéteau)
O’Hara S.A, Parc d’Activité du Soleil Levant, BP 656, 85806
Givrand / St Gilles Croix de Vie Cedex
Tél : 02 51 26 20 28, Fax : 02 51 26 20 27, e-mail : information@ohara.fr site : http://www.ohara.fr
(Concessionnaire à
Orgeval : 01.39.75.37.49)
Modèle Mobil-home Ohara : Ophéa 734,
4 m x 7,3 m ~ 20300 €
Superficie 25 m2 plus terrasse 10 m2 avec ameublement,
emplacement 100 m2
-
Chambres séparées : une avec 1 lit double en 140, l'autre
avec 2 lits séparés pouvant se rapprocher, plus lit convertible en 140 dans le
séjour.
-
Cuisine équipée avec réfrigérateur, plaque 3 feux et
vaisselle.
-
Salle de bains avec douche chaude cabine de douche, lavabo
et WC,
-
Parking à côté du mobil-home,
-
Coffre à planches,
-
Chauffage au gaz.
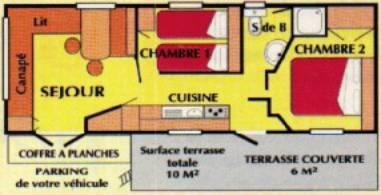
Modèle
O'Phéa 835 2S :
- Toiture 4 pentes à débordement
- 2 salles d'eau privatives : chambre parents (avec
toilettes) et chambre enfants
- Double porte d'entrée et baie fixe
- Couchages : 4/6 personnes (convertible type clic-clac
intégré)
- Cuisine : en longueur avec bar américain, réfrigérateur
table top, plaque cuisson 4 feux gaz, plan de travail, nombreux rangements...
- Coin repas séparé avec 2 chaises et banquette
- Salon : banquette en L avec table basse, claustra de
séparation
- Chambres : situées aux extrémités du modèle (literies 140
x 190 cm et 80 x 190 cm) avec salles d'eau privatives
- Larges ouvertures dans chambre parents



Ohara
indique que ces mobil-homes nécessitent un convoi exceptionnelle catégorie 4,
ne sont pas prévus pour résister aux cyclones et ne sont pas livrables en kit.
Par ailleurs le fret du mobil-home tout monté, vers l’Inde, double ou
doublerait le prix de la maison. Donc, nous abandonnerons cette piste.
Typiques des régions boisées du Grand Nord, les cabanes en
bois rond ou fuste se rencontrent dans toute la taïga, du Canada à
la Sibérie, souvent réalisées en pin polaire ou autre variété de pin, sapin,
mélèze, épicéa … (Le mot « fuste » désigne traditionnellement les
maisons faites de bois bruts ou fûts, empilés et entrecroisés aux angles). On
pourrait aussi les réaliser en madriers.
Le choix de ce type de construction en Asie, concernerait les
régions proches de grandes forêts. Construction alors facilitée par la présence
des éléphants domestiques.
(note : Nicolas Hulot a possédé une telle maison en
rondin, en lisière de la forêt de Rambouillet).
Choix et traitement du bois
Pour bâtir une cabane en bois rond, il faut choisir des
arbres bien droits et assez hauts pour que le diamètre soit identique d'un bout
à l'autre du tronc. Quand on abat les arbres, on les ébranche puis on écorce
rapidement le tronc avant que le bois sèche, par une plane ou une
vastringue. Il est nécessaire d'enlever l'écorce pour éviter que
les parasites s'installent entre l'écorce et la chair de l'arbre. La durée de
vie de la cabane en dépend.
Note : ces images, ci-après, sont diffusées sous
réserve de l’accord de M. Nicolas Vannier.
Note : pour l’Asie, il serait conseillé de traiter
les bois par produits, lasures antifongiques et
insecticides (certification européenne), contre termites, capricorne asiatique (anoplophora
glabripennis) …
De plus, quand on ne dispose pas d'un animal de trait ou d'un
engin motorisé pour le transport, les troncs écorcés glissent plus facilement
sur le sol.
Note : chez les constructeurs, le bois est souvent
d'abord stocké sous abris à l'air libre avant de séjourner en chambre de
séchage pendant plusieurs jours.
|
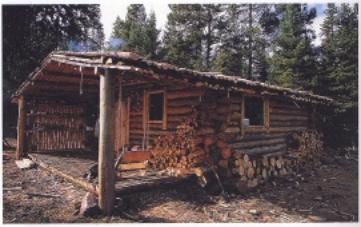
une
maison en rondin.
|
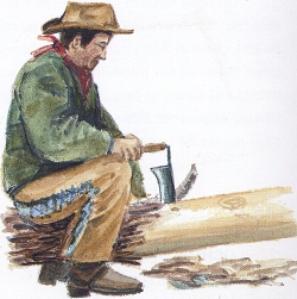
|
Les encoches, un travail fastidieux et long
Une fois la surface de la future cabane délimitée, on forme
un carré avec les premiers morceaux de bois. On creuse à In hache des encoches
pour qu'ils s'encastrent les uns dans les autres. S'ils ne sont pas bien
droits, il faut les raboter afin qu'ils s'ajustent le mieux possible. Cette
technique d'assemblage permet de monter solidement la char pente de la cabane
sans autre matériau que du bois, une hache, une scie , un rabot
, un double-mètre ou un décamètre roulant, voire un compas de
menuisier.
Mais s'il y a trop d'espace entre les troncs, le froid
risque malgré tout de pénétrer dans la cabane.

L’isolation
Autrefois, on utilisait de la mousse ou un mélange de lichen
et de terre pour boucher les interstices entre les morceaux de bois.
Aujourd'hui, la laine de verre a remplace ces matériaux. On peut utiliser
aussi, pour l’isolation, du lin (filasse de lin en bande, L 15 m x l 100 mm,
pour maison en rondin, ou pour isoler des tuyaux) ou de la laine de mouton.
Le sol peut être en terre battue, couverte de pierres plates,
d'ardoises ou de bois. Les fenêtres sont en verre à vitre (en Asie, on pourrait
les imaginer juste grillagées).
Le toit
Le toit des anciennes cabanes était d'écorce et de terre
argileuse, parfois avec du chaume dans les endroits ou poussaient des roseaux.
Aujourd'hui, la toile goudronnée et la tôle ondulée achetées au mètre
remplacent, le plus souvent, ces matériaux. L'isolation est très importante
pour empêcher la chaleur qui monte de s'échapper par le toit (en Islande, une
couche de bitume et une de terre couverte d’herbe servent d’isolant).
Le chauffage
Pour le chauffage, on peut imaginer une cheminée en pierre
(il y a à vaincre alors des réticences culturelles), un poêle à bois (en tôle,
en jante) ou un foyer en terre (courant en Inde) ou terre cuite.
Prévoir un logement à côté, pour les allumettes dans un sac
étanche, du petit bois et des bûches.
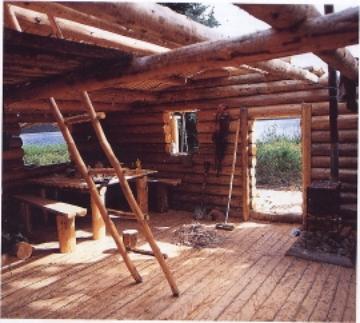

Mobilier en rondin et poêle à
droite Escalier en
rondin.
Le transport des troncs (ou grumes) :
Là où les grosses machines ne peuvent aller ou lorsqu’on ne
dispose pas de machine, on peut utiliser les éléphants et les chevaux, pour
transporter le bois (attention, que le tronc ne rattrape pas l’animal dans une
pente descendante).
Source :
« Robins du froid », Diane et Nicolas Vanier, La Martinière
Jeunesse, 1997.
Technique de Maisons Hestia inc. (http://www.hestia.net/francais/construction.html
) :
Les arbres, pin rouges ou blancs sont coupé en hiver et
écorsés au printemps. Le diamètre des billots varie de 14 à 17 pouces à la
base. Chaque billot est raboté pour la finition, est procédé ensuite à
l'encavure du billot (technique scandinave) sur toute sa longueur, à l'aide
d'une scie mécanique et d'un ciseau à bois, de manière à ce que l'arbre
s'ajuste parfaitement à la forme de celui qui le précède, ce qui évite l'emploi
d'un calfeutrant. Une fois les murs de billots assemblés, est effectué le
travail de finition: coupes finales des bouts, coupes et clés d'envoûtement
pour les portes et les fenêtres, trous pour passer et cacher les fils et les
boîtes électriques, sablage des noeuds et des bouts de billots et enfin
l'application d'une couche de teinture sur les murs extérieurs.
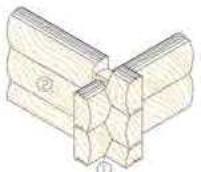
Autre type
d’emboîtement des madriers © Casa Dani.
Quelques adresses de constructeurs :
Groupe HONKA, PL31, 04401 JARVENPAA, FINLANDE
(Boutique Showroom, 160 rue de la Pompe 75016 PARIS).
http://www.honka.fr/default.htm
AESEA (maisons LAPRISE) : distributeurs de maisons
préfabriquées en bois au Canada.
http://maison.en.kit.aesea.free.fr
Créations PACIFIC :
Maison en rondin (Modèle « Le Franois »)
C/O Alain SCHWARTZ, 29 rue des Vinaigriers, 75010. Paris.
FRANCE
tél.: 00.33(0)1.42.05.64.01 fax. : 00.33.(0)1.42.05.66.02
http://www.pacific-maisonsbois.com mail : pacific@pacific-maisonsbois.com
© NATURE AQUA SUD - contact@buildingbois.com
32 vieux chemin de gairaut "Le chenier" - 06100
NICE - FRANCE
Tél: +33 (0)4.93.52.22.15 - Fax: +33 (0)4.92.09.23.11 -
SIRET 442 086 534 00017
Société RONDIN DES BOIS, 48300 ROCLES / NAUSSAC
Tel :04.66.69.50.46 / Fax :04.66.69.53.83
http://www.camping-rondin.com/acc_const.htm
ENSILLRESTUGAN (Constructeurs suédois de maisons en bois en
kit), Ensillre 2503, 841 92 ÅNGE, Suède, Tél/Fax: +46 690 120 20, GSM: +46 70
625 22 74 (et son représentant français TIRO e.u.r.l, Le Motté, 61210 Neuvy au
Holme, France, Tél: 02 33 39 05 22, GSM: 06 08 02 53 03, Fax: 02 33 39 04 93,
site: http://www.ensillrestugan.com/ Prévoir actuellement, 120 Euro HT/ M2, mini.
ARCHITECTEURS - 42, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS
- FRANCE
E-mail : info@architecteurs.fr - Téléphone : 33 (0)1 55 37 17 00 -
Télécopie : 33 (0)1 55 37 17 07
Bibliographie sur la construction des maisons en bois :
- LES 4
CAHIERS DE L'ART DE LA FUSTE
1-Découvrir : Découvrir la construction en bois brut, 03/04
2-Apprendre : Apprentissage et premières entailles, 04/03
3-Concevoir : Conception et plans (104 p., 20 euros) 09/01
4-Réaliser :
Maîtriser la technique pour faire une maison, 06/00
http://boisbrut.free.fr/artfuste.html#decouvrir
- Journal
du bois, n°61 Novembre- décembre 2000
Maisons, décors et intérieur, plan de maison, n°24 Novembre- Décembre 03 - Janvier 04
- Cabanon
à vivre, christian Lagrange, éditions Terre vivante (plans et des
techniques de construction sur les cabanes).
Chez : HM diffusion, BP 157, 38081 L'ISLE D'ABEAU
CEDEX, tél.:04.74.28.66.64.,fax: 04.74.28.66.64 :
- MAISONS
ÉCOLOGIQUES D'AUJOURD'HUI, De J-P Oliva, A. Bosse-Platière, C. Aubert
- Cabanons
à vivre de Christian La Grange
- Fraîcheur
sans clim de T. Salomon et C. Aubert, HM diffusion
- Habitat
écologique, quels matériaux choisir ? F. Kur, HM diffusion
- Les
clés de la maison écologique, Association Oïkos, HM diffusion
- L'isolation
écologique,J. Oliva, P. Rondin, Terre vivante, Eyrolles.
Pour mention : Dans les régions riches en
bambous géants, il est possible de fabriquer des maisons avec ce matériau
anti-sismique (des maisons sont totalement en bambou au Laos. Voir photo p.
24).
Il a un très bas coût (c’est la matériau du pauvre), est
facile à cultiver, à régénérer, avec une grande vitesse de croissance. Il a une
bonne association avec d’autres matériaux. Il a une grande résistance aux
efforts mécaniques. Il peut servir à fabriquer des tuyaux et canalisations, des
récipients de stockage d’eau, des meubles, des charpentes,
des cloisons, des échafaudages, de la pâte à papier (80 % de la production indienne), des haies
brise-vent, à entraver les inondations, des flûtes …
En Asie, la variété « Phyllostachys bambusoides P.
Mazelli » est très utilisé pour son bois doté d’excellentes qualités de
résistance et d’élasticité. Mais celle-ci n’a atteint des hauteurs importantes
que dans de bonne conditions de climat, de sol et de soins culturaux.
On pourrait construire les murs, avec plusieurs couches de
bambous entrecroisées (en trame), plusieurs couches de troncs entrelacés (pour
renforcer leur résistance au vent) (maison sur pilotis ?).
Analyser si la forme rectangulaire est la plus adaptée
(pourquoi pas en carène de navire inversé, comme les cases des indiens
amazoniens Yanomami ?). Ces maisons sont faciles à monter et les habitants
locaux peuvent les réaliser sans aide extérieure. Elle ont un bilan écologique
positif.
Une suggestion : Un kit de genre de maisons
préfabriquées en bambous, pourrait être produit, de façon industrielle en Inde
ou Chine. Essayer d’étudier comme les faire résister aux cyclones. Pour
renforcer ces maisons, par exemple, a) solidariser les bambous entre eux par du
fil de fer _ en tirant fermement des anneaux de fils de fer, autour des tubes
de bambous (avec douceurs) avec une pince.
b) voire, tirer des câbles d’acier ou de nylon autour de la
maison, avec précaution.
Si choix d’un toit en palme, ce dernier est facile à
réaliser mais doit être renouvelé tous les 5 / 10 ans (risque : il peut être un nid d’insectes parasites. Il est
fragile face aux tempêtes).
Source : • Grow
your own house de Simon VELEZ et Bambus – Bamboos de Klaus DUNKELERG
• Bamboo in building structure, J.J.A Janssen., Wibro,
Eindhoven 1981
• Maison prototype en bambou en Equateur, coût ~5000$ :
http://www.inbar.int/housing/Guyaquil.htm
Mail : bambou@bambouseraie.fr
, site: http://www.bambouseraie.fr/

Exemple
d’une reproduction de maison laotienne en bambou
à la bambouseraie
d’Anduze (France). © bambouseraie (La).
On pourrait imaginer une maison en kit, constituées de
caissons (ou réservoirs) creux d’aluminium anodisé et peint (caissons
solidarisés entre eux), caissons ensuite rempli de sable sec, ou au contraire
d’eau alcaline (par un peu de soude, pour éviter la corrosion), gélifié pour
empêché les fuites, par ajout d’une poudre de polymère acrylique (telle que le
régulateur hydrique « Cygne d’eau »). Ce concept, inspiré par les
« Algeco » et les caravanes, est encore inconnu.
L’aluminium est cher en Inde (1200 $ / tonne).
Les maisons de Jean Prouvés _ inventeur du mur-rideau,
spécialiste de la tôle pliée … _ sont caractérisées par leur modularité, leur
légèreté. Elles sont facilement démontables.

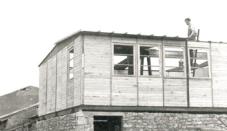
Pavillons démontables pour
les sinistrés de Lorraine, 1945 (Arch. Jean Prouvé).


La maison des jours
meilleurs, Paris, pour l’Abbé Pierre (Arch. Jean Prouvé). Portique métallique J. Prouvé.


Maison Prouvé, Nancy, 1954 (Arch.
J.Prouvé).

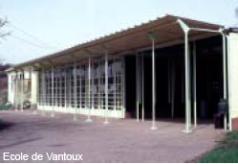
Structure de l’école expérimentale de Vantoux, de J. Prouvé
(Moselle).
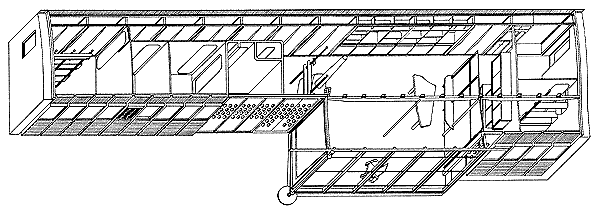
Perspective de la maison Prouvé, Nancy, 1954 (Arch. J.Prouvé).
C'est en expérimentant la flexion
naturelle des panneau « multiplis » (basés sur le principe du collage
de lamelles en bois massif et du croisement des couches) que J.Prouvé va
réaliser la toiture légèrement courbée de sa propre maison à Nancy en 1954. J.
Prouvé va aussi utiliser sa rigidité pour faire des cloisons et des portes sans
huisserie. Les murs des locaux techniques (salle de bain, cuisine …) sont
ajourés et éclairés par des hublots en verre.
En 1958, il conçoit une maison
saharienne légère, avec l'architecte Charlotte Perriand.
Il met au point des systèmes de
façades légères dont l'élément déterminant est le « profil
raidisseur ».
Source / Bibliographie :
> Association des amis de Jean Prouvé, 105, rue Leblanc
75015 Paris
> Les Amis de Jean Prouvé, Mme Coley, 29 rue du Haut-Bourgeois
54000 Nancy, tél.: 03 83 37 14 67
> http://www.jean-prouve.net/ (pour l’instant ce site ne fonctionne plus).
> http://claude.fourcaulx.free.fr/mon_hist/Jean%20PROUVE/Jean%20PROUVE.htm
> sur
les panneaux « Multiplis » : Source : http://www.crit.archi.fr/~bois/Bois/4.Usages/Page8.html
> Film : Maison des jours meilleurs (La).
(architecture & design). 1956,5', noir et blanc, documentaire Réalisation :
Michel Zemer. Production : films du Rond Point
> "Architectures sur Arte". La Maison de
Jean Prouvé [à Nancy], documentaire de la série
http://www.arte-tv.com/fr/connaissance-decouverte/architectures-nancy/Jean_20Prouv_C3_A9/779342.html
La conception de Domobile se développe à partir d'un cube de
base de 2.5m de côté. L'addition de cubes identiques dans les deux directions
du plan horizontal (voir même en hauteur) permet la génération de multiples
surfaces habitables.
Chaque face du cube est délimitée par des barres de
dimension est unique de 2.5m. Selon le programme spécifique, cette structure
est renforcée par des barres additionnelles qui peuvent être placées tous les
0.25 m.
Le montage Domobile est très rapide, en quelques semaines,
par une personne seule, pour une maison.
La face supérieure du cube sert de toiture terrasse
accessible qui accueille des capteurs solaires, recueille les eaux de pluie et
permet aussi bien la culture de végétaux que l'étendage du linge.
Domobile consiste à utiliser uniquement des matériaux
recyclables pour son ossature
et ses parois (métaux et verre) et renouvelables pour les
revêtements intérieurs.
Pour les revêtements intérieurs, Domobile n'utilise que des
matériaux abondants dans la nature (pierres nobles) ou renouvelables (bois,
textiles organiques), exempts de liants synthétiques.
Les essences locales et les bois de récupération sont
privilégiés.
Tous les éléments structurels, ainsi que toutes les parois,
sont assemblées par boulonnage, garantissant leur déconstruction pour de
futures réutilisations.
Comme tous les composants de Domobile sont assemblés et
joints « à sec » sans soudures, rivets, colle, ni mastic; ils sont tous
démontables et interchangeables. Les dimensions du bâtiment ainsi que son
organisation intérieure peut être modifié avec quelques outils à tout moment, y
compris par les habitants, au gré de l'évolution de leurs besoins et de leurs
goûts. L'isolation, la translucidité et l’aspect des façades vitrées peuvent
être modifiés en y coulants temporairement des matériaux en vrac. Les cloisons,
plafonds et planchers sont amovibles.
Les
équipements spécifiques tels que salle de bain, douche, cuisine, penderie,
garde manger, débarras, bibliothèque, etc. se présentent sous la forme de blocs
équipés, indépendants et déplaçables. Chaque élément
peut être porté par un homme seul et transporté par voiture.
- Possibilité de vitrer les façades à 100% pour bénéficier
des gains solaires et de la lumière naturelles tout en prévenant les
surchauffes et l’éblouissement. Utilisation de fenêtre à doubles ou triples
vitrages, pourvues de verres à basse emissivité pour les baies et verrières
- Utilisation de matériaux d'isolation naturelle en forte
épaisseur, tel que diverses fibres ligneuses, de liège en vrac, de laines de
moutons et feutres de coton ou de lin. Sont proscrits les isolants présentant
le moindre risque pour la santé et l'environnement, tels que mousses
synthétiques, fibres minérales, solvants, colles, etc.


Montage
d’une maison © Domobile. Aménagement du toit du © Domobile.


Façade
d’une maison © Domobile.
Concepteur : François Iselin, architecte, Epalinges,
Suisse, e-mail : francois.iselin@epfl.ch,
Site : http://www.domobile.ch/
Texte
en construction (voir ci-après) 
Nous allons maintenant imaginer la reconstruction des
maisons pour les victimes du tsunami, en maisons préfabriqués, à
monter (par une ou 2 personnes seules), avec une ou des solution(s)
modulaire(s) cette fois-ci, en bois.
Nous les imaginons comme un jeu de
construction simple, utilisant si possible des matériaux locaux ou faciles à
trouver sur place. L’avantage du matériau bois est
qu’il est plus léger et plus facile à transporter, en particulier par camion
(que le béton).
A) il faut tenir compte, au niveau des contraintes concernant les normes,
règles de construction de ces maisons en bois, pour la reconstruction des
victimes du tsunami en Asie du Sud :
a) du climat chaud et
humide, surtout en période de mousson dans ces région (pouvant
gondoler le bois, créer des tâches et auréole de moisissures inesthétiques,
voire pourrir le bois, risque de champignons _ mérules … _ qu’on trouve aussi
dans ces régions chaudes … )
=> solution : d'où des solutions
avec vernis étanches (hydrofuges, qui peut être anti-salissure en même
temps. Voir vernis marins, magasins de bricolage),
(voir sur
les sites suivants, pour ce genre de produit :
http://www.peinturesjulien.fr/webapp/wcs/stores/JULFR/ICIPaints/servlet/JulTNCategoryView?storeId=10602&catalogId=1000&langId=-2
www.peintures-julien.info/vernis/vernis-marin.html
http://www.barpimo.es/frances/dbpmade.htm
http://www.blanchon.com/blanchon/mcpa/prodmcpa/vermarin.htm
http://www.diamantine.fr/diam_vernis_marin.htm etc.
...
Note : Ce genres de produits
existent dans tous les pays).
b) des parasites et
xylophages,
=> Solution : bois traités antiparasites (une/des lasure(s),
fongicides ...).
Note: un des fongicides les moins chers
est « la bouillie bordelaise », une solution de sulfate de cuivre
additionné de chaux, que l'on dose généralement de 10g/l et 20 g/l.
Les panneaux trempés et traités ainsi prendront alors une couleur bleu-vert
(mais ce n'est pas
inesthétique). Mais la solution est encore à tester.
Note 2 : On pourrais imaginer que les panneaux
trempent plusieurs semaines dans une solutions de bouillie bordelaise, d’alun
et d’autres sels ignifuges (++).
On pourrait aussi les tremper dans des bains de colorants
pour rendre les panneaux colorés.
Afin de réaliser des maisons des différentes coulerus.


c) de la résistance au
feux, ignifugation (+) (selon les normes AFNOR et européennes, locales
...) par :
Solutions à base de :
=>
lamellés multi-couches, intercalant des couches isolantes anti-feux (++).
=>
mortier coupe-feu...
=> flocage
et traitement anti-feu ...
=>
imprégnation d'un produit retardant le feux
_ solutions d'alun, ... Voir toute la liste de ces produits listés
par BATIWEB en bas de ce mail et encore (*) etc ...
(+) L'ignifugation
consiste à protéger, diminuer, contrôler ou retarder la combustion des
matériaux inflammables.
(++) couches isolantes anti-feux à base de :
a) couche en laine de verre,
b)
couche en satin de verre enduit double face de polyuréthane ,
( c)
solution ancienne de couche d'argile (?) ... à tester ).
etc ...
La plupart
des traitements ignifuges du bois, se font en autoclave (c'est donc un traitement cher
!).
Les
entreprises impliquées dans les recherches sur l'ignifugation sont :
QUIMUNSA,
MAGMA INTERNATIONAL, SPW et PREVENTOR,
dont la
production est orientée vers des matériaux résistants au feu :
TUKOEX ,
INGARP, SKUTSKÄRS TRÄ et IMPREGNUM,
qui se
consacrent au traitement du bois par autoclave.
http://www.netbois.com/info/info.php?artc=2196
c2) Il faut
aussi que les portes voire les fenêtres soient coupe-feu (en tout cas
retarde le feu. Vitres & volets fondants, brûlants, cassants (explosants) le plus tard
possible).
Les gaines
électriques doivent être remplis de produits intumescents
(voir : www.bicsi.org/Content/Files/PDF/CF-3IM05.pdf
).
c3) Il faut
que les endroits, il y a du feu : la cuisine, la cheminée, le four
traditionnel indien (le "tandoor") soient isolés par des
matériaux isolants _ béton, briques, ciments, mortiers, terre
cuite ... _
de la partie bois de la maison [1].




(exemple de
"tandoors").
Il est
important de prévoir le coin du feu / du foyer (quel type de
foyer ? quelle type de
cheminée _
en acier, en brique type tuiles, en céramique ... ?
la place
pour stocker le combustible _ crottin, bouses de vache, bois coupé,
ramassé ...).
(Voir, à ce
sujet, le document [1] en fin de ce mail).



Exemple de foyers indiens
Sinon, il
existe pas mal de solution d'ONG, proposant différents type de foyers (y
compris les cuiseurs solaires _ attention, ces derniers ne sont pas
toujours opérationnels tout le temps), évitant le gaspillage du bois du feux (par contre, il y a
une étude à faire au sujet de la résistance normale des mentalités face aux innovations) :
a) DIA'SSO (www.diasso.org )
b) BOLIVIA INTI (http://boliviainti.free.fr/ ou
http://www.boliviainti.org/) (+)
c) GERES
-
Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarité, 2 cours
Foch, 13400 Aubagne France, Tel: 33/0 4 42 18 55 88,
Fax: 33/0 4 42 03 01 56, e-mail : geres@free.fr , site : http://geres.free.fr/ .
Le GERES s'occupe d'énergie solaire dans les pays en voie de
développement.
d) Un certain nombre de ces foyers améliorés sont présentés
sur le site de WeNet Cambodge : http://www.wenetcam.net/french/improvedcookstoves.php
 (source photo
WeNet Cambodge).
(source photo
WeNet Cambodge).
(e) EDIF - Énergies Durables en Île-de-France,
Espace Info Énergie 10ème /18ème /19ème arrondissement de Paris, 17 rue curial 75019
Paris, tél..: 01 42 09 66 75, www.edif.asso.fr ).
c4) On pourrait imaginer isoler les plaques /
modules en bois du préfabriqués, par des plaques de tôles, placées en sandwich
entre les panneaux de bois du module. Mais alors il faut protéger ces plaques
de tôles contre la corrosion (pour au moins 50 ans).
c5) Des tests anti-feux de vos matériaux, idées,
solutions peuvent être réalisés par des sociétés comme : CREPIM (http://www.crepim.fr/ ).
B) Mais il
faut aussi tenir compte de la salinité du lieu (c’est à dire des
attaques salines, en bord de mer) :
Si vous
utilisez vos éléments de solidarisation (type plaques de métal) entre vos
panneaux (en bois ...), il faut les rendre résistante pour au moins 50 ans aux attaques
salines (même l'aluminium peut se piquer et être attaqué par l'air salin). Il faut
que ces éléments soient anti-corrosion, anti-condensation ...
Solutions
concernant les problèmes de salinité pour les poutres / poutrelles en acier :
=>
l'idéal c'est l'inox (mais cher),
Il reste
encore la solution des éléments de « solidarisation » en :
a)
plastique très solide (mais attention au feu),
b) certains
aluminium traités, anodisés (un peu moins cher, mais cher pour ces pays),
c) certains
aciers, couverts de protection anti-rouilles (type minium mais en mieux),
voire recouvert d'un film plastique isolant indéchirable :
Solution :
=> acier
galvanisé (par une trempe dans un bain de zinc en fusion) puis laqué
de polyester ou polyéthylène anti-UV (par un bain dans du polyéthylène ou de
colle à chaud en fusion) ... (ce type d’acier existe. Il est encore appelé
"acier zingué anti-corrosion revêtement polyester". Par exemple
pour les mâts de tentes ... (Voir aussi : http://www.atoca.com/indexAtoca/Acier_galvanise.html
et voir certaines chaises de jardin de CASTORAMA traité ainsi www.castorama.fr/ ).
Solutions
concernant les problèmes de résistance aux parasites, au feu,
d’inprutrescibilité des panneaux/plaques de bois :
=> Les
panneaux de bois (ou en bio-matériaux, voir plus loin) seraient trempées
pendant une semaine dans des bacs remplis une solution saturée de calcaire
broyée et de chaux grise. Puis les panneaux seraient séchés au soleil. Et il
faudrait aussi éventuellement, que quand ces derniers soient secs, qu’ils
soient recouvert d’une lasure ou vernis ignifuge (par ex.
« silicifiante ») et anti-parasitaire.
Sinon,
on peut imaginer l'agencement, la forme des panneaux/éléments/modules,
et des éléments de
« solidarisation » des panneaux entre eux (tubes en acier ou poutres
en bois ...), comme
sur le schéma et dessin ci-dessous. Ce ne sont que des propositions (voire
cette figure, deux page plus loin).
Si les éléments de solidarisation étaient des tubes en
aciers _ à section carré ou éventuellement à section en U, leur section étant
égale à l’épaisseur des panneaux en bois, de 1à ou 15 cm de côté, tubes de 5 à
10 m de long, galvanisés et recouverts d’une protection plastique _, voici alors comment on les agencerait et
solidariserait entre eux, pour constituer l’ossature de ces maisons :



Ces structures sont visibles sur des immeubles d’habitation
à la Cité des Sciences de la Villette.


Certains tubes se termineraient par des bouts cylindriques,
pour s’enficher dans des trous circulaires pratiqués dans l’extrémité d’autres
tubes. Les gros poutres à section carrée, formerait l’ossature de la maison,
tandis que des croisillons de poutres plus fines s’enfichant dans les premières
servirait à construire l’armature du plancher et du toit. Armatures sur
lesquels reposeraient des planches Multiplat étanches et résistantes aux
éléments, servant de toit ou de plancher.
|

Les maisons modulaires pourraient
s’inspirer pour
leur design de cette salle de sport construite en région parisienne.
|
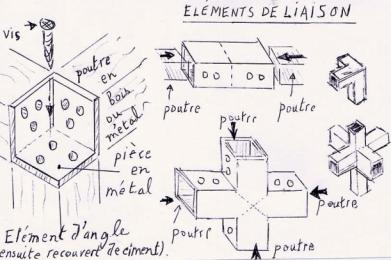
Différents
éléments de liaisons entre les poutres
|
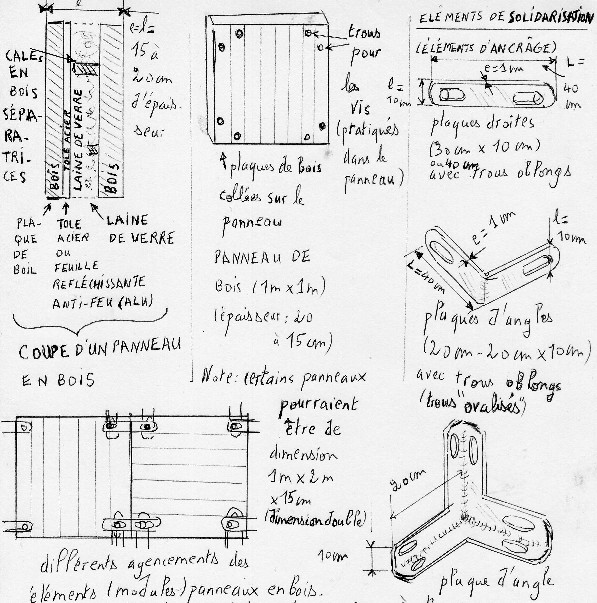
Les
éléments de « solidarisation » en acier, sont reliés par des boulons
et des écrous de fixations galvanisés très solides (d’une taille d’au moins la
taille d’un tire-fond de traverse de chemin de fer).
Lorsque les boulons et écrous sont vissés sur les éléments /
panneaux en bois, peut-être :
a)
seraient-ils noyés ou badigeonnés de bitumes pour qu’ils ne
rouillent pas
b)
puis ils seraient recouverts d’un capuchon hémisphérique en
plastique, afin éviter que les enfants se cognent dessus et se blessent.
Il faut que tous les éléments aient aucun angles tranchant
et blessant. Tout les éléments seront chanfreinés.
Les joints entre les panneaux (contre l’humidité) pourraient
être assurés par de l’argile ( ?).
Pour l’instant, nous n’avons pas encore
étudier les éléments porteurs. Peut-être une structure métallique légère comme
pour les maisons Domobile de l’architecte suisse François Iselin (des
structures porteuses peut-être en poutrelles d’acier ( ?)). Voir ses
maisons ci-avant dans le document.
Dossier
en construction, non terminé, concernant ces solutions d’habitations modulaires
en bois 
Voici le concept de
cette solution bois et métal :
=> une maison
constitué d'un treillage (réseau/maillage) de fines poutrelles en T (pour le
plancher, le plafond, les mur, avec quelques poutrelles porteuses en H _ IPN_
ou T).
Ce "treillage"
de poutrelles métallique étant ensuite comblé par des panneaux d'aggloméré
(ou/et de panneaux de particules) _ chaque panneau de bois (ou d'aggloméré)
étant recouvert ensuite de contreplaqué (ou de la laminé), puis de petite latte
de bois ou de bardeau de bois, juste pour l'esthétique (entre certaines
couches, il y a des couches multicouches isolantes ignifuges et thermiques).
Avec au centre de cette
maison, un bloc sanitaire et cuisine en béton préfabriqué (pour minimiser
l'utilisation du béton dans la maison).
Tout le concept de cette
n° maison étant basée sur l'idée d'un jeu de construction, ne se montant
qu'avec des vis et des boulots (et des clés anglaises et à cliquets), et avec
de la pâte « étanchéifiante », pour fermer/colmater les interstices
entre les poutrelles métallique portant/supportant les panneaux de bois, et ces
derniers panneaux de bois. (cette pâte « étanchéifiante », étant soit
en tube, comme pour le mastic silicone, ou comme des bandes Rubson).
Cette maison aurait un
système très simple d'attaches ou de fixations des panneaux sur les poutrelles
(une solution étant de percer les poutrelles de trous, pour faire passer les
vis).
Les poutrelles
pourraient être métalliques ou en bois très solide (par exemple en bois
stratifié).
Les poutrelles
métalliques seraient galvanisées (cad trempées d’abord dans un bain de zinc
fondu, après avoir été brossées, après la sortie du laminoir, pour éviter tout
point de rouille, puis après avoir été refroidie passée dans un bain de colle
plastique à chaud _ colle pouvant être colorée en une couleur esthétique _,
afin de résister aux agressions du sel marin).
Par ce système, on
pourrait construire toute forme possible de maisons y compris sur pilotis (des
pêcheurs du Sri Lanka, en possède l’espace sous la maison, servant de remise à
leurs instruments de pêche, comme les filets etc. …).
Pour monter la maison,
il y aurait des poutrelles métalliques IPN, plantées verticalement dans du
béton coulé dans des pneus (servant de cylindre-blocs contre le séisme), tout
autour du rectangle de la base de la maison. Les plaques de bois carrées seront
glissées dans les rainures des poutrelles verticales IPN (et s’adaptant
rigourement aux dimensions de la rainure). Pour l’angle (le coin) de la maison,
2 poutrelles IPN, au lieu d’une, seront plantées verticalement à angle droit.
Les poutrelles verticales seront solidarisées entre elle par
une poutre verticale en bas, en T (limite base de la maison), et une poutrelle
horizontale en haut, en T (limite haut de la maison), toutes les duex, tournées
vers l’intérieur, vissées entre elles (chaque poutrelles comportant des trous
et orifices pour faire passer les vis permettant de relier et solidariser les
poutres verticales et horizontales entre elles).
Pour vérifier la verticalité ou l’horizontalité des poutres,
on aura des fils à plombs, des niveaux à bulles et de grandes équerres
métalliques. On fera en sorte que les poutrelles ne soient pas
« griffées », rayées, pendant la construction, afin d’éviter toute
corrosion future de celles-ci.
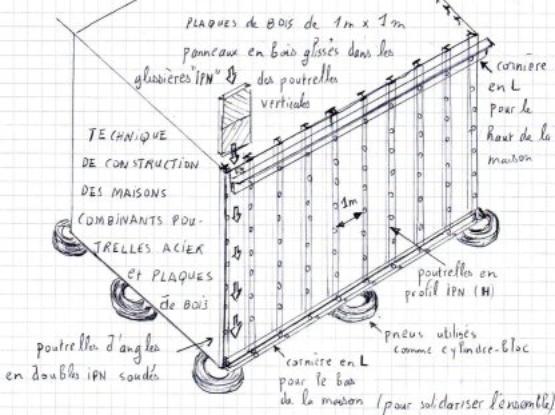
Plan de montage des poutrelles formant
l’armature de la maison

(plan
en construction).
Triple-fenêtre, intégrant des fenêtres secondaires en
poupées gigognes dans la fenêtre.
Elle
serait sur le modèle de certaines double-fenêtres monobloc). La fenêtre
principales étant fermée, par une crémone. Et les fenêtres secondaires (en
poupée gigogne / incluses dans la fenêtre principales) fermées par
des targuettes ou des loqueteaux. Pour les loquets, targuettes ou loqueteaux, voir par exemple sur le
site http://www.quincaillerie-ancienne.fr/forge_main.htm
(La
fenêtre principale bien entendue posée sur des gonds à sceller _ ces
derniers eux-même fichés/scellés dans le mur). Voir dessin ci-joint.
Inconvénient
: fenêtre complexe à réaliser
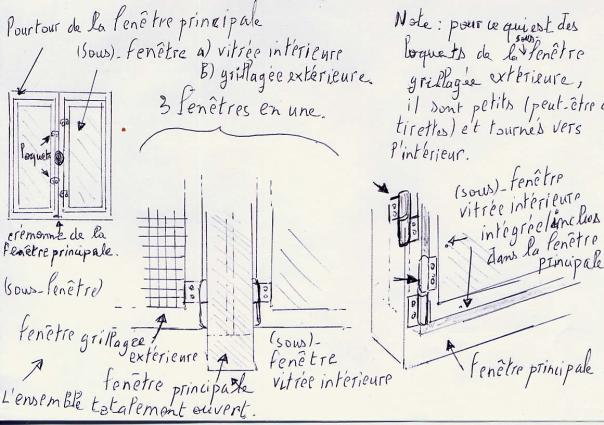
(++)
ignifugation par :
a) couches
textiles en :
1) Satin de verre enduit double face de polyuréthane ignifugé,
2) Couvertures incombustible en fibre de verre,
b) imprégnation du bois par :
1) solutions d'alun,
2) Produits d'ignifugation : composés. halogénés tels que chlorure de
zinc, bromure (plus utilisés pour les textiles) :
source : http://www.google.fr/search?hl=fr&q=ignifugation&meta=
c) Exemples
de vernis d'ignifugation :
Ø Pyroplast HW présenté par RUSTIFRANCE
Ø Vernis PU
Rustiflam présenté par RUSTIFRANCE
Ø MONOFLAM
91709 présenté par MONOPOL
Ø Texguard
présenté par GUARD
INDUSTRIE
Ø Pyroplast
Steel D présenté par RUSTIFRANCE
Produits
de protection incendie, ignifugation (s) :
Ø Medium ignifuge présenté par ISOROY panneau de fibres de moyenne densité
protection incendie, ignifugation plaque, panneau de fibre de bois, fribagglo
Ø Cloison
coupe feu présenté par SOCAB
cloison et séparatif, protection incendie, ignifugation
plaque, panneau de particules traitées contre le feu
Ø Bentley
Harris présenté par FEDERAL
MOGUL , protection électrique, protection
incendie, ignifugation
Ø DOW
CORNING FRANCE présenté par DOW
CORNING FRANCE , Etanchéité
- toiture, façade, locaux humides, Protection, sécurité incendie - alarme,
verrou, contrôle d'accès, Matériau de base - sable, adjuvant, tôle, tube,
brique, parpaing, ciment, plâtre, béton
Ø Ruban
coupe-feu adhésif présenté par PROSYTEC
TREMCO , protection incendie, ignifugation
géosynthétique, produit semi-tissé, non-tissé, bande, fond de joint, calicot
pour revêtement mural
Ø AISM
présenté par AFIMES
, protection
incendie, ignifugation
Ø Pyroplast
HW présenté par RUSTIFRANCE
, peinture
ou vernis d'ignifugation, protection incendie, ignifugation
Ø Impralit
F3/66 présenté par RUSTIFRANCE
, protection incendie, ignifugation
Ø Alumawood présenté
par EURAMAX
INDUSTRIE , panneau
isolant en composite à parements bois
volet battant, volet aluminium, protection incendie, ignifugation
Ø Isol
Ouate Xylobell présenté par LABO
XYLOBELL , procédé d' isolation thermique,
procédé d' isolation acoustique, protection incendie, ignifugation
Ø AIP
présenté par AFIMES
, protection
incendie, ignifugation
Ø Vernis PU
Rustiflam présenté par RUSTIFRANCE
, peinture
ou vernis d'ignifugation
protection du bois, protection incendie, ignifugation
Ø EUROTEXTIL
Sécurit (Procès verbal) présenté par ALFA
FLOR , protection
incendie, ignifugation
Ø EUROFLOR
Sécurit (Procès verbal) présenté par ALFA
FLOR , protection
incendie, ignifugation
Ø Incendie
présenté par MONOPOL
, protection
incendie, protection incendie, ignifugation
Ø Pyroplast
Steel D présenté par RUSTIFRANCE
, peinture
ou vernis d'ignifugation
protection incendie, ignifugation
Ø Securité
physique HAFFNER présenté par RITZENTHALER
, porte
anti-effraction, blindée
coffre-fort, chambre forte, protection incendie, ignifugation
Ø
Firemaster
présenté par PROSYTEC
TREMCO , protection incendie, ignifugation
géosynthétique, produit semi-tissé, non-tissé
Ø EUROSAPIN
Sécurit (Procès verbal) présenté par ALFA
FLOR , protection
incendie, ignifugation
Sources
sur les produits et entreprises d'ignifugation :
1) http://www.produits.batiweb.com/search/liste_marque_rub.asp?niv=1726&nb=21
2) http://www.sageret.fr/html/liste_articles.php?listeSF=1
Bibliographie :
[1] Collaboration
Etat-ONG à la gestion des ressources rurales: programme indien de fourneaux de
cuisine améliorés
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/u7760f/u7760f05.htm
(*) TYPE DE PRODUITS INGNIFUGES
(plutôt pour les textiles) :
Absorption
de la chaleur et refroidissement des gaz dégagés en dessous de leur température
d’inflammation.
>Produits d’ignifugation de ce type : sels cristallisés, composés
phosphorés, bromés ou chlorés…
Enrobage
des fibres par une mousse, un film ou une croûte charbonneuse incombustible ce
qui isole le textile du feu et bloque la diffusion des gaz combustibles.
>Produits d'ignifugation de ce type:borates (borax, acide borique,...),
silicate ou carbonate de sodium, sulfates et phosphates, composés phosphorés et
halogénés (chlorés et bromés), …
Étouffement
de la flamme par des gaz inertes (ininflammables) ou des fumées “lourdes” qui
diminuent la concentration des gaz combustibles (inflammables) provenant de la
fibre.
>Produits d'ignifugation de ce type : composés azotés sous forme de sels
(sulfate, sulfamate, ...) d'ammonium, borates, complexes chlorés, urée, sels
d'antimoine, …
Destruction
des substances susceptibles d'entretenir la combustion, sur polyester
notamment, ou inhibition de l'oxydation.
>Produits d'ignifugation de ce type : composés halogénés tels que chlorure
de zinc, bromure d'aluminium, ..., composés phosphorés, …
Source : http://www.gtfi.org/doctech/ignifugation_du_%20textile.pdf
Syflex est un
coffrage flexible qui permet de réaliser simplement des rectilignes, des arcs
ou des angles directement sur le chantier.
Il est particulièrement performant pour le coffrage de chapes, de
bordures de terrassement et de marches. Syflex est un
coffrage original en polyéthylène (très
léger).
Il se présente sous la forme de profils de hauteurs 10,
15, 20, 25 et 30 cm qui sont livrés en par longueurs de 5m.
Les joints finaux
permettent la connexion des profils et l’extension infinie du coffrage. Le
système de fixation excentré est utilisé pour connecter solidement les profils
dans la hauteur et pour ancrer le coffrage dans le
sol.
|

Syflex le Profilé
|

Syflex joint de
connexion
|

Syflex système
excentré
|
|


Syflex barres de
soutien
|

Syflex mise en
place du système excentré
|
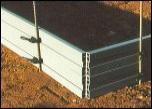

Syflex montage
d'angle
|
|

Syflex point de
tension
|

Syflex jonction de
coffrage
|

Fondations maison
avec Syflex
|
Source : http://www.btponet.com.tn/html/nouveautes/btinnovation/syflex.html
Note : A comparer avec le système du coffrage en
polystyrène expansé CLX Conception au chapitre suivant. Si ce système
pouvait être peu coûteux pour l’Inde, il pourrait être intéressant là-bas.
Monsieur
Michel ROSELL, architecte et urbaniste (ancien professeur d’architecture)
propose le concept d’une maison para sismique, en matériaux de récupération à
faible coût (dont il déjà réalisé plusieurs prototypes et réalisations).
Concept des
maisons à bas coûts de M. Michel ROSELL :
1) murs pas
éloignés, de plus de 4 m, entre eux (pour des raisons parasismiques).
2) surface de 100 m2 au sol (11 m x 11 m).
3) une ossature bois, rempli de matériaux de récupération (en bois de
palettes, en déchets de parquets et de toutes sortes, pour les murs, qu'on
remplit ensuite de toutes sortes de déchets : déchets,fane de tournesol, de
maïs, bagasse de canne à sucre, papiers, cartons, paille compressée, fougère,
de chanvre, pierres …).
4) une salle à manger polyvalente (pouvant servir de salon,
salle de réunion ...), une cuisine, 4 chambres, un WC écologique, une salle de
bain reliés à un système de bacs de phyto-épuration par des plantes (situé à
l’extérieur de la maison), un patio central avec jardin intérieur, avec un
accès sur la terrasse (ou une toiture prairie) où se trouvent 4 "ogives de
survie" (voir au chapitre 12), des citernes de stockage d’eau (sous le
patio) avec un système de potabilisation (par un filtre de 1 m³ de sable, un
filtre de 1 m³ de charbon de bois et un filtre avec un lit d’argile).
5) Autour de cette maison, des petites serres obliques de
2x3m (sauf devant les portes et les fenêtres) dans lesquelles seront placés: le
jardin potager fleuri, une phyto-épuration pour le traitement de l’eau, une
culture de spiruline familiale de 5m², un séchoir et une cuisinière solaire.
6) dalle de la maison posée (éventuellement) sur 800 pneus
usagés (ou un lit de sable sec, mais pas des remblais, pour des raisons parasismiques) et
utilisation (éventuellement) de déchets ménagers triés de 10 maisons
pendant 1 an pour réaliser les fondations de la maison.
7) utilisation, pour monter les murs, de palettes placées
dos à dos que l’on remplit de bio matériaux que l’on pose verticalement et que
l’on enduit à la truelle, ou de chevrons de bois remplis de
"bio-matériaux" ou de torchis "coupe feu" (1 seau de chaux,
2 seaux de sable, 4 seaux de paille + 2 seaux d’eau). Le bois et les
bio-matériaux étant traités à la chaux grise, pour éviter les parasites.
8) La
toiture prairie est constituée de plusieurs couches. Plusieurs choix pour le
plafond: lattes de bois, canisses, plâtre ou soliveaux apparents, au dessus un
plancher constitué soit de bouscasses de Ø 5 soit de planche de coffrage etc.
Au dessus du bidim, des couvertures de laine de mouton, dessus une bâche
épaisse (style des camions) et dessus 5cm de terre et 5cm d’humus.
9) Autour
du patio une gouttière pour récupérer l’eau de pluie.
10) un
système de phytoépuration composée de bacs de 20cm de gravier de 1m x 2m ici
21m², remplies de plantes locales _ jacinthe d’eau, papyrus etc … _, qui
épureront l’eau.
Les questions
cruciales à analyser restent la solidité face aux cyclones, vagues des
tsunamis, tremblement de terre et la durabilité des écomatériaux (on sait par
exemple que les matériaux crus résistent très mal à l’eau et à l’affouillement
par les vagues. On sait que les maisons les plus solides face aux cyclones
restent, pour l’instant, les maisons en murs porteurs en bétons, en briques ou
en acier (style « Algéco »).
M. Michel
ROSELL estime le coût de cette maison en matériaux de récupération, en
France, à 12000 Euros.
Plans
proposés pour cette maison (voir ci-dessous) :
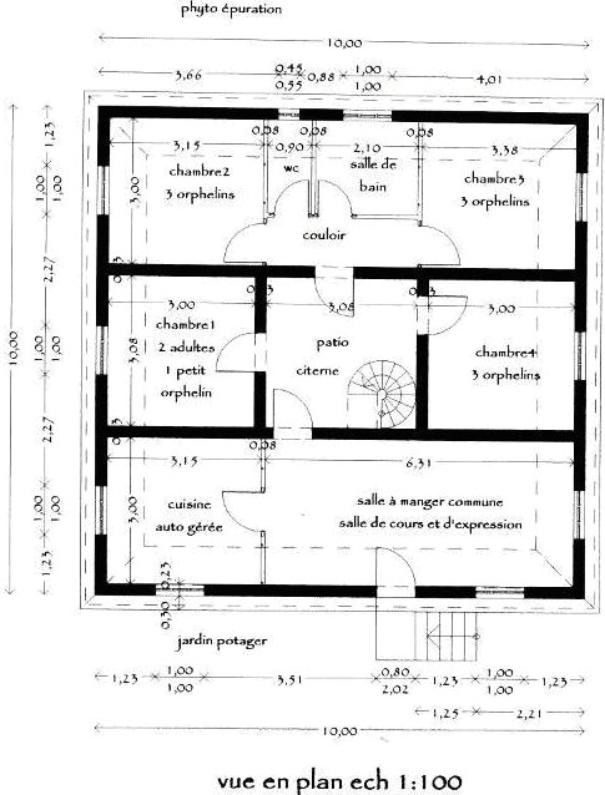
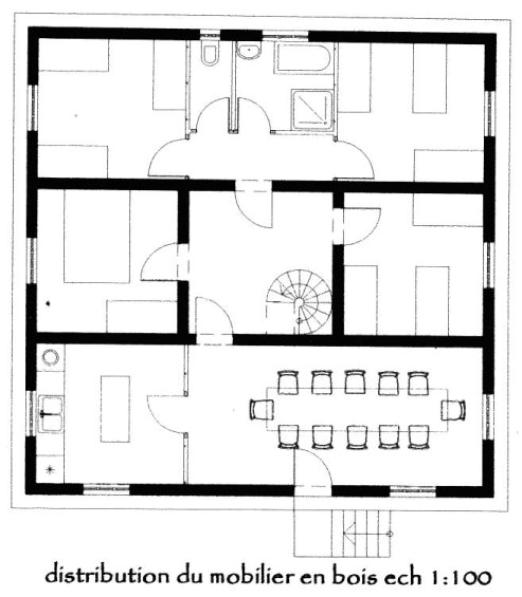
Plans de la maison économique de
Michel Rosell @ Michel Rosell
Sources /
Toutes les informations sur ces maisons :
Michel
Rosell, Université d'Ecologie Appliquée et Solidaire, Le Chabian 3O7OO
AIGALIERS.
http://ecosocial.free.fr/Maison1000Euros.htm
http://ecosocial.free.fr/tsunami.htm
[15] Sites
sur les maisons en bottes de paille : www.lamaisonenpaille.com
http://rmosaic.tripod.com/associationregardsmosaic
Ce genre de maisons en kit (à panneaux « agglo »)
sont très courantes aux USA et au Canada. Elles ne sont pas prévues pour
résister aux cyclones (niveau 5) ou tornades. En Islande, elles sont un peu
plus solides, parce que recouvertes sur les murs de plaques de tôles ondulées
(pas toujours esthétique). Les maisons en bois rond sont plus solides mais plus
chères (comme Hestia ci-dessous).
Au Canada (en général au Québec) :
- Panexpert
(Québec www.panexpert.com ),
maisons en kit (panneaux en aggloméré, couverte de feuille d’aluminium,
montage en 11 h _ 1 à 2 jours par équipe de Panexpert),
- Laprise -
AESEA (Québec, www.maisonlaprise.com
), maisons en kit, modèle W1478 : 82.80 m2, prix: 43467 $ can (~ 26.743,87
Euros). La moins chère, Modèle W2107, 78,2 m2, 38,081.00$ can (avec
taxe : 33900 Can Dollars = ~ 20851,45 EUR). Livraison, pour
l’exportation, en conteneur hi-cube de 40'(12 mètres) pour une maison de
100 m²… Pour toute livraison hors Canada, les taxes de 7 à 15 % ne doivent
pas être additionnées.
- La Charpenterie
(Québec, www.lacharpenterie.qc.ca
), émail : letourneault@lacharpenterie.qc.ca
.
- Confort
Design : http://www.confortdesign.com/
- Demtec, http://www.demtec.com/ , construites en
usine, résistante aux termites (par traitement autoclave du bois),
anti-sismique,
- Maison
IDEA, http://www.maisonsideahouses.com/
, CLASSIC KIT de 9,75 m x 10,97 m pour un total de 104.8 M2, 61 895,00 $
can (tout le sanitaire, l'électricité, la plomberie compris dans le prix.
Montage non compris).
- Hestia (Québec), Maisons en bois rond,
modèle ESTRIE : 100000 $ Ca
- Attention,
aux travaux de plomberie et d'électricité, en général non calculés dans le
contrat des maisons en kit au Canada, sauf exception (Prévoir ~ 11000 $
can, en plus).
- Attention,
aux taxes appliquées dans le pays de réception (Inde …), à rajouter.
Note : dans ce dossier, on n’a été cité les firmes US,
car prix assez équivalents à ceux au Canada.
En Belgique :
- CLX
Conception Belgique, http://www.clxconceptions.be/,
BM Eco kit a l’avantage des murs tout en béton, béton apporté
sous forme liquide dans un tuyau tiré à partir d’une centrale à béton,
puis versé dans des blocs de coffrage isolant en polystyrène ‘’Isohome’’
(ressemblant à des Legos et s’emboîtant comme eux). Ensuite, il faut
introduire le ferraillage dans les coffrages. Solidité des murs en
béton épais, toit semblant plus fragile face aux cyclone (peut-être à
renforcer). Modèle de maison BM BUN (« bungalow » sans garage 2
chambres 65,00m2, 6,m x 10 m, avec sanitaire, électricité, plomberie) : €
39.679 (pour un rayon de +/- 80km autour de Liège). contact: laid.dali@clxconceptions.be
(CLX Conception France : ldali@toutaide.com
). La maison toute équipée peut-être totalement construite en un mois. Les
blocs de bases coûtent ~ 12 € TTC pièce. Pour la BM BUN, il faut environ
~1000 blocs. Au niveau ferraillage, 2 barres tout le tour (ceinture du
plancher), 4 barres dans piliers verticaux de chaque coins, voire
ferrailler les semelles, voire une barre tous les 2 blocs, moins d’une
tonne de ferraille (en anti-sismique, ferrailler au moins 2 fois plus).
- CLX
Conception France est prête à transférer totalement le concept sur
place (en Inde …). On peut produire ces blocs polystyrène sur place (NIRAJ THERMOCOLES AND
ELECTRICALS PVT., http://www.nirajthermocols.com/ émail: response@nirajthermocols.com , MEGA
PACKS (0253) 2357909, EPES
THERMORUB (I) PVT.LTD. …).
|

plaque de
béton du plafond (concept maison
« Un toit pour tous »)
|

Poutres
faîtières du toit
(maison
« Un toit pour tous »).
|

^ bloc en
polystyrène CLX
v

<= BM
eco kit – remplissage du béton dans les blocs de coffrage en polystyrène CLX
|
|

Maison
« BM Eco kit » de « CLX Conception » (Constructeur Belge
et Français)
|

Maison
« Clx Conception » : coulage de béton dans coffrages
|
En Suède :
HONKA PARIS, M. Arnaud Le Claire
M. David Fouks
160, rue de la Pompe 75116 Paris,
tél. 01 56 90 20 20 / fax. 01 56 90 00 90
E-mail
: arnaud.leclaire@honka.com , david.fouks@honka.com
(pour une maison de 60 m2 mini,
prévoir ~ 950 €/m2 , soit 57 000 €, équipe de technicien qui vient monter _
électricité et plomberie non comprise. Epaisseur mini du bois du mur 112
mn).
En Italie :
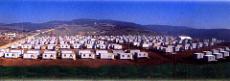 @ Yapi
@ Yapi
Ciment :
La Thaïlande exporte du ciment aux USA à 12-15 $ US / la tonne (avec coût
de transport élevé, vers les USA, de 30 $ US la tonne).
Le prix moyen du ciment indien (en Inde) est quand à
lui : Rs 500-1,200 la tonne soit ~
8 – 21 € la tonne (taux 1 € = 57.4800798 Rs). Avec le coût du
transport, on pourrait rajouter 50 % à ce coût.
Pour une maison avec 20 tonnes de ciment, le coût de cette
dernière serait de : ~ 630 €.
(Par comparaison, le prix moyen du ciment turc est de
30 dollars la tonne).
Aluminium :
2000 $ US / la tonne (INDAL INC. India _ firme connue sous le nom de HINDALCO)
(92,95 Rs / kg).
Acier :
~ 300 $ US / la tonne de ferraille en Inde (actuellement
flambée des prix à cause de la Chine).
(source : http://steel.nic.in/
, producteurs : Tata Steel, Essar, Ispat Industries and Jindal
Vijaynagar).
(Prix de la ferraille
broyée en Europe
~240 € / la tonne, fin 2004. Prix semblable en Inde).
Salaire minimum et coût de la main d’œuvre en Asie :
(salaire minimum le plus souvent non respecté dans ces pays)
:
Bangladesh : TK (ou BTD ?) 930 par
heure (0.1096 € ???)
Chine : RMB (ou CNY ?) 2.63 par heure (0.24 €/h) (le
plus souvent RMB 1,5 par heure)
Pakistan: : 35 USD = 2050 Rs / mois (26 € / mois) en 2004
(permet à peine de vivre)
Inde : idem (permet à peine de vivre. Il leur
faudrait 7000 Roupies /
mois, soit ~ 122 € / mois, pour vivre décemment dans une grande ville).
Les cantonniers le long des routes indiennes _ souvent des indiens du Bihar,
une des région les plus pauvres de l’Inde _ pour ce travail saisonnier (on
pourrait dire ce travail de forçat sous le cagnard), gagnent en moyenne 100 à
150 /- par jour (~ 2,6 € / jour, soit 57 € / mois, en 2002).
Prix du
transport d’un conteneur 40 pieds de Paris jusqu’au port de Colombo (Sri Lanka) :
1400 €
(source vén. Chandaratana voir plus loin).
Attention,
ce prix ne prend pas en compte les frais de dédouanement sur place.
Note : Prix du
bois en termes constants (en 1994) en dollars américains par
mètre cube ~ 250 $
Un certains nombres de facteurs influences la construction
des maisons, créant des contraintes dans leurs réalisations.
La fonction première de l’architecture est la protection de
l’homme contre les éléments naturels.
La protection contre le froid :
=> conséquences sur l’architecture et le mode de vie : isolation ou
épaisseur des murs, diminutions des ouvertures, cloisonnement des activités à
l’intérieur des constructions, => aménagement des espaces intérieures avant
les espaces extérieurs, etc.
La protection contre la chaleur :
une certaine isolation, protection, par l’architecture contre le rayonnement
direct du soleil : véranda pouvant protéger les ouvertures, des rayons
solaires, avancées du toit devant les ouvertures (fenêtre …), isolation du toit
(couleurs claires) …
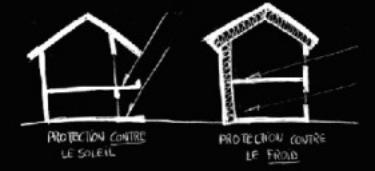
Protéger l’habitant contre a) la pluie, b) les effets
néfastes de la pluie : eaux de ruissellements, infiltrations (étanchéité
du toit, des murs, des ouvertures, maisons détachées du sol pour se protéger du
ruissellement …), etc.
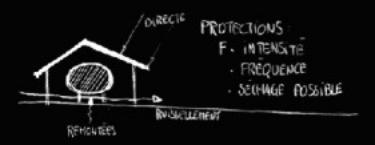
Influence sur le degré d’ouverture des maisons : en
région tropicale chaude et humide : bâtiments aérés, détachés du sol
(pour éviter les remontées d’humidité), profitant du moindre mouvement d’air
pour rafraîchir l’habitation (séchage facile de la maison).
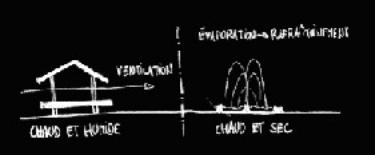
Le vent a) sert à améliorer le confort (aération par piège à
vent, rafraîchissement intérieur, séchage …),
Ou b) est un élément contre lequel il faut se prémunir
(comme le passage fréquent d’ouragans). Dans ce cas l’habitation est souple,
autorisant un mouvement dans sa structure (flexibilité,
« élasticité »), ou/et elle tente d’offrir une résistance moindre aux
éléments extérieurs (aérodynamisme) ou encore ne s’oppose pas directement à la
force des vents (faible hauteur).
Rôle du vent : a) dans l’orientation de la maison, b)
dans l’organisation des espaces extérieurs.
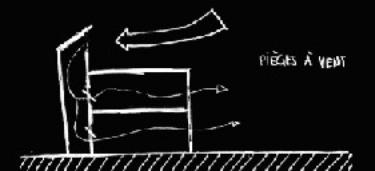
Les éléments du relief sont généralement intégrés à la
conception de la construction : les axes principaux de la construction
chercheront le plus souvent à s'aligner sur les courbes de niveau et la ligne
de plus grande pente. Le dénivelé permettra également de créer des différences
de hauteurs et des décalages dans l'organisation des pièces, ou encore imposera
à toutes les constructions une même orientation.

Qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle participe
entièrement à la vie d'une habitation. Sous certains climats, la végétation a
une utilité directe : elle protège du soleil et humidifie l'air en été, elle
laisse passer la lumière en hiver.

Les préoccupations écologiques des habitants vont influencer
leur mode de penser la construction : réductions de l'utilisation des énergies
fossiles, utilisation de l'énergie solaire sous forme active ou passive : ces
principes orientent ainsi la conception même de la construction.
Dans certains cas, on éviter les déperditions d’énergie
(chaleur, fraîcheur …), par l’isolation ...
Selon la nature du sol et les ressources disponibles, les
habitations vont se concentrer dans les endroits où l’on ne peut pas cultiver,
dégageant au maximum les zones dont on pourra tirer profit. La disponibilité de
la nappe aquifère influencera également le positionnement des habitations.

La nature des matériaux va influencer l'utilisation que l'on
va pouvoir en faire : les contraintes technologiques sont en effet inhérentes à
la nature des matériaux et elles orienteront la conception du bâtiment : la
longueur des troncs d'arbre disponibles, par exemple, limitera les portées
franchissables sans appuis, de même que la nature même du bois utilisé,
certains étant plus résistants que d'autres.
(on ne peut faire des voûtes, que si le matériau résiste à
la construction …).
Les disponibilités des ressources vont influencer
l'utilisation que l'on peut en faire : si on dispose de bois à volonté, on
pourra construire des maisons entièrement réalisées dans ce matériau. Si le
bois vient à manquer (ou son lieu de production est très éloigné), on le
réservera au domaine d'application où il excelle. Le visage de la construction
en sera ainsi modifié.
Les matériaux ne sont rien si on ne dispose pas de
techniques adaptées pour les rendre utilisables dans la construction. De même,
à partir d'un même matériau de base, il est possible d'obtenir de nombreux
matériaux dérivés qui sont tous différents quant à leur qualité et aux moyens à
mettre en œuvre pour les transformer.
Le développement économique implique l'état de développement
des techniques, des réseaux de communications et de transports, qui sont un
ensemble de facteurs qui va avoir une influence directe sur les échanges
d'idées et de matériaux, se répercutant eux-mêmes sur les modes de
construction.
Si on n’a pas de moyens de transports, si l’état des routes
sont mauvaises pour des distances conséquentes, il sera plus difficile alors de
faire venir les sacs de ciments, les éléments préfabriqués …
La connaissance des techniques n'implique pas nécessairement
de pouvoir les mettre en œuvre. Le coût associé aux transformations et mise à
forme en limite souvent l'application dans des pays ne disposant pas des
ressources financières suffisantes. Si la région ne dispose pas de
haut-fourneaux ou d’autres types de fours pour la transformation du fer en
acier, on ne disposera pas de poutrelles en acier ...
Pour protéger de la pluie et pouvoir disposer facilement de
ses équipements de pêche (filets …), certains villages sri lankais ont mis
leurs maisons sur pilotis afin que ces objets soient stockés sous celles-ci.
36.4.1.1
Composition et structure
La composition de la famille et la hiérarchisation qui peut
exister dans celle-ci va influencer l'organisation de la maison, sa forme ainsi
que la répartition des pièces.
Une maison devant recevoir le mari, ses trois femmes et ses
quinze enfants aura une toute autre physionomie qu'un appartement pour un
couple sans enfant.
De même, lorsqu'il y a une descendance nombreuse, on privilégie,
selon les régions, l'aîné, les garçons ou les filles, leur attribuant une pièce
individuelle ou une position particulière par rapport au chef de famille.
Selon que l'on se trouve dans une société patriarcale ou
matriarcale, la pièce respective du chef de famille peut acquérir une
importance particulière.*
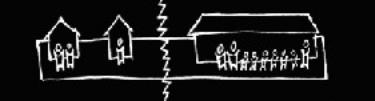
36.4.1.2
Mariage – Monogamie – Polygamie
Lors du mariage, plusieurs situations peuvent se présenter :
les mariés deviennent indépendants et s'installent ensemble dans un endroit
sans lien avec leur famille respective… mais la femme peut venir vivre dans la
famille de son mari, l'habitation étant parfois une pièce de la maison du
père, celui-ci faisant même construire, à ses frais, une nouvelle
construction pour le jeune couple.
Le régime marital va aussi avoir de l'influence sur
l'habitat : monogamie ou polygamie : comment sont installées les épouses
(époux), vivent-elles seules, existe-t-il une hiérarchie entre elles, se
traduit-elle physiquement, etc. Le mari vit-il dans la même maison que ses
femmes, vivent-elles séparées, va-t-il chez l'une puis chez l'autre.
36.4.1.3
Descendance et succession
Comment se transmet la propriété ? Revient-elle à la
communauté à la mort de l'utilisateur ? La maison familiale a-t-elle une valeur
affective particulière ? À qui revient la maison dans la descendance ?
Préserve-t-on son habitat afin de le transmettre ? La succession des
propriétaires a-t-elle une traduction formelle ?
36.4.2.1
Système foncier
Qui est propriétaire de la terre ? La notion de propriété
privée va influencer l'usage que l'on va avoir du sol et l'investissement dans
l'habitat. Qui est responsable de l'attribution des terrains ? À qui reviennent
les constructions bâties sur les terrains communs ?
Ces paramètres influencent à leur tour la manière d'aborder
la construction.
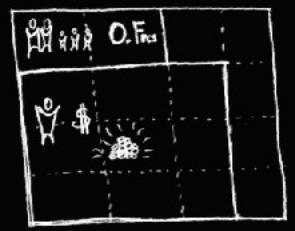 O Francs pour les uns, tous pour l’un d’eux.
O Francs pour les uns, tous pour l’un d’eux.
36.4.2.2
Attribution – ethnie – rang social
Qui peut s'installer à quel endroit ? Dans de nombreuses
villes, ils existent des quartiers réservés à certaines populations, se
regroupant et formant une communauté vivace. Volontaire ou non, cette
ségrégation a pour effet de développer la conscience de son identité et devient
souvent source de conflit.
On peut également trouver cette dissociation basée non plus
sur un système ethnique mais économique : nous avons nos quartiers à logements
sociaux, nos parcs résidentiels, nos cités ouvrières, qui cloisonnent tout
autant les populations.
La religion ou les croyances philosophiques peuvent se
traduire par une adaptation de l'habitat, dans l'orientation de pièces par
exemple, mais cette influence peut être beaucoup plus grande, la maison
devenant la représentation symbolique du système philosophique des habitants.
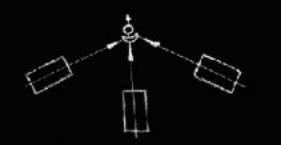
À côté de tous ces facteurs dont l’influence peut être
mesurée de manière objective, il en est d’autres dont les conséquences
résultent plus d’une manière de penser et d’appréhender la construction que
d’une analyse objective de la situation.
Ces paramètres sont évidemment plus difficiles à discerner
mais jouent néanmoins un rôle important dans l’orientation des choix que seront
faits pour la construction. Il s’agit des modèles communément considérés
comme " la " référence en la matière, de l’image que l’on se fait de
la " réussite ", en somme de tous les a priori culturels ancrés
dans les mentalités.
Source : http://users.swing.be/geoffroy.magnan/mali/3Context.htm
Frontier
Polymers Pvt. Ltd. (Inde)
- Business type: fabriquant,
exportateur
- Product types: réservoirs
d'eau, y compris de couleur blanche, des réservoirs chimiques, des
supports des conteneurs, des puisards industriels, des filtres (?)…
- Address: 4th Floor, 5 Community Centre, East of Kailash,
New Delhi, New Delhi INDIA 110065
- Telephone: +91 11 51622733 / FAX: +91 11 51622734
- Web Site: http://www.frontierpolymers.com E-mail: Send Email to Frontier Polymers
Pvt. Ltd.
ELECTRO PROTECTION SERVICES
INDIA (P) LTD. (Inde)
- Business type: manufacturer, exporter
- Product types: cathodic protection systems, heat exchangers,
Sacrifical anodes, Impressed anodes, Hull anodes, Tank anodes, Platform
anodes, Offshore anodes.
- Address: 86/1, Vengaivasal Mainroad,Gowrivakkam, Chennai,
TamilNadu India 601 302
- Telephone: (91) - ( 044) 22781745, 22781409
Ferrocements Pre Fab Ltd (Inde)
- Business type: Manufacturers and Suppliers
- Product types: Water Storage Tanks, Transmission Poles, Long
Span Folded Plate trough section Roof Element.
- Address: 2, CTHBCS Layout, 30th Main, Banashankari 3rd
Stage, Bangalore, Karnataka India 560085
- Telephone: 6796044 / FAX: 91806570714
Heatex India Corporation (Inde)
- Business type: manufacturer
- Product types: heat exchangers, air cooling systems, water
filtering and purification systems, water storage tanks, air heating
systems, air cooling system components.
- Address: Uv-69 Udyog Vihar Gurgaon Phase-4, Gurgaon,
Haryana India 122015
- Telephone: 91-124-2341523,2348723
Pralka Associates (Inde)
- Business type: retail sales
- Product types: cogeneration systems, water storage tanks, wood
burning stoves and furnaces, biomass energy boilers, heat exchangers,
meters and measuring equipment, thermic oil heating systems upto 30
million kcal/hr on any fuel.
- Address: 0-B, Vijay Kunj, Nehru Road, Santacruz(E),
Mumbai, Maharashtra India 400055
- Telephone: 91-22-26653144
Rapid Solar Division (unit of
Rapid Enginnering Co. Pvt. Ltd.) (Inde)
- Business type: manufacturer of Solar PV Modules
- Product types: Solar Photo-Voltaic Modules.
- Address: A-11/1, Site IV, Link Road Industrial Area,,
Sahibabad, U.P. INDIA 201010
- Telephone: +91-120- 2896655 / FAX: +91-120-2896656
Sensors Technology Private
Limited
- Business type: manufacturer
- Product types: water pumps, water storage tanks, home
automation, water filtering and purification system components, air
cooling system components, air heating system components, tank water level
sensor & water level meter and home radon radiation alarm.
- Address: Am-51, Deen Dayal Nagar, Gwalior, Mp India 474020
- Telephone: +91-751-2470680 / 5045716 / FAX: +91-751-5045715
Shree Sadguru Industries (Inde)
- Business type: manufacturer, retail sales, wholesale supplier,
exporter
- Product types: Mobile Lighting Mast, High Mast tower,MOBILE
TOILET-URINAL&BATHROOM VANS,Bunk house,Natural daylighting,tubuler
skylighting,storage tanks and all types critical Fabrication..
- Address: Jaybharat Rangshala compound,Bapunagar,
Ahmedabad, Gujarat India 380024
- Telephone: 91-79-22744769 / FAX: 91-79-22748112
Sintex International Limited (Inde)
- Business type: manufacturer, wholesale supplier, exporter
- Product types: solar water heating systems,solar cookers, parabolic
solar cookers, water purifiers & water filters, solar lanterns, water
storage tanks, insulated tanks, solar lighting systems, isi marked solar
collectors.
- Address: Near Seven Garnala, Kalol (North Gujarat),
Gujarat India 382721
- Telephone: 91-2764-224301/2/3/4/5 & 220031/2/3/4/5 - FAX:
91-2764-229940/220385
Sri Lakshmi Industries (Inde)
- Business type: manufacturer
- Product types: wind energy towers and structures (large), wind
energy towers and structures (small), heat exchangers, water storage
tanks.
- Address: D 96, Developed Plots Estate, Thuvakudi,
Tiruchirappalli, Tamil Nadu India 620 015
- Telephone: 914312500667
Sterling Agencies (Inde)
- Business type: retail sales, wholesale supplier, importer
- Product types: solar water heating systems, solar cooking
systems, water storage tanks, solar electric power systems.
- Address: Grain Market, Opp. Chamber Of Commerce,,
Jamnagar, Gujarat India 361001
- Telephone: 91-288-2551810 / FAX: 91-288-2556005
Super Shapers (Inde)
- Business type: manufacturer
- Product types: heat exchangers, wind energy system components
(large), wind energy towers and structures (large), wind energy towers and
structures (small), water storage tanks, appliances, collapsible pallets,
frp lined tanks for phosphating, hot dip galvanising, electro galvanising,
all kinds of machine components, roller conveyors, conveyor rollers, heavy
fabrication.
- Address: D-58, Developed Plots Industrial Estate,
Thuvakudi,, Tiruchirappalli, Tamil Nadu India 620015
- Telephone: +91-431-2500669, +91-431-2513627
Sustainable Development
Agency (Inde)
- Business type: manufacturer, exporter,
- Product types: solar cooking systems, solar water heating
systems, biomass energy systems, water storage tanks, waste treatment
systems, solar garden lights.
- Address: Parathodu, Kottayam, Kerala India 686512
- Telephone: 91482890646 / E-mail: Send Email to Sustainable
Development Agency
Universal Tubes &
Pipes,T.D.Road North End,Cochin,Kerala
- Business type: wholesale supplier
- Product types: distributors in Jindal composite pipes,steel/GI
pipes , storage water tanks(sona) in kerala,India.
- Service types: distributors in Jindal composite pipes,steel/GI
pipes , storage water tanks(sona) in kerala,India
- Address: T.D.Road North End, Cochin, Kerala INDIA. 682035
- Telephone: (0484)2366860,2355756 / FAX: 0484-2372353.
Source :http://energy.sourceguides.com/businesses/byGeo/byC/India/byP/water/waterstorage/waterstorage.shtml
Fabricants indiens :
- COCO CARBON ACTIVATORS, #73/B, 6TH MAIN, 3RD PHASE,
PEENYA INDL. AREA, BANGALORE 560058 ,KARNATAKA ,INDIA.
- HIMADRI CHEMICALS & INDUSTRIES LTD., A.I.E., Pedagantyada,
Visakhapatnam-44, Ph.No.2573 563
- FROST & SULLIVAN, Tower VI, 4th Floor, Solitaire
Corporate Park, Chakala, Andheri (East)
Mumbai - 400093, India, Tel: 91 (22) 2832 4705, Fax: 91 (22) 2832 4713
- S.K. CORPORATION
- KAN-CARBON PRIVATE LIMITED, F-205, Friends Tower, Commercial Center, Paschim Vihar, New Delhi -
110063, India, Phone: 91-11-25273547/ 25273548, Fax: 91-11-25273548
Sinon, possibilité de réaliser du charbon actif avec de la
noix de coco, imprégnée d’iodure d’argent.
1) Ambassade de l'Inde (en France),
15 rue Alfred DEHODENCQ, 75016 - Paris, FRANCE
Tél. : 01 40 50 70 70 - Fax : 01 40 50 09 96
M. P. K. SHARMA - Secrétaire de M. l'Ambassadeur
Tél. : 01 45 20 60 73 - Fax : 01 40 50 09 96
E-mail : ambassador2@wanadoo.fr
http://www.amb-inde.fr/french/index_fr.html
2) Ambassade du Sri Lanka en France :
16,
rue Spontini 75016 Paris,
Tél. :
01 55 73 31 31, fax : 01 55 73 18 49, E-mail : sl.france@wanadoo.fr
(Ambassade de
France, au Sri Lanka, Colombo : 89 Rosmead place - PO box 880 - Colombo 7, Tél
: [94] (1) 69 97 50 (ou 52) - 69 88 15, Fax : [94] (1) 69 90 39 - 67 73 74).
3) Ambassade d’Indonésie (en France) :
47-49 rue Cortambert, 75116 Paris,
Tél: 01 45 03 07 60, Fax: 01 45 04 50 32,
Site : www.amb-indonesie.fr/
émail : komparis@online.fr
4) Ambassade Royale de Thaïlande (en France) :
bureau du conseiller économique : 01 56 90 26 00
(Note : site Ambassade de France en Thaïlande : www.ambafrance-th.org/ ).
5) Consulat des Maldives (pas d’Ambassade en
France) :
Consulat Honoraire 24, Fontaine Billenois 21000 Dijon - Tél
: 03 80 41 51 07 - Télécopie : 03 80 42 07 92
6) Ambassade de Somalie (en France, s’adresser à
l’Ambassade du Kenya) :
C/O Ambassade du Kenya,
3 r Freycinet 75116 PARIS
Tél.: 01 56 62 25
25, fax : 01 47 20 44 41 (pour l’instant, situation très instable en Somalie).
Control Room (24-hrs)
Ministry of External Affairs, New
Delhi
Tel. No. : 00-91-11-2301 1954, 2301
2292, 2301 7160 / Fax. No. : 00-91-11-2301 3945, 2301 0889
Bangkok (Thailand)
Embassy of India
Tel. No. : 00-662-260 4166
/ Fax Nos. : 00-662-2584627/2621740
General Tel. Nos. :
00-662-2580300-05, E-mail : indiaemb@mozart.inet.co.th
Jakarta (Indonesia)
Tel. No. : 00-62-21-5204153
/ Fax No. : 00-62-21-5204160
E-mail : eoijkt@indo.net.id &
ambindia@indo.net.id
Colombo
(Sri Lanka)
Tel. Nos. : 00-94-11-2472684 & 2422788 / Fax Nos. :
00-94-11-2446403 & 2448166
E-mail : hoc.Colombo@mea.gov.in
Male (Maldives)
Tel. Nos. : 00-960-324857 &
323015 / Fax No. : 00-960-324778
Mobile No. : 00-960-771728,
E-mail : hoc.male@mea.gov.in &
Itm.male@mea.gov.in
Singapore
Tel. Nos. : 00-65-9026 2594 & 9753 6565
Kuala Lumpur
(Malaysia)
Tel. No. : 00-603-2095 3369 / Fax No. : 00-603-20933507 & 2092 5826
E-mail : highcomm@po.jaring.my
& fsch@po.jaring.my
- Patong Hospital , Tel: 00 66 76 342 633 – 4
Ornanong Annie Laokwanstitaya, Tel: 00 66 1 910 8389
Sharinee Shannon Kalayanamitr, Tel: 00 66 1 905 9868
Nina Polvanich, Tel: 00 66 9 477 9809
KRUNGTHAI Bank Ltd ., Head Office Bangkok , Thaïland
Cable Address: KRUNGTHAI Bangkok . S.W.I.F.T.Add. : KRTHTHBK
Swift Code: KRTHTHBK , CHIPS UID: 007895, Bank: Pay to KRUNGTHAI Bank
Ltd.,
Account name: Patong Hospital Tsunami Relief Fund, Account number:
837-0-00774-0
Un compte spécial « SOS Phuket
hôpital, Thaïlande » est ouvert et à votre disposition au Crédit Agricole
de Marolles-les-Braults. don à : SOS Phuket hôpital, Thaïlande
Crédit Agricole, Rue de
Bonnétable, 72260 Marolles les Braults
Ou Montri Hautemains, 36, rue de
Mamers, 72260 Marolles les Braults
- Mirissa
for life, Mirissa, Sri Lanka, Julien et Delphine Anto, julienanto@numericable.fr
- CCFD - 4 rue Jean Lantier - 75001 Paris – www.ccfd.asso.fr, Par chèque à l’ordre
de « CCFD – urgence Asie ». (Virements : CCP 46 00 F – Paris)
- Secours
Populaire Français - 6, rue Fulton - Z.I. Nord - 87280 LIMOGES -
Tel 05 55 04 20 - www.spf87.org
- Wardha Developpement, construit des maisons à
faible coût en brique crues, des sanitaires simples, en Inde, et
respectant les besoins des habitants et l'environnement et utilisant les
matériaux locaux, 1 rue Saint Bernard 31000 Toulouse. Contact : Hervé
Beaudet, 06 74 40 56 71, herve.beaudet@wanadoo.fr
site : http://wdatech.free.fr/CSVTECH/mudfacts.htm
- Collectif
Pêche & Développement avec la mention Solidarité
Asie - 1, Avenue de la Marne - 56100 Lorient - France - tél.: +33 (0) 297
84 05 87 - fax: +33 (0) 297 64 64 32 - http://www.peche-dev.org
Les amis de
Ceylan (à Lorient)
: 02.97.89.36.29
Philippe FABRY
Sri Lanka Solidarity
Association Bouddhique Internationale, Centre
Bouddhique International, 7,Cité Firmin Bourgeois, 93350 Le Bourget, Tel: 01 48
35 10 71, http://centrebouddhique.net
Vénérable Parawahera Chandaratana, Association Educative,
Culturelle et Sociale Sri Lankaise (Sri Lanka Educational Cultural and Social
Association), International Buddhist Center, 7, Cité Firmin Bourgeois, 93350 Le
Bourget, Tél : 01 48 35 10 71 - Fax: 01 48 37 21 75, émail : chandaratana@aol.com , centrebouddhiste@free.fr site : http://www.centrebouddhique.net/Aide%20au%20Sri%20Lanka.htm
Opération SANGAMITTA, en relation avec Bouddhisme Actualité
et le Consulat du
Sri-Lanka BP 484 MC 98012 Monaco cedex.
Les chèques doivent porter la mention «Solidarité Sri-Lanka»
"Via Campesina-Solidaridad-Tsunami" - 3035
0022 4202 2005 5606
e spedirlo all'indirizzo seguente:
Paul Nicholson EHNE - Inigo lopez de Hano 9
Gernika -Bizkaia -Pais Vasco E.
España email : nico.verhagen@t-online.de
http://www.altragricoltura.org/tsunami/default.htm
·
Association humanitaire Plan-France :
http://planfrance.org/ ou http://www.planfrance.org/
- Service
18, 40 rue Leibniz 75018 PARIS, Tél. : 01 44 85 84 25 / 01 42 63 70
76, Capucine Fromangé (ingénieur).
émail : services18@wanadoo.fr
- Maison
des Associations (Mairie du 18°), 15 passage Ramey 75018 PARIS, Tél.: 01
42 23 20 20 / fax : 01 55 79 01 36 (à voir).
·
Le Quai d’Orsay.
·
Conseil de
l’Europe …
·
PNU, FAO, … ONU,
Banque mondiale, Coopérations des pays (suisse, française etc …)
ONG :
- ANPE ?
- BIOFORCE, 9 rue Aristide Bruant, 69694
Vénissieux cedex ?
Partenaires
privés, par exemples voyagistes :
Club Med : 0 810 810 810
Nouvelles Frontières et TUI : 01 45 16 77 79
FRAM : 05 62 15 17 83
Jet Tours : 0 820 042 032
Kuoni : 01 45 61 87 70
Par exemple :
Emission
« Tous égaux », Producteur Réservoir Prod. Eédaction : E-mail : tousegaux@france3.fr Tél : 01.53.84.29.68 Courrier : Réservoir
Prod -Tous Egaux - BP 2113 - 75 771 Paris Cedex 16.
Etc …
Du fait de la guerre qui ravage le nord du Sri Lanka,
beaucoup de Tamouls sri lankais, craignant pour leur vie, cherchent asile au
Tamil Nadu, l'Etat indien qui fait face au Sri Lanka. 72 000 Tamouls sri
lankais dispersés dans les 132 camps de réfugiés que le gouvernement du Tamil
Nadu « accueille ». Selon de nombreux réfugiés, la fuite en Inde n'a
pas véritablement amélioré leur sort.
À la fin de 2001, environ 345 000 réfugiés vivaient en Inde,
dont quelque 144 000 Srilankais (au Tamil Nadu), 110 000 Tibétains (en
provenance du Tibet), 52 000 Birmans (dans les États de Mizoram et de
Nagaland), 15 000 de Bhoutans (dans les États d'Assam et du Bengale
occidental), 12 000 Afghans et de 5000 à 20 000 Bengalideshi (au Bengale
occidental). De ce nombre, il faut encore ajouter plus de 500 000 citoyens
indiens qui ont été déplacées à l'intérieur de l'Inde en raison de la violence
politique, dont environ 350 000 Kashmiris et plus de 157 000 autres dans le nord-est de l'Inde.
Sans compter les pauvres, intouchables, vivant des camps, comme ceux venant des états du
Gujarat, du Bihar etc …
Auxquels
doit se rajouter, maintenant, les 647.000 sinistrés sans abris, en
Inde, dus au Tsunami.
[1] A. Liébard, A. De Herde, K. de Myttenaere, C. Kanene
Guide de l'architecture bioclimatique. Tome 3 : construire en climats chauds.
Commission européenne - DG XVII - programme Altener. 2001 -
128 pages.
(à compléter) Etc …
Je propose mon expérience de conseil, d’animateur local et
d’informaticien, sur ce projet de reconstruction (voir CVs ci-joint). Mais
j’accepte tout travail, même le plus modeste, pour ce projet.
J’ai déjà une expérience _ de la gestion de projets informatiques
(plus de 15 dans le domaine) et humanitaires (durant 6 mois), sur le tas _ voir
mes CV ci-joints :
a)
CV d’informaticien,
b)
CV de mes actions humanitaires bénévoles.
Je suis prêt à me rendre à tout rendez-vous pour discuter du
projet (questions et solutions techniques, faisabilité, apporter ma
connaissance du sujet _ humanitaire, technique etc. …).
Sinon, je
suis même prêt à offrir mes services, en tant qu'informaticien _ car
ayant des compétences de Directeur Informatique et d’Ingénieur (voir mon CV
ci-joint) _, pour installer, par exemple :
a) une
salle informatique avec serveur,
b) un
réseau local,
c) une
salle de cours informatique avec des PC,
d)
d'importer dans un pays en voie de développement du matériel informatique
d'occasion (PC d'entreprise amortis).
e) de
réaliser le site, serveur et messagerie web de l'école, de l'association,
du village ... (ayant déjà l'expérience de la réalisation de 3
sites web, un pour des muletiers zankaris pauvres , un pour mon ONG et mon site
perso), ... dans tous pays en voie de
développement et dans tous lieux ayant ce type de besoin.
Le
projet pourrait se faire en collaboration avec l’ONG « Télécoms sans
Frontière ».
Source : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=1169
Télécoms
Sans Frontières est une Organisation non gouvernementale française. La mission
de TSF est de remettre sur pied quelques heures après une catastrophe des
solutions de télécommunications (voix, données) via satellite, à destination
des populations sinistrées, bien sûr, mais aussi des autres ONG présentes sur
place afin de permettre une meilleure organisation et coordination des secours.
TSF a mis sur pied un projet visant à optimiser
l’intervention d’urgence sur les lieux de crise. Il est constitué d’un système
d’alerte + une plateforme web accessible à toutes les ONG de la planète pour
avoir à disposition toutes les informations concernant une crise quasiment en
temps réel. Objectif : avoir les bonnes infos pour prendre les bonnes
décisions et gagner du temps pour intervenir au plus vite.
Document
déposé sous enveloppe Soleau, à l’INPI de Paris, le 3/3/05.
Sources :
7 Vidéos sur les techniques économiques de constructions de maisons du PNUD
Education, « Ramigé Films produktions » (1997) : 1) Apprendre à
travailler le bois, 2) Constructions, 3) Transformations des aliments, 4)
Transformation des métaux etc. …
UNESCO - Division of Policies
and Strategies of Education, Support to Countries in Crisis and Reconstruction,
7, Place de Fontenoy - 75352 Paris 07 SP (France), Tel.: (33)1 45 68 10 34 •
Fax: (33)1 45 68 56 45, mail: k.bensalah@unesco.org site: http://www.unesco.org/education/emergency/
D’après
l’expérience de l’auteur de ce projet, le meilleur logiciel d’optimisation de
trajet de camions, le plus puissant, est le logiciel OPTRAK (http://www.optrak.co.uk/, Optrak
Distribution Software, Princess Mary House, 4 Bluecoats Avenue, HERTFORD,
Hertfordshire, SG14 1PB , United Kingdom, Phone: 01992 411000, Fax: 01992
411001, email vrs-sales@optrak.co.uk
. En 95, ce logiciel à sa création, coûtait ~ 150 000 €. Mais dans le cadre de
cette opération humanitaire, avec une version réduite (light, sans toutes les
options non nécessaires dans ces pays), on pourrait négocier un prix bien moins
élevé (si possible).
![]() Projet
« Un toit pour tous (dans le monde) »
Projet
« Un toit pour tous (dans le monde) »
![]()
![]() .
.
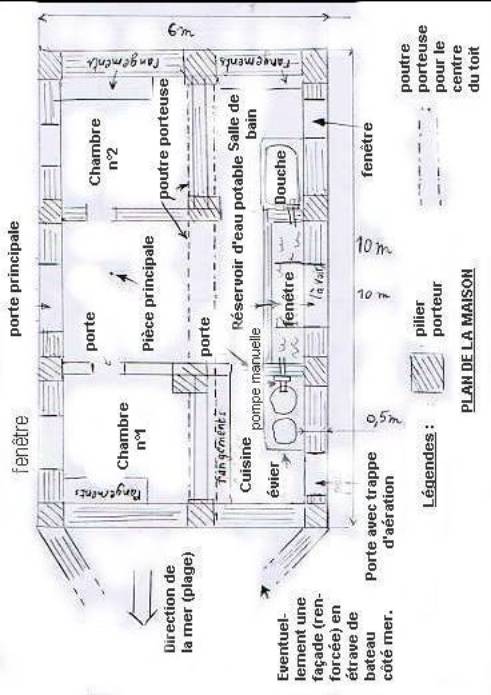
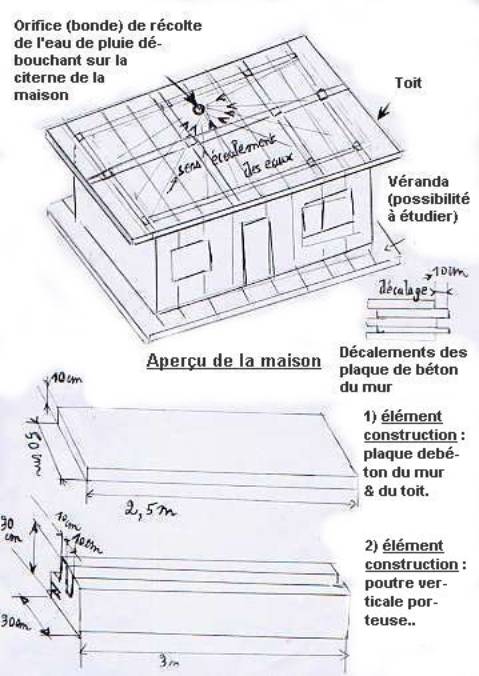
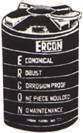 ©
ERCON (Inde)
©
ERCON (Inde)
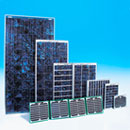

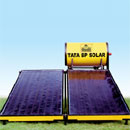
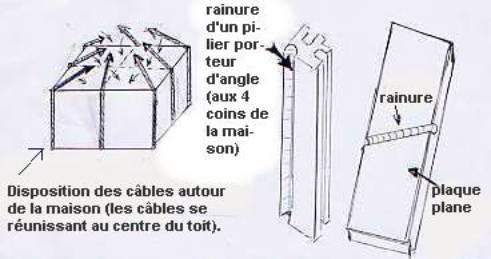 ©
B.Lisan.
©
B.Lisan.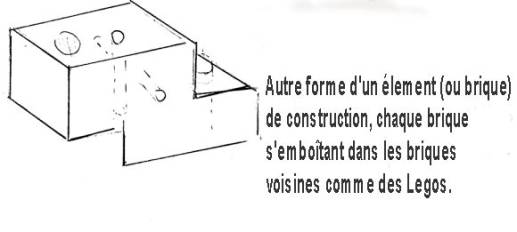 ©
B. Lisan.
©
B. Lisan.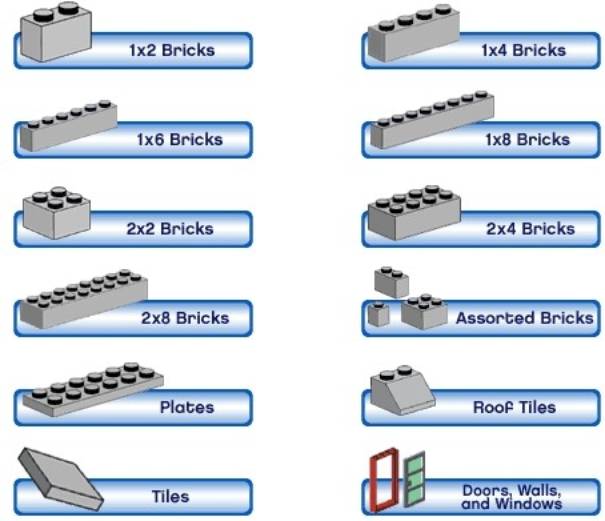
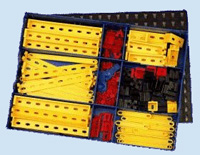

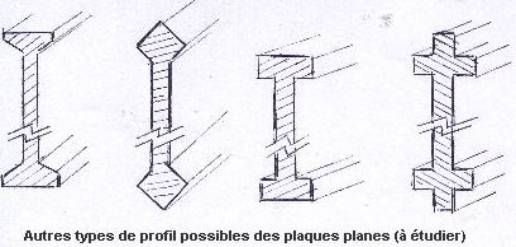
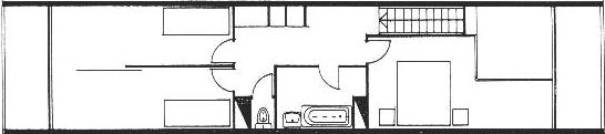
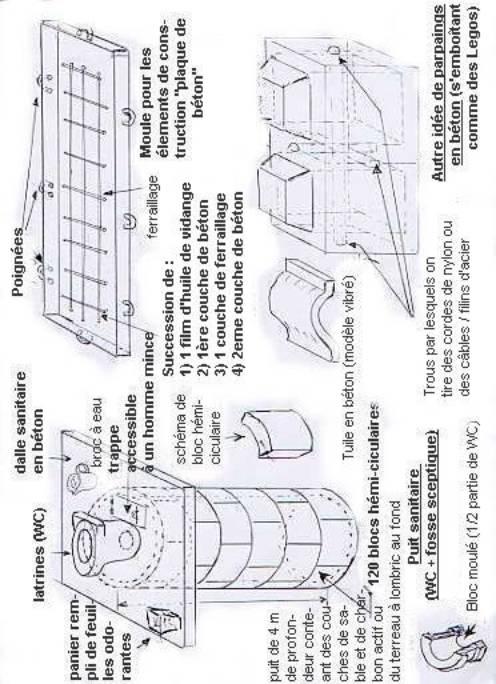





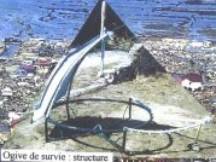
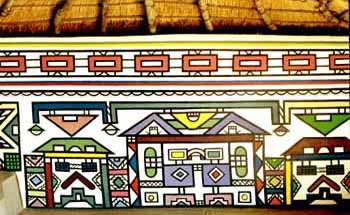
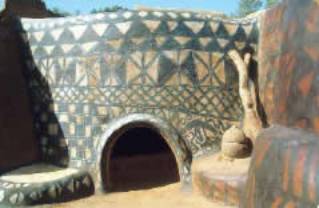
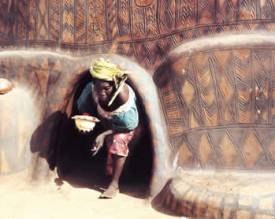
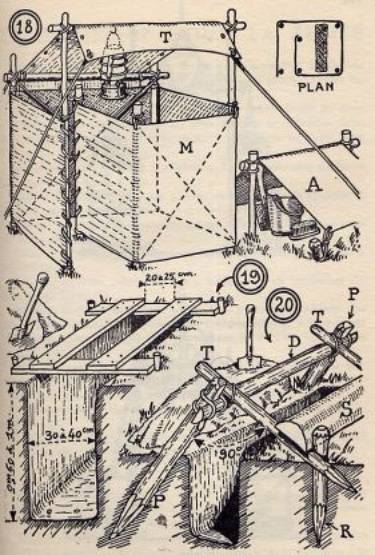


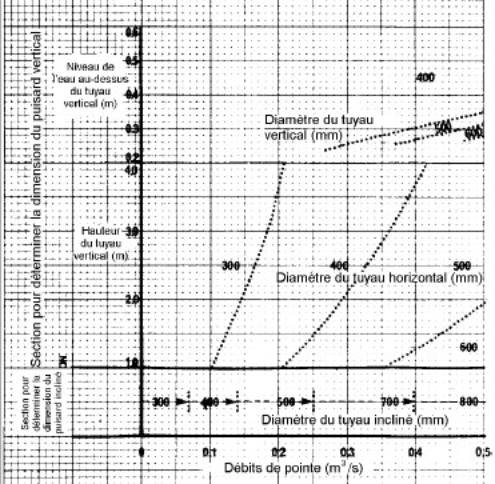
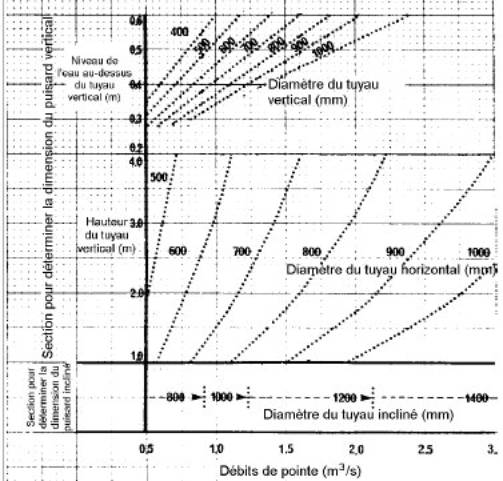
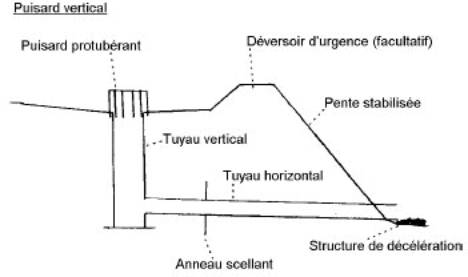
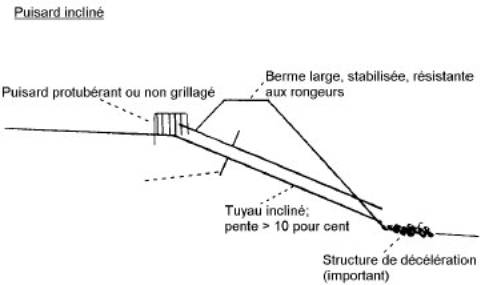


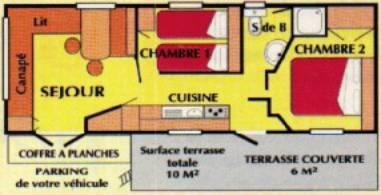



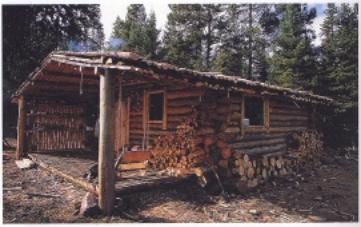
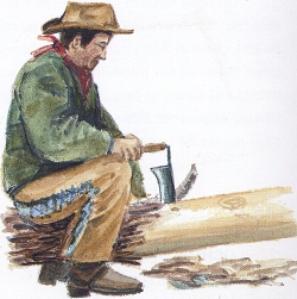
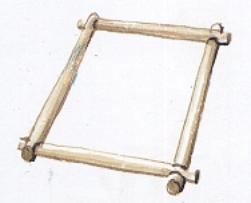
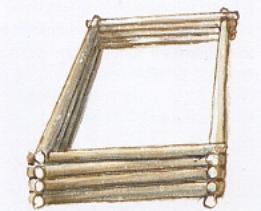

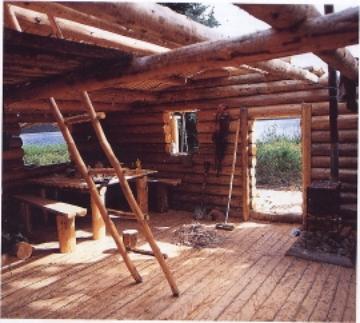

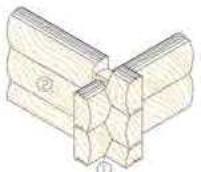


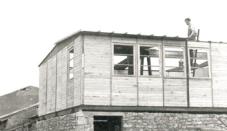





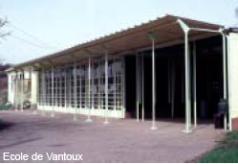
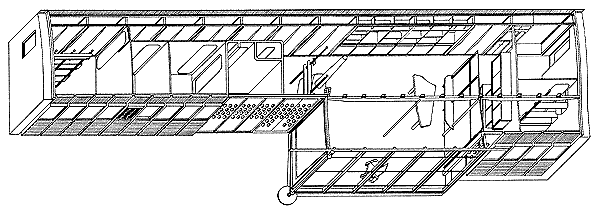

















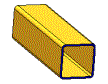 tube
à section carré
tube
à section carré