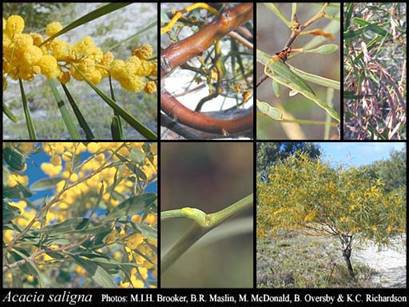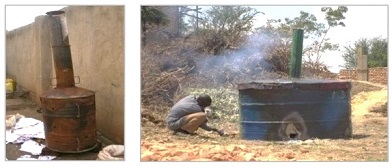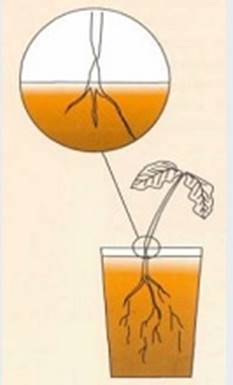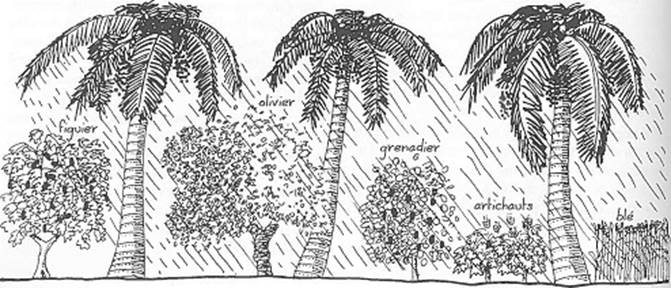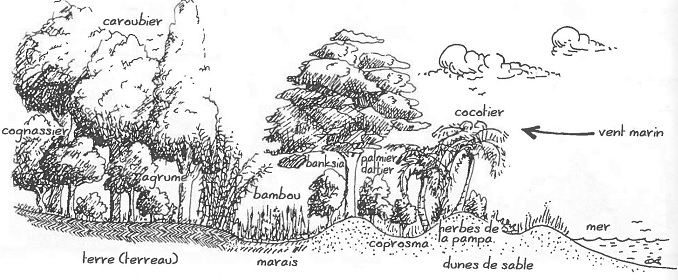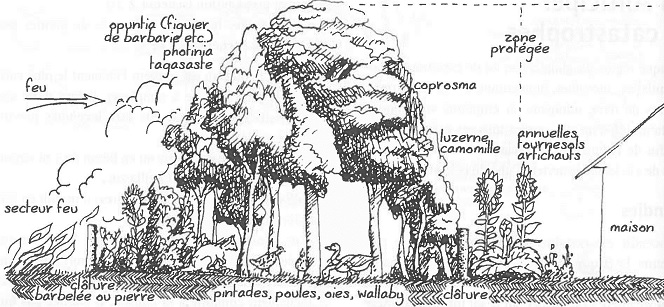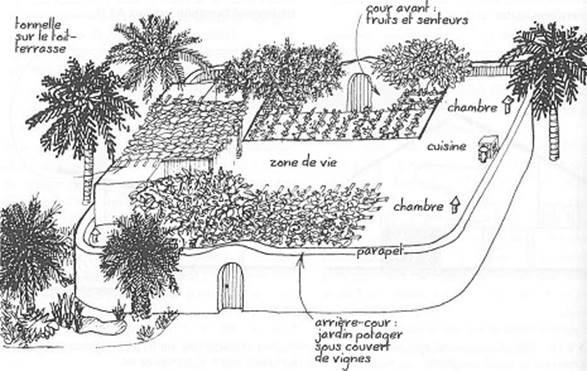Aride (adjectif) :
Sens 1 : Stérile, sec. Anglais : arid.
Synonymes : désertique, déshérité, desséché, incultivable, ingrat,
pauvre, pelé, rébarbatif, rebutant, sec, stérile, vide.
Aridité :
L’aridité se traduit par l’absence d’écoulement superficiel (aréisme),
ou par son indigence. Dans ce dernier cas, il y a impossibilité pour les cours
d’eau d’atteindre les mers et océans libres (endoréisme). L’aridité
impose un paysage minéral dû à l’inexistence ou à la rareté de la végétation,
et des formes de relief spécifiques (pédiments et glacis d’érosion, dépressions
fermées, dont les sebkhas couvertes de sel en phase d’intense évaporation,
surfaces caillouteuses, grandes formations dunaires).
L'aridité est une caractéristique permanente du climat, définissable
par un déficit pluviométrique structurel par rapport aux besoins en eau de la
végétation naturelle et cultivée. Elle est caractéristique des zones pour
lesquelles les besoins en eau sont au moins une fois et demie plus élevés que
les précipitations. En termes scientifiques, le rapport entre précipitations et
évapotranspiration potentielle (P/ETP) est compris entre 0,005 et 0,65.
Désertification :
Le surpâturage, la coupe des forêts, le changement climatique (lui-même
lié aux activités humaines, qui produisent du CO2 …) et le prélèvement excessif
de l’eau de la nappe phréatique et des cours d’eau peuvent provoquer la désertification
d’une région. Pour l’éviter, il faut économiser l’eau, préserver les forêts,
gérer d’une façon intelligente toutes les ressources, en général (eau,
biodiversité etc. …).
Les causes de cette salinisation sont diverses : mauvaises techniques
d’irrigation, montée du niveau des mer, due au réchauffement climatique (en
Floride, Maldive, Tuvalu …).
Variation [Sels] dans la rhizosphère : Insuffisance (Problème
nutritionnel) ou Excès.
Le stress salin s’applique plutôt à un Excès d’ions, en particulier, mais
pas exclusivement, aux ions Na+ et Cl‑.
Source : Stress
Salin, Adaptation des plantes à l'environnement, Mehdi JABNOUNE, www.supagro.fr/theses/extranet/08-0043_JABNOUNE.pdf
Aujourd’hui dans le monde, près de 20 % des cultures sont irriguées
avec l’eau saumâtre.
Si certaines cultures comme la betterave ou l’asperge s’accommodent
fort bien d’un sol salé, il n’en est pas de même pour d’autres cultures
comme les agrumes ou certaines légumineuses.
Les ressources en eau douce menacent donc de diminuer dans les
prochaines décennies.
Plus de la moitiés des terres d’Irak sont salines. La salinisation des
terres survient en Egypte, Pakistan, Tunisie, Turquie etc.


Acanthus ilicifolius : Distribution : Inde, Sri Lanka, Asie, Malaisie, Australie et les îles
du Pacifique. Petit arbuste qui pousse le long des lacs et des marais et des
rivages. Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthus_ilicifolius

Distribution : Afrique subtropicale (Sahara, très commune au
Sahara Septentrional jusqu'au Tademaït, Egypte), Asie tempérée et subtropicale
(Israel, Arabie, Jordanie, Irak). Déserts, steppes. Ce buisson pérenne,
de 20 à 40 cm, composé de branches ramifiées, épineuses, dont les
feuilles opposées sont réduites à des écailles, aux fleurs dépourvues de
pétales et disposées en épi terminal
dense, est utilisé comme plante médicinale en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient et dans la pharmacopée marocaine traditionnelle pour l’hypertension.
Plante aux rameaux grêles et charnus, articulés, dressés, très nombreux. Les
rameaux foncent et noircissent en séchant. Les rameaux âgés sont gris-brun et
les rameaux nouveaux sont d'un vert légèrement blanchâtre. Feuilles
opposées très petites en triangle. Les fleurs sont généralement solitaires
à l'aisselle des feuilles, elles donnent un fruit entouré de 4 à 6 ailes de taille
identique généralement vivement coloré (jaune, rose ou rouge). Les cendres de
cette plantes mélangées à de l’huile d’olive permet de fabriquer un savon.
Sources : a) http://www.plantarium.ru/page/view/item/48340.html,
b) https://pl.wikipedia.org/wiki/Haloxylon_scoparium,
c) http://www.ethnopharmacologia.org/recherche-dans-prelude/?plant_id=6553
|

|

|
|

|
 
Saligne à balai (Haloxylon scoparium ou
Hammada scoparia).
|
Synonymes : Tripolium pannonicum ou Tripolium vulgare. Famille des Astéracées ou Composées. C'est une
plante à fleur bisannuelle halophile typique des marais salés de
20 à 60 cm de haut. La plante pousse au bord de la mer, dans
les marais salants.
Elle est comestible crue ou cuite surtout en période juvénile (taille de
la feuille de 5 à 20 mm). Elle se cuisine très facilement et se marie
avec toutes viandes et poissons.
|

Genre Salicornia : la salicorne (comestible)
(climats tempérés et tropicaux)
|

Les palétuviers (climat tropical)
Au moins 14 espèces.
|

Le genre Suaeda : la soude. Exemple : Suaeda maritima (L.)
Dumort. - Soude maritime (climat tempéré)
|
Voici, dans les
pages suivantes, une liste de plantes pouvant apporter la prospérité, dans des
zones salines et/ou arides.
Originaire de Chine et
répandu dans les régions méditerranéennes,
c’est un arbuste épineux,
aux feuilles luisantes et caduques, de 6 à 10 m de haut. Ce
petit arbre, atteignant 15 m de haut, avec un tronc de 40 cm de diamètre ou
plus, en ombrelle (cime étalée), produit des fruits comestibles, les jujubes.
Cet arbre rustique se développe dans des conditions plutôt sèches et
une pluviométrie annuelle de 300 à 500 mm (150 à 2225 mm). L'arbre a une grande
tolérance à la fois à l'engorgement et à la sécheresse.
En Inde, sa température minimum de survie est 7-13 ° et la t. maximale
est de 50 °C. Il possède une bonne résistance au feu. Cet arbre se
développe, à la faveur des feux de brousses. « Il rejette
des pousses après les incendies » (Weber, 2003, p 460). Des études
indiquent que cette espèce prospère dans les sols alcalins avec un pH plus
élevé que 9,2. Les sols limoneux avec un pH neutre ou légèrement alcalin sont
considérés comme optimale pour la croissance. [6]
Habitat : bords de rivières, oueds, sources, plaines alluviales, sites
côtiers …
Le fruit est de forme et de taille variable. Il peut être ovale,
obovale, oblongue ou ronde, et peut être 1 à 2,5 cm (2.5 à 6.25 cm) de long,
selon la variété. La chair est blanche et croquante. Ce fruit est un peu
juteux et a une odeur agréable.
Son fruit comestible,
riche en vitamines A et C, ayant la consistance et
le goût d'une pomme,
entrant dans diverses préparations médicinales, est appelé jujube. La couleur des
fruits vont de vert à rouge brun.
Le miel de jujubier,
réputé au Yémen, est
censé avoir des vertus médicinales.
Les jujubiers fournissent un bon bois pour le charbon de bois.
Multiplication : semences dispersés par animaux, oiseaux, humains. Une
espèce très variables avec de nombreuses variétés et cultivars.
Le jujubier a été domestiqué en Asie
du Sud, depuis 9000 AJC. Plus de 400 cultivars ont
été sélectionnés.
Selon certains auteurs (voir bibliographie), Ziziphus jujuba et Ziziphus
mauritania seraient des synonymes.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Jujubier_commun,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Jujube,
c) http://edis.ifas.ufl.edu/st680,
d) http://selectree.calpoly.edu/treedetail.lasso?rid=1483
e) http://www.hear.org/pier/species/ziziphus_jujuba.htm f) http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_mauritiana,
g) Plantes de Madagascar (Atlas), Lucile Allorge,
Ulmer, 2008.
h) http://www.hear.org/pier/species/ziziphus_mauritiana.htm
|

Fruits
|

Fruits
|
|

|

Fruits et feuilles
|
Le Jujubier épine du Christ, est un arbre à feuilles persistantes,
atteignant 20 m de haut, originaire de l'Afrique du Nord, tropicale et australe
et l'Asie occidentale.
Il est largement cultivé pour ses fruits agréables au goût et son ombre
[3]. Ses fleurs sont une source importante de miel
en Erythrée et le Yémen [4] .
Maladie : Il est parasité par le gui hémiparasite Plicosepalus
acaciae.
Habitat : oueds du désert …
Il est très robuste, très résistant à la chaleur et peut être trouvé
dans les zones désertiques, même avec 100 mm précipitations par an. Il préfère
les bords des étangs, rivière et les rives ses oueds (wadi), où l'eau
souterraine est disponible. L'arbre est sensible au gel. Il peut résister à un
engorgement d'eau pour un maximum de 2 mois et à 8-10 mois de saison sèche.
C'est un colonisateur agressif, formant fourrés épineux
impénétrables.
Limites biophysiques :
Altitude: 0-2 000 m.
Température moyenne annuelle: 19-28 °C
Pluviométrie annuelle moyenne: 100-500 mm
Type de sol: Z. spina-christi préfère les plaines alluviales
avec des sols profonds, mais il peut aussi se développer sur des terres
argileuses [clay]; où l'eau est disponible, et sur les sols salins.
Nom vernaculaire arabe : « Zizouf ».
Sources : a) http://www.cabi.org/isc/abstract/20073185345
a) Zohary M. Flora Palaestina. II. Jerusalem: The Israel Academy of Science and Humanities; 1972.
pp. 307–308 cited in Amots Dafni, Shay Levy, and Efraim Lev, The
ethnobotany of Christ's Thorn Jujube (Ziziphus spina-christi) in
Israel, doi:10.1186/1746-4269-1-8 & http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1277088/?tool=pubmed
b) Eden Foundation. "Nutritional study on Ziziphus
spina-christi". eden-foundation.org.
c) http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Zizyphus_spina-christi.pdf
d) http://www.beesfordevelopment.org/info/info/flora/christs-thorn-ziziphus-sp.shtml
e) http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Zizyphus_spina-christi.pdf
Photos de Ziziphus spina-christi
Originaire des régions tropicales sèches de l'Afrique de l'Est, cet
arbre (famille des Fabacées, sous-famille des Caesalpinioidées),
atteignant 20 m de haut, à croissance lente et à longue durée de vie, a été
diffusé dans toutes les régions tropicales et subtropicales, en raison des
nombreuses utilisations du tamarinier _ gousses comestibles, usages médicinaux
et culinaires, ombre, bois …
Le tamarinier est sensible au gel mais peut supporter de brèves
températures proches de 0°C. Lors de sécheresses, il perd une partie de son
feuillage. Le tamarinier Il ne pénètre pas dans la forêt tropicale. Son système
racinaire étendu contribue à sa résistance à la sécheresse et au vent, est bien
adapté à des conditions semi-arides tropicales, de faible altitude (Climat chaud
et sec). Il préfère les zones semi-arides et les savanes boisées, et peut
également être trouvée de plus en plus le long du ruisseau et des rives. Il
tolère également de l'air et du brouillard salin dans les régions côtières.
Ces arbres donnent habituellement des fruits au bout de trois à quatre
ans, si les conditions de croissance sont optimales.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarinier,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Tamarind,
c)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarin_(fruit), d) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-tamarinier.pdf
Vieux tamarinier (village près de Morombe, côte ouest de
Madagascar) © B. LISAN.
Originaire des
régions méditerranéennes, Afrique du Nord, Proche-Orient, Europe
méridionale, cet arbre thermophile (famille des fabacées) a
été largement répandu, car cultivé pour son fruit, la caroube, et se
plaît sur des pentes arides.
Il est
adaptable à une large gamme de sols, sols sablonneux et pauvres, coteaux
rocheux, les sols profonds. Préfère les terreaux [en Anglais « loams »] sableux
bien drainés. Les sols calcaires à haute teneur en chaux conviennent également.
Il semble bien tolérer la salinité (Source : World Agroforestry Centre).
Il ne tolère pas les sols gorgés d’eau.
Le caroubier ne
résiste que très peu au froid (environ - 5 °). Un arbre peut fournir entre 300
et 800 kg de caroubes par an.
Sources : a)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroubier, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Ceratonia_siliqua,
c) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-caroubier.pdf
|

Forme basse de ramification naturelle de l'arbre dans
l'habitat naturel à l'Oasis
WWF de Monte Arcosu , Sardaigne , Italie. © Wikipedia
En.
|

 
Gousses verte et mûres (à gauche), feuille (à droite)
|
|

|
 
Fleurs mâles ↑ et femelles ↗
|
Le pistachier cultivé (famille des Anacardiaceae) est un
arbuste de 3 à 10 mètres, qui pousse dans les garrigues et
surtout dans les maquis au climat méditerranéen.
Le pistachier est une plante du désert et est très tolérant au sol
salin. Il a été rapporté bien grandir lorsqu'il est irrigué avec de l'eau
ayant 3000-4000 ppm de sels solubles [7]. Les pistachiers sont assez
robustes dans de bonnes conditions, et peuvent survivre à des températures
comprises entre -10 ° C (14 ° F) en hiver et 48 ° C (118 ° F) en été. Ils
ont besoin d'une situation ensoleillée et d’un sol bien drainé.
Les pistachiers deviennent maladifs dans des conditions de forte
humidité, et sont sensibles à la pourriture des racines, en hiver, s’ils ont
trop d'eau et si le sol n'est pas suffisamment drainé. Des étés longs et
chauds sont nécessaires pour le bon mûrissement du fruit.
Les pistachiers sont vulnérables à une grande variété de maladies (voir
ci-dessous). Parmi ceux-ci est l'infection par le champignon Botryosphaeria, ce
qui provoque la panicule et la brûlure des pousses (c’est-à-dire qu’il
tue les fleurs et les jeunes pousses), et peut endommager des vergers
entiers de pistachiers.
Pistacia vera est souvent confondue avec d'autres espèces
du genre Pistacia qui sont également connue sous le nom de
pistachier. Ces espèces peuvent être distinguées de P. vera par
leurs distributions géographiques (dans la nature), et leurs graines qui sont
beaucoup plus petites et ont une coque plus fine. Il se reproduit par semis.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_vera,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pistachio,
c) New pistachio varieties, http://californiaagriculture.ucanr.edu/landingpage.cfm?article=ca.v063n01p18&fulltext=yes
d) Liste des
maladies des pistachiers : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pistachio_diseases
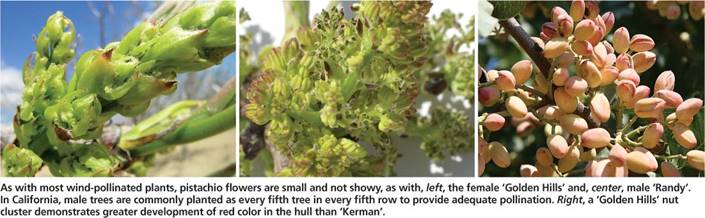
Comme pour la plupart des plantes pollinisées par le vent, les fleurs
de pistache sont petites et peu voyantes, comme avec, à gauche, la femelle
'Golden Hills' et, au centre, le mâle 'Randy'. En Californie, les arbres mâles
sont généralement plantés tous les cinq arbres sur cinq rangées, pour assurer
une pollinisation adéquate. À droite, une grappe de noix « Golden
Hill » démontre un plus grand développement de la couleur rouge, dans la
coque, que pour le « Kernam ».
↗ Les pistachiers du verger expérimental
de Wolfskill (USA) permettent botanistes à poursuivre les recherches sur la
variété Kerman et autres nouvelles variétés prometteuses de pistaches. Source :
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201306/in.search.of.the.mother.tree.htm#sthash.AnnPITwf.dpuf
L’arbre au mastic est un arbuste (famille des Anacardiaceae),
ne dépassant pas 6 mètres, à feuillage persistant, poussant dans les garrigues et
les maquis des climats méditerranéens. Il donne des fruits, d'abord
rouges, puis noirs.
Il est courant d'observer des galles formées aux dépens
du limbe foliaire du pistachier lentisque. Les parasites qui
induisent la production de ces galles, et s'en nourrissent ensuite, sont
l'acarien Eriophyes stefanii (galle par enroulement marginal
serré par en haut) et surtout le puceron Anopleura lentisci
(galle réniforme).
Habitat : fruticées [formation végétale formée
d'arbustes ou d'arbrisseaux] et forêts sclérophylles.
Il résiste bien aux feux. Il est considéré comme un arbre
écologiquement important. Il se reproduit par semis.
La graine est identique aux pistaches et peut être préparée en la
faisant bouillir avec des petites fèves, du blé et des pois chiches, à la
cuisson, arrosée légèrement avec de l'huile d'olive. Cette préparation est très
appréciée dans l'Est Algérien.
En médecine traditionnelle, on utilise la résine aromatique de
pistachier lentisque afin de combattre les ulcères d'estomac.
Les indications principales de son huile essentielle sont les
problèmes des systèmes veineux et lymphatique.
L'huile de lentisque est utilisée contre la bronchite, l'asthme, la
sinusite, l'eczéma (psoriasis et lichen plan) et les brûlures.
Une tisane, préparées avec ses feuilles, agirait contre les problèmes
de l'appareil digestif (ulcère, colopathie, parasites).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
|

Fruits
|
 
Fleurs
|
|
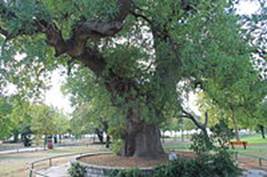
Un vieux pistachier lentisque dans le parc de Fenerbahçe
à İstanbul
|

Maquis à pistachiers lentisques (Sabaudia,
Italie). Le sol présent sous les buissons de cette espèce est considéré comme
un bon substrat pour le jardinage.
|
|

Fruits
|

Galle (maladie)

Mastic
|

Fleurs
|
|

|

Pistachier lentisque (Sant Tomás à Minorque)
|
|
|
|
|
|
Le « Térébinthe » est un arbuste (famille des Anacardiacées),
atteignant 10 mètres de haut, à feuillage caduc, poussant dans la garrigue et
le maquis, commun dans tout le bassin méditerranéen (sauf la Corse).
L'essence de térébenthine était à l'origine fabriquée avec
la sève de cet arbre.
Habitat : Le pistachier térébinthe est rustique et tolérant à la
sécheresse. Plante des garrigues, il nécessite un sol parfaitement drainé,
souvent calcaire, et se plaira là où pousse le chêne vert, une exposition
abritée (du vent) et ensoleillée. Jusqu'à une altitude de 500 m.
Il est plus exigeant en humidité et plus résistant au froid (au gel)
que le pistachier lentisque.
La résine, qu’on peut mâcher, peut être utilisée comme antiseptique et
à la fabrication de vernis et de friandises.
Les graines, comestibles mais aigrelettes, peuvent être utilisées pour
produire une huile comestible.
La galle du pistachier térébinthe amène la feuille à subir
une mutation pour contenir les œufs de son parasite. Les galles les plus
courantes sur cette espèces sont causées par les pucerons Forda
marginata, Forda formicaria et Baizongia pistaciae (feuille
transformée en énorme « corne » atteignant20 cm de long).
Très sensible aux pucerons parasites, utilisant ses feuilles pour y abriter
leurs larves, ils présentent très souvent des galles rougeâtre ourlant leurs
feuilles ou proliférant en forme de cornes brun rougeâtre atteignant 20 cm de
long (Baizongia pistaciae) ne mettant pas en péril le végétal.
Il est utilisé comme porte-greffe pour le pistachier
vrai. Il se reproduit par semis.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistachier_t%C3%A9r%C3%A9binthe,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_terebinthus
|

Fleurs
|

Fruits
|

Galles par Baizongia pistaciae
|

Dans les gorges du Gardon (France)
Cet arbre fruitier (famille des Lythracées) auto fertile,
pouvant vivre 200 ans, est cultivé pour ses fruits comestibles
(les grenades) et pour les qualités ornementales de ses grandes fleurs.
L'espèce tolère bien les sols calcaires et salins, une
légère sècheresse (qui pourra modifier la qualité des fruits) et peut
supporter de courtes périodes de gel (jusqu'à -15 °C). Il préfère les
climats secs. Il se reproduit par boutures et mal par semis. Les oiseaux sont
friands des fruits murs.
En zone humide, le grenadier a du mal à fructifier _ car il a besoin de
fortes chaleurs pendant toute la période de fructification _ sinon il est
attaqué par des maladies fongiques dont il ne se remet pas.
Le grenadier est un arbre robuste qui ne nécessite que peu de soins,
mais il peut tout de même être attaqué par un puceron s'attaquant aux jeunes
pousses et provoquant la fumagine, le papillon Virachola isocrates,
la punaise Leptoglossus zonatus, le coléoptère xylophage Xylébore
(Xyleborus dispar …), le zeuzère (Zeuzera pyrina ...), la
mouche du fruit (Ceratitis capitata), un parasite moins courant, ne
sévissant que par temps très chaud en zone méditerranéenne, une maladie
fongique (Aspergillus castaros), en zone humide, pourrissant
les fruits de l'intérieur (à traiter par bouillie bordelaise en préventif).
L'écorce du fruit est utilisée contre la dysenterie. Les fleurs
fraîches du grenadier sont utilisées en infusion contre l'asthme.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadier_commun,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pomegranate
|

Fleurs
|

Fleurs et fruits (Tunisie)
|
|

|

|
|

Sépales de grenadier et étamines sèches après la fécondation
et la chute des pétales.
|

Fleur de grenadier
avant la chute des pétales
|
Pour mention. Arbuste
de 2 m à 4,5 m de haut aux feuilles persistantes, endémique de
l'île de Socotra, près de la corne africaine de Somalie
(genre Punica).
Le feuillage n'est pas brouté par les animaux, le bois ne présente
aucun intérêt économique, ni comme source énergétique, ni comme matériaux
technologique. Le fruits est très acide et âpre et n'est consommé ni par les
humains ni par le bétail.
Aire de répartition : Son aire total de répartition occupe une zone
d'une centaines de kilomètres carrés sur des terrains humides calcaires ou
granitiques à une altitude de 300-1 200 m parmi les bosquets de crotons. Les
implantations sont très fragmentées est présentent différentes sous-populations
par exemple sur les plateaux les plus hauts. Il a un port prostré, alors qu'il
est érigé aux altitudes plus basses. Dans certaines zones, il est très commun
et la population se régénère normalement, alors qu'ailleurs, l'arbre peut pour
des raisons inconnus avoir disparu ou ne présenter que quelques individus
reliquaire.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Punica_protopunica
Ce sont des arbrisseaux sarmenteux, proche des lianes, à feuillage
caduc, de la famille des Vitaceae,
grimpants, s'accrochant à des supports par des vrilles, dont les tiges peuvent atteindre
six mètres de long.
Principale espèce de vigne cultivée en Europe et dans le monde, elle
est à l'origine de très nombreux cépages de cuve (cabernet, merlot, pinot, sauvignon, etc.) ou de table. Il existe
actuellement entre 5000 et
10000 variétés de raisins Vitis vinifera, bien
que seules quelques-unes aient une importance commerciale pour la production de
vin et de raisin de table.
Autres espèces de vignes pour
la viticulture : Outre Vitis vinifera, les espèces du genre Vitis adaptées à la viticulture
sont : Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri, Vitis amurensis, Vitis coignetiae, Vitis vulpina, Vitis acerifolia, Vitis aestivalis, Vitis
rotundifolia ... Certaines de ces espèces peuvent servir
de porte-greffe pour des cultivars afin de les protéger de maladies parasitaires comme le phylloxéra. Des hybridations entre les espèces peuvent s'avérer par
ailleurs efficaces pour lutter contre des maladies
cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium.
Sous-espèces : Le raisin sauvage est souvent
classé comme V. vinifera subsp. sylvestris (dans
certaines classifications considéré comme Vitis sylvestris),
avec V. vinifera subsp. vinifera limité aux
formes cultivées. Les vignes domestiquées ont des fleurs hermaphrodites, mais
subsp. sylvestris est dioïque (fleurs mâles et femelles sur des plantes séparées) et la pollinisation est nécessaire
au développement des fruits. Pour résumer, on accepte deux sous-espèces :
·
Vitis
vinifera subsp. sylvestris - La vigne sauvage,
vigne des bois ou lambrusque, dioïque (strictement
protégée en France. Sa cueillette y est interdite. Ses fruits sont plus acides
et amers que ceux du raisin de cuve).
·
Vitis vinifera subsp. vinifera (syn. Vitis
vinifera var. sativa) - La vigne commune à proprement parler,
fleurs hermaphrodites.
Racines
: Un plant de vigne cultivé développe des racines qui s'enfoncent
généralement à une profondeur de 2 à 5 mètres et parfois jusqu'à 12-15 mètres
voire plus. Feuilles : Leurs feuilles à nervures palmées,
comportant pour la plupart cinq lobes principaux plus ou moins découpés, ont
généralement une base cordiforme (forme de cœur).
Fleurs : Leurs fleurs, petites et verdâtres
à blanches, sont regroupées en inflorescences. Fruits : leurs fruits, de formes différentes selon les sous-espèces, sont des baies regroupées
en grappes. Les graines de ces baies sont des pépins.
Distribution de la vigne cultivée : originaire de la région
méditerranéenne, la vigne
est désormais cultivée dans tous les continents (sauf Antarctique). Elle
prospère dans une gamme de climats allant de chaud et sec, à même frais humide
et subtropical, avec différents types de sols (si possible drainés, graves …).
Elle peut résister à la sécheresse..
Distribution
de la vigne sauvage : Afrique du Nord (Algérie, Maroc et
Tunisie), Asie tempérée et
moyen Orientale, Eurasie caucasienne, Europe centrale, Europe du Sud Est,
Europe du Sud-Ouest (France, Espagne).
Reproduction : La multiplication de la vigne peut se faire
par (voir ci-dessous) :
·
Semis ;
·
Bouturage ;
·
Provignage (marcottage).
On peut aussi trouver Vitis
vinifera à l'état subspontané, notamment dans le sud de la France.
Usages : L'espèce est cultivée pour
ses fruits en grappes, le raisin, soit
consommé frais comme raisin de table, soit transformé pour produire du jus, du vin
(jus fermenté), de l’alcool, du vinaigre ou séché pour produire des raisins secs. Dans le bassin méditerranéen, les
feuilles et les jeunes tiges sont traditionnellement utilisées pour nourrir les
moutons et les chèvres après la taille de la vigne. Les feuilles de vigne sont
remplies de viande hachée (comme l'agneau, le porc ou le bœuf), de riz et
d'oignons dans la fabrication du dolma
traditionnel des Balkans.
Note : Il ne semble pas que la vigne résiste
au stress salin.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera,
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne_sauvage, d) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
|

Grappes et feuilles.
|

Débourrement.
|

Jeune rameau.
|

Inflorescence.
|
|

Inflorescence.
|

Floraison.
|

Cep de vigne sur son support.
|

Vignes cultivées (Vignoble du cognac, en Charente).
|
|

Feuille de lambrusque mâle,
bord de la Charente.
|

Fleur mâle de lambrusque, bord
de la Charente.
|

Pied femelle avec raisin, Conservatoire du Vignoble
Charentais.
|

Vigne grimpante sarmenteuse,
sur façade.
|
Tableau : Cépages résistants à la sécheresse (au stress hydrique),
pour des terres non irrigables, certains pouvant supporter des températures de
45°C (auteur B. Lisan) :
|
Cépages
|
Origine
|
Couleur
|
Mildiou
|
Oïdium
|
Botrytis
|
Gel
|
Chaleur
|
Sèchere.
|
|
Assyrtiko
|
Grèce,
Santorin
|
Blanc
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Agiorgitiko
|
Grèce
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torrontes riojano
|
Argentine
|
Blanc
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Assyrtiko R2
|
Grèce
|
Blanc
|
|
|
|
|
|
|
|
Torrontes riojano R2
|
Argentine
|
Blanc
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Calabrèse
|
Italie
|
Rouge
|
|
|
|
|
|
CC
|
|
Montepulciano
|
Italie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Néro d’Avola
|
Italie,
Sicile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grenache rouge
|
Espagne
|
Rouge
|
|
|
|
|
|
C
|
|
Grenache blanc
|
Espagne
|
Blanc
|
|
|
|
|
|
C
|
|
Airen
|
Espagne
|
Blanc
|
|
|
|
|
|
CC
|
|
Malvoisia Sardegna
|
Italie
|
Blanc
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Malvasia volcanica
malvoisie volcanique
|
Lanzarote
(Canaries)
|
Blanc
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Anglianico
|
Italie
|
Blanc
|
|
|
|
|
|
|
|
Bobal
|
Espagne
|
Rouge
|
|
|
|
|
|
|
|
Trépat
|
Espagne
|
Rouge
|
|
|
|
|
|
CC
|
|
Zinfandel / Primitivo
|
Croatie/Italie
|
Rouge
|
|
|
|
|
|
|
|
Negro amaro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saperavi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiano
|
|
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Manseng noir
|
France
(ancien)
|
Rouge
|
|
|
|
|
C
|
|
|
Tardif
|
France
(ancien)
|
Rouge
|
|
|
|
|
C
|
|
|
Ramsey
|
Australie
|
Porte-greffe
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Morrastel
|
Espagne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vidoc
|
France (INRA)
|
Rouge
|
C
|
C
|
|
|
|
CC
|
|
Artaban (IJ131)
|
France (INRA)
|
Rouge
|
C
|
C
|
|
|
|
CC
|
|
Floréal B
|
France (INRA)
|
Blanc
|
C
|
C
|
|
|
|
CC
|
|
Voltis
|
France (INRA)
|
Blanc
|
C
|
C
|
|
|
|
CC
|
|
Bronner B
|
France (INRA)
|
Blanc
|
C
|
C
|
æ
|
|
C
|
CC
|
|
Mourvèdre
|
France,
Langued
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cabernet-Sauvignon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitis berlandieri
|
Amérique
|
Porte-greffe
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Cinsaut
|
France (ancien)
|
Rosé
|
C
|
C
|
|
|
C
|
CC
|
|
Rolle
|
France
(ancien)
|
Rosé
|
C
|
C
|
|
|
C
|
CC
|
|
Vitis rotundifolia
(Muscadine)
|
Amérique
|
Porte-greffe
|
C
Variable
|
C
Variable
|
|
|
C
|
CC
|
|
Monarch Noir
|
|
Rouge
|
C
|
C
|
C
|
|
|
|
|
Muscaris Blanc
|
|
Blanc
|
C
|
C
|
C
|
|
|
|
|
Prior Noir
|
|
Rouge
|
C
|
C
|
C
|
|
|
|
|
Souvignier Gris
|
|
Blanc
|
C
|
C
|
C
|
|
|
|
|
Fetească
neagră ou noir des pucelles
|
Roumanie
|
Rouge
|
C
|
|
|
Hiver
Print.
|
C
|
CC
|
|
110R
|
Australie
|
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
140Ru
|
Australie
|
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Saperavi
|
Géorgie
|
Rouge
|
C
|
C
|
|
Hiver
|
C
|
CC
|
|
Bourboulenc (B)
|
France,
Langued
|
Blanc
|
|
|
|
|
C
|
CC
|
|
Tourbat (B), torbato, caninu ou malvoise du Roussillon
|
Italie,
Sardaigne
|
Blanc
|
æ
|
æ
|
|
|
C
|
CC
|
|
Morastel, graciano
|
France
(ancien)
|
Rouge
|
(æ)
|
C
|
|
|
C
|
CC
|
|
Agiorgitiko
|
Grèce
|
Rouge
|
æ
|
æ
|
æ ?
|
|
C
|
(æ)
|
Note : tableau à compléter.
Arbre endémique du Maroc (dans la région du
Sud-Ouest et en particulier la plaine du Souss) et de la région
de Tindouf en Algérie (famille des Sapotaceae),
aux rameaux épineux, de 8 à 10 m de haut, vivant
jusqu'à 150-200 ans, il fournit l’huile d’argan, extraite de ses amandes. Encore
appelé affiache.
Son fruit jaune-brun à maturité contient une noix très dure
abritant deux ou trois amandons.
Un arbre produit, chaque année,
de 10 kg à 30 kg de fruits environ. Il a besoin
de soleil.
Il faut environ 38 kg de fruits ou
bien 2,6 kg d'amandons pour
produire 1 litre d'huile.
Ses feuilles, vert sombre et coriaces, sont consommées par
les dromadaires et les chèvres.
Son système racinaire particulièrement profond est dépourvu de
poils absorbants. Il profite d'une symbiose avec différents types de
champignons pour pallier cette déficience, seuls ces derniers pouvant apporter
les différents nutriments à l'arbre. La reproduction artificielle et la mise en
culture de celui-ci nécessite ainsi l'inoculation de plusieurs espèces de
champignons au niveau de ses racines. L'aire géographique de l'arganier
bénéficie d'une forte humidité, tant par les précipitations saisonnières que
par une fraîcheur relative, que l'arganier piège et restitue au sol. Peu
exigeant en eau (climat aride à semi-aride). S'il est peu exigeant en matière
de sol, il semble apprécier l'air humide (influence océanique).
Pluviométrie annuelle : 150 à 250 mm en plaine; 200 à 450 mm en
montagne. Source : http://ma.chm-cbd.net
L'arganier supporte les températures élevées (50°C à Taroudant), mais
pas les basses températures. On l’a vu résister à 7°C à Agadir.
Distribution : S. Aziki estime que des forêts d'arganiers
plus vastes et denses existaient autrefois mais qu'elles ont été dégradées par
l'homme et ses troupeaux domestiques. Les semences peuvent être conservées au
sec, plus de 8 ans.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Arganier,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Argania,
c) http://www.vulgarisation.net/bul95.htm,
d) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-arbre-arganier.pdf,
e) Multiplication
végétative de l’arganier au Maroc (projet John Goelet), http://bft.revuesonline.com/gratuit/BFT64_304_5BellefonMonte304.pdf
C’est une plante (famille des Arécacées /
Palmiers, sous-famille des Coryphoideae), de 15
à 30 m de haut, largement cultivé pour ses fruits :
les dattes.
Dans l'agriculture d'oasis saharienne, c'est la plante (et non pas
un arbre, au sens botanique, car ne produisant pas de vrai bois), dominant
la strate arborée des arbres fruitiers, poussant à son ombre et couvrant
cultures maraîchères, fourragères, voire céréalières.
Le palmier dattier résiste à un grand écart de température (-5 à 50
°C), a un optimum de croissance entre 32 et 38 °C et ne pousse plus en dessous
de 7 °C. L'activité végétative se réduit dès 40 °C et cesse autour de 45
°C. Le givre fait des dégâts. Le palmier dattier peut tolérer environ 5 g/l de
sel.
La pollinisation se fait normalement par le vent. Le plus
souvent à la main.
La propagation des palmiers dattiers se fait par clonage, soit par
prélèvement de drageons ou rejets, soit par culture in vitro.
En Tunisie, on compte plus de 300 variétés2,3, au Maroc, environ 150.
En Algérie, plus de 1160 cultivars sont recensés.
Toutes les parties de l'arbre sont utilisés, pour faire des cordes, des
paniers, des ruches, comme poutres pour les maisons …
Il est sujet à de nombreuses maladies dont le bayoud (fusariose,
champignon Fusarium oxysporum) etc.
Ses graines ou semences [et leur pouvoir germinatif] se conservent très
longtemps.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoenix_dactylifera,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Date_palm,
c) Date Palm
Cultivation, FAO, http://www.fao.org/docrep/006/Y4360E/Y4360E00.HTM,
d) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_date_palm_diseases
Originaire du sud-ouest d'Amérique du
Nord, de Californie, Arizona, Utah et Nevada, cet
arbre (famille des Asparagacées) est à croissance rapide pour le
désert; les nouveaux plants peuvent croître à un taux moyen de 7,6 cm (3,0
po) par année, dans leurs dix premières années, puis que croître d'environ 3,8
cm (1,5 po) par an par la suite. Il tolère les sols pauvres, alcalins et
salins. Il résiste à des températures entre 4 & 46°C.
Les fleurs sont produites au printemps,
en panicules de 30-55 cm de hauteur et 30-38 cm de large.
Les amérindiens ont utilisé les feuilles de Y. brevifolia pour
tisser des sandales et des paniers et ont récolté les graines et boutons
floraux pour se nourrir. Les racines de ce yucca contiennent
des glycosides de saponine (toxiques).
Comme la plupart des plantes du désert, leur épanouissement floral est
tributaire de la pluviométrie au bon moment. Ils ont également besoin d'un
gel de l'hiver avant de pouvoir fleurir.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Yucca_brevifolia,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Yucca_brevifolia,
c) Yucca brevifolia, http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/yucbre/all.html#94
Originaire des zones arides du Nord-est du Mexique, ce Yucca, très
ramifié, aux feuilles droites ensiformes, se développant
en rosettes en forme de grappes à la fin de chaque branche, peut
atteindre 15 m de hauteur.
On le distingue des autres yuccas par
son inflorescence de fleurs blanches, en grappe retombante.
Ses fleurs et ses feuilles sont utilisées au Mexique pour
l’alimentation humaine. Dans l'agro-industrie, ses fibres servent à la
fabrication du papier ou pour certains combustibles. La saponine extraite du
tronc ou est utilisée dans l'industrie pharmaceutique et
comme nutraceutique dans l'élevage. La saponine extraite des racines
est toxique.
Cette plante est pollinisée par un papillon de
nuit (Tegiticula yuccasella) qui ne se trouve que dans son habitat
naturel, ailleurs l'intervention de l'homme est nécessaire pour obtenir
une fructification. Il prospère dans des régions sèches et semi-arides
_ les précipitations annuelles moyennes sont de 250 mm, et les
températures varient de 40 °C à –30 °C _ au climat
subtropical tempéré par la continentalité et l’altitude (l’essentiel de cette
région se trouve entre 1 000 et 1 500 m d’altitude) et
dont les sols drainant sont sableux ou pierreux. Les gelées sont occasionnelles
dans son aire de répartition naturelle, notamment dans la partie mexicaine du
désert de Chihuahua et il peut supporter des températures minimales de
–15 °C 15.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Yucca_filifera,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Yucca_filifera,
c) http://es.wikipedia.org/wiki/Yucca_filifera
Washingtonia est un genre de
la famille des Arécacées (Palmiers).Originaire du
Sud-Ouest des États-Unis (Californie, du sud-ouest de l'Arizona) et
du nord-ouest du Mexique, il se développe en colonies, dans les gorges et
les canyons humides des régions arides. Les deux espèces (Washingtonia
filifera, Washingtonia robusta) sont très cultivées en dehors de leur
habitat naturel, notamment dans les pays tempérés, pour leur bonne résistance
au froid qui avoisine les - 10°/-12°C. Elles ont de plus une croissance très
rapide.
Les Amérindiens utilisaient leurs feuilles
comme chaume et faisaient de la farine avec les fruits du Washingtonia
filifera, qui sont comestibles et présentent de bonnes qualités nutritives.
Les fruits sont des drupes. Parvenus à maturité, ils prennent une couleur
marron-noir. Ils mesurent de 6 à 10 mm de diamètre. Le palmier jupon mesure
jusqu'à 23 m de hauteur. Le palmier à jupon ou palmier de Californie (Washingtonia
filifera) est considéré comme envahissant à Hawaii et en Australie dans la
région de Perth.
Sources : a) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia,
b) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_filifera
Variété, domestiquée depuis plusieurs millénaires et cultivée dans les
régions de climat méditerranéen, de l'une des sous-espèces d'arbre
fruitier toujours verts de Olea europaea (famille des
Oléacées), produisant les olives, un fruit consommé sous
diverses formes et dont on extrait une huile alimentaire, l'huile d'olive.
Résistance à la sècheresse : En cas de sécheresse, les feuilles sont
capables de perdre jusqu'à 60 % de leur eau, de réduire fortement
la photosynthèse et de fermer les stomates permettant les
échanges gazeux pour réduire les pertes en eau par évapotranspiration,
permettant ainsi la survie de l'arbre au détriment de la production
fructi-florale. C'est grâce à sa feuille que l'olivier peut survivre en milieu
aride. Quand il pleut, les cellules foliaires s'allongent pour emmagasiner
l'eau. Et, en cas de sécheresse, les feuilles se rétractent et bloquent
l'activité de photosynthèse au détriment des fruits.
Racines : Lors de la germination du noyau, le jeune
plant développe une racine pivotante. Puis en croissant, l'olivier
développe un système racinaire essentiellement peu profond 60
à 100 cm à développement latéral, dont les racines principales
débordent peu l’aplomb du feuillage, alors que les racines secondaires et les
radicelles peuvent explorer une surface de sol considérable. Le chevelu
racinaire se limite en général au premier mètre de sol et est
particulièrement développé dans les zones plus humides. Au-delà du premier
mètre poussent des racines permettant l'alimentation de l'arbre en cas de
sécheresse. Seules les radicelles émises au cours de l'année permettent
l'absorption de l'eau. Les racines de l'olivier sont capables d'extraire de
l'eau en exerçant une importante force de succion de l'ordre de
- 25 bars sur le sol, contre - 15 bars en général
pour les autres espèces fruitières, lui permettant de prospérer là où d'autres
se flétriraient. Pour limiter la concurrence hydrique entre les oliviers,
l'espacement entre les arbres doit tenir compte des ressources en eau : la
plantation sera plus rapprochée dans les oliveraies irriguées et plus espacée
dans les vergers en culture pluviale soumis à la sécheresse.
L'Olivier cultivé (Olea europaea europaea europaea)
descend de l'oléastre, l’olivier sauvage (Olea europaea europaea silvestris).
Multiplication : L'olivier peut être multiplié par différentes
méthodes : noyaux d'olives (méthode hasardeuse), morceaux de souche et
rejets (souquets), greffes et bouturage herbacé.
Maladie : une seule maladie est réellement mortelle pour l'arbre,
le pourridié (Armillaria mellea). Autres maladies : Chancre ou
« rogne » ou Tuberculose de l'olivier (Pseudomonas savastanoi),
fumagine (Capnodium oleaginum ou Fumago salicina) etc.
Insectes : cochenille noire de l'olivier (Saissetia
oleae), mouche de l'olive (Bactrocera oleae), teigne de
l'olivier (Prays oleae), hylésine de l'olivier (Hylesinus
oleiperda), zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina), otiorhynque de
l'olivier (Otiorhyncus cribricolis) etc.
L’olivier cultivar 'Picual', originaire d'Espagne, est autofertile,
vigoureux, précoce, et s'adapte bien aux sols secs et est résistant au sel
(jusqu'à 10dSm-1).
Il existe cinq autres sous-espèces d’Olea europaea :
·
Olea europaea subsp. cerasiformis (Madère ;
sous-espèce tetraploïde),
·
Olea europaea subsp. cuspidata (la sous-espèce la
plus largement répandue dans le monde : Afrique du Sud jusqu'au Sud
de Égypte, et du Sud de l'Arabie jusqu'en Chine, régions sèches
d'Asie …),
·
Olea europaea subsp. guanchica (îles Canaries),
·
Olea europaea subsp. laperrinei (Massifs montagneux
du Sahara : Hoggar (Algérie), Aïr (Niger), et Jebel Marra (Soudan)),
·
Olea europaea subsp. maroccana (Haut Atlas
(Maroc) ; sous-espèce hexaploïde).
Production : L'olivier ne produit naturellement qu'une année sur
deux en l'absence de taille, et la production s'installe lentement,
progressivement, mais durablement : entre 1 et 7 ans, c'est la
période d'installation improductive, dont la durée peut doubler en cas de
sécheresse ; jusqu'à 35 ans, l'arbre se développe et connaît une
augmentation progressive de la production ;
entre 35 ans et150 ans, l'olivier atteint sa pleine
maturité et sa production optimale. Au-delà de 150 ans, il vieillit
et ses rendements deviennent aléatoires.
Sa longévité est exceptionnelle, peut-être plus de 3000 ans. Il peut
atteindre jusqu'à15 m de hauteur.
Par ailleurs, des populations envahissantes ont été signalées en
Australie et dans certaines îles du Pacifique. Les analyses génétiques ont
démontré que ces populations ont deux origines distinctes, l'une à partir de
formes cultivées méditerranéennes (Sud Australie) et l'autre à partir de formes
sauvages de la sous-espèce cuspidata du Sud de l'Afrique (e.g.
Est Australie, Hawaï). Une possibilité d'hybridation entre ces deux formes a
également été rapportée4.
Climat et pluviométrie : L'olivier exige un climat doux, lumineux, et
supporte tout à fait bien la sécheresse. Il craint plutôt le trop d'eau et donc
les excès d'arrosage (apport de trente à quarante litres d'eau, une à deux fois
en juillet et août, et seulement la première année après la plantation). Avec
six-cents millimètres de pluie bien répartis sur l'année, l'olivier se
développe et produit normalement. Entre 450 et 600 mm/an, la
production est possible, à condition que le sol ait des capacités de rétention
en eau suffisantes, ou que la densité de la plantation soit plus faible. Dans
le sud de la Tunisie, où la pluviométrie peut être inférieure
à 100 mm par an, la plupart des plantations comportent moins de
vingt arbres par hectare.
L'olivier ne résiste pas en général à une température inférieure
à -15 °C sauf pour certaines rares variétés
(Mouflal −25 °C). De 35 à 38 °C, la
croissance végétative s'arrête et à 40 °C et plus, des brûlures
endommagent l'appareil foliacé, pouvant provoquer la chute des fruits, surtout
si l'irrigation est insuffisante.
Sources : a) http://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-275-olea-europaea.html
b) Long term responses of olive trees to salinity,
Agricultural Water Management, Volume 96, Issue 7, July 2009, Pages 1105–1113.
c) http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Olive,
d) http://fr.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea, e) Oela (genre), http://fr.wikipedia.org/wiki/Olea
|
 
↖ Fruits verts – Fruits mûrs ↗
|
 
↖ Fleurs jeunes – Fleurs ↗
|
|

|

Olea europaea ssp. sylvestris(oléastre) à Majorque.
|
|
 
Tronc ↗
|

Oliviers envahissants, Adelaide Hills ,Australie.
|

Planche d’illustration d’Olea europaea par Franz
Eugen Köhler dans Plantes
médicinales de Köhler.
Arbre dont les fleurs d'un blanc rosé, apparaissent avant les feuilles.
C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver.
Il peut atteindre 6 à 12 mètres de haut. Il vit en moyenne plus de 100
ans et se multiplie par semis ou par greffes. Son bois, de bonne qualité,
s'utilise en ébénisterie.
Il valorise les terres pauvres car il peut pousser sur des sols
dolomitiques, caillouteux, secs, pauvre en matière organique. Il a très peu
d'exigences sauf un sol profond et perméable. Il s'accommode même des sols
légèrement salés et se plaît sur les sols calcaires. L'amandier qui préfère un
sol calcaire et sec (ph 7,5), très perméable pour évacuer les excès d'eau. Il
craint la pluie quand cela dure trop longtemps, surtout si le sol est lourd et
non drainé.
Les fleurs de l'amandier sont très sensibles au froid et cet arbre a
besoin de lumière, de soleil et d'air sec. La pollinisation dépend
essentiellement des abeilles. La récolte d'amandes fraîches (en vert) se fait
manuellement en mai et juin.
La récolte d'amandes sèches a lieu en septembre, octobre, lorsque l'écale (la
partie verte qui entoure la coque) est bien ouverte et sèche. Il aime le
soleil, il résiste bien à la sécheresse (50 à 60 mm d'eau par mois pour se
développer / 800 à 850 mm/an).
Son fruit est l'amande et est consommable par l'Homme. L'amande est
très riche en huile, protéines, glucides et vitamines. Elle contient 50 %
de lipides avec en majorité des acides gras, soit en moyenne : 75 %
d'acide oléique, 18 % d'acide linoléique et 7 % d'acide palmitique.
Elle se mange telle quelle ou séchée. L'huile d'amande amère extraite du noyau
est, depuis l'Antiquité, très utilisée pour ses propriétés cosmétiques,
adoucissantes et hydratantes en cas d'inflammation cutanée (cicatrisante et
anti-inflammatoire en cosmétologie). Elle adoucit, tonifie la peau et est
utilisée en dermatologie. Elle est aussi laxative, utilisée par les éleveurs et
vétérinaires comme purgatif pour le bétail.
Les espèces d'amandiers sauvages (Prunus dulcis amara) sont
toxiques, alors que les amandes domestiques ne le sont pas. L'amande amère
(fruit de l'amandier sauvage), est toxique pour l'homme et peut être mortelle à
certaines doses car elle contient un glycoside cyanogénique (amygdaline), qui
donne par hydrolyse de l'acide cyanhydrique lors de la consommation.
Maladies : Les maladies cryptogamiques comme la moniliose,
l'anthracnose, le coryneum et plus récemment le verticillium ainsi que les
ravageurs tels que les pucerons, les scolytes, les acariens et le capnode sont
les principaux agents biotiques qui compromettent la production et la longévité
des amandiers. Il existe des différences de sensibilité variétale.
La moniliose (due à Monilia taxa) provoque le dessèchement des
bouquets floraux. Puis des chancres se développent sur les rameaux, causant la
mort des parties situées au-dessus. La criblure (due à Coryneum bejerinckii)
se manifeste par la formation de taches circulaires brunâtres sur les feuilles,
taches qui se perforent facilement. En outre, sur les rameaux naissent de
petites lésions circulaires qui laissent exsuder de la gomme. Pour lutter dans
les deux cas, commencer par couper les rameaux malades. Pulvériser des
fongicides à base de cuivre (bouillie bordelaise), ou à base de captafol et de
thirame pour la criblure. En cas d'attaques de pucerons
Des observations sur le terrain et l'intervention des services de la
protection des végétaux permettent d'établir un calendrier de traitements en
fonction des conditions climatiques locales et des cycles des parasites.
On cultive généralement l’amande douce Prunus dulcis var. dulcis
à coque épaisse et dure, dont on se sert en pâtisserie surtout pour fabriquer
la pâte d’amande. L’amande à coque tendre (Prunus dulcis var. fragilis)
est aussi comestible et très appréciée pour la table à l’état frais, moins par
l’industrie, car la coque très mince se brise facilement.
Cet arbre fruitier, à feuilles caduques, peut se multiplier par semis
ou par greffes.
Même autofertile, l’amandier sera bien productif s’il est en présence
d’une autre variété pollinisatrice.
L’amandier n’est généralement pas autofertile ce qui implique la
proximité d’un second arbre fleuri en même temps.
Noms Scientifiques : Prunus amygdalus var. dulcis. Synonymes : Amygdalus
communis var. dulcis, Prunus amygdalus var. sativa, Prunus communis var.
sativa, Prunus dulcis.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Amandier,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Almond,
c) http://frutales.files.wordpress.com/2011/05/manual_cultivo_almendro.pdf
d) http://www.legume-fruit-maroc.com/amandier.php,
e) Maladies amandiers, http://www.agrimaroc.net/87.pdf,
f) http://www.jardiner-malin.fr/fiche/amandier-taille-plantation.html
Le Figuier comestible ou Figuier commun, est un arbre
fruitier caduque, dioïque (famille des Moracées) donnant des fruits comestibles
appelés figues.
C'est le seul représentant européen du genre Figuier qui représente
près de 600 espèces, la plupart tropicales.
Le figuier mâle qui ne donne pas de fruits comestibles, est aussi
appelé « Caprifiguier » (c'est-à-dire « Figuier de bouc »).
Il semble originaire d'une zone de climat tempéré chaud, englobant le
pourtour du bassin méditerranéen jusqu'à l'Asie centrale.
Certaines variétés peuvent cependant atteindre 8 mètres de hauteur pour
dix mètres de périmètre en conditions favorables (zone peu gélive, sol frais et
fertile) - au tronc souvent tortueux, au port souvent buissonnant.
Toutes les parties de la plante (rameaux, feuilles, fruits) contiennent
un latex blanc et irritant.
Les figuiers sauvages ont pour particularité d'avoir une reproduction
dépendant d'une symbiose avec un insecte :
le blastophage (sauf pour les variétés parthénocarpiques dites
autofertiles). Cet insecte assure la pollinisation des fleurs
femelles. En retour, le figuier abrite et nourrit l'insecte, dont le cycle se
déroule quasi entièrement dans la plante. L'hiver, les ovaires, transformés
en galles, des fleurs femelles des figues-mammes (des plants mâles)
contiennent leurs larves .
Peu exigeant, le figuier est robuste, nécessitant peu voire pas de
traitements, et peut produire très longtemps.
Le chancre du figuier (Diaporthe cinerescens), est la
seule maladie ayant une incidence économique.
Le figuier peut être cultivé sur une large gamme de sols, sable aride
et pauvre, riche limon, argile lourde ou calcaire, pourvu qu'il y ait
suffisamment de profondeur, de drainage et de nourriture. Le sol sablonneux
demi-sec contenant une bonne dose de chaux est idéal lorsque la récolte est
destinée au séchage. Les sols très acides ne sont pas adaptés. Le pH doit être
compris entre 6,0 et 6,5. L'arbre est assez tolérant à une salinité modérée7.
Il se développe sauvage dans les zones sèches et ensoleillées, avec des sols
profonds et frais, également dans les zones rocheuses, du niveau de la mer à
1.700 mètres.
Les racines du figuier étant souvent peu profondes, il faut éviter de
travailler le sol au pied de l'arbre et procéder à un paillage en été
pour conserver l'humidité du sol. Le paillage permet également de réduire la
sensibilité aux nématodes.
Le figuier commun se bouture très facilement en prélevant
durant l'hiver des rameaux d'une vingtaine de cm de long de 2 ou 3 ans d'âge
soit environ 1 cm de diamètre (ou à défaut un rameau avec bourgeon
terminal intact mais le taux de réussite sera alors plus faible) qu'on plante
tel quel dans un substrat maintenu humide et au chaud12. On peut aussi le
multiplier par semis.
Note : Le genre Figuier (Ficus) représente près de 600 espèces,
la plupart tropicales.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Ficus_carica,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Common_fig
Cet arbre (famille des moracées), mesurant jusqu'à 20 m de haut et
6 m de large, pousse du Sénégal au Nord Est de l'Afrique du Sud, dans
la péninsule Arabique et certaines régions de Madagascar, à
l'exclusion des régions tropicales humides.
Ses figues comestibles, de 2 à 3 cm de diamètre, passant du
vert au jaune rosé, poussent en grappe tout au long de l'année. Mais elles
sont souvent remplies d'insectes.
Une guêpe Ceratosolen arabicus, vivant en symbiose
dans son fruit, l’aide à se reproduire sexuellement. Dans les zones tropicales,
où la guêpe est commune, des mini-écosystèmes complexes, impliquant la guêpe,
les nématodes, les autres guêpes parasites, et divers grands prédateurs,
tournent autour du cycle de vie de la figue.
Les fruits comme les feuilles peuvent servir d'alimentation pour le
bétail en améliorant la production de lait.
Il a un port étalé donnant une ombre appréciée dans les pays chauds.
Le figuier sycomore se propage bien par bouture classique ou
même par large tronçon.
Dans son habitat d’origine, l’arbre pousse généralement sur des sols
riches, le long des rivières et dans les forêts mixtes.
Note : Pas d’indication dans la littérature sur sa
résistance au sel (?).
Suggestion : On pourrait faire pousser les figuiers dans
les limans.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier_sycomore,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_sycomorus
c) http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Ficus_sycomorus.pdf
Cet Arbre à feuilles caduques, fixateur d’azote, très épineux,
atteignant 8 m de haut, aux branches nombreuses, très ramifiées, est utilisé en
agroforesterie.
Il présente des adaptations morphologiques à
la sécheresse : pubescence, sclérification, feuilles
coriaces, rameaux chlorophylliens réduit à l'état d'épines de 2 à 7
cm, système racinaire double (un appareil racinaire superficiel
étendu capte de manière très performante l'eau immédiatement après les
précipitations dans un rayon de 20 mètres et un appareil racinaire profond
puise dans les réserves du sol jusqu'à 7 mètres). Il peut survivre à de grandes
sécheresses, telles celles de 1972-1973 et 1984-1985, jusqu'à deux ans en
l'absence de précipitations. Il pousse lentement. Il sert aux haies vives.
L'homme le cultive au Sahel, en Égypte, au Soudan,
en Arabie et en Inde. Il est commun au Sénégal et en
Mauritanie.
Il pousse bien en sol sablonneux et désertiques sur
tout type de géomorphologie : dépressions, fond
des vallées, plaines, et même montagnes. Il tolère une
grande variété de types de sols, du sable à fortement argileux
et des niveaux d'humidité allant d’aride à subhumide. Il est relativement
tolérant aux inondations, à l'activité de l'élevage, et aux feux.
Ses feuilles sèches tombées (talufakt en tamasheq) et les fleurs
(azakalkal en tamasheq) sont consommées par
différents ruminants : dromadaires, chèvres et moutons,
les éléphants … Il s'agit d'un excellent pâturage, très appétent.
Le pouvoir germinatif des graines est augmenté après leur
ingestion par une chèvre.
La partie jaune du fruit, au goût sucré avec une pointe d’amertume, est
souvent consommé frais par succion, une fois débarrassé de
son épicarpe. De l’huile alimentaire est également extraite
des amandes. Au Mali, on fait également macérer le fruit pour
produire une boisson, l’asaborad et l’amande contenue dans le
noyau, appelée tandilba, est consommée après une longue cuisson. Les
feuilles sont quant à elles séchées et réduites en une poudre utilisable dans
différentes sauces.
Le liquide obtenu en pressant le fruit est utilisé traditionnellement
pour stimuler la production de lait des mères allaitantes, et les
graines sont utilisés pour traiter des troubles digestifs. L’huile est
également utilisée pour soigner des problèmes cutanées.
Les graines et l’écorce de Balanites aegyptiaca ont des
effets molluscicides sur l’escargot Biomphalaria
pfeifferi.
Le bois jaune pâle à brunâtre est utilisé pour fabriquer des meubles et
des outils. Il fournit un bon bois de feu et un bon charbon de bois.
Note : Pas d’indication dans la littérature sur sa
résistance au sel (?).
Sources : a) http ://fr.wikipedia.org/wiki/Balanites_aegyptiaca,
b) http ://en.wikipedia.org/wiki/Balanites_aegyptiaca
c) http ://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Balanites_aegyptiaca.pdf
Le Madd (ou made) est le fruit d’une plante rampante ou liane ligneuse
sauvage, à vrilles, à latex blanc (toxique), nommée Saba senegalensis,
poussant dans les savanes africaines, généralement en bordure de cours d’eau,
plutôt dans la moitié Sud du Sénégal, mais aussi cultivé comme arbuste. C’est
une espèce à écorce gris foncé, à feuilles entières opposées aux limbes
elliptiques ou ovales. La floraison est étalée sur toutes les saisons. Les
fleurs sont très odorantes et de couleur blanche, jaunâtre ou blanc verdâtre.
Son fruit arrive à maturité avec les premières pluies, après avoir passé plus
d’un an sur la liane...
Son fruit est une coque globuleuse qui contient des graines enrobées de
pulpe jaune juteuse, acidulée et sucrée.
On peut déguster le fruit tel quel ou l’assaisonner avec du sucre, du
sel et du piment.
C'est possible de faire du jus avec le Madd. Mélangées avec de l’eau et
du sucre, les pulpes donnent un délicieux jus. C'est un fruit riche en vitamine
C, thiamine, riboflavine, niacine, en vitamine B6, acide malique, calcium,
phosphore et en magnésium. Son fruit est appelé zaban (en bambara ou dioula),
malombo (dans le bassin du Congo), maad (en wolof), made (en français d’Afrique)
et wèda (en mooré), ou côcôta (en Côte d’ivoire).
On le retrouve aussi en
Afrique de l’Est, lui ou un fruit voisin (et une plante très voisine), Saba comorensis, en Tanzanie par exemple.
Le Saba senegalensis est apprécié pour son ombrage et son rôle
ornemental. Il est de plus en plus utilisé dans les aménagements paysager, se
développant sur un ou sans support.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Saba_senegalensis,
b) https://uses.plantnet-project.org/fr/Saba_senegalensis
|

Plante (Saba senegalensis)
|

Fruit (Saba senegalensis)
|
|

Fleurs (Saba senegalensis)
|

|
|

Fruit ouvert et pulpe (Saba senegalensis).
|

Fleur de Saba comorensis
|
C’est une plante grimpante ou liane répandue dans la plupart des pays
d'Afrique tropicale, ainsi qu'à Madagascar et aux Comores. Cette liane peut mesurer plus de 20 m
de long. Elle produit un latex collant quand on la coupe. Cette
plante présente des feuilles vertes, simples, opposées, elliptiques et sessiles
avec un bord entier, à base arrondie, à extrémité obtuse ou arrondie, mesurant
de 7 à 16 cm de long sur 4 à 8 cm, des fleurs très parfumées à cinq pétales de
couleur blanche. Les fleurs s'organisent en ombelles à terminaisons courtes,
leurs corolles sont tubulaires, avec une gorge jaune et des pétales blancs.
Le fruit mesure 4-8 cm de
long et 3.5-6 cm de large. D'abord vert, il vire au jaune orangé avec une peau
d'orange dure. Une fois ouvert, il contient une douzaine de pépins marron
foncé, qui ont la même texture qu'une graine de mangue avec les fibres et le
jus enfermés dans ces fibres. Le fruit donne également un jus délicieux au goût
de mangue, orange et ananas. L'espèce ne fructifie pas chaque année. La
période de floraison de cette plante envahissante est assez variable.
Elle débute en octobre au Burkina faso et en février en Tanzanie.
Sources : a) https://en.wikipedia.org/wiki/Saba_senegalensis
C’est une
espèce d'arbustes, à feuilles persistantes, de la
famille des Capparaceae (celle des
câpres), originaire d'Afrique de l'Ouest (Sahel).
Aliment
traditionnel en Afrique, son fruit peu connu en Occident a le potentiel
d'améliorer la nutrition, renforcer
la sécurité alimentaire, favoriser le développement rural et l’entretien
durable des terres.
Cet arbuste peut pousser n'importe où de 2 à 5 m (6 pi 7 po à 13 pi 1
po) de hauteur dans des conditions favorables. Il supporte bien le vent. Les
feuilles à pétiole court sont petites et coriaces. Elles atteignent 12 cm × 4
cm (4,7 po × 1,6 po). Il produit des fruits, regroupés en petits bouquets, sous
la forme de baies jaunes sphériques, jusqu'à 1,5 cm (0,59 pouces) de diamètre.
Ces fruits contiennent 1-4 graines, qui sont d'une teinte verdâtre à maturité.
Utilisations : Ses graines sont transformées en diverses
produits alimentaires. Elles servent à la fabrication d'entre autre de
couscous, farines, gâteaux, biscuits, popcorns, hommos, et boissons. L’espèce à
des utilisations médicinales.
Il est reconnu comme une solution potentielle à la faim et un tampon
contre la famine dans la région du Sahel.
Amertume : Les graines de hanza sont à l'état brut
fortement amères, un goût dû à des doses élevées de glucocapparine (MeGSL).
Pour qu'elles soient rendues comestibles, elles doivent d'abord être
désamérisées. Ceci se fait habituellement par des techniques d'immersion
prolongée dans l'eau, pouvant durer une semaine. La glucocapparine se dégage
dans l'eau, où elle se retrouve dans une forme transformée, en
methylisothiocyanate (MeITC). Cette eau amère a des effets de pesticide et
d'herbicide.
L'amertume du hanza joue un rôle de pesticide naturel, qui protège les
fruits lorsqu'ils sont sur l'arbre. Il est rare de voir des prédateurs
s'attaquer aux fruits avant que ceux-ci ne soient pleinement mûrs. C'est alors
seulement que les oiseaux s'intéressent à leurs mésocarpes sucrés. De même, des
graines amères récoltées et séchées n'ont pas de parasite connu lors du
stockage. Ainsi, les graines de hanza peuvent être conservées durant des années
sans grand effort, tant qu'ils sont à l'abri de la pluie et de l'humidité. Ils
peuvent ensuite être désamérisés et consommés au fur et à mesure, selon le
besoin. Ceci peut être d'une grande utilité dans la recherche de la sécurité
alimentaire.
Source : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Boscia_senegalensis,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Boscia_senegalensis
|

Boscia senegalensis, apparus dans un champ
|

Feuilles et fruits
|
|

Fruits non mûrs
|

Pain hanza, biscuits et hanza cuit, Zinder, République du
Niger.
|
C'est une espèce d'arbres africains, pouvant atteindre 40 m de haut, natif du Sénégal et d'autres pays d'Afrique
de l'Ouest. Contrairement
à la plupart des espèces de Fabacées (légumineuse), il
produit des fruits sphériques ou de forme ovale, de couleur verte, avec pulpe
farineuse, et ne fixe pas des quantités significatives
d'azote. Il fournit aussi
des ingrédients pour la médecine traditionnelle et un bois de qualité.
Description : il
a des branches épaisses irrégulièrement disposées. Le tronc des arbres adultes atteint
typiquement 60 à 100 cm de diamètre. Son fruit est une drupe sphérique vert foncé contenant une pulpe
fibreuse entourant une graine unique. Cette disposition est proche de celle des
fruits du tamarinier.
La saveur aigre-douce du fruit est appréciée et celui-ci se conserve bien sur
les étals, grâce à sa peau épaisse et à sa pulpe sèche.
Toxicité et amélioration génétique : Certains individus
produisent par exemple des fruits toxiques et il n'existe pas de moyen
certain de les distinguer de ceux dont les fruits sont comestibles. Les arbres
qui produisent des fruits toxiques sont souvent identifiables par la présence de
fruits intouchés à leur pied, alors que les animaux s'en emparent normalement
très rapidement. Les arbres du
genre Detarium n'ont pas encore été systématiquement cultivés ou améliorés
génétiquement, alors qu’il est nécessaire de l'améliorer génétiquement,
pour pouvoir les exploiter plus largement en agriculture et résoudre ce
problème de toxicité.
Habitat, écologie : Ces arbres poussent généralement dans
les forêts-galeries, les savanes ou le long des berges des rivières. Ces arbres
supportent bien la sécheresse et peuvent pousser dans des zones infertiles,
dans la mesure où ils sont relativement insensibles à la nature du sol, à
l'altitude, à la chaleur et à l'humidité.
Reproduction, feuillaison, floraison, fructification : Cet
arbre se propage grâce à ses
graines, souvent transportées par les éléphants ou les chimpanzés qui
consomment ses fruits. Ces graines germent entre 6 et 10 semaines après avoir
été dispersées, mais leur taux de germination est naturellement bas. Il possède deux phases de fructification.
Il perd généralement ses feuilles au début du mois de mars et elles repoussent
quelques semaines plus tard. La floraison se produit après le développement des
jeunes feuilles. À mesure que le fruit mûrit, son goût devient plus sucré et il
se charge en vitamine C. Il atteint son plein mûrissement entre août et novembre,
selon la région.
Le temps de multiplication
peut être réduit par la greffe. Pour Detarium senegalense, la greffe
apicale est la plus efficace, si elle est faite à la fin de la saison sèche.
Maladies : Leur bois présente une bonne résistance
aux attaques des termites, des Platypodinae et des térébrants
marins ; il est cependant sensible à celles
des Bostrichidés du genre Lyctus.
Utilisations : La farine d'« ofo » produite à
partir des graines est souvent utilisée pour épaissir les soupes. La pulpe du
fruit est mangée directement, en sorbet, en jus, en confiture ou séchée comme
des dattes. Le bois, surnommé « acajou africain », est caractérisé par
sa teinte brun-rouge sombre. Il est lourd mais facile à travailler et résiste à
l'humidité, aux intempéries et à des ravageurs comme les termites et autres
térébrants. Il est apprécié pour la construction de bâtiments, de clôtures et
de bateaux, mais aussi comme bois de chauffe, car il brûle facilement et
proprement. Ces arbres sont souvent employés dans les programmes de
reboisement dans les zones au sol dégradé, puisqu'ils poussent bien même sur
des sols pauvres.
Stockage : Leur stockage à
environ 4 °C leur
conserve leur qualité en limitant la perte de vitamine C. Lorsque le fruit
s'abime, sa peau devient brun-jaune. Un tamis est utile pour séparer les débris
et la graine de la pulpe, et un mortier permet de réduire celle-ci en purée.
Economie, sécurité alimentaire : Les « detars »
jouent aujourd'hui un rôle important dans la cuisine et l'économie du Sénégal. Il pourrait contribuer à la sécurité
alimentaire, à une agriculture
durable et au développement rural. Des
fruits comme le ditakh peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de
vie locale (aliment et source de revenus), dans la mesure où ils sont riches en
nutriments, faciles à préparer et ont un goût communément apprécié. Le jus de
ditakh, riche en vitamine C, est délicieux et très apprécié au Sénégal.
Tabous et conflits : Il est important d'essayer d'améliorer
l'estime des populations pour les fruits sauvages, car leur consommation est
traditionnellement mal considérée.
Des conflits pour la possession des arbres peuvent aussi survenir si
ceux-ci ne sont pas cultivés. Une solution potentielle est l'adoption de la « sylviculture
de sauvegarde », où les populations locales bénéficient d'une part garantie des
profits, ce qui les motive à préserver la ressource sauvage.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Detarium_senegalense,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Detarium_senegalense
c) https://www.senegal-export.com/le-ditakh,91
d) https://uses.plantnet-project.org/fr/Detarium_senegalense_(PROTA)
|

fruits
|

|

|
|

Infusion de fruits de ditakh
|

Jus
|

|
|

Port de l’arbre © P. Poilecot. CIRAD
|

© Sénégal Export.
|
|
C'est un arbre caduque, de
la famille des Combretaceae,
à croissance rapide, pouvant atteindre 12 m de hauteur et 60 cm de diamètre,
présent en Afrique tropicale, depuis le Sénégal, la Mauritanie, jusqu'au Soudan
et en Ouganda.
Plus ou moins pérenne, il perd ses feuilles pendant quelques mois
durant la saison sèche des régions les plus sèches, mais les conserve dans la
savane.
Description : Il possède une couronne ouverte avec des
branches basses qui retombent et est à feuilles caduques. Le tronc est
généralement tordu et bas ramifié, avec une écorce rugueuse gris-noir. Les
feuilles vertes coriaces épaisses ont une sensation gommeuse et sont gluantes
quand elles sont jeunes. La plante fleurit pendant la saison sèche après les
feux de brousse qui facilitent le rinçage des feuilles qui favorise la
floraison. Au Burkina Faso et au Mali, les fleurs ont tendance à apparaître
entre décembre et mars, mais cela varie d'une région à l'autre et les fleurs
peuvent apparaître jusqu'en juillet. Le fruit est une samare elliptique à
quatre ailes et a une sensation collante, rougeâtre et devient jaunâtre vers la
fin de la saison. Le fruit mesure généralement 2,5 à 4 centimètres (0,98 à 1,57
in) de long et 1,5 à 3 centimètres (0,59 à 1,18 in) de diamètre. Il porte des
fruits généralement en janvier et la fructification dure jusqu'en novembre.
Habitat : On la rencontre dans la savane arborée, habituellement
sur des sols peu profonds, dégradés, plutôt sableux, drainés, dans des zones où
les précipitations sont comprises entre 200 et 700 mm (900 mm) par an.
Maladies : Les parasites végétaux, infectant Combretum glutinosum, sont
ceux de la famille des Loranthacées.
Récolte : Les graines sont récoltées en secouant les
branches de l'arbre.
Utilisations : Récoltée à l'état sauvage, l'espèce connaît
de très nombreuses utilisations. Quoique amères, les jeunes feuilles sont
parfois consommées comme légumes. Les graines sont oléagineuses et un
kilogramme contient environ 20 000 graines, et il a un rendement potentiel en
huile d'environ 24%. Plusieurs parties de la plante sont employées pour
fabriquer divers colorants. Le bois est dur, dense et résistant. On l'utilise
pour la construction, la menuiserie, la fabrication d'outils, ou pour faire du
charbon de bois. Il est très prisé en médecine traditionnelle et des travaux
scientifiques ont mis en évidence la présence de plusieurs composants actifs.
Stockage des graines : Les graines conservées pendant 18 mois à
une température maintenue à 4 °C (39 °F) ont un taux de germination de 84 % à
la plantation. 95% de germination a également été rapporté par "après
séchage à des teneurs en humidité en équilibre avec 15% d'humidité relative et
congélation pendant 1 mois à (-) 20 degrés C." La température optimale
pour la germination se situerait entre 25 °C (77 °F) et 30 °C (86 °F).
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Combretum_glutinosum
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Combretum_glutinosum
c) https://uses.plantnet-project.org/fr/Combretum_glutinosum_(PROTA)
|

Feuilles de Combretum glutinosum, Réserve de Pama,
Burkina Faso
|

Une espèce
de Combretum au Burkina Faso.
|

Port de l’arbre en fruits (Prota).

Branches en fruits (Prota).
|

Albizia lebbeck © Bruce Cook
|
(Famille des Fabacées
/ Fabaceae)
|
 
|
U
|
|
|
Il est l' Arbre de Vie à Bahreïn. Ce petit arbre, de 3 à 5 m
de haut, a une durée de vie d’environ 400 ans ou plus. Il pousse dans les
déserts dépourvus de toute source visible de l'eau.
Le bois de P. cinéraire est une bonne source d'énergie,
et offre un excellent charbon de bois [4] [7]. Les feuilles, appelées
"Loong" en Inde et les gousses sont consommées par le bétail et sont
un fourrage bénéfique. Au Rajasthan, en
Inde, P. cinéraire est cultivé dans un cadre de l'agroforesterie
en collaboration avec le mil [7]. L'arbre est bien adapté à
une agroforesterie souple, car il a un seule épaisseur de feuillage,
il est un fixateur d'azote (contribuant ainsi à enrichir le sol), et sa
profonde racine évite la concurrence pour l'eau avec les cultures.
Comme d'autres Prosopis spp., Prosopis cineraria a
démontré une tolérance pour les environnements fortement alcalins et
salins.
L'arbre se rencontre dans des conditions extrêmement arides, avec des
précipitations aussi faibles que 150 mm par an; dans ces conditions, sa
présence est indicative d'une nappe d'eau profonde.
Cet arbre ne convient pas pour la plantation dans les zones riveraines
(sur les berges de rivières) ou des environnements subhumides où il peut
devenir un colonisateur agressif et se propager rapidement.
Mais il est à préférer au Mesquite (Prosopis juliflora).
Source : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Prosopis_cineraria
b) www.winrock.org/fnrm/factnet/factpub/FACTSH/P_cineraria.htm
|
(Famille des Fabacées
/ Fabaceae)
|
 
|
U
|
|
|
Callitris tuberculata est un arbuste persistant,
atteignant jusqu’à 8 m, la famille de la famille des cyprès (Cupressaceae),
originaire du sud de l'Australie occidentale. Selon l'INRA, il est l’arbre le
plus résistant du monde à la sécheresse.
Note : La cavitation correspond à la formation d'une bulle d'air dans
les vaisseaux des arbres (xylème), qui rompt la colonne d'eau et rend ainsi
impossible le transport de la sève dans l'appareil vasculaire. La cavitation se
produit lors d'épisodes de sécheresse sévère et conduit à la mort de l'arbre
lorsqu'elle atteint des taux importants. Or le Callitris tuberculata
possède une grande résistance à ce phénomène.
Synonyme : Callitris preissii Miq., C. robusta
(°) partie orientale du sud des Wheatbelts de la région
de Goldfields dans le Grand désert de Victoria. Callitris
tuberculata pousse principalement sur les collines et
les plaines de sable du désert rouge et sur les dunes
côtières.
Sources : a) Extreme aridity pushes trees to their
physical limits, Larter M., Brodribb J., Pfautsch S., Burlett R., Cochard
H., Delzon S., 2015, Plant Physiology. doi:10.1104/pp.15.00223, b) http://de.wikipedia.org/wiki/Callitris_tuberculata, c) http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/Toutes-les-actualites/Communique-presse-Callitris-tuberculata-l-arbre-le-plus-resistant-du-monde-a-la-secheresse,
d) https://fr.wikipedia.org/wiki/Callitris_preissii, e) http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2692900,
f) http://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:biodiversity.org.au:apni.taxon:409007 (?)
Contact scientifique : Sylvain Delzon (05 40 00 38 91) Unité
Biodiversité, gènes et communautés (Inra, Université de Bordeaux),
|
(Famille des Fabacées
/ Fabaceae)
|

|
U
|
|
|
Originaire d'Afrique australe, on le trouve en Angola, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, au Swaziland, en Tanzanie, au Zaïre, au Zimbabwe et en Zambie.
Il est également connu sous le nom d'arbre à bois de sang, car
lorsqu'il est haché ou endommagé, une sève rouge foncé qui ressemble
étrangement au sang, suinte de l'arbre. En fait, le but de la sève est de
coaguler et de sceller la plaie pour favoriser la guérison, tout comme le sang.
Pterocarpus angolensis est un arbre à feuilles caduques de
taille moyenne avec une couronne ouverte, arrondie ou étalée ; il pousse
généralement de 5 à 20 mètres de haut mais des spécimens allant jusqu'à 35
mètres. Parfois, la plante n'est qu'un arbuste pouvant atteindre 5 mètres de
haut.
Les arbres qui poussent sur de bons sites en pleine lumière vivent
jusqu'à 100 ans, âge auquel ils atteignent une hauteur d'environ 20 mètres ou
plus, avec un diamètre de couronne de 10 à 12 mètres et un diamètre de fût de
50 à 60 cm. Son épaisse écorce liégeuse le protège des feux de brousse.
Usages
Son bois brun est résistant
aux termites et foreurs, est durable et a un parfum agréable épicé.
Ce bois se polit bien et est connu en Afrique
tropicale sous le nom de "Mukwa" quand il est utilisé pour fabriquer
des meubles. Comme il ne gonfle pas ni ne
se réduit au contact de l'eau, il est idéal pour la construction de pirogues.
Une espèce de bois clé dans toute son aire de répartition, donnant un
bois de haute qualité (bois précieux).
La plante est également souvent cultivée comme arbre d'ornement pour
les rues et l'ombre, étant particulièrement appréciée pour ses masses de fleurs
jaune-orange parfumées.
Reproduction
La régénération est suffisante mais peut être épisodique, en fonction
des incendies ou des fortes précipitations.
Menaces
Dans la plupart des régions de son aire de répartition, l'espèce est
devenue moins fréquente, en particulier là où elle est fortement utilisée par
les populations locales.
Dans certaines parties de son aire de répartition, les arbres les
plus grands et les plus matures sont menacés par la surexploitation du bois, ce
qui entraîne le déclin de certaines sous-populations en dehors des zones
protégées et parfois à l'intérieur des sites protégés en raison de
l'exploitation forestière légale et illégale. Dans les zones d'extraction,
la structure de taille des sous-populations est devenue tronquée, les arbres
plus petits étant beaucoup plus courants que ceux de plus grande taille, ce qui
réduit la quantité de graines produites par la population. On s'inquiète de
l'impact que cela pourrait avoir sur la régénération de certains sites.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir dans
quelle mesure cela menace la viabilité future de l'espèce. Malgré ces menaces
pour l'espèce, il est probable qu'une grande population de Pterocarpus
angolensis subsistera dans toute son aire de répartition, car tous les
arbres ne sont pas exploitables en raison de défauts ou de leur petite taille.
L'espèce est également très répandue. La persistance de l'espèce à un stade de
suffruque et sa capacité à coloniser des paysages exposés sont également à son
avantage. On sait que de grands peuplements sont encore présents par endroits,
en particulier dans les zones protégées d'Afrique du Sud, du Botswana et de
Namibie .
La plante est classée comme "préoccupation mineure" dans la
liste rouge des espèces menacées de l'UICN.
Sources : a) Pterocarpus angolensis, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pterocarpus_angolensis
b) https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Pterocarpus+angolensis+DC.
c) http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Pterocarpus+angolensis
|
(Famille des Fabacées
/ Fabaceae)
|
 
|
U ↗
|
|
|
Arbre pouvant atteindre 18 à 30 m de haut, originaire
des régions tropicales du sud de l'Asie, il est largement cultivé et naturalisé
dans d'autres régions tropicales et subtropicales. Les bovins le préfèrent en
tant que fourrage.
Habitat / écologie: « forêts fermées tropicales, zones perturbées.
Les habitats indigènes de cet arbre fixateur d'azote comprennent les bancs de
sable des rivières, les savanes, les forêts et les endroits broussailleux. Il
est bien adapté aux sols pauvres, tolère le brouillard salin côtier ». (Weber,
2003, p 36.). Souvent planté comme arbre d'ombrage à croissance rapide.
« L'arbre produit de grandes quantités de graines et des
plantules à croissance rapide et il peut atteindre des densités élevées. Les
surgeons de ses racines, une fois établies forment des peuplements denses »
(Weber, 2003, p 36.).
A Porto Rico, il apparaît dans une liste gouvernementale sur
les espèces envahissantes (Federal Highway Administration, 2001).
En Afrique du Sud, A. lebbeck envahit les brousses côtières et les berges. Il
est considéré comme invasive au Venezuela, dans les Caraïbes, les îles du
Pacifique, à la Réunion …
Taux « d’invasivité » : A évaluer (Australie), Score :
4. Risque élevé (Pacifique), le score: 7
Usages : Il est souvent utilisé pour son fourrage, en
agroforesterie, ses applications médicinales, son bois, comme arbre d'ombrage.
Certains herbivores l’utilisent comme ressource alimentaire.
Source : a) https://uses.plantnet-project.org/fr/Albizia_lebbeck,
b) http://www.hear.org/pier/species/albizia_lebbeck.htm,
c) http://fr.wikipedia.org/wiki/Albizia_lebbeck,
d) http://www.mi-aime-a-ou.com/Albizia_lebbeck.php
e) http://www.doc-developpement-durable.org/fiches-arbres/Fiche-presentation-albizia-lebbeck.pdf
|

Fleurs et graines
|


Fleurs et feuilles
|

|
|

Graines
|

|
|
(Famille des Fabacées
/ Fabaceae)
|
 
|
U ↗
|

|
|
C'est un acacia atteignant une hauteur de 8 à 10 m environ, à
inflorescence globuleuse et fortement parfumé largement répandu dans les régions
tropicales.
Les branches retombantes, de cet arbuste au port érigé, sont armées de
longues épines stipulaires, droites et blanches, de 1,5 à 5 cm.
Il possède une floraison en glomérules (12 mm de diamètre)
[en boules] de fleurs jaunes, très parfumées.
Les graines, brunes _ dans des gousses rondes, brunes à noirâtres
d'environ 7 cm de long _, mesurent jusqu'à 7 mm de long.
Usages : On extrait des fleurs une huile utilisée en parfumerie. Le
feuillage est une source importante de fourrage, contenant environ 18% de
protéine. En Australie, le feuillage de cet arbuste est parfois utilisé
pour nourrir le bétail. L'écorce est utilisée pour son tanin. Les feuilles
sont utilisées comme un tamarin pour aromatiser
les chutneys et les gousses sont torréfiés pour être utilisées dans
les plats aigre-doux. Mais son usage le plus commun est ornemental ;
il peut être planté seul ou en bosquet, mais il est aussi utilisé pour
constituer des haies. L'écorce et les fleurs sont, utilisées, en médecine
traditionnelle, contre le paludisme, pour traiter les diarrhées et
les maladies de la peau, en la frottant avec les feuilles.
Peu exigeant en ce qui concerne la nature du sol, cet arbuste préfère
les situations ensoleillées et résiste à la sécheresse. Aux Antilles, on le
trouve dans les fourrés épineux xérophiles.
Cette espèce est originaire d'Amérique tropicale, et répandue par
l'homme dans d'autres zones chaudes du monde, comme dans de nombreux pays
d'Afrique, et en Australie. Elle est commune dans les Antilles françaises.
Appelé parfois Cassie ancienne, Cassie du Levant, Mimosa
de Farnèse (pour certains auteurs, Vachellia farnesiana).
Propagation : par les graines. Durée de vie : 25 à 50 ans. Il prospère
dans les endroits secs, salins, ou les sols sodiques.
Il est considéré comme envahissant en Australie (Nouvelle-Galles du
Sud), aux Fidji. Invasivité : Risque élevé, score: 14 (Australie).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassier,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Vachellia_farnesiana,
c) http://www.hear.org/pier/species/acacia_farnesiana.htm
|
(Famille des Fabacées / Fabaceae,
sous-famille des Mimosaceae,
selon la classification phylogénétique).
|
 
|
U $
|
|

|
Arbre épineux à l'écorce verdâtre ou rougeâtre pâle de 6-10 m
(20-30 pi) de hauteur. Avec l'Acacia senegal, il s'agit d’une des deux
espèces produisant de la gomme arabique. La gomme obtenue à partir de
cette espèce est de consistance plus friable (ou Vachellia seyal selon
certains auteurs).
Ses fleurs sont réparties dans des grappes rondes jaunes claires
d'environ 1,5 cm dans (0,5 po) de diamètre. Ses épines peuvent atteindre
7-20 cm de long. Dans Vachellia seyal var. Fistula, plus
fréquente sur les sols argileux lourds, la base renflée de des épines
offrent un abris à certaines fourmis symbiotiques.
Son aire de distribution va de Egypte au Kenya et à
l'ouest du Sénégal. Au Sahara, il pousse souvent dans les
vallées humides.
Cette espèce comprend plusieurs variétés distinctes :
Selon Catalogue of Life (19 juin 2013) :
Variété Acacia seyal var. fistula et variété Acacia
seyal var. seyal
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Acacia_seyal,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Vachellia_seyal
Arbre épineux mesurant jusqu'à 30 m de
hauteur et 2 m de diamètre, originaire d'Afrique et
du Moyen-Orient.
Sa racine pivotante pénétrant profondément le sol
(jusqu'à 15 m de profondeur2) le rend très résistant à
la sécheresse.
Il pousse dans des zones recevant
250-600 mm de précipitations annuelles. Le Faidherbia
albida a une stratégie de vie inversée par rapport à la plupart des
arbres de zones arides. Il est le seul arbre de la zone
semi-aride sahélienne à perdre ses feuilles à la saison des pluies et
à reverdir en fin de saison des pluies, en prolongeant sa période de
feuillaison en saison sèche (« phénologie inversée »).
Perdant ses feuilles en début de la nouvelle saison des pluies, elles se
décomposent mieux.
C'est une espèce intéressante pour l'agroforesterie car elle offre
un ombrage et un fourrage apprécié du bétail. L'arbre s'alimente dans
les nappes phréatiques profondes et ne concurrence pas les cultures,
de plus sa litière améliore les sols. En pleine saison sèche les stomates se
ferment et les feuilles réduisent de moitié leur « pertes » d'eau,
avec alors une moindre capacité photosynthétique, probablement liée à un manque
d'azote disponible et mobilisable par l'arbre. Ils sont capables, en saison des
pluies, de changer de stratégie et de prélever alors leur eau près de la
surface. Ils évapo-transpirent beaucoup d'eau, surtout en début
de la saison sèche (+/- 400 litres/jour pour un arbre dont le tronc
mesure 65 cm de diamètre, cependant, comme il y a peu de ces
arbres par hectare, leur rôle de transfert d'eau de la nappe vers l'atmosphère
reste limité, bien qu'atteignant environ 5 % des pluies.
Ses fleurs fournissent du pollen aux abeilles à la fin de la
saison des pluies, quand la plupart des autres plantes locales n'en ont pas.
Les gousses sont très importantes pour l'alimentation
du bétail (bovins, dromadaires, etc.). Ses fruits et ses
feuilles sont utilisés dans la pharmacopée traditionnelle. L'arbre
fournit également du bois et le tannin de son écorce.
L'acacia Faidherbia Albida est considéré par les populations
soudano-sahéliennes comme l'« arbre miracle » du fait de ses nombreuses
fonctions et de sa capacité à pousser dans des sols sablonneux semi-arides.
Il tolère l’inondation et la salinité saisonnière mais ne peut pas
supporter les sols argileux lourds (selon l’ICRAF).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Faidherbia_albida,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Faidherbia_albida,
c) http://database.prota.org/PROTAhtml/Faidherbia%20albida_En.htm,
d) http://www.fao.org/docrep/006/s4009f/S4009F22.htm
e) Les
moissons du futur, Marie-Monique Robin, ARTE, http://www.arte.tv/fr/faidherbia-l-arbre-miracle/6984730,CmC=6984954.html
f) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-Faidherbia-albida.pdf,
g) Faidherbia albida, World Agroforestry Centre (ICRAF), http://www.worldagroforestry.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=1
|

Système de racines d’Acacia albida
|

Palmiers rônier
et Faidherbia poussants en agroforesterie dans
un champ de maïs.
|
|
 
Fleur (à gauche), gousse (à droite)
|

Gousses
|
|

|

|
|

|

|
|

|
|
|
|
|
Petit arbre ou arbuste avec une houppe étalée [au port étalé], à fleurs
blanches, en grappes de 2,5 à 6,0 cm de long.
Gousse oblongue, aplatie, glabre, 3,0-8,0 x 1,5-2,5 cm, brun pâle,
comme du papier, ressemblant à ceux d'Acacia Sénégal. Il préfère les sols
à texture moyenne à fine.
Distribution : Écozones soudaniennes et guinéennes, dans des conditions
de sol relativement humide dans le sud du Sahel (vallées étages, autour des
étangs, etc.).
Produits et utilisations : broutage / pâturage, bois de service, bois
de feu, charbon de bois, de fibre (racines), médecine (anti diarrhéique) et la
réhabilitation des terres et des sols.
Il s’hybride
avec Acacia laeta et Acacia Sénégal dans leur zones de
chevauchement.
Sources : a) http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/gbase/DATA/Pf000353.htm
b) L’acacia au
Sénégal, IRD, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010016064.pdf
|
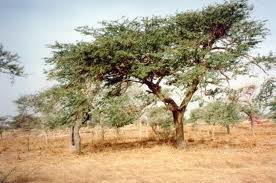
|

|
|

Fleurs
|
 
Gousse (à gauche), écorce (à droite).
|
Cet arbre épineux, encore appelé gommier blanc, peut atteindre
une hauteur de 5-12 m et un tronc de 30 cm de diamètre. Il peut être
multiplié par semis ou boutures.
S. senegal est la source de la gomme arabique de la
plus haute qualité dans le monde. On tire de l'exsudat de l'Acacia senegal
la gomme arabique, utilisée à large échelle dans les industries pharmaceutique,
alimentaire, cosmétique et textile (elle est utilisée comme additif
alimentaire, dans l'artisanat, et comme cosmétique). On le récolte en
pratiquant des entailles dans le tronc et les branches de l'arbre. Le bois très
dense sert à fabriquer des manches d'outils et à produire un charbon de haute
qualité. L'écorce est riche en tannins et est utilisée dans la
pharmacopée populaire pour ses propriétés astringentes et expectorantes. Le
jeune feuillage est très utile comme fourrage (les éléphants, les girafes
… l’apprécient). Les graines séchées sont utilisées
comme nourriture par l'homme. L'écorce de l'arbre et ses racines sont
utilisées pour fabriquer de la corde.
Comme les autres espèces de légumineuses, S. senegal fixe
l'azote dans les rhizobiums ou bactéries fixatrices d'azote qui
vivent dans les nodules des racines. Cette fixation de l'azote
enrichit les sols pauvres où il est cultivé, permettant la rotation d'autres
cultures dans les régions naturellement pauvres en éléments nutritifs. Sa
croissance est lente.
Il est adapté aux régions chaudes et sèches, même à des pluviométries
pouvant atteindre 300 à 500 mm par an.
Il aurait des propriétés médicinales et traiterait
les saignements, la bronchite, la diarrhée, la
gonorrhée, la lèpre, la fièvre typhoïde et les infections
des voies respiratoires supérieures (à vérifier). De 2003 à 2007, le
prix de la tonne de gommes est passé de 1500 $ à 4500 $.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Acacia_S%C3%A9n%C3%A9gal,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Senegalia_senegal,
c) http://database.prota.org/PROTAhtml/Acacia%20senegal_En.htm
Arbuste d’environ 4 ½ m de haut, très résistant à la sécheresse,
présent dans le Sahara, au nord du Sahel, Afrique de l'Est et de l'Arabie.
Il peut survivre dans les zones avec une gamme de précipitations
entre 50 et 400 millimètres (2,0 et 15,7 po) par an. Il croit
généralement dans les dépressions et des ravins peu profonds, les lieux où l’on
peut s'attendre que l'eau s'infiltre dans le sol, lors des rares occasions où
la pluie tombe. Il est souvent dominant dans le type de végétation de la zone
dans laquelle il se développe. Il est important qu'il ne soit pas surexploité
en raison de son importance pour les peuples autochtones .
Le feuillage d'Acacia ehrenbergiana est utilisé pour
l'alimentation du bétail et les arbres sont parfois étêtés à cet
effet. Il s'agit d'une plante fourragère importante pour les chameaux, les
chèvres et les moutons. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui font du
miel d'acacia à partir du nectar. Le bois est utilisé pour le
charbon de bois et le bois de chauffage. La fibre de l'écorce sert à faire des
cordes. La sève produit une faible qualité de gomme qui
suinte de parties endommagées du tronc. Une pommade est faite à
partir de parties broyées la plante.
Difficultés pour sa multiplication : faible taux de germination des
graines et une forte mortalité des semis. Il existe une technique de
multiplication in vitro (voir biblio ci-dessous).
La plante ressemble un peu à A. seyal avec lequel il a été parfois
confondu.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_ehrenbergiana, b) http://plants.jstor.org/upwta/3_271, c)
The useful plants of west tropical Africa, Vol 3, Burkill, HM 1985. d) In vitro
regeneration and multiplication for mass propagation of Acacia ehrenbergiana
Hayne: a potential reclaiment of denude arid lands, S. B. Javed, M. Anis, P. R.
Khan, I. M. Aref, Agroforestry Systems, June 2013, Volume 87, Issue 3, pp
621-629 (article payant), http://link.springer.com/article/10.1007/s10457-012-9583-8
Arbuste ou petit arbre 2-8 m de haut, aux fleurs blanc ou de crème par
25-50 formant une boule.
A. ampliceps fait partie, avec A. bivenosa, d’un complexe
qui comprend également A. ligulata, A. salicina et A. sclerosperma, bien
que les trois derniers soient morphologiquement très différents du premier. Tandis
que les trois autres A. sclerosperma, A.
ligulata et A. salicina se développent très bien dans
les zones arides méditerranéennes de Tunisie et d'Israël (Le Houérou et
Pontanier, 1987). A. sclerosperma est donc le seul du
groupe à être en forme à la fois au Sahel et dans les terres arides du bassin
méditerranéen dans l'état actuel des espèces introduites dans les deux
écozones. En raison de son port buissonnant, complexe,
s’étendant latéralement, A. sclerosperma est particulièrement
adapté à des projets de lutte contre l'érosion (Dommergues et al., 1999).
Note : A. ampliceps, A. bivenosa et A.
sclerosperma se développent bien au Sahel et Cap-Vert, mais pas A. ligulata et A. salicina
(Delwaulle, 1979; Hamel, 1980; Cossalter, 1985, 1986, 1987).
Il est endémique d'une région du Territoire du Nord et des régions de
Kimberley et de Pilbara en Australie-Occidentale où il est présent le long des
cours d'eau et dans les plaines inondables, sur les dunes de sable côtières et
les marais salants poussant sur des sols sablonneux.
Durée de vie: jusqu'à 50 ans. Il nécessite 200-800 mm et 3-7
mois de saison des pluies. Il peut être trouvé sur les sols sableux ou limoneux
alluviaux ou alcalins. Il est très tolérant à la salinité (on l'appelle aussi
Acacia salé). L'arbre est sensible au gel.
Usage : bois dur rond, bon combustible, bon fourrage, les
graines sont consommées par les humains.
Reproduction : Il se propage par ses semences.
Source : a) http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/data/pf000362.htm,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_ampliceps
Arbuste de la famille des Fabacées, de 1-3 mètres de haut, mais
pouvant atteindre 8 mètres, originaire des régions semi-arides de l'Afrique
comme le Sahel, où il est fréquent.
Les rameaux sont disposés dans un même plan, les plus petits sont en
forme d’épines. L’écorce est grise, lenticellée. Les feuilles sont
petites, fortement bilobées, gris-vert mat, persistantes. Les fleurs sont
jaune-verdâtre à blanc rose, de type cinq, groupées en racèmes de 5
cm. Ses gousses sont indéhiscentes, contournées en spirale et
brun foncé, presque noires à maturité ; elles contiennent de 4 à 10 graines.
La multiplication par graines après traitement à l'eau bouillante et
refroidissement lent donne un taux de germination de 40%.
Sols : peu exigent, sur des sites secs et sablonneux, pierreux,
également sur des sols argileux latéritiques, souvent dans des terres en
jachère. Elle est rustique et pousse sur tous les types de sol. Espèce recommandée
pour la création de haies-vives défensives, fourragères ou ornementales.
Bauhinia fixe l’azote de l’air. C’est un arbuste fourrager important :
la valeur fourragère des rameaux feuillés est de 0,12 UF/kg et celle des
gousses vertes ou sèches est de 0,94 UF/kg. Les rameaux sont appréciés des
ovins, des caprins et des chameaux, les feuilles par les bovins. L’écorce est
tanifère. Elle est découpée en bandes pour tresser des cordes.
De nombreux usages en pharmacopée : fébrifuge, diurétique,
antientéralgique et autres usages. Le bois est brun clair à grain fin. On
l’utilise en charpente, sculpture, artisanat et comme bois de feu. Il est
également utilisé comme plante ornementale.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhinia_rufescens,
b) (CIRAD) http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/42/92/75/PDF/Bauhinia-rufescens.pdf,
c) Bauhinia rufescens (CIRAD), https://agritrop.cirad.fr/518849/1/document_518849.pdf,
d) http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/Gbase/data/pf000148.htm
e) http://ne.chm-cbd.net/biodiversity/la-diversite-biologique-vegetale/les-especes-vegetales-et-leurs-utilites/bauhinia-rufescens
Cassia sieberiana est un arbre caduque, de 10-20 mètres de
hauteur, ayant des fleurs jaunes très lumineuses.
On le trouve dans la partie sud du Sahel, au Sénégal, Soudan et
Ouganda. On le trouve aussi en Afrique de l'Est.
Dans les régions très sèches, c’est un arbuste. En général, il n’est
jamais seul et pousse au sein de groupes d'autres plantes.
Il pousse mieux dans les sols bien drainés et humides avec une
pluviométrie annuelle d'environ 500 mm (20 pouces).
L'extrait doux des tiges est utilisé comme nourriture. Des bâtonnets à
mâcher peuvent également être fabriqués à partir de la racine. Il a de
nombreuses utilisations médicinales. Les racines sont utilisées comme
diurétique et vermifuge et pour traiter des maladies telles que
l’éléphantiasis, la lèpre, la diarrhée, les hémorroïdes, la dysenterie et les
maladies vénériennes. Il peut également être utilisé pour soulager les
symptômes, liés au cycle menstruel, et les douleurs. D'autres utilisations
incluent le traitement des oreilles avec la racine et les graines. Les
graines sont aussi utilisées comme sédatifs. L'écorce de racine est
également utilisée en outre pour l'hydropisie, l'enflure et la
goutte. Enfin, les feuilles aident à traiter les symptômes de l'arthrite
et les rhumatismes. Les gousses font également l’objet d’un commerce local, en
particulier comme vermifuge.
Il est principalement multiplié par graines.
Sa racine est très utilisée comme tonique et aphrodisiaque en poudre ou
en macération (allégations à vérifier).
Cassia sieberiana est utilisé pour fabriquer des outils,
des pilons, mortiers, et également utilisé pour la construction car c'est un
bois très dur, résistant aux termites. En outre, il est aussi un arbre
d'ornement en raison de ses fleurs aux couleurs vives.
Il est présent dans les savanes arborées ou arbustives où la
pluviométrie annuelle est inférieure à 800 mm. Il pousse le plus souvent dans
les lieux argileux (°).
Note : Mais selon la base de données PROTA, il préfère un sol
sableux et acide (!).Donc donnée à vérifier.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Cassia_sieberiana,
b) http://database.prota.org/PROTAhtml/Cassia%20sieberiana_Fr.htm,
(°) c) Selon http://www.seyilaabe-htkm.com/2011/01/la-chronique-du-mardi-au-jardin_11.html
|
(Famille des Caesalpiniaceae).
|
 
|
U $
|
|
|
Arbre caduque d'Afrique australe, de 4 et 18 m de haut. Sa feuille en
forme de papillon et sa gousse fine et fragile sont
caractéristiques. Il dégage une forte odeur de térébenthine. Ses graines
sont résineuses.
L'arbre existe exclusivement en Afrique. Il pousse dans les régions
chaudes et sèches [sans gel] situées de 200 à 1 150 mètres d'altitude des
parties les plus septentrionales de l'Afrique australe. Selon leur
taille, ils sont regroupés en fruticées ou en forêts, forêts
parfois comparées à des cathédrales de mopanes (jusqu’à 30 m).
Il pousse dans les sols alcalins (à haute teneur en chaux
(calcaire ?)), peu profonds et mal drainés. Il croît aussi dans les sols
alluviaux (formés par les sédiments déposés par les rivières). Il
pousse mal en dehors des zones chaudes et arrosées par des pluies estivales.
Pluviométrie annuelle moyenne : 200-800 mm. Sa croissance est lente.
La forte densité du bois lourd de mopane le rend résistant aux termites
et pour cette raison et pour sa riche couleur rougeâtre, il est depuis
longtemps utilisé dans la construction de maisons, palissades,
planchers, traverses de chemin de fer ou bois de soutènement
de mine. Il est également de plus en plus utilisé dans la fabrication
d'instruments de musique, en particulier des instruments à vent
(clarinettes …), le Dalbergia melanoxylon (ébène du
Mozambique ou grenadille), étant de plus en plus difficile à trouver.
Il est assez huileux, sèche très bien avec peu de fentes et donne aux
instruments un son chaud et riche.
Il fournit des brindilles à mâcher en guise de brosse à dents. Son
écorce est employée pour fabriquer de la ficelle et des produits
de tannage. Il a des usages médicinaux (ses feuilles aideraient à la
cicatrisation des plaies…). Son écorce est employée pour fabriquer de
la ficelle et des produits de tannage. L'arbre est une source
importante de nourriture pour le ver mopane (chenille de
la pyrale de l'Imbrasia belina). Les chenilles sont riches
en protéines et couramment consommées. La vente de vers mopane
grillés ou séchés contribue significativement à l'économie rurale. L'arbre agit
également comme plante hôte du vers à soie
sauvage d'un papillon de nuit (Gonometa rufobrunnea). Les
cocons sont récoltés pour donner de la soie sauvage. Le bois est aussi utilisé
pour faire du charbon de bois. Son écorce résiste aux feux. Il ne supporte
pas le gel.
(Seule espèce du genre Colophospermum, de la
famille des Fabaceae). Il peut fournir un fourrage aux bovins.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Mopane,
b) http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Colophospermum_mopane.pdf,
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Mopane, c) http://www.plantzafrica.com/plantcd/colomopane.htm
|
(Famille des Fabaceae).
|
  
|
U ↗
|
|
|
Arbre à croissance rapide, fixateur d'azote, résidant en zone
tropicale ou subtropicale humide (250 à 2500 ml/an) mais résistant à la
sécheresse. Il pousse en plein soleil, sur des sols difficiles, même salés.
L'arbre pousse dans la plupart des sols (sablonneux et
rocheux, calcaires …), même avec ses racines dans l'eau salée.
Il « s’auto-ensemence » fortement et peut propager ses
racines latérales jusqu'à 9m. S'il n'est pas géré avec soin, il peut
rapidement devenir une espèce envahissante (c’est le cas en Floride). Ses
racines peuvent menacer les fondations de maisons. Cependant, son réseau
dense de racines latérales rend cet arbre idéal pour contrôler l’érosion
des sols et fixer les dunes de sable. Précipitations annuelles de 500
-2500 mm (20-100 po). Températures : de -3°C à 50°C.
L'Inde encourage actuellement fortement la plantation de cet arbre
ainsi que de l'arbuste Jatropha curcas dans les zones impropres aux
cultures traditionnelles, ceci dans l'optique de produire de l'huile végétale.
On peut planter 200 arbres par hectare et chaque arbre permet de
produire dès la 6 ou 7e année de 25 à 40 kg de fruits
dont la teneur en huile est de 30 à 35 %. Une personne peut récolter
chaque jour (8 heures de travail) 180 kg de fruit. Les
rendements moyens sont de5 tonnes/hectare/an la dixième année. Tandis
qu’avec Jatropha curcas avec lequel il faut attendre 3 ans
pour obtenir le rendement maximal, avec Millettia pinnata, cette
phase de maturation dure 4 à 5 ans. Les tourteaux obtenus après
extraction de l'huile sont d'excellents fertilisants. Il est souvent utilisé à
des fins d'aménagement paysager comme brise-vent ou arbre d'ombrage, en
raison de sa couronne large et dense et de ses fleurs odorantes voyantes.
Son bois est utilisé pour faire des poteaux et des manches d'outils.
Tandis que l'huile et les résidus de la plante sont toxiques et vont
induire des nausées et des vomissements en cas d'ingestion, les fruits, avec
les graines (toxiques), et les pousses sont utilisés dans de nombreux remèdes
traditionnels. Les jus de la plante, ainsi que l'huile,
sont antiseptiques. L’huile faite à partir des graines (en contenant
25-40%), connues sous le nom d’huile de pongamia, est utilisé
comme huile de lampe, lubrifiant et pour fabriquer du savon.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Millettia_pinnata,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Millettia_pinnata
c) http://davesgarden.com/guides/pf/go/93109/#b
Pour mention : Selon cet article,
ci-dessous, l’hybride Paulownia elongata x fortunei x elongata serait
plus résistant au sel (jusqu’à 6 g / litre), que les espèces classiques de Paulownia
(Paulownia tomentosa, Paulownia fargesii etc.) ou les autres hybrides (P.
elongata x elongata, P. elongata x kawakarnii). Cette affirmation
est encore à vérifier, parce que normalement les Paulownia ne
résistent pas au sel, de plus ils consomment beaucoup d’eau. Enfin, elle
n’est confirmée que par cet article.
Source : The salinity effect on morphology and pigments content in
three paulownia clones grown ex vitro, K. Miladinova, K. Ivanova, T.
Georgieva, M. Geneva and Y. Markovska, Bulgarian Journal of Agricultural
Science, 19 (2) 2013, 52–56, http://www.agrojournal.org/19/02-12s.pdf


Cette espèce d'arbuste ou de buisson est originaire de l'extrême sud
des Etats-Unis (Arizona et Californie) et du nord du Mexique.
Si le jojoba ne dépasse guère 2,5 m à l'état naturel, ses racines sont
très longues, jusqu'à 30 m ou plus, ce qui lui permet d'aller chercher
l'humidité très loin et très profondément dans le sol. Son feuillage rappelle
celui de l'olivier.
Les graines encore appelées « amandes » ou « fèves » sont de la taille
d'une olive et on les récolte à l'automne. La production est soumise à
l’alternance biennale. On en extrait l'huile de jojoba, une sorte de cire
liquide comparable au sébum et qui ne rancit pas.
L'huile de jojoba est utilisée dans l'industrie des cosmétiques pour
diluer les huiles essentielles, en remplacement du blanc de baleine. Elle est
aussi appréciée comme huile de massage, car elle pénètre facilement la peau et
ne laisse pas de sensation de gras, ou encore pour la lubrification des moteurs
et l'alimentation des lampes pour l'éclairage. Les graines de jojoba ont un
rendement en huile d'environ 50 % de leur poids.
La cire de Jojoba bénéficie d'une grande stabilité et peut donc être
conservée durant près de 10 ans. Elle se fige à une température inférieure à
10°C mais elle supporte des températures élevées. Dans les deux cas, sa qualité
n'est pas altérée. L'huile de jojoba est un fongicide utilisable contre le
mildiou7. Elle est comestible, mais acalorique et non-digestible, ce qui
signifie que l'huile passe à travers les intestins sans transformation et
qu'elle peut avoir un effet désagréable appelé « stéatorrhée ». Le Jojoba a été
étudié en tant que carburant biodiesel bon marché et durable.
Aujourd'hui, les principaux producteurs sont l'Argentine, Israël, les
Etats-Unis, l'Australie et le Pérou. La culture de jojoba s'est implantée dans
les régions semi-désertique d'Argentine, au nord-est du pays. Récemment, Israël
s'est lancé dans la production de jojoba et compte parmi les plus grands
producteurs mondiaux. On l'appelle encore « Or du désert » ou « Noix de brebis
» car elle pousse dans les lieux arides, en plein soleil. Moyenne de prix : 60
à 120 euros / litre. Le jojoba peut supporter de l’eau d’irrigation légèrement
salée.
Sources : a)
Jojoba, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jojoba
b) Huile de
jojoba, https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_jojoba
c) Huile de
Jojoba - Composition, Utilisation, Bienfaits, https://www.passeportsante.net/huiles-vegetales-g152/Fiche.aspx?doc=huile-jojoba
d) Effect of Seawater Irrigation on Growth and Some Metabolites
of Jojoba Plants, Sameera O. Bafeel, Hanaa K. Galal, Alaa Z. Basha, January
2016, https://www.researchgate.net/publication/315831343_Effect_of_Seawater_Irrigation_on_Growth_and_Some_Metabolites_of_Jojoba_Plants
|
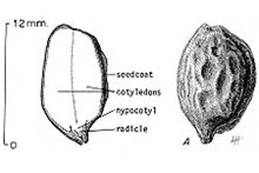
Graine
|

Flacon d'huile de jojoba non raffinée.
|
|

Feuillage et fruits.
|

Fleurs.
|
|
(Famille des Amaranthaceae).
|
 
|
U ↗
|
|
|
Originaire d'Afrique et du Sahara au Maroc, c’est un
arbuste fourrager, halophyte
de 1,5 m à 2 m de haut. Avec son réseau très
dense de rameaux dressés à partir du sol, il forme des buissons très touffus,
impénétrables. Sa croissance est rapide et il peut s'étendre grâce à ses rejets
souterrains.
Car tolérant des conditions sévères de sécheresse (très résistante
à la sécheresse et aux embruns) et pouvant grandir dans des sols très
alcalins et salins, cette plante est souvent cultivée comme fourrage et
utilisée pour valoriser les zones dégradées et marginales. Elle supporte bien
la taille. L'arroche marine est souvent plantée pour constituer des haies
brise-vent sur le littoral. Les feuilles de l'arroche marine sont consommées
crues dans les salades, dans certains pays d'Europe. Dans les zones arides
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, elle constitue un fourrage très apprécié
du bétail (notamment pour les dromadaires).
Les extraits des feuilles ont montré des effets hypoglycémiques
importantes.
Elle sert à la fixation biologique des dunes mobiles (par exemple, en
Tunisie).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Atriplex_halimus, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Atriplex_halimus
|
(Famille des Amaranthaceae).
|
 
|
U
|
|
|
Atriplex lentiformis est originaire du Sud-Ouest des
États-Unis et le nord du Mexique, où elle pousse dans les habitats salins ou
les sols alcalins, comme les marais salants et les lacs asséchés, sur
le littoral, et dans les broussailles du désert. Il peut également être
trouvée dans les sols annulaires non salins sur les berges et les bois.
Cet arroche est un arbuste, fortement ramifié, atteignant un à trois
mètres de hauteur et généralement plus en largeur. Ce "Saltbush" peut
atteindre 3,5 mètres (11 pi) de hauteur et de largeur dans les endroits les
plus avantageuses, avec la forme d’une grande hémisphère aplatie, avec des
hémisphères adjacentes fusionnant en un fourré impénétrable. Sa hauteur
maximale est atteinte lorsqu’une source d’eau souterraine fournit une
humidité abondante et les conditions de sol salin sont optimales. Il est
utilisé dans la restauration d’habitats riverains.
Cependant, les espèces envahissantes _ le Tamaris - Tamarix
ramosissima et le virevoltant ou Tumbleweed (de l'anglais,
littéralement « l'herbe qui tourne ») (Lechenaultia divaricata) et
l’arroche rosée ou oracle Tumbling - Atriplex rosea _ sont des
concurrents problématiques [sérieux], pour cette plante.
Usages : Les Feuilles, jeunes pousses et les graines cuites
sont comestibles. Mais la graine est plutôt petite et difficile à utiliser.
Cette plante des prés salés (saltbush), A. lentiformis, et Atriplex
canescens sont des plantes alimentaires pour le papillon aux
« ailes de suie » (« Sootywing ») Hesperopsis alpheus.
La plante supporte mal le gel.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Atriplex_lentiformis
b) https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Atriplex+lentiformi
|
(Famille des Amaranthaceae).
|
 
|
U
|
|
|
Cet arbuste vivace, ramifié, à feuilles persistantes d'un vert
grisâtre, à croissance lente, atteignant des hauteurs comprises entre 1 et 3
mètres et des diamètres allant jusqu'à trois mètres, est originaire
d'Australie, poussant sur tout le continent australien, sauf la Tasmanie, dans
les zones méditerranéennes arides et semi-arides (précipitations allant de 250
mm à 600 mm par an). On la trouve ailleurs en Océanie, ainsi que dans l'île de
Taiwan. Elle a été introduite dans d'autres régions du globe, pour des usages
variés, notamment en Afrique du Sud, depuis le début du XXe siècle, au
sud-ouest du désert américain et au nord du Mexique.
Le système racinaire subérifié,
comporte une racine pivotante très développée, avec des racines latérales
horizontales. Les feuilles alternes épaisses, ovales à triangulaires arrondies,
sont aromatiques, coriaces, ondulées et, parfois, dentées de terne, mesurant de
2 à 7 centimètres de long et 1 à 4 cm de large. Les fleurs mâles, petites,
rondes, de couleur jaune-brun, sont organisées en panicules de 7,5 cm à 10 cm
de long. Les fleurs femelles, peu colorées, sont situées à l'aisselle des
feuilles ou en inflorescences terminales ramifiées, denses et épaisses.
Ecologie : Cette plante fourragère pousse généralement sur
les sols argileux et salins des basses terres, comme les plaines inondables, en
dessous de 400 m d'altitude, mais peut aussi se rencontrer dans les sous-bois
d'eucalyptus.
En cas d'aridité, elle peut atteindre l'humidité de la nappe
souterraine, jusqu'à 10 m de profondeur. Elle a une grande efficacité dans
l'utilisation de l'eau. Dans le Karoo, en Afrique du Sud, celle-ci atteint 4 kg
de matière sèche par m³ d'eau. Elle résiste très bien aux températures élevées,
avec une photosynthèse optimale entre 30 et 35 °C. Elle supporte des
températures descendant jusqu'à - 8 à - 12 °C, pendant quelques heures, mais
des températures hivernales très basses provoquent la mort de la plante. Elle
résiste également bien au feu et supporte la sécheresse ; elle peut survivre
avec des précipitations annuelles apportant seulement 50 mm d'eau. Elle a une
durée de vie d'environ quinze ans.
Fourrage : Les animaux domestiques, notamment les caprins,
mangent l'arroche nummulaire, plante halophyte adaptée aux milieux arides avec
des sols salé. Ces arbustes sont utilisés comme fourrage pour les animaux, mais
sa consommation peut être limitée par la concentration en sel dans les tissus
de la plante. Les animaux ont alors besoin d'une ration quotidienne d'eau plus
importante, afin de pouvoir éliminer les ions sodium Na+. La part de l'arroche
nummulaire ne doit pas excéder 20 à 30 % du fourrage fourni au bétail. Une
plantation d'arroche nummulaire peut alimenter 20 à 25 moutons par hectare
durant quatre mois.
Culture/reproduction : La plante peut être monoïque ou dioïque.
Les plantes sont multipiées par bouturage ou semis. La température optimale de
germination est comprise entre 15 et 20 °C. Le taux de germination est amélioré
en frottant les graines sous l'eau courante pendant plusieurs minutes ou en les
faisant tremper dans l'eau pendant au moins une heure, afin d'éliminer le sel
qu'elles contiennent.
Les graines sont lenticulaires, de 2 mm de diamètre, formées de deux
feuillets écailleux parcheminés. Les feuillets contiennent une forte
concentration de chlorure de sodium, qui inhibe la germination des graines.
Ceux-ci doivent donc être lessivés par suffisamment d'eau, pour que la
germination puisse commencer. La pollinisation est effectuée par le vent. La
floraison a lieu au printemps, entre avril et juin.
Les boutures sont réalisées à partir de rameaux de 25 cm de long et
d'au moins 6 mm de diamètre. On laisse un œil ou une feuille à l'extrémité du
rameau. Celui-ci est planté dans une terre sablonneuse et arrosé régulièrement.
Le nouveau système racinaire apparaît au bout de six semaines. Le repiquage est
possible, après dix semaines, dans un mélange 2/5 terre, 2/5 compost et 1/5
sable.
Les plançons nécessitent un arrosage. Cultivées en pépinières, les
plantes sont repiquées en pots, dans lesquels elles demeurent jusqu'à avoir
atteint une hauteur suffisante (10 à 15 cm) pour être transplantées sur le
terrain, bien drainé et ensoleillé, clos (auxquels les animaux n'ont pas
accès), à l'automne ou au début de l'hiver, au début de la saison des pluies.
La plante est prête à être utilisée comme fourrage la seconde ou la troisième
année après la plantation en sol, lorsque sa hauteur atteint 1,5 m. La coupe
s'effectue à au moins 50 cm du sol. La récolte est parfois donnée aux
volailles.
Stabilisation des sols : La plante sert dans le cadre des
efforts de lutte contre le déboisement et la désertification (au Chili ...) et
pour la stabilisation des dunes de sable (au Botswana ...).
Autres emplois : Utilisée comme combustible, l'arroche
nummulaire récupère en trois mois après la coupe. La plante est aussi utilisée
comme haie coupe-vent, avec son feuillage ornemental résistant à la taille.
Avec ses feuilles facilement visibles la nuit, elle est appropriée aux
plantations en bordure de route. Les aborigènes d'Australie consomment ses
graines.
Plante envahissante : elle classée plante invasive de
catégorie 2, en Afrique du Sud.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Atriplex_nummularia,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Atriplex_nummularia
|

|

Grand arbuste.
|
|

Fruits et fleurs
|

Graines
|
|

|

Tige et segment foliaire
|
Le genre Salsola regroupe des plantes halophytes, présentes dans
les prés salés, sur le littoral sablonneux, de la famille des Amaranthaceae
(selon la classification phylogénétique) ou de la famille des Chenopodiaceae
(selon la classification classique) (voir ci-après) :
|

|
Soude
vermiculée
(Salsola
vermiculata)
En
anglais :
Salicorne de
Damas ou Méditerranéenne
|
Il s'agit d'un arbuste à
feuilles persistantes, hermaphrodite,
jusqu'à 1,5 m de haut, très branchu, très irrégulier en taille, parfois
complexe. Le tronc et les branches principales
sont très fissurés à écorce grise. Habitat :
tous types de terrains ou semi-arides,
plus ou moins salés, ou
côtiers intérieurs. Espèces pastorales utilisée pour le rétablissement
des parcours en milieu aride.
Sources :
a) http://es.wikipedia.org/wiki/Salsola_vermiculata
Invasive aux
USA :
b) http://www.invasive.org/browse/subinfo.cfm?sub=4550,
c) http://www.cdfa.ca.gov/plant/ipc/weedinfo/salsola-vermiculata.htm
|
|


|
Soude commune
(Salsola
soda)
en anglais : Salicorne à feuilles
opposée.
|
C'est une plante
annuelle succulente pouvant
mesurer 70 cm de haut originaire du bassin
méditerranéen, qui peut être irriguée avec de l’eau salée ou non
salée. On en trouve sur le littoral Atlantique de la France et du Portugal et
sur la côte de lamer Noire.
Il s'est naturalisé le long de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord, et
l'on se préoccupe de son caractère invasif en Californie dans les marais salants. Il est
également naturalisé en Amérique du Sud.
Son goût est herbacé et légèrement salé avec une texture croquante
agréable. La plante est le plus souvent cuite et consommée comme légume-feuille. Salsola
Soda a été étudié comme une « plante de compagnonnage désalinisatrice »
pour les cultures des tomates et poivrons quand ils sont
cultivés en sols salins.
Salsola extrait assez de sodium du sol, améliorant la
croissance de la plante cultivée. Un meilleur rendement des cultures en
résulte malgré la concurrence des deux plantes pour le reste des minéraux du
sol.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Soude_commune,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Salsola_soda
|
|

|
Soude
maritime, Suéda maritime (Suaeda maritima)
|
Petite plante comestible de Méditerranée, Atlantique et Manche. Elle
vit uniquement sur des sols salés du littoral. Elle est parfois consommée
sous forme de condiment en salade. Historiquement, de ses cendres était
autrefois extraite de la soude utilisée artisanalement dans la fabrication du
verre ou de la lessive
|
Nitraria est
un genre comprenant neufs plantes
à fleurs (en général des arbustes), de la famille des Nitrariaceae,
toutes résistantes à la sècheresse et au sel.
|

|
Nitre du bush
Nitraria
billardierei
|
Plante
vivace arbustive tolérant
le sel. On le trouve souvent dans les zones salines, argileuses,
ou des zones qui ont été surexploités. Les fruits sont comestibles, dit le
goût des raisins salées, et ont été mangés par les
Australiens autochtones. Les fruits peuvent aussi être transformé
en confiture ou
séché et stocké. C'est un arbuste large et bas, jusqu'à 2 mètres (7
pi) de hauteur et 4 m de large. En Australie, sa propagation et sa
germination sont facilitées, grâce à la consommation de fruits par les
émeus.
|
|

|
Nitraria
retusa
|
Arbuste
ou un buisson tolérant le sel. La plante pousse à 2.5m de haut, mais il
est généralement inférieur à 1 m de hauteur. Il a de minuscules fleurs
parfumées, blanc à vert, et un petit fruit
rouge comestible. La plante est originaire des régions désertiques du
nord de l'Afrique
(Tunisie …), où elle pousse dans la
succession primaire sur des dunes
de sable arides. Il est lié aux sols gypseux ou salés. Cette espèce
indique également une nappe phréatique peu profonde. Son enracinement est
puissant et pivotant, mais sa croissance assez lente. Elle est utilisée pour
la fixation biologique des dunes littorales et la régénération des pâturages
salés.
|
|

|
Nitraria
tangutorum
|
Nitraria tangutorum Bobr. appartient à la famille Zygophyllaceae.
Son aire de distribution se situe principalement dans la région du
Xinjiang du Nord, en Chine. Il est aussi appelé "cerise du Désert
". La consommation de ses fruits nourrit l'estomac, la rate et les
poumons. En médecine chinoise, il est utilisé pour aider à la digestion,
apaiser les nerfs, la lactation, prévenir la neurasthénie, et favoriser la
circulation sanguine. Il contient une grande variété de nutriments, y
compris de la vitamine C, des polysaccharides, des acides gras insaturés, des
protéines, des acides aminés.
Cette halophyte typique du désert joue un rôle écologique important
en raison de sa meilleure tolérance aux graves sécheresses et à des fortes
salinités (Source : Halophytes database, http://www.sussex.ac.uk/affiliates/halophytes/index.php
).
|
Noms communs : Hassaniya: aguerzim; pulaar: guiyel goti;
anglais: salt tree.
Famille : Nitrariacées/Nitrariaceae (Zygophyllaceae).
Caractéristiques : Buisson épineux de 1,5 m
de hauteur (parfois 2,5 m de haut), vert toute l’année, aux feuilles grasses à
peu près triangulaires, alternes et diversement colorées (vertes, jaunes ou
rouges). Il produit des petites fleurs blanches/vertes/jaunâtres et des petits
fruits comestibles rouges. Il accumule souvent le sable sous forme de nabkhas ou nebkas parfois
importantes. Il est tolérant au sel et résistant à la sécheresse et est lié aux
sols gypseux ou salés. Cette espèce indique également une nappe phréatique peu
profonde. Son enracinement est puissant et pivotant, mais sa croissance assez
lente.
Distribution / Ecologie : La plante est originaire des
zones désertiques d'Afrique du Nord et de l'Est, de la péninsule arabique et du
Moyen-Orient, où elle pousse en succession primaire, sur des dunes de sable
stériles, et dans des zones à haute salinité telles que les marais salants, les
zones salines semi-arides des déserts.
Selon une autre source, concernant l’Afrique de l’Ouest : D’origine
méditerranéenne, Nitraria retusa est limitée en Mauritanie au littoral
dans la zone de salure des nappes phréatiques. Elle est très prospère du
Cap Blanc au bas-delta du Sénégal. Elle est aussi présente dans la wilaya du
Zemmour.
Il peut s'associer au jonc marin (Juncus rigidus), aux Phragmites sp., à l’herbe
à sel (Sporobolus
spicatus), au Zygophyllum album et/ou au Tamaris du Nil (Tamarix nilotica).
Multiplication : Elle se fait par graines, en
pépinière ou en milieu naturel. La capacité de germination est bonne.
Utilisations : Cette espèce est très appréciée par
les dromadaires. Ses fruits, aqueux et légèrement sucrés, sont comestibles.
Elle est utilisée pour la fixation biologique des dunes littorales, la
stabilisation des sols meubles et la régénération des pâturages salés. Le bois
est utilisé comme combustible et les fruits sont parfois utilisés pour faire
une boisson enivrante. N. retusa est l'une des nombreuses plantes
tolérantes au sel étudiées en tant que cultures fourragères potentielles pour
le bétail.
Sources : a) https://en.wikipedia.org/wiki/Nitraria_retusa
b) Quelques
espèces ligneuses et herbacées utilisées pour la fixation des dunes, page
56, http://www.fao.org/docrep/012/i1488f/i1488f10.pdf
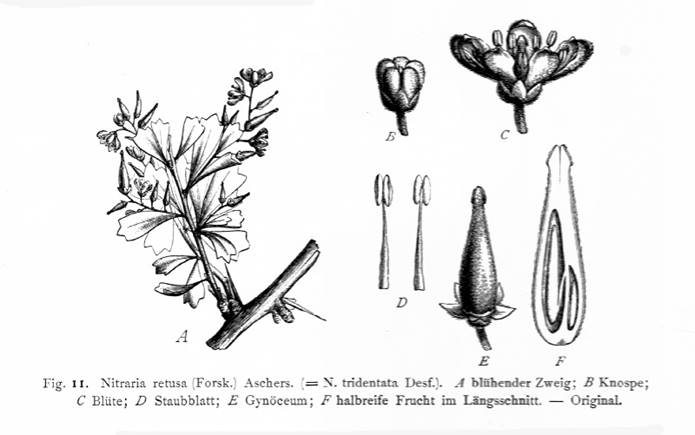
|
(Famille des Chenopodiaceae, en classification classique. Famille
des Amaranthaceae en classification phylogénétique).
|
  
|
U ↗
|
|

|
C’est un arbuste dicotylédone, sempervirent d'environ 2 m de
haut qui peut atteindre 9 m de haut, aux feuilles squamiformes, réduites à
des épines vertes, endémique de l'Asie centrale.
Les fleurs sont bisexuées ou mâles, très petites, aussi longues ou plus
courtes que les bractéoles. La période de floraison est de mars à avril (autre
source : l'éclosion des fleurs, petites et jaunes se fait entre avril et
juin). Les inflorescences sont constituées de courtes pousses latérales portées
sur les tiges de l'année précédente. Dans le fruit, les segments du périanthe
développent des ailes étalées brun pâle ou blanches. Le diamètre du fruit ailé
est d'environ 8 mm. La graine a un diamètre de 1,5 mm. La période de
fructification est d'octobre à novembre (Autre source : Les fruits, des
utricules vert foncé, apparaissent en septembre et contiennent des graines
noires).
Il joue un rôle primordial dans la prévention de la dégradation et de
l’érosion des dunes de sable, grâce à ses racines qui s’enfoncent très
profondément dans le sol. De plus, les forêts de saxaoul diminuent l’intensité
et le danger lié aux tempêtes de sable. Il constitue également la ressource
essentielle en bois de chauffage et de construction pour les abris permanents
ou temporaires. De plus, il est indispensable à la présence de troupeaux
d'animaux dans le désert.
On le trouve dans les déserts arides et salés de l'Asie centrale,
particulièrement dans la région du Turkestan et à l'est de la Mer Caspienne,
mais également dans le désert de Gobi et dans les déserts iraniens.
Il est le plus souvent regroupé en "forêts".
Il possède des racines profondes et succulentes lui
permettant de prospérer dans des environnements arides, salins ou sablonneux.
Sa densité de son bois très dur est telle qu'il coule. Son écorce épaisse gris
clair contient de l’eau.
Deux autres espèces proches du genre Haloxylon, Haloxylon
aphyllum ou Saxaoul noir et Haloxylon persicum ou
Saxaoul blanc, existent.
Menaces sur l’espèce : La pression humaine, l’utilisant
comme bois de feu ou carburant (lors de la crise de l’énergie de l’Asie
centrale de 2008), l’a conduit à être inscrit comme en danger d'extinction. Le
saxaul est planté sur une grande échelle dans le boisement des zones
arides en Chine. L’Ouzbékistan a planté 27 000 hectares de saxaoul.
Il peut être attaqué par Turcmenigena varentzovi. Le saxaoul
est atteint d'une maladie fongique due à Erysiphe saxaouli : les
arbres semblent recouverts d'une couche de cendre.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Haloxylon_ammodendron, b) Farangis Najibullah (January 13, 2008). "Tajikistan:
Energy shortages, extreme cold create crisis situation“, http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp011308.shtml,
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Haloxylon_ammodendron, d) https://fr.wikipedia.org/wiki/Haloxylon_ammodendron, d) http://en.wikipedia.org/wiki/Haloxylon_persicum
|

|

|
|

|

|
|

Jeunes plantations de saxaoul (avril 2012) sur l’ancien
fond de la mer d’Aral – au sud de la Grande mer d’Aral en Ouzbékistan.
|

Feu de bois de saxaoul.
|
|
(Famille des Rubiaceae).
|

|
U ↗
|
|
|
C’est un arbuste ou petit arbre, de 2 à 3 m de haut, natif de
Nouvelle-Zélande. Dans les zones abritées, il peut atteindre jusqu’à 8 mètres
de haut. Ses feuilles épaisses et très brillantes varient considérablement en
taille, en fonction lors de l'exposition aux éléments. Ses feuilles brillantes
l’aide à survivre à proximité des zones côtières. Elle pousse dans les régions
tempérées et résiste au vent, feu, embrun et sécheresse. Elle retarde le feu.
La plante sert souvent à faire des haies.
Cette plante est adaptée aux côtes, marais et sous-bois. Elle est une
plante refuge. Dioïque, elle nécessite 5% de plants mâles. Elle se bouture
facilement. Les moutons, chevaux et vaches raffolent de son feuillage, qui est
aussi un bon engrais. Cet arbre se taille bien au sécateur.
Les plantes femelles produisent drupes ovoïdes rouge-orange,
comestibles (sucrées, avec un léger arrière-goût amer), d’environ 8 mm de
diamètre et 10 mm de longueur. Ses fruits et graines sont excellents pour les
volailles.
Dans le sud de l’Australie et en Tasmanie, elle est considérée comme
une mauvaise herbe.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Coprosma_repens,
b) Introduction à la permaculture, Bill Mollison, Ed. Passerelle Eco,
2012, pages 179 et 211, c) http://www.kahikateafarm.co.nz/fruit-and-nuts/item/341-taupata.html
|

Feuilles
|

|

Feuilles
|
|

|

Fleur femelle
|

Fleur femelle
|

Fruits.
Diverses variétés d'Eleagnus à feuillage caduc ou persistant sont
utilisées comme haies en bord de mer. Ils résistent aux embruns et aux sols
salés. Le plus courant est l'Eleagnus ebbingei, petit arbuste (2,5
mètres de haut) à feuillage persistant. L'olivier de Bohème (Elaeagnus
angustifoli), un peu plus grand (4-6 mètres) fait partie de la même
famille. Ses nodules racinaires fixent l’azote de l'air. Ils lui
permettent de grandir sur des supports minéraux nus. Ses fleurs parfumées sont
mellifères. Le fruit est comestible et sucré, mais avec une texture farineuse.
Elle présente une bonne résistance au froid, supportant des températures
minimales jusqu'à près de -40 °C, mais craint les gelées printanières
tardives. C’est plutôt une plante héliophile, n'aimant guère l'ombrage.
Elle pousse à des altitudes généralement inférieures à 2 000 m.
On la trouve souvent près de l'eau : côtes maritimes, rives de lacs et
rivières, bordures de fossés, marais, plaines inondables, mais aussi dans le
lit de rivières asséchées. L'espèce est invasive, car fructifère (un individu
peut produire de nombreux fruits) et la durée de vie des individus est longue.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Elaeagnus_angustifolia
|

Elaeagnus angustifoli
|

Détail des fleurs
|

Fruits mûrs (Elaeagnus angustifoli)
|
|

Coupe montrant l'akène englobé dans l'hypanthe charnu (Elaeagnus
angustifoli).
|

Écorce d'un vieux tronc.
|

© Gerbaud.
|

Eleagnus ebbingei. Photo prise dans le parc du Fogeo
sur la presqu'île du Rhuys (Commune d’Arzon, Morbihan, France). Source : http://fogeo.free.fr/flore/arbustes_halophiles.pdf
|
(Famille des Solanaceae)
|

|
U ↗
|
|

|
Le lyciet commun ou lyciet de Barbarie (Lycium
barbarum) est un arbuste largement répandu de l'Europe méridionale à
l'Asie. Le Lycium chinense ou lyciet de Chine, est
un arbrisseau de 1 à 2 mètres de haut, touffu, à rameaux flexibles,
tombants, légèrement anguleux et peu épineux (avec des épines
de 0,5 à 2 cm), répandu du pourtour de la Méditerranée à l'Asie orientale.
Le goji ou baie de goji est le nom commercial de
la baie du lyciet commun (Lycium barbarum) et du lyciet de
Chine (Lycium chinense). Les lyciets sont cultivés surtout en altitude, du
nord-ouest de la Chine (dans la région autonome Hui du Ningxia)
à la Mongolie. Le lyciet commun, le lyciet d'Europe et le lyciet
de Chine sont les trois espèces de lyciet poussant naturellement en France. En
début d'été, il se pare de petites fleurs violettes et blanches en étoile,
remplacées vers le mois de septembre par les baies rouges. Lycium barbarum est
peu exigeant. Il pousse dans n'importe quelle terre de jardin enrichie d'un peu
de terreau, de préférence pour les sols alcalins (basique ; pH >7),
plutôt riches en minéraux. En hiver, pas d'arrosage en extérieur. En été, le
Goji appréciera un sol relativement frais, qu’il faut arroser régulièrement. Il
résiste à -20°C. Il préfère une exposition soleil / mi-ombre. Ses baies,
semblables à de petites cerises allongées, légèrement sucrées et de faible
acidité, sont commercialisées principalement sous forme de jus, généralement
pasteurisés et souvent mélangés avec d'autres jus de fruits, ou de fruits
déshydratés ou encore réduits en poudre. Les feuilles fraiches, riches en
vitamines C et E, peuvent être consommées comme légumes. Semis : Semez les
graines dans un terreau bien fin, sous
une mini-serre à une température comprise entre 20 et 25°C. La
germination interviendra sous 4 à 6 semaines.
Controverses : ce fruit ne contiendrait pas plus de vitamines que
l'orange ou la pomme, et moins que les baies d'argousier.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_goji,
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycium_chinense,
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycium_barbarum
C’est
l'espèce la plus cultivée du genre Moringa de la famille monotypique des Moringaceae.
Originaire
d'Inde et
du Sri Lanka, elle est
maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales : ce
petit arbre mellifère à croissance rapide, résistant à la sécheresse, peut
mesurer jusqu'à 10 mètres. Ses jeunes gousses et les feuilles sont
utilisées comme légumes. Les
bourgeons axillaires sur la tige verte apparaissent à partir de la mi-mai,
moment de reprise de la croissance végétale. Les graines sont aussi utilisées
comme amuse-gueules, pour purifier l'eau (floculation), comme détergent, ou
comme plante médicinale.
Description : Plante succulente xérophyte à caudex, Moringa oleifera est un
petit arbre à croissance rapide, à feuillage caduc, qui peut atteindre une
hauteur de 10−12 mètres pour un diamètre du tronc de
45 centimètres, à tronc résineux et écorce vert pâle, à cime légère.
L'écorce de couleur gris blanchâtre est entourée par une épaisse couche de
liège. Ses feuilles d'apparence plumeuse sont tripennées. Les fleurs odorantes et bisexuées comptent 5 sépales et 5
pétales de tailles inégales, blanc jaunâtre. La floraison peut se produire dès
les six premiers mois suivant la plantation. Selon les conditions saisonnières
de températures et de pluviométrie, la floraison peut se produire deux fois par an, voire toute
l'année. Le fruit est une longue capsule pendante, trigone, marron, à section anguleuse,
formée de 3 valves, contenant jusqu’à une trentaine de graines huileuses
garnies de 3 ailes. Les graines globuleuses, portant trois ailes blanchâtres papyracées, sont
disséminées par le vent et l'eau. En culture, il est souvent émondé de 1 à 2 mètres chaque année, ce qui permet de garder
les capsules et les feuilles à portée de bras sur les rejets.
Utilisations :
De nombreuses parties du moringa sont comestibles, avec des utilisations
régionales très diverses :
|
·
Capsules (fruits) immatures
·
Feuilles
·
Graines mûres
·
Huile extraite des graines
·
Fleurs
·
Racines
|

Gousses vendues sur un
marché.
|
Le moringa a nombreuses
applications en cuisine du fait de sa répartition mondiale. Il peut être
consommé cru, sans préparation, mais est souvent employé dans une variété de
plats. Ses feuilles sont la partie la plus
nutritive de la plante. Des analyses nutritionnelles ont montré qu'elles sont
plus riches en vitamines et protéines que la plupart des légumes. Caractère
invasif possible : Cette espèce se comporte comme une plante
envahissante à Cuba.
Lutte
contre la malnutrition : Beaucoup de programmes humanitaires
utilisent les feuilles de Moringa oleifera contre la malnutrition et ses
maladies associées (cécité, etc.) [comme avec la spiruline]. Il est
particulièrement utile pour lutter contre la malnutrition chez les nourrissons
et les mères allaitantes. Le moringa pouvant pousser en zone aride ou
semi-aride, il peut donc y constituer une source d'aliments nutritifs et variés
tout au long de l'année.
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera
|

Fleurs et feuilles.
|

Fleurs.
|

Les
gousses de Moringa oleifera à Panchkhal, Népal.
|
|

Arbres et gousses
|

Feuillage.
|

Branche
avec des fleurs et des feuilles au Bengale occidental.
|
|

Moringa
séché avec gousses et graines au sol à Hawaï.
|

Capsule.
|

Le moringa développe un
caudex sur sa racine pivot.
|
|
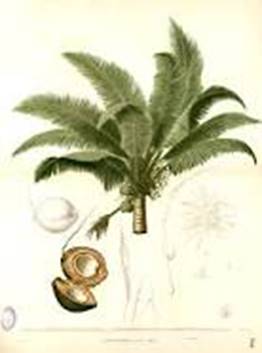
Cocotier
|


Cachiman-cochon, Mamain ou Mammier (ou Kachiman kochon) (Annona
glabra)
|
|
(Famille des Combretaceae)
|

|
U ↗
|
|
|
Le badamier (Terminalia catappa) est un arbre
fruitier. Il peut atteindre une vingtaine de mètres de hauteur. Originaire
de Nouvelle-Guinée, il s'est naturalisé dans de nombreuses régions
tropicales. Son fruit est appelé « myrobalan » ou
« badame ». C'est un arbre1 de 9 à 25 m de haut, aux branches
horizontales verticillées, lui donnant une ramification à étages typique. On
trouve cette espèce dans les arrière-plages sableuses. L'activité
hépatoprotectrice de ses feuilles (protectrice du foie) est confirmée. Le fruit
contient un seul noyau, très dur, renfermant une amande comestible, au goût
délicat. Les badames se mangent généralement crues. Elles se consomment au pied
de l'arbre, après avoir cassé la coque entre deux pierres. Elles se vendent
aussi sèches, sur les marchés urbains. Le bois sert à fabriquer des pirogues ou
à sculpter des objets artisanaux. C'est un bon combustible et un bon bois de
charpente. L'écorce est très souvent utilisée dans le traitement de la toux
(extrait de jus) ou des infections urinaires (décoction). Ses feuilles sont
utilisées en aquariophilie, pour la prévention de diverses pathologie des
poissons (phytothérapie). Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Badamier
|
(Famille des Euphorbiaceae)
|

|
(U)
|
|

|
Parfois surnommé « pomme de plage » ou « poison goyave », cet arbre
très toxique, de 5 à 10 m de haut (jusqu'à 25 m en situation abritée), possède
le port d'un poirier, aux feuilles luisantes, ovales à elliptiques,
de 3 à 20 cm de long, et une écorce grise assez lisse. Le fruit est une
drupe de 3 cm de diamètre ressemblant à une petite pomme verte. Ce fruit très
toxique exhale pourtant une odeur agréable de citron et pomme reinette. C'est
un arbre monoïque, portant sur un épi (de 4-15 cm) à la fois des fleurs
mâles vers l'apex en groupe de 3-5 et des fleurs femelles globuleuses dans les
aisselles des bractées inférieures. La floraison a lieu en février-mars puis en
août-novembre. Le mancenillier pousse sur le littoral sableux, généralement à
proximité des plages et est présent dans toutes régions sèches et chaudes
d'Amérique tropicale (sud de l’Amérique du Nord, Amérique centrale, nord de
l’Amérique du Sud et des Caraïbes).
Rôle écologique : Bien que très toxiques, ces arbres jouent un
rôle précieux dans les écosystèmes locaux : le mancenillier se développe dans
des bosquets denses et constitue un excellent coupe-vent naturel, ses racines
stabilisent le sable et permettent de prévenir l’érosion côtière. Confusion
possible avec le catalpa, aux fruits rugueux et feuilles moins brillantes.
Les charpentiers de ces régions utilisent le bois du mancenillier pour
créer des meubles depuis des siècles, après avoir soigneusement coupé et séché
le bois au soleil, afin de neutraliser la sève toxique.
Toxicité : Toutes les parties du mancenillier sont extrêmement
toxiques (Florida Institute of Food and Agricultural Sciences – IFAS). Son
latex blanc déclenche par simple contact avec la peau (ou les muqueuses), une
réaction inflammatoire intense. Le fruit provoque des brûlures intenses, un
gonflement des lèvres ainsi que la tuméfaction de la langue (qui se couvre
alors de cloques). L’intoxication due à ce fruit s’accompagne d’une chute de la
tension artérielle et d’un choc général. Les conséquences peuvent être fatales.
Même le bois est toxique et les bûcherons qui abattent l’arbre ainsi que les
menuisiers qui le travaillent, doivent prendre de grandes précautions. Dans
certaines régions, ces arbres sont marqués par une croix (ou un cercle) rouge.
Source : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippomane_mancinella,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Manchineel
Palmier monoïque de la tribu des Cocoeae, présent dans
toute la zone intertropicale humide. Surtout cultivé le long des côtes, il n'y
reste pas confiné. En Inde, il est planté jusqu'à mille mètres d'altitude.
La longévité de la plante dépasse un siècle.
La dissémination du cocotier est due à la flottaison des
fruits au gré des courants marins et, beaucoup plus tardivement, aux voyages et
migrations humaines. Il produit des inflorescences avec
des fleurs femelles et des fleurs mâles. Il peut donc se
féconder lui-même ; la plupart des cocotiers nains se reproduisent
d’ailleurs de cette façon.
La pulpe séchée, se composant à 60-70 % de lipides, est
appelée coprah. Celui-ci sert à la fabrication d'huile utilisée dans la
confection de margarine, de savon et de monoï. Les noix de
coco immatures contiennent un liquide sucré, l'eau de coco, qui est une boisson
rafraîchissante. La pulpe de la noix de coco comestible est râpée puis pressée
pour en extraire le lait de coco.
La fibre de coco entourant la coque de la noix de coco, est
utilisé pour faire des brosses, paillassons, matelas et des cordes.
Certains cultivars comme Grand Panama, Nain Brun Nouvelle Guinée et son
hybride, avec le Grand Rotuma, sont plus résistants à la sècheresse.
Le cocotier est très tolérant au sel et aux embruns.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Coconut
c) http://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=537539
|

Plantation en Inde.
|

|

|
|

|

|

Beurre de coco.
|
|

Diversité des fruits du cocotier dans la collection
internationale de Côte d'Ivoire.
|
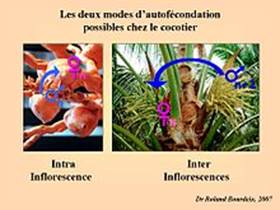
Les deux modes d'autofécondation possibles chez le
cocotier.
|
|
|
|
|
Le Raisinier bord de mer est une plante arbustive. Elle doit
son nom de Raisinier bord de mer à ses fructifications ressemblant
superficiellement à des grappes de raisins. Arbre petit ou moyen de
3 à 8 m parfois rabougri sous l'action du vent. On le retrouve sur les plages
de certaines zones tropicales. Ses fruits sont très appréciés des enfants.
Branches tortueuses. Ecorce gris-clair ou blanchâtre se détache par plaques.
Ses feuilles simples et alterne. Elles sont arrondies et larges. Fruits en
grappe. Verts au début, deviennent rouges violacés en mûrissant. Fruits
comestibles du mois d'août à novembre.
Le raisinier est un arbuste ou petit arbre poussant sur les plages en
bordure de rivage, à côté des cocotiers au niveau des tropiques en Amérique et
dans les Caraïbes. Il peut atteindre une hauteur de 8 mètres. Il
est extrêmement résistant au sel et aux embruns, mais ne tolère pas le gel.
Dans les Îles du Nord de la Caraïbe, les fruits du raisinier entrent dans la
composition de certains rhums arrangés et nombreux sont les
insulaires qui les grignotent lorsqu'ils sont bien mûrs. On peut également en
faire une confiture.
Sources : a) http://www.ac-guadeloupe.fr/Cati971/Prem_Degre/preste/activite_classe_fichiers/lesite/vegetation1.html
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccoloba_uvifera
|

Wikipedia FR.
|

|

|
|
|

Sources : TopTropicals.com
|
|
En Anglais, pond apple, alligator apple (parce que les alligators
mangent ses fruits), swamp apple, corkwood, bobwood,
ou monkey apple. C’est un petit arbre, de 3 à 5 m (exceptionnellement de
6-7 m), souvent à contreforts à la base. Il se rencontre dans les Petites
Antilles (Martinique, Guadeloupe), les Grandes Antilles, dans les zones
côtières du Mexique au Sud du Brésil et en Afrique occidentale. C’est un
arbuste des lieux marécageux (arrière-mangrove, forêts à Pterocarpus) ou
sableux humides. Il est tolérant à l' eau salée, mais ne peut pas se
développer dans un sol sec. La pulpe du fruit à maturité est jaune à orangé. Le
fruit est comestible pour l' homme et son goût rappelle le melon.
Il peut être transformé en confiture et il est un ingrédient
populaire de nouvelles boissons aux fruits aux Maldives. La pulpe
orange, aromatique et agréable au goût, est très appréciées des crabes et sert
d’appâts pour la pêche.
Une étude réalisée en 2008 dans la revue, Anticancer
Research, suggère que les extraits alcooliques de ses graines contiennent
des composés anticancéreux qui pourraient être utilisées pharmaceutiquement.
Les feuilles du cachiman-cochon sont réputées calmer les diarrhées. Il est
une espèce envahissante dans le nord
du Queensland en Australie et au Sri Lanka , où il
pousse dans les estuaires et étouffent les zones marécageuses
des mangroves.
Sources : a) https://en.wikipedia.org/wiki/Annona_glabra,
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Annona_glabra
Le palmier Nypa pousse dans la vase ou la boue, où le courant
de la marée lui apporte les nutriments nécessaires à sa croissance. Le palmier
peut se disséminer aussi loin que le courant parvient à déposer les graines.
Haut de 8-9 m, il est courant sur les côtes et les rivières de l’océan
Indien et de l’océan Pacifique du Bangladesh. Zone tropicale
humide. Zone 12.
Usages : Les feuilles longues du palmier Nypa sont
utilisées par les populations comme chaume pour recouvrir les maisons, ou comme
matériel pour la construction des habitations. Les feuilles sont également
utilisées pour la production de biens artisanaux comme les paniers.
L'inflorescence sert, avant sa floraison, à récolter une
douce sève comestible grâce à laquelle on produit une boisson
alcoolisée. Les jeunes plants sont également comestibles et
les pétales des fleurs peuvent être infusées pour donner une tisane
aromatique. Attap chee est le nom malaisien pour
les fruits immatures qui sont des boules douces, translucides et
gélatineuses utilisées comme ingrédient dans les desserts. Sur certaines îles,
on donne le palmier Nypa à manger aux cochons durant la saison sèche.
Emplacement : soleil, mi-ombre avec les pieds dans l'eau. Il peut
devenir envahissant, colonisant les espaces.
Fruit : grosse noix hérissée à l'écorce externe dure à
l'endosperme blanc comestible avec un noyau central.
Sol : marais tourbeux d'eau saumâtre ou d'eau douce.
Multiplication : attention uniquement par semis à chaud de graines très
fraîches, car le pouvoir germinatif est vraiment de très courte durée entre 2
et 4 semaines surtout si le stockage n'a pas été fait dans les règles pour
éviter le dessèchement.
Sources : a) http://nature.jardin.free.fr/1105/nypa_fruticans.html,
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Nypa,
c) https://en.wikipedia.org/wiki/Nypa_fruticans,
d) http://www.stuartxchange.org/Nipa.html
|
(Tribu des Fabaceae)
|
 
|
U
|
|
|
Arbre pouvant atteindre 30 m de haut et possédant de
larges contreforts s'élevant parfois à 5 m sur le tronc. Adulte, il
peut avoir une base de 5 ou 6 m de largeur. Le système racinaire est toujours
superficiel et limité dans son extension horizontale aux buttes générées par
l'accumulation de litière au pied des grands arbres.
Les feuilles sont alternes, composées de 5 à 9
folioles elliptique, luisantes, de 5 à 17 cm de longueur sur 5-6 cm de
large. Les fleurs sont petites (10 à 15 mm) jaunâtres marbrées de brun-rouge,
regroupées en panicules lâches de 5 à 20 cm de long. Le calice de 5 mm est à 5
dents courtes. Une corolle de 1,25 cm de long, qui entoure 10 étamines, unies
en un tube. Le fruit est une gousse suborbiculaire, plate et indéhiscente,
semblable à une médaille (d'où son nom de mangle-médaille en Guadeloupe). Elle
est uniséminée, brièvement pédonculée, ailée d'un côté, et d'un diamètre de 3 à
5 cm.
Le bois sec, couleur crème, tendre, léger, se scie et se travaille facilement,
mais ne résiste pas aux xylophages et champignons. On le trouve dans les forêts
marécageuses littorales tropicales. Cette espèce se développe dans les milieux
faiblement salé, jusqu'à 12 g/l de sel.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pterocarpus_officinalis
|

Contreforts de Pterocarpus officinalis
|

Feuille pennée
|
|

Pterocarpus officinalis dans la forêt
marécageuse du littoral (Guadeloupe).
|

 bois bois
|
|

Fruits (gousses en forme de médaille)
|

Fleurs
|
Plantes ne
résistant pas normalement à la sècheresse, mais poussant dans l’eau salée et/ou
l’eau de mer.

L'épave érodée d'un navire à vapeur, du XIXème siècle, en
provenance d'Ecosse a trouvé son lieu de repos au large de l'île Magnétique,
dans le nord de l'Australie. La nature reprend ses droits.
|

Mangrove.
Avicennia marina (Schatz 2001)
|
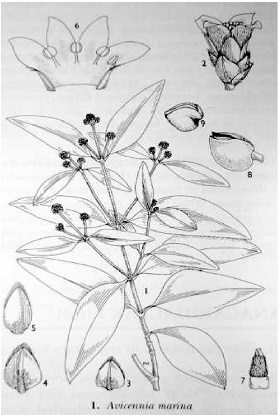
|
|
Espèces de la
mangrove
|
Matériel de plantation
|
Usage pour Plantation
|
Famille botanique
|
|
Avicennia marina (Forsk.)
Vierh.
|
Fruits
|
Dans les zones dégradées
|
Avicenniaceae
|
|
Avicennia officinalis
L.
|
Fruits
|
Dans les zones dégradées
|
Avicenniaceae
|
|
Excoecaria agallocha L.
|
Jeunes plants
|
Dans les zones dégradées
|
Euphorbiaceae
|
|
Aegiceras comiculatum (L.)
Blanto
|
Propagules
|
Dans les zones dégradées
|
Primulaceae
|
|
Bruguiera gymnorrhiza (L.)
Savigny
|
Propagules
|
Pour la diversité génétique
|
Rhizophoraceae
|
|
Rhizophora apiculata BI.
|
Propagules
|
Pour la diversité génétique
|
Rhizophoraceae
|
|
Rhizophora mucronata
Lamk.
|
Propagules
|
Pour la diversité génétique
|
Rhizophoraceae
|
|
Ceriops tagal
|
Propagules
|
|
Rhizophoraceae
|
|
Sonneratia apetala Buch.-Ham.
|
Graines
|
Pour la diversité génétique
|
Sonneratiaceae
|
|
Sonneratia alba
|
Graines
|
|
Sonneratiaceae
|
|
Xylocarpus moluccensis (Lamk.) M.Roem.
|
Graines
|
Pour la diversité génétique
|
Meliaceae
|
|
Xylocarpus granatum
|
Graines
|
|
Meliaceae
|
|
Lumnitzera racemosa
|
|
|
Combretaceae
|
|
Heritiera littoralis
|
|
|
Sterculiaceae
|
|
Pemphis acidula
|
|
|
Lythraceae
|
|
Barringtonia asiatica
|
|
|
Lecythidaceae
|
Source : Détails sur les espèces de palétuviers et le
matériel de plantation. Source : http://www.drcsc.org/VET/library/Nursery/Mangrove_Nursery_manual_HR.pdf
|
Espèce
|
Nature du substrat
|
Durée d’immersion
|
Taux de salinité requis
|
Localisation
|
Station préférentielle
pour la régénération
|
Morphologie des individus
adultes
|
|
Sonneratia alba
(Sonneratiaceae)
|
Sablo-vaseux sur les fronts
|
Longue à permanente
|
Moyenne (13,92 à 35,190g/l)
|
Zones externes (front de la
mer)
|
Sédiments nouvellement formés
|
3 à 12 m de haut,15 à 25cm de
diamètre, à pneumatophores
|
|
Xylocarpusgranatum
(Meliaceae)
|
Sablo-vaseux
|
Occasionnelle
|
Faible
(10 à 20g/l)
|
Zones intermédiaires
|
Sur les bancs externes peu
salés
|
Grands arbres, 10à 12m de
haut, de gros diamètre
(60cm),
|
|
Rhizophora mucronata
(Rhizophoraceae)
|
Vaseux riche en substance
colloïdale
|
Régulière et quotidienne
|
Forte (7,753 à 42,410g/l)
|
Zones externes (bord des
chenaux) et zones intermédiaires
|
Vase inondée périodiquement
|
7 à 12m de haut,10 à 15cm de
diamètre, port droit et à racine échasse
|
|
Ceriops tagal
(Rhizophoraceae)
|
Sablo-vaseux à sableux
|
Courte mais régulière
(résistante à une Exondation prolongée)
|
Forte
(15 à 45g/l)
|
Zones internes et
Intermédiaires
|
Bien éclairée
|
2 à 4m de haut, de petit
diamètre (<10cm), port plus moins droit et à contrefort
|
|
Bruguiera gymnorhiza
(Rhizophoraceae)
|
Sablo-vaseux à compact
|
Courte mais régulière
|
Forte
(15 à 45g/l)
|
Zones externes (bord des
chenaux) et zones intermédiaires
|
Vase peu salée périodiquement
inondée
|
10 à 14m de haut,10 à 15cm de
diamètre, à contrefort
|
|
Avicennia marina
(Avicenniaceae)
|
Sablo-vaseux
|
Immersion quotidienne à
occasionnelle
(Espèce ubiquiste)
|
Forte
(15 à 45g/l)
|
Zones externes (bord des
chenaux)
|
Plus ou moins sableux
Occasionnellement inondée
|
4 à 10m de haut,15 à 20cm de
diamètre, à pneumatophores
|
|
Lumnitzera racemosa
(Combretaceae)
|
Sableux
|
Occasionnelle
|
Forte (2,625 à 43,021g/l)
|
Zones internes
|
Limite interne de
l'arrière-mangrove
|
Arbuste (<1,5m de haut),
feuilles succulentes
|
|
Heritiera littoralis
(Sterculiaceae)
|
Sableux
|
Occasionnelle
|
Faible
(10 - 20g/l)
|
Zones internes à la limite
des formations non-mangroves
|
Limite interne de
l'arrière-mangrove
|
3 à 4m de haut, 7à 10cm de diamètre
|
Caractéristiques des 8 espèces les plus reconnues à
Madagascar.
Source : Tostain, 2010 ; Kathiresan et Bingham, 2001 et
Kathiresan et al., 1996 in RAZAKANIRINA, 2016.
Écosystème qui
se développe le long des côtes protégées des zones tropicales et subtropicales.
Elle pousse dans un milieu à dépôt salin présentant diverses formes de sols
anaérobies. Elle accueille une flore peu diversifiée mais une faune très riche.
Cet écosystème est caractérisé par trois types de formations végétales :
- La mangrove de bord de mer, essentiellement composée de Palétuviers
rouges (Rhyzophora mangle) qui peuvent atteindre 8 mètres de haut.
- La mangrove arbustive, en arrière de la ceinture côtière, où les
Palétuviers rouges ne dépassent pas 2 mètres de haut et d'où émergent quelques
Palétuviers noir Avicennia germinans, Palétuviers blancs Laguncularia
racemosa et Palétuviers gris Conocarpus erectus selon le niveau de
salinité des sols. Dans cette partie de la mangrove, ces espèces peuvent former
des peuplements plus élevés mais assez ouverts, fréquemment parsemés d'arbres
morts ou dépérissants. Il s'agit des étangs bois secs.
- La mangrove haute et les peuplements périphériques, situés après les
étendues arbustives et culminants à des hauteurs variant entre 10 et 20 mètres.
Dans cette partie de la mangrove, le Palétuvier blanc fait la transition avec
les marais herbacés ou la forêt marécageuse. Cette espèce donne un couvert
assez clair qui permet le développement de la Fougère dorée Acrostichum
aureum. Le Palétuviers gris, assez peu abondant, se rencontre dans les
endroits les mieux drainés (sols sableux ou rocheux). Il est surtout fréquent
aux abords des plages.
Autres définitions (voir ci-après) :
·
Ensemble des formations végétales, arborescentes ou
buissonnantes, colonisant des atterrissements intertidaux marins ou fluviaux,
périodiquement submergés par la marée saline (Guilcher 1954).
·
Zone baignée périodiquement par les eaux très salées (Kiener
1978).
·
Ecosystème intertropical, littoral des basses côtes (Conard
(1993).
·
Ecosystème incluant un groupement de végétaux principalement
ligneux spécifique, ne se développant que dans la zone de balancement des
marées appelée « estran » des côtes basses des régions tropicales (souvent à
l’embouchure des fleuves).
·
Groupe diversifié d'arbres tolérants au sel (halophyte) et en
général toujours verts.
Les espèces ligneuses les plus notables sont les palétuviers,
des arbres ou arbustes tropicaux avec leurs pneumatophores et leurs
racines-échasses, appartenant à diverses espèces, capables de prospérer le long
des rivages marins dans la zone de balancement des marées.
Chenier : type de cordon littoral mobile se présentant
comme une accumulation de sable à la surface d'un marais.
Mangal : terme désignant, en anglais, la mangrove sans
faire de contre-sens, mangrove, en anglais, désignant en même temps les
palétuviers et la mangrove.
Pneumatophore
: organes aérifères propres à certains palétuviers et à certains arbres des
forêts marécageuses continentales. On distingue des pneumatophores droits,
souples (Avicennia), durs (Sonneratia) ou coudés (Bruguiera,
Lumnitzera). Les pneumatophores se développent le long des racines.
Propagules (appelées également "plantules" ou
"hypocotyles") : Beaucoup de palétuviers sont vivipares c'est-à-dire
que leurs graines germent sur l'arbre parent avant de tomber. Quand la
propagule est mûre, il chute dans l'eau où il peut être transporté sur grandes
distances. Il peut survivre à la dessiccation et rester dormant durant des
semaines, des mois, ou même une année jusqu'à ce qu'il arrive dans un
environnement approprié. Une fois qu'une propagule est prête à s'enraciner, il
changera sa densité de sorte qu'au lieu de faire un système racinaire
horizontal favorisant la flottaison et il produit un système racinaire
vertical. En cette position, il est prêt s'enraciner dans la boue. Si une
propagule ne s'enracine pas, il peut changer sa densité de sorte qu'il flotte
plus loin encore à la recherche de conditions plus favorables (Wikipedia 2010).
Racines échasses : parmi les palétuviers les plus
communs, seul le genre Rhizophora possède des racines échasses (celles
qui partent du tronc) et des racines aériennes (celles qui partent des branches
parfois appelées cordages) partant des branches.
Régénération : au travers l'observation d'une
bonne régénération, l'on peut juger du bon état de santé d'un peuplement de
palétuviers. Elle s'exprime par une densité de plantules et de jeunes arbres
dans le sous-bois.
Tanne herbacée : étendue de sol couverte d'halophytes de petite
taille (salicornes, Sesuvium portulacastrum, Cressa creica, Sporobolus spp.,
etc.) se développant aux dépens de la mangrove. La surface des tannes herbeuses
est moins salée que celle des tannes vives (zones brunes) ce qui explique la
présence d'herbacées ou de tout petits ligneux.
Tanne vive : on appelle tanne vive une étendue de sol nu
se développant aux dépens de la mangrove. Il existe deux origines au phénomène
de « tannification » : la salinisation et parfois l'acidification. Une
diminution de la salinité ou de l'acidité des nappes et des sols peut conduire
à une re-colonisation partielle et souvent temporaire des tannes par les
palétuviers.
Voile algaire : c'est une pellicule organique fibreuse de
quelques millimètres d'épaisseur, d'aspect cartonneux lors des périodes sèches,
couvrant des dépressions à la surface des tannes ; il est formé par des Cyanophycées.
Sa couleur varie considérablement. Si l'absence de précipitations correspond à
des marées de morte-eau, le voile peut se dessécher, se détacher de la surface
du sol et être emporté par le vent.
Zonation végétale :au sein d'une mangrove, la zonation
végétale s'exprime par des peuplements d'espèces différentes de palétuviers
s'organisant en bandes grossièrement parallèles. Cette zonation est dépendante
de la topographie, aussi subtile soit-elle, qui influe elle-même sur la durée de
l'inondation par les marées.
Source : http://mangrove.mangals.over-blog.com/categorie-10994492.html
|

Tanne à salicornes en Nouvelle-Calédonie
|

Tanne à Sesuvium portulacastrum
|

Voile algaire.
|
Les mangroves y sont l'un des écosystèmes les
plus bioproductifs du monde. Ce sont les seules grandes espèces à
survivre sur des vases dépourvues d’oxygène.
Les palétuviers, il joue un rôle important de nurserie et de fixation
des littoraux vaseux ou vaso-sableux. En première ligne lors des tempêtes, il
peut en souffrir durement, mais les mangroves qu'il constitue
semblent augmenter la résilience des écosystèmes littoraux et leur
résistance face à certains aléas géoclimatiques (cyclones, tsunami).
Ils y constituent un véritable barrage vert qui devient le support et
l'abri d'une faune importante, et qui protège les littoraux instables des
assauts de la mer et des tempêtes.
Ces milieux procurent des ressources importantes (forestières et
halieutiques) pour les populations vivants sur ces côtes. La mangrove sert de
nurserie aux alevins, crabes, crevettes, mollusques, huitres, etc.
Leurs bois sont souvent utilisés pour le chauffage, comme bois de
charpente, dans la construction (voir ci-dessous), pour la construction de
radeaux, de pilotis et de poteaux devant séjourner dans l'humidité ou dans
l'eau. Le bois du palétuvier est souvent très dur, coriace, imputrescible,
renfermant beaucoup de tannin. L'écorce riche en tanin, de certains
palétuviers, servent à tanner les peaux. La mangrove sert de zone de pêche.
Certaines espèces sont médicinales. Le fruit de certains palétuviers, le
mangle, est comestible. Les feuilles de certaines espèces de fourrage.
Rôles
écologiques de la mangrove (suite) :
·
Stabiliser les sédiments
·
Accumuler la matière étrangère détritique ou autre
·
Servir d’habitat pour des épiphytes
·
Servir de nurserie pour les poissons et les invertébrés
·
Servir de perchoirs et de sites de nidification pour les oiseaux
·
A un rôle limité en tant que source alimentaire directe.
·
Contributeur majeur à la chaîne alimentaire détritique.
Les mangroves
favorisent la sédimentation : 0.5-20 mm/an. Le sol s'exhausse, donc le
rivage avance et la mangrove se déplace vers le large (voir ci-dessous).
|
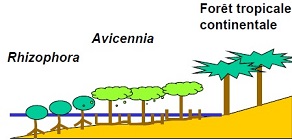
|

La litière dans une mangrove
|
|
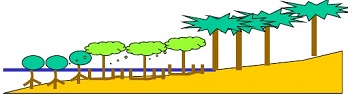
|
|
|
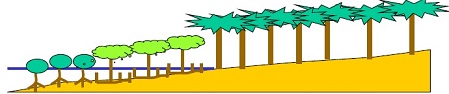
|
|
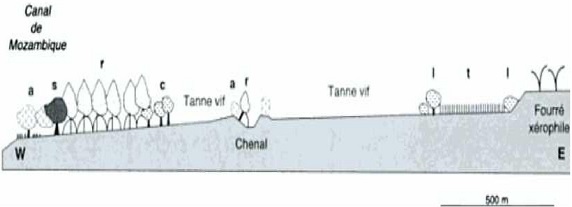
Séquence de Tsinjoriaka (sud de Morombe, Madagascar). a : Avicennia
marina, c : Ceriops tagal, l : Lumnitzera acemosa, r : Rhizophora
mucronata, s : Sonneratia alba, t : Typha augustifolia, h : Hibiscus
tiliaceus (voir page, ci-avant).
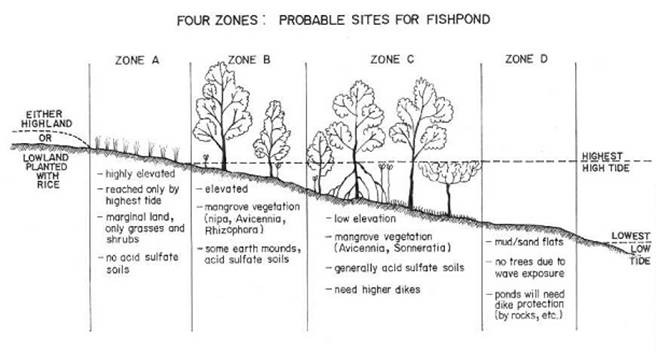
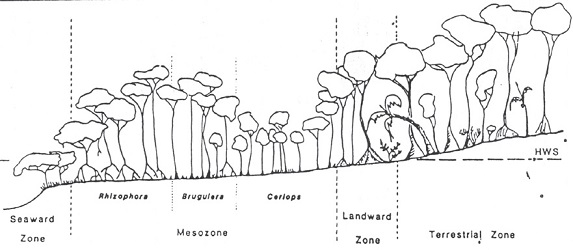
Coupe d'une section typique de mangroves divisée en zone
inférieure, méso et supérieure.
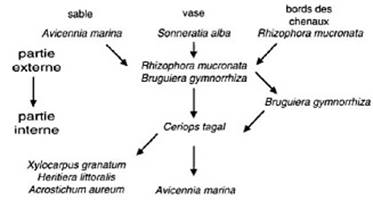
Les zonations végétales dans les mangroves de la partie
centrale du littoral oriental de l'Afrique (d'après Chapman V.J. 1976 p. 103).
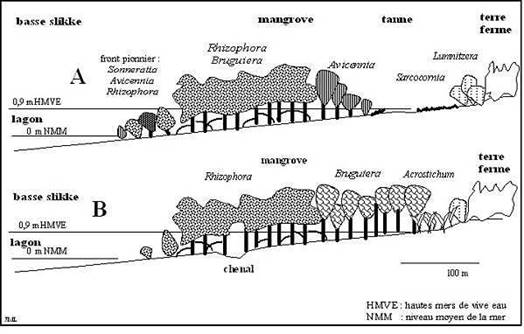
Exemples de la Nouvelle-Calédonie. A. Séquence montrant un sur-salement
progressif et aboutissant à un tanne et à une frange interne à Lumnitzera en
bordure de terre ferme. B. Séquence montrant un dessalement progressif et
aboutissant à une prairie à Acrostichum aureum. Lebigre, J.-M. 2004. Les
marais à mangrove de Nouvelle-Calédonie, un exemple de milieu « naturel »
lagonaire. Nouméa, Centre de Documentation Pédagogique, Scérén, Sce 44, 48 p.
·
Pisciculture de poissons et de crevettes,
·
Tampons naturels contre les ouragans (éviter que les rizières
soient envahies par l’eau salée),
·
Principale source détritique,
·
Nurserie pour de nombreux animaux différents (poissons, crabes,
crevettes …),
·
Nourriture pour : les personnes, les crabes, les champignons, les
bactéries, autres animaux,
·
Charbon de bois,
·
Matière tannante,
·
Miels de qualité.
La mangrove permet la reproduction du poisson (pisciculture possible),
des coquillages, des huitres (ostréiculture possible), la possibilité de
remettre en culture des rizières précédemment envahies par l’eau salée, la
production de bois d’œuvre ou bien un excellent miel que les abeilles
produisent à partir des fleurs du palétuvier.
|

Mangrove restaurée, protégeant un village des assauts
de la mer (au Guyana, Amérique du Sud).
|

Le programme SmartFish
en appui à l’exploitation du crabe de mangrove, Août 2014, Madagascar
© NJARATIANA RAKOTONIAINA
|
|

Production de poissons
|

Production de coquillages.
|

Produits de la mangrove au Guyana (miel, sculptures en
bois, fruits …).
Caractéristiques
des plantes se développant dans la mangrove, adaptées à un milieu hostile :
•
Une salinité élevée,
•
Des racines immergées,
•
Une faible oxygénation du sol due à la vase,
•
Un sol instable,
•
Des eaux chaudes.
·
Océan ouvert < 50 g C/m2/an.
·
Les récifs coralliens 1000 g C/m2/an.
·
Mangroves 500 g C/m2/an.
ð Plate-Forme
Continentale:
·
Les herbiers 1000 g C/m2/an.
·
Les estuaires et les marais salants 800 g C/m2/an.
·
La plus grande partie de la production primaire des palétuviers,
non exportée [par les courants marins …], est consommée par des animaux
détritivores.
·
Les Crabes en Australie accélèrerait (x 10-20) la biodégradation
de 70-80% de la litière.
|

Chenille se nourrissant de plantule d'Avicennia.
|

Sphaeroma serratum ↑
Crustacé, de la famille des cloporte, xylophage foreur
des palétuvier.
|

Escargot herbivore (un bigorneau), vivant sur les
branches et racines aériennes du palétuvier rouge (Rhizophora
mangle).
|
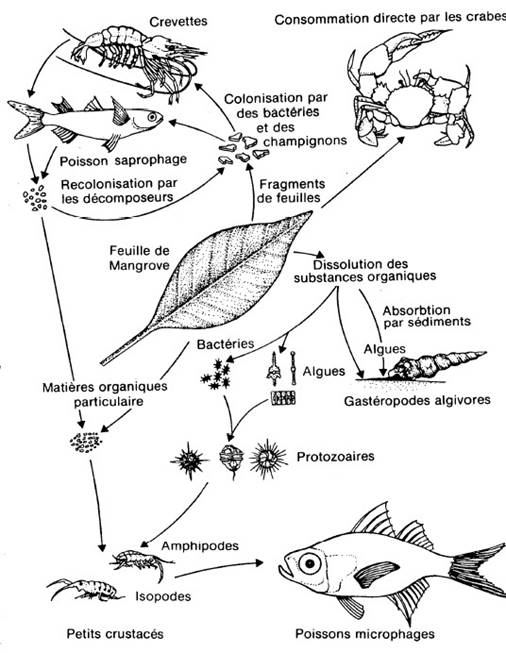
Chaînes alimentaires médiolittorales issues des feuilles de
palétuviers (d'après Lear et Turner in Ramade (1984). D’après Ramade, 1984. Eléments
d'écologie. Ecologie fondamentale. McGraw Hill publ., Paris : i-ix + 1-403
+ 33 pl. h.t
·
Estrans des régions tropicales et subtropicales peu profonds et
protégés,
·
Les mangroves se localisent le long des rivages tropicaux, en eau
marine et saumâtre (parfois douce),
·
Il y a des mangroves de front de mer, d'îlots, d'estuaire et de
lagunes,
·
Les mangroves s'installent généralement sur un substrat meuble.
·
Restreintes aux habitats marins et intertidaux adjacents,
·
Plage de température : 10 ° C à 20 ° C.
Les mangroves ont une tolérance élevée en sel. Ils peuvent survivre
bien dans un sol avec une salinité de 90 ؉
La moyenne de l'océan est de 35 ؉ (35 pour mille). Ils ont besoin de se prémunir de la
perte d'eau par soit :
•
L’excrétion du par feuilles.
•
L’exclusion du sel dans les racines.
•
L’excrétion du sel et l’abscission (en supprimant les organes
chargés de sel).
La mangrove vit dans la zone de transition écologique entre milieu
continental et milieu marin. Les plantes, se développant dans la mangrove
(palétuviers, badamier …), sont adaptées à un milieu hostile, ayant ces
caractéristiques suivantes :
·
Une salinité élevée,
·
Des racines immergées,
·
Une faible oxygénation du sol due à la vase,
·
Un sol instable,
·
Des eaux chaudes (Wikipedia 2010).
La mangrove héberge des animaux : crabes (crabes violonistes …),
poissons (périophtalmes …), ses crustacés, fameuses huîtres et délicieux
mollusques. Elle sert de nurserie aux alevins.
·
L'action des vagues : vent de la côte au vent (plus de flux de
marée) versus vent de la côte sous le vent (plus de conditions de anoxiques, de
stagnation, de prolifération d'algues),
·
Les nutriments,
·
Le flux de la marée (la force de la marée),
·
Le flux fluviale (la force du fleuve),
·
Le couvert forestier,
·
sol: sa faible teneur en oxygène (anaérobie), sa haute teneur en
sulfure d'hydrogène, les sols à grains fins (boueux), les bactéries anaérobies
de réduction du soufre,
·
Les coquilles calcaires de mollusques sont utilisées par les
bactéries de soufre --- qui, à leur tour, fournissent les nutriments Ca ++ que
la mangrove et d'autres animaux ont besoin, mais qui augmentent également
l'alcalinité du sol.
·
Canalisation, drainage, et envasement.
·
Ouragan.
·
Les herbicides et défoliants.
·
Pesticides et pollution.
·
Charge thermique (chaleur).
·
La plupart des mangroves sont vivipares, leurs propagules tombent
des branches et sont emportés par les vagues.
·
Pas d'étape de repos des graines : le corps fructificateur (la
propagule) est un semis.
·
Les palétuviers présentent un certain nombre d'adaptations
au milieu très particulier dans lequel ils vivent. Leurs graines sont
souvent vivipares : elles germent sur l'arbre afin de se ficher dans la vase
quand elles tombent (Rhizophora, Avicennia).
|
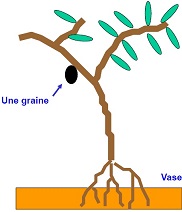
|
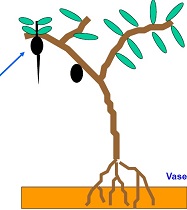
Une graine germée sur l'arbre (vivipare).
|
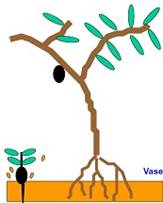
Une graine germée (plantule) fichée dans la vase.
|
Les racines aériennes aident à soutenir l'arbre. Ce système
racinaire peut être très étendu. Les pneumatophores ont une fonction
respiratoire. Le sol est très anaérobie, de sorte que les pneumatophores se
maintiennent au-dessus de la surface et capture l'oxygène O2. Ils fonctionnent
aussi en repoussant les nutriments vers la couche supérieure du sol. Les racines
échasses et les pneumatophores peuvent porter les huitres et autres
coquillages.
|

Racines aériennes en échasses.
|
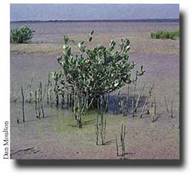

Pneumatophores
|

Paillasson de pneumatophores d’Avicennia marina © FORMAD
Environnement.
|
|

Pneumatophores d’Avicennia germinans © FORMAD
Environnement.
|

Pneumatophores de Sonneratia alba © FORMAD
Environnement
|

Racines échasses (Nouvelle-Calédonie : baie de Prony).
© FORMAD Environnement.
|
« Les mangroves semblent bien préservées dans les pays à faible
densité de population et ressources en bois suffisantes (Gabon, Guyane,
Australie) et en régression dramatique où la pression démographique est forte.
Par exemple, aux Philippines et en Equateur, elles ont été abusivement
converties en bassins d'aquaculture, tandis qu'en Indonésie, le rythme de leur
exploitation forestière est excessif. En Afrique de l'Est, la principale cause
de leur régression a été la conversion en marais salants.
Peu d'aménagements durables pour la production de bois (énergie et
bois de service) sont appliqués sauf localement dans certains pays asiatiques
(Inde, Bangladesh, Thaïlande, Malaisie). C'est l'Australie qui semble le mieux
assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation de ces
écosystèmes (vingt-trois parcs nationaux et sites effectivement protégés). Le
rôle des mangroves dans la protection contre l'érosion côtière et la
conservation de la faune aquatique a été reconnu : des reboisements et des
remises en état de mangroves dégradées sont réalisés dans certaines zones
d’Asie et d’Amérique centrale.
Les mangroves peuvent être techniquement gérées de façon durable en
vue d'un rendement soutenu en produits ligneux et autres produits forestiers.
Toutefois les aménagements sont fortement dépendants des pratiques
d'utilisation des zones terrestres, surtout en ce qui concerne les variations
des régimes hydriques, d’où la nécessité d’intégrer les zones en arrière du
littoral dans l’aménagement des mangroves ».
La dégradation rapide de certaines mangroves, dans le monde entier, _
surexploitées pour leur bois, le fourrage _ est devenue préoccupante, parce
qu'elles constituent des stabilisateurs efficaces pour certaines zones
côtières fragiles qui sont maintenant menacées, et parce qu'elles
contribuent à la résilience écologique des écosystèmes après les cyclones et
tsunamis et face aux effets du dérèglement climatique, incluant la montée
des océans.
« Sur le plan mondial, les mangroves occupent approximativement une
superficie de 152 000 Km² (Spalding et al, 2010). Cette estimation de la
couverture mondiale a été révisée à la baisse à 13 776 000ha par Giri et al.
(2011). En 2016, la superficie des mangroves mondiales a connu une diminution
significative à hauteur de 8 349 500 ha selon Hamilton et Casey. La croissance
démographique, le développement de la zone côtière, l’aquaculture, la conversion
en agriculture telle que la riziculture, la surexploitation des bois en sont
les principales raisons. » [22].
Les espèces, poussant à la limite terrestre de la zone de la mangrove
et ne supportant pas d'être immergées en permanence, peuvent être plus menacées
par l'élévation du niveau de la mer que d'autres espèces [22].
|

Zone de mangrove fortement dégradée. © Oceanium á ↗
|

© Oceanium.
|

Stocks de rondins de palétuviers coupés pour leur bois (au
Guyana).
|
|

Arasement / nivellement d’une mangrove, à Tahun anggaran (Indonésie).
|

Coupe de bois de Rhizophora, pas de repousse ©
FORMAD.
|
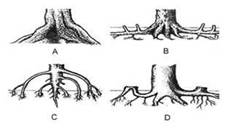
Racines échasses :
A) Xylocarpus granatum;
B) Avicennia marina,
Sonneratia alba;
C) Rhizophora
mucronata;
D) Bruguiera gymnorrhiza
© FORMAD Environnement
Note : image en rapport avec le paragraphe "Racines
aériennes et pneumatophores".
|
|

Feu de forêt dans la mangrove (au Guyana), à cause de
l’homme.
|

Mangrove à Sonneratia très « attaqué » par l’homme,
pour la récolte du bois de feux (sur la route entre Tuléar et Ifaty. Côte
Ouest de Madagascar). © B. Lisan
|
|

Les coupes à blanc pour la production de charbon de bois met les
villages face aux risques de l'augmentation de l’impact des vagues, du vent
et des inondations. Les villages le long du côté ouest (au vent) de cette
île, en Indonésie, ont tous connu des inondations. Elles ont augmenté en
raison de la coupe à blanc des mangroves côtières; pour la production de
charbon de bois et le développement de bassins piscicoles.
|

Pour éviter la surexploitation du bois des mangroves, certaines ONG
apprennent à construire et à utiliser des cuiseurs performants et économes en
bois. Ces initiatives peuvent contribuer encore plus à ce que les
communautés locales s’engagent encore plus dans la préservation de leur
mangrove.
|
Famille
: Verbenaceae, ou Acanthaceae (ex Aviceniaceae), selon la
classification phylogénétique.
Synonyme
: palétuvier noir (en français) ou palétuvier gris (en anglais).
Écologie : Les palétuviers noirs Avicennia marina se
trouvent près de la mer, au niveau des basses eaux. Ce sont parmi les premiers
arbres à former et coloniser la mangrove (avec les arbustes du genre Sonneratia).
Ces arbres ont de longues racines qui fixent la vase et permettent à de
nouveaux sédiments de se déposer derrière. Comme les autres palétuviers, cette
espèce contribue à la fixation des sédiments et du trait de côte. Les racines
de cette plante, en complément du travail de crabes fouisseurs tels que Uca
vocans, réoxygènent en permanence le sédiment vaseux et modifient le cycle
du soufre et du carbone en contribuant à la biogéochimie des sulfures.
Salinité : Forte (15 à 45g/l). Les Avicennias marina
supportent un degré élevé de salinité. Ils supportent aussi d'être presque
continuellement submergés dans l'eau salée de la mer.
Zonation : immersion quotidienne (zone intertidal), immersion à
forte marée, atterrissements vaseux, immersion aux grandes marées d'équinoxe
(chenaux des marées) ;
Plantule : Cette espèce ne forme pas de propagules mais plutôt
une graine qui dispose donc d’une plus grande zone de dispersion, ce qui lui
permet de coloniser des espaces éloignés par rapport à l’arbre-mère.
Plante : 4-10 m de hauteur.
Tronc : écorce jaunâtre, circonférence 35-57 cm
Feuilles : opposées décussées, ovale, allongée, épaisse, une
seule nervure centrale apparente en relief sur la face inférieure, face
inférieure vert-clair, exudats de sel.
Racines : Il présente une adaptation aux milieux anoxiques sous
forme de pneumatophores,
de 6 à 30 cm (95 à 525 par m2 ou 41 à 492), le long des racines principales.
Inflorescences : débute mi-septembre
Fruits : rond avec une pointe, jaunâtre à vert clair, écorce duveteuse.
Deux gros cotylédons.
Période de
collecte des fruits : mars (à Madagascar).
Utilisation
: les fruits sont mangés par les zébus et les chèvres, cercueil, clôture,
médicament (feuille séchée ou verte contre maux de ventre et jaunisse), roue de
charrette, chaux. Les feuillages d’Avicennia marina permettent la survie
des zébus car les herbes ne suffisent pas pendant la saison sèche. De temps en
temps, les éleveurs cueillent les feuilles pour nourrir leurs zébus ou ils
envoient leurs bovins pâturés dans la mangrove.
Utilisation
en construction : Charbon, clôture, renforcement de la toiture.
Utilisation
en bois d’énergie : Fumage traditionnel de poisson, cuisson.
Conservation
:des graines : ?
Multiplication
: par graine.
Bois :
faible qualité du bois.
Sources : a) Espèces
de palétuviers dans les mangroves de Toliara, Serge Tostain, FORMAD
Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Avicennia_marina
|

Fruits
|

Individu pionnier de l'espèce A.
marina dans le lagon de Batticaloa, au Sri Lanka.
|

Fleurs
|
Famille
: Rhizophoraceae
Synonyme
: palétuvier orange.
Écologie : Il se trouve principalement à l’intérieur des
mangroves, et fortement liée à la présence de Rhizophora mucronata. En
termes de succession écologique, elle a tendance à se développer à la suite de Rhizophora
mucronata, profitant de la présence de cette dernière pour pousser à l’abri
de la force de la marée. Le
palétuvier Bruguiera gymnorhiza pousse à
l'intérieur de la mangrove de l'Asie du Sud-Est près de la terre ferme,
derrière les premiers arbustes et arbres colonisateurs du genre Sonneratia et
les palétuviers noirs du
genre Avicennia qui poussent près de la mer, au niveau des basses eaux ;
et aussi derrière les palétuviers rouges du genre Rhizophora.
Salinité
: Forte (15 à 45g/l).
Zonation
: immersion quotidienne (zone intertidale)
Plantule
: propagules courtes, épaisses et sillonnées.
Plante : environ 10 à 14 m de hauteur. Arbre sempervirent
généralement haut de 10 à 20 mètres, mais pouvant atteindre environ 35 mètres
de haut et 1,5 mètre de diamètre à la base.
Tronc :
rouge. Tige rougeâtre avec traces des pétioles.
Pneumatophores
:
Feuilles
: ovales pointus, en verticille à l'apex alternes. Pétiole rouge sur une courte
distance. Il présente des feuilles lancéolées disposées en étoile.
Racines : Ses racines ne sont que rarement voire jamais
submergées par la marée haute. Un palétuvier sans échasses, avec des racines coudées ou des pneumatophores (aussi appelées « racines en genou »).
Inflorescences
: rougeâtres sépales en pointe. Les fleurs, solitaires, vont du rouge vif au
rouge-rose. Elles sont généralement retombantes. Les pétales sont en forme de
fines dents acérées.
Fruits : graines germées sur l'arbre (propagules). Les fruits sont des baies campanulées,
vertes et oblongues, renfermées dans le tube du calice. Ils contiennent une ou
deux graines. Ils s'allongent pour former un hypocotyle de 25 centimètres de long.
Période de
collecte des propagules : mars (à Madagascar).
Utilisation : bois de chauffe. Pour être mangés, les propagules
doivent être pelés, lavés, éventuellement macérés (dans la vase), râpés
et longuement cuits. On relève parfois un goût amer que l'on fait
disparaître à Guam en les faisant bouillir avec de la cendre. Aux Antilles, les
"Nègres marrons" n'en consommaient que la "pulpe" centrale.
Dans l'île de Biak qui fait partie de l'actuel Papua indonésien, on fabrique à
partir des propagules une pâte riche en protéines. Les propagules ou gousses
vertes sont consommées comme légume cuit.
Utilisation en construction : Bois d’œuvre, élément de structure
de case.
Utilisation en bois d’énergie : Charbon, cuisson.
Conservation
:des graines : ?
Multiplication
: propagules très fines.
Source : a) Espèces de palétuviers dans les mangroves de Toliara,
Serge Tostain, FORMAD Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Bruguiera_gymnorrhiza
|

|

Fleur
renfermant un hypocotyle.
|

|
|

Photo : RAHERITAHIANA, 2016
|

Racines en genoux.
|

Racines en genoux.
|
Famille : Rhizophoraceae
Synonyme
: Ceriops condolleana ou Ceriops boviniana, palétuvier jaune.
Écologie : Son habitat est dans les zones d'eau saumâtre dans
les zones de marée. Elle ne supporte pas en revanche les longues périodes
d’immersion, ce qui la place au plus haut niveau de l’estran, au-delà du cœur de
mangrove. Les individus de cette espèce se rassemblent généralement sur des
langues de terres sèches qui s’inondent à chaque marée haute. C. tagal a
tendance à se produire dans les marécages d'espèces mixtes (avec Xylocarpus
et Avicennia). On observe systématiquement de nombreuses populations de
crabes violonistes au niveau de leurs racines, ainsi que des crabes araignées
des mangroves, lorsque la marée est haute.
Salinité : Forte (15 à
45g/l). Espèce résistante à la dessiccation (à la sècheresse) ainsi qu’au
stress salin.
Zonation
: immersion quotidienne (zone intertidale), immersion à forte marée avec
atterrissements vaseux.
Plante : 6 à 8 m de hauteur en moyenne. Arbre de taille moyenne
atteignant une hauteur de 25 mètres (80 pieds) avec un diamètre de tronc allant
jusqu'à 45 cm (18 pouces). L'habitude de croissance est colonnaire ou
multi-tronc.
Tronc :
Ecorce gris argenté à brun orangé, lisse avec des lenticelles pustuleuses
occasionnelles.
Pneumatophores
: coudés.
Feuilles
: ovales plus ou moins allongé. Les feuilles sont en paires opposées, vert
jaunâtre brillant dessus, obovales avec des marges entières, jusqu'à 6 cm (2,4
po) de long et 3 cm (1,2 po) de large.
Racines : longue radicule, grêle et verruqueuse. Grandes racines
en contrefort. Les racines d'ancrage rayonnantes sont parfois exposées et
peuvent s'enrouler par endroits.
Inflorescences : Les fleurs sont portées seules à l'aisselle des
feuilles ; chacun a une longue tige et un tube calice court et des pièces par
cinq ou six. Les étamines appariées sont enfermées dans les pétales qui
s'ouvrent de manière explosive lorsqu'elles sont dérangées.
Fruits : graines germées sur l'arbre (propagules). Les fruits ovoïdes mesurent jusqu'à 3 cm
(1 po) de long suspendus au tube du calice rétréci. Brunes d'abord, elles
changent de couleur en mûrissant et l'hypocotyle émerge. L'hypocotyle est long et mince, atteignant
environ 35 cm (14 po) de long, et est côtelé, une caractéristique qui distingue
ce palétuvier du palétuvier jaune à fruits lisses (Ceriops australis).
Période de
collecte des fruits : février-mars
Utilisation : mât de pirogue, maison, chaise, table, lit,
charbon, clôture, bois de chauffe. Le bois durable est utilisé dans la
construction de maisons. Il est également utilisé dans la fabrication de
charbon de bois et est préféré comme bois de chauffage, étant le deuxième
derrière Rhizophora spp., et un colorant peut être extrait de l'écorce.
Parmi les espèces de palétuviers, son écorce et sa sève donnent des colorants
rouges et noirs qui sont utilisés dans le batik et le tannage du cuir. Bois de
bonne qualité. Utilisation en construction : Bois d’œuvre, élément de
structure de case et de clôture. Utilisation en bois d’énergie :
Charbon, cuisson.
Conservation
des graines :
Multiplication
: propagules à grosses côtes
Source : a) Espèces de palétuviers dans les mangroves de Toliara,
Serge Tostain, FORMAD Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Ceriops_tagal
c) https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?g=pe&p=Ceriops+tagal+(Perr.)+C.B.Rob.
d) http://queenslandcoast.blogspot.com/2016/09/australias-spurred-mangroves-ceriops-sp.html
|

Propagules (jeunes)

Propagules
|

Fleurs

Feuilles
|
|

Les hypocotyles matures sont beaucoup plus gros et
peuvent avoir des colliers au sommet (C. tagal) (© Queensland
coast).
|

Feuilles
|

Fleurs
|
|

Propagules (fruits)
|

Tronc
(© Queensland coast)
|

Racines et habitat du Ceriops tagal
(© Queensland coast).
|
Famille
: Combretaceae
Synonyme :
Roneho, Sahiranko (en malgache).
Écologie : Il pousse dans la partie supérieure de la zone
intertidale et se trouve à la fois sur les plages et le long des berges des
criques. C'est une espèce pionnière à croissance rapide.
Salinité
: Forte (2,625 à 43,021g/l).
PH :
6,7-7,7
Zonation : immersion à forte marée avec atterrissements vaseux,
immersion à grandes marées d'équinoxe et chenaux des marées, sols salés des
chenaux marins, terres fermes peu salées, tannes.
Plantule :
Plante : 1,5 m à 2 m de hauteur. Arbre à feuilles persistantes de taille petite à moyenne,
atteignant une hauteur maximale de 37 m (121 pi).
Tronc :
Racines / Pneumatophores
: coudés ? L’arbre développe
des pneumatophores et a souvent des racines échasses.
Feuilles : ovale, opposées, décussées avec quelques échancrures,
nervure centrale peu apparente, épaisse, sans pointe. Les feuilles sont
disposées en spirale à l'extrémité des pousses ; elles sont simples et
obovales, avec des bords légèrement dentés.
Inflorescences
: très petites fleurs blanches. Les inflorescences se développent en épis
courts à l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des pousses. Les fleurs sont
petites et blanches.
Fruits :
Fruits ligneux aplatis contenant une seule graine.
Période de
collecte des fruits :
Utilisation
: bois de chauffe, maison, bétail. Son bois est solide et durable et a de
nombreuses utilisations, y compris la construction de ponts. Le bois est très
apprécié pour la fabrication du charbon de bois au Cambodge. L'écorce est récoltée
pour les tanins qu'elle contient.
Conservation
:des graines :
Multiplication
: propagules très fines.
Sources : a) Espèces de palétuviers dans les mangroves de Toliara,
Serge Tostain, FORMAD Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Lumnitzera_racemosa
|

|

Petites fleurs blanches
|

|
|

|
 
Feuilles
|

Fruits verts caduques.
|
Famille
: Rhizophoraceae
Synonyme
: Tanga marotagna (malgache), palétuvier rouge.
Écologie : Il pousse à l'intérieur de la mangrove de l'Asie du
Sud-Est, juste derrière les premiers arbustes et arbres colonisateurs du genre Sonneratia
et les palétuviers noirs du genre Avicennia qui poussent près de la mer,
au niveau des basses-eaux. L'habitat
naturel de Rhizophora mucronata est constitué d'estuaires, de
criques de marée et de zones côtières plates soumises à des crues
quotidiennes. Il semble être plus tolérant aux inondations que les autres
espèces de mangrove et forme souvent une frange à feuilles persistantes dans
les zones de mangrove. Il se présente parfois en peuplement pur ou peut
pousser avec Rhizophora
apiculata. Les plantules sont souvent endommagées par
les crabes. Les feuilles sont également mangées par les crabes et
font partie du régime alimentaire du macaque mangeur de crabes (Macaca irus). L'arbre est attaqué par le
coléoptère Poecilus fallax. Dans
le sanctuaire d'oiseaux de Mangalavanam près de Cochin, en Inde, il pousse en association avec la
mangrove Avicennia
officinalis,
la fougère
doré, fougère des marais ou acrostic doré (Acrostichum
aureum) et l’acanthe à
feuilles de houx (Acanthus
ilicifolius).
Salinité
: Forte (7,753 à 42,410 g/l).
PH :
6,6-7,7.
Zonation
: immersion quo.
Plantule : propagule germée. L'espèce se régénère facilement à
partir de graines. L'espèce se reproduit via la germination de propagules et se
disperse par hydrochorie, c’est-à-dire grâce à l’action de marée. Elle est
également capable de viviparité en permettant à la propagule de germer en étant
toujours accrochée à l’arbre-mère.
Plante :
10-12 m de hauteur. Arbre de 7 à 12 m de haut, 10 à 15 cm de diamètre, port
droit et à racine échasse.
Tronc :
rugueux.
Racines : en échasses au-dessus du sol. L'espèce est
reconnaissable à ses hautes racines échasses. La racine commence à s'allonger
et peut atteindre une longueur d'un mètre (yard) ou plus. La propagule se
détache alors de la branche lorsqu'elle est suffisamment développée pour
s'enraciner dans la vase en dessous.
Pneumatophores
: non.
Feuilles : grandes feuilles ovales allongées, opposées, nervure
centrale très apparente en relief sur la face inférieure, épaisses, vertes. Les
feuilles sont elliptiques et mesurent généralement environ 12 centimètres (4,7
pouces) de long et 6 centimètres (2,4 pouces) de large. Ils ont des pointes
allongées mais celles-ci se cassent souvent. Il y a des verrues liégeuses sur
le dessous pâle des feuilles.
Inflorescences : petites fleurs jaunes à 4 sépales et 4 pétales.
Les fleurs se développent en grappes axillaires sur les rameaux. Chacun a un
calice dur de couleur crème avec quatre sépales et quatre pétales blancs et
velus.
Fruits :
vivipare, les graines germent sur l'arbre formant des propagules. Les
graines sontvivipares et commencent à se développer alors qu'ils sont encore
attachés à l'arbre.
Période de
collecte des propagules :
Utilisation : bois de chauffe, mât de pirogue, maison, chaise,
table, clôture, roue de charrette, bois de chauffe. Les jeunes feuilles de
Rhizophora sont susceptibles soit d'être mangées bien cuites, soit de servir à
donner un goût original à un plat. Elles sont réputées riches en acides
aminés, thiamine, riboflavine, acide folique et choline. En Floride on utilise
les feuilles de Rhizophora mangle préalablement séchées pour fabriquer
le "Maritime Tea". Des tablettes protéinées sont élaborées à partir
de ces mêmes feuilles (blog Lebigre 2009).
Il est utilisé pour aider à prévenir l'érosion côtière et dans la
restauration des habitats de mangrove. Le bois est utilisé pour le bois de
chauffage et dans la construction de bâtiments, comme poteaux et pilotis, et
dans la fabrication de pièges à poissons. Les fruits peuvent être cuits et
consommés, le jus est extrait pour faire du vin, et les jeunes pousses peuvent
être consommées comme légume. L'écorce est utilisée en tannage et un colorant
peut être extrait à la fois de l'écorce et des feuilles. Diverses parties de la
plante sont utilisées en médecine traditionnelle.
Multiplication
: grandes propagules sans côte.
Sources : a)
Espèces de palétuviers dans les mangroves de Toliara, Serge Tostain, FORMAD
Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mucronata, c) https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mucronata
|

|

|
|

|
 
Raheritahiana, 2016 (à gauche). Fleurs (à droite).

|
|
|
|
Famille
: Lythraceae (ou Sonneratiaceae).
Synonyme :
Songery (en malgache).
Écologie : Son habitat est abrité, constitué de rivages
sablonneux et de criques dans la zone tidale (celle des marées). C’une espèce
typique des zones à forte et fréquente immersion.
Salinité
: 13,920 g à 35,190 g / l
PH :
6,7-8,2
Zonation
: immersion quotidienne (zone intertidale).
Plantule
:
Plante : 5 – 6 m à 8-10 m de hauteur. S. alba pousse
jusqu'à 40 m (130 pi) de hauteur avec un diamètre de tronc jusqu'à 70 cm (30
po).
Tronc :
90 à 118 cm de diamètre. L'écorce fissurée est brunâtre, virant au gris sous la
marque de la marée.
Pneumatophores
: droits ou coudés, gros en forme de cône, 49 à 247 par m2. Ou grands, durs et
pointus.
Racines
:
Feuille
: épaisse, large, arrondie
Inflorescences
: beaucoup d'étamines. Les fleurs sont blanches, avec du rose à leur base.
Fruits :
ronds, graines difficiles à faire germer en pépinière), pas de dormance. Les
fruits vert foncé mesurent jusqu'à 5 cm (2 po) de long.
Période de
collecte des fruits : tardifs, mai (à Madagascar).
Utilisation : bétail (fourrage), charbon, chaux, cercueil, bois
de chauffe. S. alba est utilisé comme bois de chauffage. Son bois est
utilisé dans la construction de maisons et de bateaux. Les fruits aigres sont
utilisés pour parfumer le poisson et sont parfois consommés crus. Les feuilles
se consomment également crues ou cuites.
Conservation
:des graines :
Multiplication
: par graines.
Sources : a) Espèces
de palétuviers dans les mangroves de Toliara, Serge Tostain, FORMAD
Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Sonneratia_alba
|

|

|
|

|

Fleur
|
|

|

Fruit sec contenant de très nombreuses petites graines
(elles germent difficilement en pépinière).
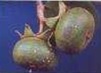
|
|

Pneumatophore pointues (Sonneratia alba)
|

Sonneratia alba (fleur)
|
Famille
: Meliaceae (ex Combretaceae)
Synonyme
: Carapa obovata, palétuvier casse-tête ou puzzle, palétuvier boulet de
canon, palétuvier cèdre.
Noms
vernaculaires :
Écologie
: milieu peu salé.
Salinité : Il tolère une salinité de 0,1-3%. Il se rencontre
préférentiellement dans les zones peu immergées, ce qui explique sa faible
adaptation aux stress hydriques et salins.
Zonation : immersion quotidienne (zone intertidale), immersion à
forte marée, atterrissements vaseux, immersion à grande marée d'équinoxe et
chenaux des marées, sol salé des chenaux marins. Il pousse dans la zone
intertidale supérieure et se trouve dans les estuaires et le long des berges
des ruisseaux.
Plantule
: ?
Plante :
6-9 m de haut ; 65 à 75 cm.
Tronc : Le tronc a des contreforts et des racines aériennes qui
s'étendent sur de longues distances de chaque côté. L'écorce est brune et
lisse, et se détache en flocons.
Racines
: à contrefort.
Pneumatophores
: absents.
Feuilles : composées folioles en nombre pairs, ovale, vert clair.
Les feuilles sont pennées et disposées en spirale sur les rameaux; elles ont
deux à quatre paires de folioles et sont vert pâle lorsqu'elles sont jeunes et
s'assombrissent avec l'âge.
Inflorescences : L' inflorescence se développe en une courte
panicule à l'aisselle d'une feuille ou à l'extrémité de la pousse. Les fleurs
individuelles mesurent 8 mm (0,3 po) de large, avec des parties par quatre, et
sont blanches ou jaune rosâtre.
Fruits : très gros fruits sphériques, légers. Les fleurs sont
suivies de grandes capsules ligneuses sphériques, de 9 à 12 cm (4 à 5 pouces)
de diamètre, qui se fendent pour révéler jusqu'à une douzaine de graines. Le
nom commun "palétuvier casse-tête" dérive de la forme irrégulière des
graines : un puzzle peut être créé en mélangeant les graines et en essayant de
les réassembler dans leur arrangement sphérique original.
Période de
collecte des fruits : mai (à Madagascar)
Utilisation : Le bois est dur et durable et peut être utilisé
pour la construction de bateaux _ Kasama (étrave) de pirogue … _, l’encadrement
de porte, la construction et la fabrication de meubles, mais les arbres sont
tordus et souvent creux, de sorte que les gros morceaux de bois peuvent ne pas
être disponibles ; le bois est également utilisé pour les manches d'outils et
autres petits objets, et peut être utilisé comme bois de chauffage, mais brûle
assez rapidement (donc il est rarement utilisé comme bois de chauffe). L'écorce
est riche en tanins et a été utilisée pour renforcer la corde et teindre le
tissu. L'écorce, les fruits et les graines ont été utilisés en médecine traditionnelle.
Conservation
:des graines :
Dormance
: pas de dormance.
Multiplication
: par graines.
Sources : a) Espèces
de palétuviers dans les mangroves de Toliara, Serge Tostain, FORMAD
Environnement, Toliara, juin 2010, http://www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Xylocarpus_granatum
c) https://uses.plantnet-project.org/fr/Xylocarpus_granatum_(PROTA)
Famille
: Sterculiaceae (celle du
cacaoyer).
Synonyme
: talotus philippin, mangrove-miroir ou dugun.
Écologie : arbre de mangrove et de sub-mangrove. Il pousse sur
la marge intérieure des mangroves, là où l’eau douce se mélange à l’eau de mer
ou prédomine. On le trouve parfois aussi sur des rivages rocheux, et plus
souvent sur les berges de cours d’eau soumis à la marée.
Salinité : Il semble être intolérant à une salinité élevée.
PH : ?
Zonation :
Plantule
: Plantule à germination hypogée.
Plante :
Grand arbre à noix en forme d'aile, de taille moyenne, de 5 à 15 m de hauteur,
toujours vert.
Tronc : écorce grise rosâtre, lisse sur les sujets jeunes et
plus écailleuse sur les arbres plus âgés.
Racines : Le fruit se fend sous l’action de la radicule épaisse
et dure qui en sort et forme une racine primaire qui pénètre profondément dans
le sol. La racine primaire se ramifie ensuite rapidement, et finalement la
plumule apparaît.
Pneumatophores
: absent.
Feuilles : Feuilles oblongues, ovales à elliptiques, avec une
extrémité pointue, de 10 à 20 cm de longueur. Elles sont vert foncé sur la face
supérieure et très blanche à argentée sur la face inférieure. Il est facilement
reconnaissable par les écailles argentées présentes sur la face inférieure de
ses feuilles, qui apparaissent donc vert d'en haut et blanc d'en bas.
Inflorescences : Panicule axillaire jusqu’à 18 cm de long, très
ramifiée, à poils écailleux. Fleurs unisexuées, régulières, (4–)5-mères,
petites ; pédicelle jusqu’à 5 mm de long ; calice en coupe, d’environ 5 mm de
long, à lobes courts, poilu ; pétales absents ; fleurs mâles avec des étamines
fusionnées en une colonne ; fleurs femelles avec (4–)5 carpelles réunis de
manière lâche, généralement un seul carpelle se développant pour former un
fruit.
Fruits : Le fruit est une graine boisée elliptique d’environ 6
cm de long et 4 cm de large, de couleur pourpre à marron, brillante avec une
quille raide sur un côté bien caractéristique. Fruit : nucule ellipsoïde à
oblongue-ovoïde de 6–8 cm × 3–6 cm, avec une crête dressée distincte sur un des
côtés, ligneuse, brun luisant, renfermant 1 graine. Graine oblongue-ellipsoïde,
aplatie, d’environ 3 cm de long, brune.
Période de
collecte des fruits : ?
Utilisation : Son bois est lourd, dur et résistant. Le bois de
cœur est brun rougeâtre ou brun foncé, avec souvent une teinte chocolat ou
pourpre. La densité est de 830–1040 kg/m³ à 15% de taux d’humidité. Contrefil,
grain fin et régulier. Le bois de cette espèce est apprécié pour sa ténacité,
sa durabilité et sa résistance à l'eau salée. En tant que tel, il est
couramment utilisé dans la construction navale et dans la fabrication de pieux,
de ponts et de quais. Le bois dur est utilisé pour la construction de canoës,
de mâts, de poteaux pour les maisons, pour les charpentes de bateaux. Le bois
est un excellent combustible, ayant un grand pouvoir énergétique.
Les brindilles sont utilisées aux philippines comme brosse à dent. Un
extrait de la graine est utilisé pour traiter la diarrhée et la
dysenterie. L’écorce aurait des vertus anti-inflammatoires. Ses racines, dont
l'action toxique est due à à la présence de sesquiterpénoïdes, sont utilisées
comme poison de pêche.
Le fruit grillé est comestible. Le fruit des espèces du genre est
utilisé dans la cuisine philippine pour neutraliser le goût de poisson du
kinilaw, un plat local de poisson cru au vinaigre ou aux jus d'agrumes.
Conservation
:des graines :
Dormance
:
Multiplication
: Graine insubmersible dispersée par les courants marins.
Sources : a) http://www.tahitiheritage.pf/toto-margot-heritiera-littoralis/
b) https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Heritiera+littoralis+Aiton
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Toto_margot
Suggestion
: Peut-être serait-il possible d’utiliser le gène de résistance au stress salin
du Toto margot, afin de rendre le cacaoyer résistant au sel et lui permettre de
pousser dans une mangrove ?
Pour commencer, il est important de bien s’organiser. Un responsable du
village doit déterminer le rôle de chacun pour le jour j du reboisement :
1.
Une équipe formée d’anciens et de jeunes enfants s’occupera du tri des
propagules,
2.
Un groupe d’hommes ou de femmes tracera les limites de reboisement,
3.
Les jeunes hommes costauds joueront le rôle de porteur,
4.
Le reste du village formera le groupe des planteurs.
Attention :
- N’oubliez pas de prévoir des bidons et des bouteilles d’eau pour
que tout le monde puisse boire.
·
Apportez aussi des seaux, des calebasses ou tout autre récipient
pour transporter les propagules.
|

Traceurs
|

Trieurs
|
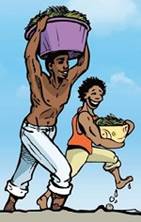
Porteurs
|
|

Planteurs
|

Ne pas oublier de l’eaux pour boire
|
|
© Images / dessins Oceanium Dakar
·
Pour vous donner toutes les chances de réussir le reboisement, il
faut choisir en priorité des zones où poussent déjà (ou ont déjà poussé) des
palétuviers.
·
Attention, les propagules ne pousseront pas dans n’importe quel
sol. La zone doit être impérativement immergée à chaque marée haute, y
compris lors des petites marées en saison sèche.
·
Enfin, il faut choisir un sol vaseux (poto-poto) sinon les
palétuviers auront très peu de chance de pousser dans un sol trop dur (sur un
tanne sec, dans du sable dense, etc.).
|

Choix d’une zone où la mangrove a déjà poussée.
|
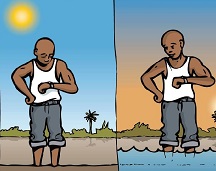
Choix d’une zone immergée à marée haute.
|

Choix d’un sol vaseux.
|
© Images / dessins Oceanium Dakar
·
L’étape suivante consiste à délimiter la zone de reboisement.
·
Cette opération doit être faite en fin de saison sèche,
quand le coefficient de marée est au plus bas (c’est a dire quand la lune
n’apparait qu’à moitié dans le ciel).
·
Sur la zone, attendez que la marée soit au plus haut et plantez
des piquets sur cette limite.
·
Cela vous permettra d’être sûr que les jeunes plants que vous
allez planter seront immergés à chaque marée haute, y compris pendant les
périodes les plus dures de la saison sèche.
·
Déterminer aussi la durée de l'inondation des marées et sa
fréquence - en supposant qu’il y a deux marées hautes quotidiennes, au cours
d'une année entière.
|

Former à délimiter le niveau moyen de la mer.
|

|
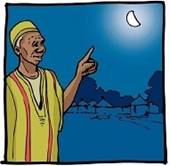
|
|

La marée monte.
|

La marée est au plus haut.
|

La marée redescend.
|
© Images / dessins Oceanium Dakar.
A partir du mois de décembre [dans l’hémisphère Sud] ou de juillet
[dans l’hémisphère Nod], formez une délégation pour aller vérifier si les
propagules sont assez mûres pour être cueillies. La récolte ne pourra commencer
que si :
- certaines plantules sont déjà tombées au sol,
- les propagules sont de couleur vert foncé (vert clair = pas assez
mûres),
- lors du décapsulage un petit bourgeon apparaît (si le bourgeon se
casse, la propagule n’est pas bien mûre).
Une fois les bonnes conditions réunies, formez des équipes pour la
collecte. Les enfants et les plus souples peuvent se faufiler dans la mangrove
pour extraire un maximum de plantules. Les autres ramassent celles tombées au
sol ou facilement accessibles. Il faut prendre soin de choisir les
propagules les plus belles, les plus mûres et les moins abîmées et de les
ranger soigneusement à horizontal dans des sacs (sacs de riz) pour ne pas
les abîmer. Attention ! Une fois la récolte terminée, si le repiquage ne peut
se faire le jour même, il faut stocker les sacs bien a l’ombre, dans l’eau
de mer, sans oublier surtout de bien les refermer.
|

Récolte des propagules.
|
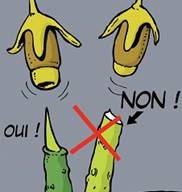
Propagules avec ou sans bourgeons.
Il faut qu’elle ait son bourgeon.
|

Rangement des propagules à l’horizontale dans le sac.
|
|
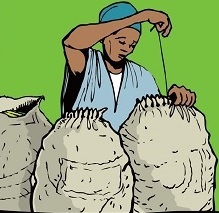
Bien fermer les sacs.
|
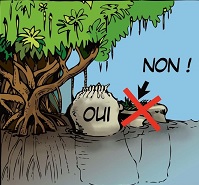
Stockage des sacs dans l'eau de mer.
|
|
C’est l’heure du reboisement !
Prenez le chemin de la zone pour rejoindre l’équipe sur place.
Equipez-vous de seaux, de calebasses ou de bassines ; ils
vous serviront à transporter les propagules. Une fois les sacs vidés, l’équipe
des trieurs sélectionne les meilleures plantules, puis les décapsule,
afin de mettre à jour le petit bourgeon qui deviendra grand.
|

Apporter des récipients avec soi.
|

L’équipe des trieur.
|
|
 
Le trieur décapsule la propagule.
|
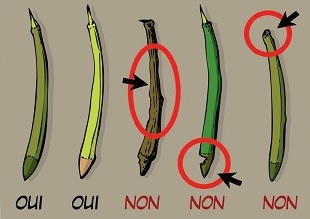
Bons ou mauvais propagules.
|
Les jeunes arbres auront besoin de place pour bien pousser. Il faut
donc éviter de planter les propagules trop serrées. Il est recommandé de
planter 5 000 plants à l’hectare (ce qui revient à planter 1 palétuviers tous
les 1 mètre sur 2 mètres).
Chaque zone peut créer sa propre stratégie pour marquer les sols et
planter. Mais voici quelques conseils pour le faire.
La premier (à gauche) consiste à marquer le sol avant de
planter. Munissez-vous d’une corde et nouez des morceaux de tissu tous les 2
mètres. Tendez la corde et avancer vers la zone à reboiser. Des traceurs
suivent chacun leur repère de tissu et marquent le sol à l’aide d’un bâton.
Cette première méthode est la plus précise. Elle vous permettra d’évaluer
précisément le nombre d’arbres plantés.
La deuxième (ci-contre) consiste à placer une équipe au bout du
terrain qui guide les planteurs à avancer bien droit pour planter. Les guides
sont séparés de 2 mètres. Important ! Travaillez en petits groupes de 10
personnes avec un chef d’équipe. Cela vous permettra d’être beaucoup plus
efficace que si vous êtes trop nombreux.
|
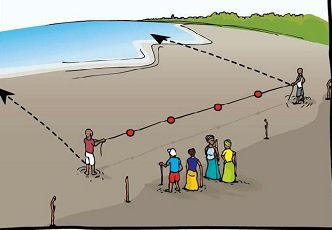
Méthode 1 : tendre la corde
|

Méthode 1 : avancer en ligne en traçant des sillons.
|
|

Méthode 2
|

Le traceur.
|
Il faut faire vite car la marée va bientôt remonter et les propagules
doivent être mises en terre. Les planteurs avancent dans le poto-poto en
suivant le tracé. Ils doivent planter une propagule à chaque deux pas.
Attention ! Prenez bien soin de planter la plantule bien droite et de
l’enfoncer d’1/3 dans la vase.
! Dans le cas où il vous est impossible de procéder à la méthode
du marquage de la zone (page précédente), suivez la méthode suivante.
Alignez-vous en écartant les bras de manière à vous toucher le bout des doigts,
puis avancez bien en ligne. Chaque 2 pas, plantez une propagule ! Plus les
jeunes plants auront de la place pour grandir, plus les arbres prendront de
l’ampleur.
|

|

|

|
|

|

Exemple de la plantation d'une mangrove au Guyana.
|

Exemple de la plantation d'une mangrove au Sénégal.
|
Quand la zone est reboisée, il est important de revenir régulièrement
constater la croissance des jeunes palétuviers.
Tous les 2, 3 mois, en équipe, faites le tour des plants et profitez-en
pour nettoyer délicatement les jeunes pousses.

© Images / dessins Oceanium Dakar.
Une coopérative de productrices constituée autour de la réserve de
mangroves a été créée afin de promouvoir des moyens alternatifs de subsistance
dans les communautés côtières, au Guyana (Amérique du Sud). La protection et la
réhabilitation des mangroves génèrent des avantages considérables pour ces
communautés locales grâce à la participation à la production de plants de
palétuviers ainsi qu'à la vente de produits forestiers non ligneux, de miel
provenant de l'apiculture et d'autres produits de la mangrove. Le site internet
du Projet de restauration des mangroves du Guyana a été créé, ainsi qu’un site
Facebook. Plusieurs publications produites dans le contexte du projet sont
disponibles sur ce site, notamment un manuel de culture du palétuvier en
pépinière, un code de pratiques pour l'exploitation des mangroves et du
matériel éducatif.
Les planteurs plantent jusqu'à 75 plants/jour. Ils touchent
US 50 cents par plant.
Des pépiniéristes cultivant les palétuviers sont aidés, dans la
création de leur entreprise, par la communauté européenne. L’ONG
Oceanium de Dakar aide aussi les autoentrepreneurs valorisant la mangrove.
|

|

Pépinière avec toit en palmes de cocotiers.
|
|

|

|

|
|
|
|
|
Utilisation d’une « luge » de fortune, permettant
de transporter une dizaine de plants, avec laquelle le planteur glisse et se
déplace dans la boue (du littoral vaseux).
a) Récolte de la boue,
b) Mise de la boue dans un sac (pour plants),
c) Plantation de la bouture ou graine dans la boue du sac,
d) Conservation du plant dans la pépinière, durant environ quatre mois,
e) Arrosage des plants deux fois par jour, en leur donnant beaucoup
d'ombre (pas de soleil direct), grâce aux ombrières au-dessus des plants.
|

Mise des jeunes plants dans des sacs plastique pour
pépinières
|

Pépinières avec canaux d’irrigation d’eau de mer.
|
|

Plantation de palétuviers (Avicennia marina et Avicennia
officinalis) (Inde).
|

Créations des banquettes / lits / planches de la
pépinière. Source : idem.
|
|

Préparation des lits de la pépinière (Source : idem).
|

Préparation des lits de la pépinière (Source : idem).
|
|
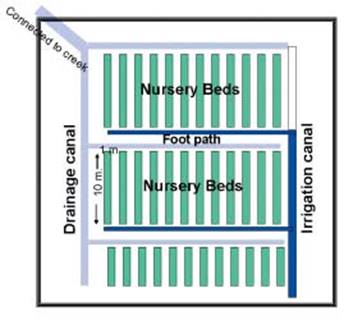
Plan de la pépinière. a) connexions à la crique (ou au
ruisseau), b) lits / planches de la pépinière, c) canal d’irrigation et d)
canal d’évacuation ou de drainage.
|
|
|

Pépinières de plants d'Avicennia germinans (au
Guyana)
|

Pépinières de plants d'Avicennia germinans (au
Guyana)
|

Sacs pour pépinières, remplis de la boue prélevée dans la
mangrove.
|
|
Espèces
de la mangrove
|
Matériel
de plantation
|
Usage
|
|
Avicennia marina
(Forsk.) Vierh.
|
Fruits
|
Plantation dans les zones dégradées
|
|
Avicennia
officinalis L.
|
Fruits
|
Plantation dans les zones dégradées
|
|
Excoecaria
agallocha L.
|
Jeunes plants
|
Plantation dans les zones dégradées
|
|
Aegiceras comiculatum (L.) Blanto
|
Propagules
|
Plantation dans les zones dégradées
|
|
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny
|
Propagules
|
Plantation pour la diversité génétique
|
|
Rhizophora
apiculata BI.
|
Propagules
|
Plantation pour la diversité génétique
|
|
Rhizophora mucronata Lamk.
|
Propagules
|
Plantation pour la diversité génétique
|
|
Sonneratia
apetala Buch.-Ham.
|
Graines
|
Plantation pour la diversité génétique
|
|
Xylocarpus moluccensis (Lamk.) M.Roem.
|
Graines
|
Plantation pour la diversité génétique
|
Détails sur les espèces de palétuviers et le matériel de
plantation.
|
Les
espèces végétales
|
Matériel
d'ensemencement (pour les semis)
|
Durée de germination
|
Pourcentage de germination
|
Hauteur
moyenne après 8 mois (cm.)
|
|
Avicennia officinalis
|
Fruit
|
6 jours
|
95
|
75
|
|
Avicennia marina
|
Fruit
|
6 jours
|
95
|
75
|
|
Excoecaria agallocha
|
Jeunes plantules
|
-
|
60
|
60
|
|
Aegiceras corniculatum
|
Fruit
|
35 jours
|
80
|
70
|
|
Sonneratia apetala
|
Semences
|
30 jours
|
20
|
80
|
|
Xylocarpus molluccensis
|
Semences
|
20 jours
|
90
|
80
|
|
Bruguiera gymnorrhiza
|
Propagule
|
35 jours
|
100
|
60
|
|
Rhizophora apiculata
|
Propagule
|
40 jours
|
100
|
70
|
|
Rhizophora mucronata
|
Propagule
|
40 jours
|
100
|
80
|
Détails d'espèces de palétuviers à suivre pour une
meilleure survie.
|
Espèces/
Sujet
|
Mois
|
|
|
|
Jan
|
Fév
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Aou
|
Sep
|
Cct
|
Nov
|
Dec
|
|
|
Avicennia
oificinalis
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
        
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avicennia
marina
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Excoecaria
agallocha
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Aegiceras
corniculatum
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
Sonneratia
apetala
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Xylocarpus
moluccensis
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
Bruguiera
gymnorrhiza
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rhizophora
apiculata
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Rhizophora
mucronata
Récolte
et semis
Période
levée
Plantation
dans la zone dégradée
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Collecte
de la boue (Gathering soil)
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
Actions pour la préparation de la
pépinière (les périodes indiquées sont adaptée à l’Inde).
|
Nom du VLI et du Village
|
Espèces cultivée
|
Nombre de plants (+)
|
Revenus pour la communauté
|
|
Sri Vigneswara EDC, Matlapalem
|
Excoecaria agallocha
|
12,000
|
Rs. 12,000
|
|
Dr. B.R. Ambedkar VSS,
|
Avicennia officinalis
|
1,000
|
Rs. 3,000
|
|
Bhairavalanka
|
Avicennia marina
|
2,000
|
|
|
Dheenadayaljee EDC,
|
Avicennia officinalis
|
60,000
|
Rs. 2,00,000
|
|
Dheenadayalapuram
|
Avicennia marina
|
1,40,000
|
|
|
Total
|
2,15,000
|
Rs. 2,15,000
|
Détails sur les jeunes palétuviers cultivés par les VLIs (°).
(+) Sapling = jeune plant.
(°) VLI = Village level institution = Institution au niveau du
village.
|
Tâches / Travaux
|
Personnes
|
Nb d’heures de travail
|
Salaires [En. : Wages]
|
Montant
|
|
Homme
|
Femme
|
Homme
|
Femme
|
|
Défrichement de la zone et débroussaillage
|
7
|
|
6
|
60
|
|
420
|
|
Préparation de la planche (culturale)
|
70
|
|
6
|
60
|
|
4200
|
|
Clôture / protection
|
40
|
|
6
|
60
|
|
2400
|
|
Remplissage des sacs
|
28
|
98
|
6
|
60
|
40
|
5600
|
|
Collecte de semences
|
|
42
|
6
|
|
40
|
1680
|
|
Transfert des sacs vers les planches
(culturale)
|
|
16
|
6
|
|
40
|
640
|
|
Planter les graines dans des sacs
|
|
108
|
6
|
|
40
|
4320
|
|
Maintenance / Soins
|
|
96
|
6
|
|
40
|
3840
|
|
Total
|
145
|
360
|
|
|
|
23100
|
Quantité de travail, dans la pépinière, pour
cultiver 30.000 jeunes plants de palétuviers.















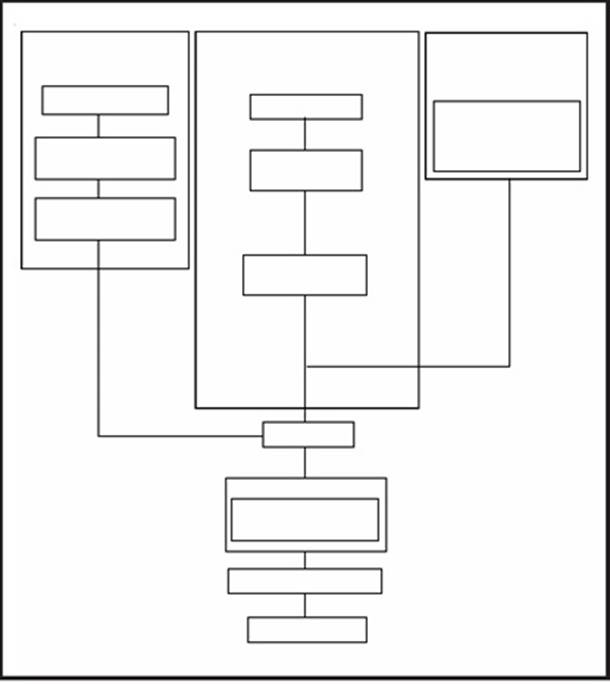
Procédure pour la préparation de la pépinière
|
Espèces
|
Caractéristiques
des semences
|
Semis
|
Soins
|
|
|
Collecte de semences
(mois) (°)
|
Indicateurs de maturité
|
Collecte de semences
(critères)
|
Stockage des semences (Nbre de jours
max.)
|
|
Arrosage
|
Parasites
|
|
Avicennia officines
|
Oct — Nov
|
Peau du fruit jaunâtre
|
Poids des graines > 5g
|
7
|
Au-dessus du sol
|
Entièrement une fois par jour
|
Crabes
chenilles
|
|
Avbennia marina
|
Oct—Nov
|
Peau du fruit jaunâtre
|
Poids des graines >
1.5g.
|
10
|
Au-dessus du sol
|
Entièrement une fois par jour
|
Crabes
chenilles
|
|
Excoecaria agaliocha
|
Sep — Oct
|
Fruits brun foncé
|
< 100 mg.
|
10
|
Au-dessus du sol
|
Entièrement une fois par jour
|
Crabes
chenilles
|
|
Aegiceras comiculatum
|
Aou — Oct
|
Epicarpe jaune
|
5 à 6 cm
de long
|
15
|
Pousse de la partie du calice de 1cm de
profondeur / d'épaisseur
|
Entièrement une fois par jour
|
Crabes
chenilles
|
|
Sonneratia apetab
|
Juil — Sep
|
Dans l'eau
|
Fruit
>15mm.
Diamètre
|
5
|
Pousse des radicelles des semences dans
le sol
|
Deux fois par jour
|
Rats. Crabes. Chenilles
|
|
Xybcarpus moluccensis
|
Sep — Nov
|
Jaune à brun fruits
Flotte sur l'eau
|
Poids des graines >
30g.
|
10
|
Au-dessus du sol
|
Entièrement une fois par jour
|
Crabes
|
|
Bniguiera gymnorrhiza
|
Juil— Sep
|
Hypocotyles bruns rougeâtres ou rouges
verdâtres
|
>10 cm.
De long
|
10
|
Pousse de
d’hypocotyte
5 — 8 cm
|
À marée de
morte-eau
|
-
|
Détails des semis et de l'entretien des
espèces de palétuviers dans la pépinière. (°) En Inde.
Une halophyte est une plante qui pousse dans les
eaux de haute salinité,
entrer en contact avec de l'eau salée à travers ses racines ou par brouillard
salin, comme dans les semi-déserts salés, les mangroves, les marais et les
marécages, et rivages. Relativement peu d'espèces de plantes halophytes sont -
peut-être seulement 2% de toutes les espèces végétales.
La grande majorité des espèces végétales sont glycophytes,
des plantes qui ne sont pas tolérantes au sel, et sont assez facilement
endommagé par une forte salinité. Le haricot et le riz peuvent tolérer environ
1-3 g/l, et sont considérés comme glycophytes (comme la plupart des plantes
cultivées). Des plantes telles que l'orge (Hordeum vulgare) et le
palmier dattier (Phoenix
dactylifera)
peut tolérer environ 5 g/l, et peut être considéré comme halophytes marginales.
L’adaptation aux milieux salins par halophytes peut prendre la forme de
la tolérance au sel (voir halotolerance) ou
d'évitement de sel. Les plantes qui évitent les effets de la forte teneur
en sel, même s'ils vivent dans un milieu salin, peuvent être considérées comme halophytes
facultatives plutôt que comme halophytes «vrais» ou obligatoires.
Par exemple, une plante, de courte durée, qui complète son cycle de vie
pendant les périodes de reproduction (comme durant la saison des pluies)
lorsque la concentration de sel est faible, le fera en évitant le sel plutôt
que de le tolérer. Ou bien une espèce de plante peuvent maintenir une
concentration «normale» interne de sel, en excrétant le sel en excès par ses
feuilles, au moyen [par le biais] d'un hydathode, ou en concentrant
les sels dans les feuilles qui meurent et tombent plus tard.
Certains halophytes sont à l'étude pour une utilisation en tant que
précurseurs de biocarburants "3ème génération". Des
halophytes tels que Salicornia bigelovii peuvent
être cultivées dans des environnements difficiles et, généralement, ne sont
pas en concurrence avec les cultures vivrières pour les ressources, ce qui les
rend sources prometteuses de biodiesel ou de bio-alcool.
Le panic érigé (Panicum virgatum) est
une espèce de céréale sauvage
(famille des Poaceae) autrefois très
répandue aux États-Unis,
présente sur tout le territoire (sauf sur la frange littorale du Pacifique). Le Gouvernement
des États-Unis la considère1 depuis
2006 comme une source potentielle d'agrocarburant, plus respectueuse de
l'environnement que d’autres, et qui pourraient réduire la dépendance des
États-Unis à l'égard du pétrole.
Sources : a)
Halophyte, http://en.wikipedia.org/wiki/Halophyte,
b) http://www.universalis.fr/encyclopedie/halophytes/
(article payant, réservé aux abonnés).
Le genre Salicornia, les salicornes,
regroupe une trentaine d'espèces de plantes halophytes appartenant à la famille des Amaranthaceae, selon la classification
phylogénétique APG III (2009). Dans la classification
classique, elle faisait
partie de celle des Chenopodiaceae. Il est proche du genre Salsola (soude).
Ces plantes annuelles,
basses, charnues, croissant sur des sols salés, sont constituées de rameaux
cylindriques semblant articulés et terminés par un épi fertile. Les feuilles
sont réduites à des gaines opposées deux à deux.
« La salicorne peut être élevée au rang de symbole du
développement durable. Non parce que demain le monde entier en consommera et
que les zones salines reverdiront, apportant ainsi une source de revenus
aux populations locales. Mais bien parce que Salicornia représente une
révolution radicale dans les modes d’irrigation » (Kauffmann, 2004).
La culture de la salicorne et son insertion dans un système
productif intégré est une solution pour les pays pauvres, pour l’utilisation et
la récupération des des terres margino-littorales (tannes, marais et vasières).
La salicorne est une plante de la famille des Chénopodiacées halophyte
qui pousse spontanément sur les vases salées du littoral ou de cuvettes
margino-littorales salées telles que sont les tannes, les dépressions inter
dunaires maritimes, les cuvettes deltaïques intérieures et les zones inondables
en saison des pluies et salée (la mer étant au même niveau).
La culture de la salicorne peut être intégrée dans le cadre d’un projet
de réaménagement de mangrove. Sa culture est facile : La salicorne doit être
arrosée régulièrement. Son nom anglais est samphire.
La salicorne se consomme en accompagnement un peu comme des haricots
verts. On peut en faire des conserves. Source : a) http://www.environnement.gouv.sn/projest%26programmes/projet-ecofermes
b) http://www.unevieenafrique.com/fbbien-manger-a-dakar
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Salicorne
Il y a deux espèces de salicorne (tropicales], qui sont cultivées
commercialement dans différentes parties du monde. L'une d'elle est Salicornia
bigelovii. Cette plante pousse dans les ceintures littorales tropicales,
humides, ouvertes.
Ses graines contiennent jusqu’à 30 pour cent d'huile et 35 pour cent de
protéines.
L'autre, Salicornia brachiata, est une plante herbacée
annuelle dressée, distribuée principalement dans les marais salants de Tamil
Nadu, Bengale et au Sri Lanka.
Elle a un rendement de semences de 100 kg par hectare, et la teneur en
huile est de 20 pour cent. Les huiles de ces deux espèces peuvent aussi servir
de biocarburant. Leur capacité à pousser sur des terres arides et à être
alimentées en eau de mer leur évitant théoriquement d'être en concurrence avec
la production alimentaire. L'université Khalifa d'Abou Dabi et Safran a mené
une petite production expérimentale de carburant aéronautique et a alimenté un
Boeing 787 pour un vol long-courrier expérimental en janvier 2019
Des champs expérimentaux de salicornes ont été plantés
à Ras al-Zawr (Arabie Saoudite, Erythrée (Afrique)
et Sonora (nord-ouest
du Mexique), visant à la production de biodiesel. La société responsable
des essais Sonora (Global
Seawater)
revendique entre 225 et 250 gallons de biodiesel BQ-9000, pouvant être produit
par hectare (sur
environ 2,5 hectares) de salicorne, et fait la promotion d’une ferme à
salicornes, à créer sur 12,000- acres (49 km2), dans Bahia
de Kino, un programme de 35 millions de dollars.
Salicornia
bigelovii peut
être cultivées à l'aide d'eau salée et de ses graines contiennent des taux
élevés d'huile
insaturé (principalement, à 30%, de
l'acide linoléique) et de protéines (35%). Elle peut être utilisée pour
produire des aliments pour animaux et/ou en tant que biocarburant, sur les
terres côtières où les cultures traditionnelles ne peuvent pas être cultivées.
L’ajout d’engrais
azoté à l'eau de mer semble augmenter le taux de croissance et la hauteur
de la plante et donc, les effluents de l’aquaculture
marine (par exemple, l’élevage
des crevettes) est une utilisation suggérée, à cet effet.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Salicornia, b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Salicorne
c) Glenn, Edward P.; Brown, J. Jed; O'Leary, James W.
(August 1998). "Irrigating Crops with Seawater" (PDF). Scientific
American (USA: Scientific American, Inc.)
(August 1998): 76–81. Retrieved 2008-11-17.
d) Clark, Arthur (November–December 1994). "Samphire:
From Sea
to Shining Seed". Saudi Aramco World. Saudi Aramco. Retrieved 2008-11-17.
e) Alsaeedi, Abdullah H. (2003 (1424H)). "Di Pattern of Salicornia Vegetative Growth in Relation to Fertilization" (PDF). Journal
of King Faisal University (Al-Hassa: King
Faisal University) 4 (1): 105–118. Retrieved 2008-11-17. "adequate
fertilization increases significantly the relative growth rate especially
during the ‘rapid’ phase of the vegetative stage".
f) "USIJI
Uniform Reporting
Document" (PDF). United States Initiative
on Joint Implementation (USIJI). c. 1997. Retrieved 2008-11-17. "Project Salicornia:
Halophyte Cultivation in Sonora".
g) Ryan C. Christiansen (2008-07-31). "Sea asparagus can be oilseed feedstock for biodiesel". Biomass
Magazine. Retrieved 2008-11-17.
h) Dickerson, Marla (2008-07-10). "Letting the sea cultivate the land". Los
Angeles Times. Tribune Company. Retrieved 17 November 2008.
i) Salicornia, oil-yielding plant for
coastal belts, The Hindu, Friday,
Sep 05, 2003, http://www.thehindu.com/seta/2003/09/05/stories/2003090500300300.htm
b) Taste of waste. How to make plants yield salt
[Le goût des déchets. Comment faire en sorte que les plantes produisent
du sel], http://www.downtoearth.org.in/node/13119
|

Salicorne en Afrique. Source : https://twitter.com/SaltFarmTexel
|

Des cultures très tolérantes au sel produisent de l'huile comestible
de haute qualité et d'autres produits comestibles et non comestibles de
valeur. Un gros plan sur un buisson succulent.
|
Originaire des régions côtières de l'est et du sud des États-Unis, ainsi que le
sud de la Californie,
du Belize et du littoral du Mexique (à
la fois les côtes est et ouest), c'est une plante à fleurs des marais salants et mangroves
(famille des Amaranthaceae).
La plante contient jusqu’à 33% d’huile de salicorne. Elle
peut être utilisée comme huile
de cuisson et en remplacement d’huiles de plus grande valeur
dans l'alimentation
des poulets. La plante peut servir de fourrage aux animaux et pourrait être
une source de biocarburant.
Elle peut aussi être arrosée / irriguée avec de l'eau de drainage
hautement salée.
Des champs de cette salicorne ont été cultivées dans les eaux de rejet de
fermes aquacoles en Erythrée et sont récoltées
pour l'alimentation animale.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Salicornia_bigelovii,
b) Bashan, Y., et al. (2000). Growth
promotion of seawater irrigated oilseed
halophyte Salicornia bigelovii inoculated with
mangrove rhizosphere bacteria
and halotolerant Azospirillum spp. Biol Fertil Soils 32:265-72.,
c) Grattan, S. R., et al. (2008). Feasibility of irrigating pickleweed (Salicornia bigelovii Torr)
with hyper-saline drainage water. J.
Environ. Qual. 37 S-149.
|

|

|
|

Production pilote de biodiesel, avec Salicornia
bigelovii, au Mexique (Global Seawater Inc).
|

|
Plante vivace
aux nombreuses racines charnues rayonnant en étoile, au feuillage fin et
ramifié, originaire de régions tempérées de l'Eurasie, Europe centrale,
méridionale, Afrique du Nord, Asie centrale et occidentale (famille des Asparagaceae).
Son nom désigne aussi ses pousses comestibles, qui proviennent de rhizomes d'où
partent chaque année les bourgeons souterrains ou turions qui donnent
naissance à des tiges s'élevant entre 1 et 1,5 mètre.
Habitats : Lieux sablonneux, incultes. Elle pousse dans les
terrains sablonneux à l'état sauvage. Souvent subspontanée.
À l'état sauvage, douze espèces en Europe : Asparagus
officinalis, Asparagus acutifolius très
commune dans le midi, Asparagus
maritimus, Asparagus albus et Asparagus
tenuifolius.
Toutes sont comestibles mais l'asperge maritime (Asparagus maritimus)
est très amère.
Sa durée est de l'ordre de 8 à 10 ans, du point de vue économique, sa
culture est rentable.
L'asperge est souvent originaire des habitats maritimes, il
prospère dans des sols souvent trop salés pour les autres plantes.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Asperge,
b) http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagus_officinalis,
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagus

Plantation d'asperges bio à Fundo Fangelica près de Chincha
(Pérou).
Plantes herbacée bisannuelle ou,
plus rarement, vivace,
aux tiges feuillues pouvant atteindre 1 à 2 mètres de haut, à racine pivotante épaisse,
originaire de l'ancien monde, dont de nombreuses variétés sont cultivées (famille des Amaranthaceae). On reconnait
généralement trois sous-espèces :
·
Beta vulgaris subsp. vulgaris qui
regroupe toutes les variétés cultivées (betteraves et blettes),
·
Beta vulgaris subsp. maritima, la bette maritime ou betterave maritime,
considérée comme l'ancêtre sauvage des variétés cultivées, qui se rencontre sur
les côtes atlantiques et méditerranéennes de l'Europe, ainsi qu'au Proche-Orient et
en Inde (spontanée sur
les rivages maritimes en Europe) (en danger d’extinction).
Beta vulgaris subsp. adanensis, autre
sous-espèce sauvage, présente de la Grèce à la Syrie.
La betterave maritime (Beta vulgaris ssp. maritima)
et la betterave à sucre (Beta vulgaris ssp. vulgaris)
ont un taux de survie de 100%, avec une croissance optimale, en condition
de faible salinité (< 25% d'eau de mer).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris,
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Betterave,
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
|

|

Beta vulgaris subsp. maritima
|

Betterave rouge précuite.
|
|

Betterave maritime (Beta vulgaris subsp. maritima), l'ancêtre
sauvage des formes cultivées.
|

Betteraves de différentes couleurs

Betteraves rouges
|
|

Plant de la betterave (Beta vulgaris)
|

Betteraves à sucre
|

Diverses variétés cultivées de Beta vulgaris.
|
C’est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des Araceae, sous-famille des Aroideae, originaire du sous-continent
indien et d'Asie du Sud-Est. La plante est cultivée dans toutes les
régions tropicales pour sa racine épaissie (un corme souvent appelé tubercule) à la chair de couleur blanche à rose, de texture sèche et au
goût proche de celui de la patate douce. Les feuilles se préparent comme
des épinards.
Cette plante est
généralement connue sous le nom vernaculaire de « taro », terme
générique qui au sens strict désigne Colocasia esculenta, mais est
parfois utilisé pour désigner diverses espèces d’Araceae à
tubercules alimentaires, notamment dans les genres Colocasia, Alocasia et Xanthosoma.
Le terme désigne aussi le corme (ou tubercule) lui-même.
Le Colocasia, ou taro
vrai, est une plante herbacée vivace par son rhizome tubéreux qui est de grosseur variable et forme un
corme, tubercule d'aspect écailleux, à peau épaisse, résultant de
l'épaississement souterrain de ce rhizome.
Feuilles : Les feuilles grandes et belles,
vertes plus ou moins foncées, parfois violacées, sont peltées, à limbe
cordiforme à la base, parfois un peu sagittées. Le limbe peut atteindre 70 cm
de longueur sur 60 cm de largeur et présente un bon effet déperlant - effet lotus.
Fleurs : Les inflorescences se présentent sous forme d'un spadice cylindrique, terminé par un appendice acuminé et rose. Les
fleurs femelles jaunes occupent la base du spadice et donneront les fruits, de
petites baies uniloculaires. Les fleurs mâles garnissent la partie supérieure.
Une spathe longue et étroite, se recourbant légèrement au sommet, est enroulée en
cornet autour du spadice. L'ensemble est une structure caractéristique
des Aracées, bien connue chez les Arums ornementaux.
Ere de répartition : La plante se trouve dans toute l'Océanie, en Amérique tropicale, et en Afrique.
Culture : Le taro ne tolère pas les changements brusques de
température. La température optimale pour son développement serait de 21°C
(ONWUEME, 1999). Son exigence pluviométrique est de l'ordre de 2000 mm d'eau
par an bien repartie dans le temps. Il supporte une nappe phréatique élevée et
peut être cultivé dans des tarodières irriguées comparables aux rizières
(CABURET et al., 2007). Cependant, le taro peut se développer sur des sols peu
arrosés. En fonction des besoins en eau, IVANCIC et LEBOT (2000) ont classé les
cultivars du taro en trois groupes :
- les cultivars adaptés aux sols bien arrosés, irrigués, voire aux
marécages;
- les cultivars intermédiaires adaptés aux sols moyennement arrosés;
- et les cultivars adaptés aux sols relativement peu arrosés.
Reproduction : La
multiplication se fait par bouture ou division du tubercule, en conservant un
œil par fragment. La plantation se fait au début de la saison des pluies. On
l'associe avec d'autres plantes telles que l'igname et l'aubergine. Son cycle végétatif s'étend de 8 à 18 mois. La plante exige
un sol humide. La récolte des tubercules s'effectue dès que les feuilles les
plus âgées dépérissent 6 à 7 mois après plantation. La production est très
souvent vivrière, assez rarement commercialisée. À Madagascar, les champs de taro (ou tarodières) sont reconnaissables de loin aux trous
circulaires pratiqués autour de chaque pied de taro pour favoriser le
développement du tubercule.
Alimentation : Le Taro est essentiellement
cultivé pour son tubercule, qui une fois déterré se conserve assez mal. D'une
manière générale, il est cuisiné comme les pommes de terre. Les bulbes de la petite variété ronde
sont pelés et bouillis, puis vendus congelés, ensachés dans leur propre liquide ou en conserve.
Toxicité : La plante est toxique, crue, en
raison de la présence de cristaux d’oxalates et d’un alcaloïde, la conine (comme dans tout le reste de la plante), mais qu’elles
peut être rendue comestibles par une simple cuisson.
Résistance au sel : Certains cultivars (exemple :
Coloeasia esculenta var antiquorum …) sont adaptés aux sols à
haute salinité (ONWUEME). Sa capacité à
pousser immergé et à supporter la salinité lui permettent d’être cultivé dans
des endroits où peu d’autres espèces le pourraient.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Colocasia_esculenta, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Taro
c) https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Colocasia+esculenta+(L.)+Schott
d) https://uses.plantnet-project.org/fr/Colocasia_esculenta_(PROTA)
e) ONWUEME 1.
(1978). The tropical tuber crops, yams cassava, sweet potato and cocoyams.
Chichester, John Wiley. United Kingdom, 92p.
f) ONWUEME 1.
(1999). Taro cultivation in Asia and the Pacific. United Kingdom. 48p
g) Caractérisation
agromorphologique d'une collection de taro (Colocasia esculenta (L.) Schott)
originaire des domaines soudanien et soudano-guinéen du Burkina Faso,
BAMBARA Husunohi, Mohamed Judicaël, http://www.beep.ird.fr/collect/upb/index/assoc/IDR-2009-BAM-CAR/IDR-2009-BAM-CAR.pdf
h) Effects of
Salinity and Plant Growth Media on in Vitro Growth and Development of Taro
(Colocasia Esculenta L.) Varieties, Varea
Vaurasi & Rashmi Kant, Acta Horticulturae et Regiotecturae, Volume 19
(2016) : Numéro 1 (Mai 2016), Page range: 17 - 20, https://www.sciendo.com/article/10.1515/ahr-2016-0005
|

Feuilles
|

Feuilles
|

Fleurs
|
|

Cormes
|

Taro sur
le marché de Port-Vila au Vanuatu.
|

La partie comestible du taro
|
|

Cormes (section transversale).
|

Culture du taro à Keanae, Maui, Hawaii.
|

Stolons de taro sur un marché à
Dhaka (Bangladesh).
|
|

Saru bhaja ou chatpata saru (recette indienne).

Cormes de taro pelés
|
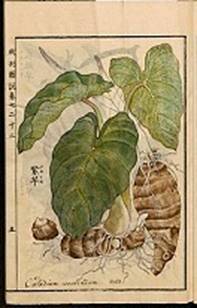
C. esculenta dans l'encyclopédie agricole
japonaise Seikei Zusetsu
|

Cormes de Colocasia esculenta.

Culture du taro à Madagascar.
|
C’est une céréale à paille, plante herbacée annuelle
(famille des poacées).
L'orge pousse aussi bien sous les tropiques qu’à 4500 m d’altitude
au Tibet.
L’orge, céréale secondaire,
est une importante ressource énergétique en alimentation animale (orge de
mouture) mais pauvre en protéines et demande
à être complétée. En alimentation humaine, son principal débouché est la brasserie. L’orge, après
avoir subi l'opération de maltage donne
le malt, dont le produit
de fermentation est la bière.
Le sirop
d'orge malté, un concentré édulcorant, est produit à partir des grains
d'orge malté.
Orge perlé -
orge mondé : sous forme de grains, on retrouve notamment l’orge mondé,
dont la première enveloppe extérieure a été retirée, mais qui conserve le son
et le germe. Quel que soit le plat auquel on le destine, l’orge se cuit dans
une proportion de trois tasses d'eau pour une tasse d'orge. L'orge perlé
peut être utilisé en salades composées, avec des légumes, ou ajouté dans les
potages. Les Tibétains ont
fait de la farine d'orge grillée, appelée tsampa, leur aliment
traditionnel de base. On en fait des biscuits, pains, farines, divers aliments
diététiques. En Afrique
du Nord, on fabrique de la semoule d'orge.
Maladies : La jaunisse nanisante de l'orge (JNO)
est une maladie due à un virus transmis
par les pucerons d'automne
(Rhopalosiphum padi). Les
graines, d’un champ virosé, ne transmettent pas le virus.
Variétés : Hordeum vulgare subsp. hexastichum L.,
l'escourgeon (employée en alimentation animale, pour la bière, adaptée aux sols
acides), sous-espèce de l'orge
commune. Hordeum vulgare trifurcatum, ou orge
du Tibet (résistante aux gels, comme les escourgeons).
L’orge sauvage (Hordeum vulgare subsp. Spontaneum) est
abondante dans les prairies et les forêts à travers le Croissant
fertile région de l'Asie occidentale et l'Afrique du nord, et est
abondant dans les habitats
perturbés, des routes et des vergers. Elle résiste bien au sel et à des
pH élevé (jusqu’à pH 8,5). Certaines variétés d’orge comme celle
de Gabès se sont montrées tolérantes au sel (BUREAU et al., 1959).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Orge_commune,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Barley,
c) L'utilisation des eaux salées au Sahara, P. Simonneau, G. Aubert,
Ann. agron., 1963, 14 (5), 859-872, page 866, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_08-09/11033.pdf
|

Hordeum vulgare subsp. Hexastichum
Epis d'escourgeon bien formés juste avant la maturation.
|

|

|
|

|

|
|
Ou herbe de Palmer, plantes halophyte, qui pousse dans le désert
de Sonora, à l'Ouest du
Mexique, et qui produit un grain ayant
quelques similitudes avec le
blé.
Une recherche menée sur les plantes restantes (il était rare) a été
couronnée de succès, et a été suivie par un programme de culture faisant passer
l'augmentation de son rendement de 5 kg/ha à 2000 kg/ha. Le grain est
également cultivé pour un usage commercial en Australie. Il
est résistant à la sécheresse et peut absorber l'eau de mer. Comme
un halophyte,
le sel qu'il absorbe est excrété par des cellules spécialisées sur la surface
de la feuille. Le rapport des Nations Unies pour l'environnement (2006) dit de
la plante: "Il est un bon candidat pour une principale culture vivrière
mondiale et pourrait devenir le plus grand cadeau de ce désert au monde". Certaines
variétés de D. palmeri ont fait l'objet de brevets
aux États-Unis.
Note : certains variétés d’halophytes proches, comme Distichlis
spicata, seraient aussi à étudier.
Sources : c) http://en.wikipedia.org/wiki/Distichlis_palmeri,
b) Nipa: un tesoro Sonorense para el mundo, Richard Stephen Felger, Drylands
Institute, Tucson, Arizona [Institut des zones arides, Tucson, Arizona], http://boletin.apnsac.org/?p=36, c)
Pearlstein, Felger et al… “Nipa (Distichlis palmeri): A
perennial grain crop for saltwater irrigation” Journal of Arid
Environmental 82 (2012) 60-70,
Toutes les recherches actuelles sont basées sur la propriété de la
tolérance au sel supérieure de Oryza coarctata, une espèce de riz
sauvage trouvé au Bangladesh, mais aussi une espèce qui est très difficile à
croiser avec des espèces cultivées Oryza sativa.
Le nouveau riz, mis au point par l’International Research Rice
Institute (IRRI) (Philippines) et par le Dr Kshirod Jena, sera comme le riz
normal, mais avec la tolérance au sel des espèces de riz sauvage, qui est
presque le double de celle des autres riz. En outre, la nouvelle variété de riz
ne contient pas des niveaux élevés de sel. Ce nouveau riz peut expulser le sel
qu'il a pris au sol, par ses glandes à sel, qu‘il a sur ses feuilles
(Super-salt tolerant rice will help reclaim millions hectares rice area says
IRRI). Variétés tolérantes mises au point par INRA Montpellier : Pokkali et
IR4630.
ISRIZ10 est une variété de riz, adaptée aux sols salés, développée par
Dr Oumar Ndao FAYE, chercheur à l'Institut sénégalais de Recherche Agricole (ISRA),
au Sénégal.
Attention ! Pour l’instant, tout cela est au stade de la
recherche expérimentale.
Sources : a) Salt tolerance in the halophytic wild
rice, Porteresia coarctata Tateoka, T. J. FLOWERS , S. A. FLOWERS, M. A.
HAJIBAGHERI & A. R. YEO, A'OT Phytot. (1990), 114, 675-684, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.1990.tb00439.x/pdf
, b) Adaptation des plantes au stress salin : caractérisation de transporteurs
de sodium et de potassium de la famille HKT chez le riz, Mehdi Jabnoune, Déc
2008, thèse Université Montpellier II/INRA, http://www.supagro.fr/theses/extranet/08-0043_JABNOUNE.pdf
, c) Porteresia coarctata (Roxb.) Tateoka, a wild rice:
a potential model for studying salt-stress biology in rice, Sengupta S , Majumder AL, Plant Cell Environ. 2010
Apr;33(4):526-42, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3040.2009.02054.x/abstract (article payant). d) Mechanism of salt
tolerance in wild rice (Oryza coarctata Roxb), A.R. Bal , S.K. Dutt, Plant and
Soil, 1986, Volume 92, Issue 3, pp 399-404, http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02372487 (article payant). d) https://isra.sn/2021/09/07/isriz-10-un-chercheur-de-lisra-met-au-point-une-variete-de-riz-adaptee-a-tous-les-types-de-sols-sales-du-senegal/, e) 26 avr 2015, http://www.oryza.com/content/super-salt-tolerant-rice-will-help-reclaim-millions-hectares-rice-area-says-irri
|

Dr. Kshirod Jena (le 1er à droite) durant une
présentation à l’abri de démonstration (Photo IRRI).
|

Oryza coarctata.
|
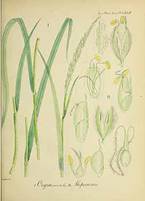
Oryza coarctata.
|
|
Normalement, pratiquement
toutes les variétés de riz ne supportent pas l’eau salée.
Plantes
de riz (Oryza sativa), cv. BRRI Dhan29, après 2 semaines de
traitement à différentes concentrations de NaCl à
Source : Salt Stress in
Rice: Adaptive Mechanisms for Cytosolic Sodium Homeostasis . Md. Abdul
Kader. Doctoral thesis. http://pub.epsilon.slu.se/1095/1/Thesis_Abdul_Kader.pdf
|
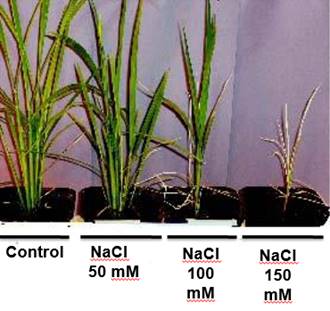
|
|
|
|
|
Une équipe de scientifiques australiens, de l’Université d'Adélaïde (de
Waite Research Institute), a renforcé la tolérance au sel dans une variété de
blé dur démontrant une amélioration du rendement des céréales de 25% sur des
sols salés.
En utilisant des techniques de reproduction des récoltes «non-OGM», les
scientifiques du CSIRO Plant Industry ont introduit un gène tolérant au sel
dans un blé dur commercial, avec des résultats spectaculaires présentés dans
les tests sur le terrain.
Les auteurs de cette étude ont réalisé que les parents sauvages de blé
moderne restent une source importante de gènes pour une gamme de
caractéristiques, y compris la tolérance à la salinité. Ils ont découvert
le nouveau gène tolérant le sel dans une cousine ancestrale de blé moderne, Triticum
monococcum. Le gène résistant au sel (connu sous le nom TmHKT1; 5-A)
fonctionne en excluant sodium à partir des feuilles. « Il produit une
protéine qui élimine le sodium dans les cellules qui tapissent le xylème, qui
sont les «tuyaux» de plantes utilisent pour déplacer l'eau de leurs racines
vers leurs feuilles », explique le Dr Gilliham.
Sources : a) Wheat grain yield on saline soils is
improved by an ancestral Na+ transporter gene,
Rana Munns, Richard A James, Bo Xu, Asmini Athman,
Simon J Conn, Charlotte Jordans, Caitlin S Byrt, Ray A Hare, Stephen D Tyerman,
Mark Tester, Darren Plett & Matthew Gilliham, Nature Biotechnology 30,
360–364 (2012), http://www.nature.com/nbt/journal/v30/n4/full/nbt.2120.html
b) World breakthrough on
salt-tolerant wheat, University of Adelaide, March
11, 2012, http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120311150717.htm
|

|
Le blé Ben Mabrouck, dont la sélection n’est pas terminée,
s’est montré très tolérant au sel (SIMONNEAU, 1962).
Source : L'utilisation
des eaux salées au Sahara, P. Simonneau, G. Aubert, Ann. agron., 1963, 14
(5), 859-872, page 866, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_08-09/11033.pdf
ß Blé dur tolérant au sel,
poussant dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud dans le cadre d'un essai
sur le terrain. Crédit: Photo par le CSIRO.
|
Nous n’en faisons que mention. Les pommes de terre poussant dans l’eau
salée sont pour l’instant expérimentées, depuis 2006, à la ferme Salty Potato
Farm, par Mark van Rijsselberghe, sur la petite île de Texel, régulièrement
inondée par la mer, au nord des Pays-Bas. Le principal problème rencontré est
que, pour l'instant, la culture en milieu salin demeure coûteuse : un kilo
de pommes de terre cultivées au sel est cinq fois plus cher qu’un kilo
classique. Autre problème, le rendement. 30 000 kilos sont produits sur un
hectare en milieu salin contre 60 000 sur des terres habituelles. Malgré
tout, les variétés « paramount » et « Miss Mignonne »,
à haut rendement, seraient prometteuses.
En 2017, la combinaison de variétés tolérantes au sel, de pratiques agricoles
adaptées et d'une utilisation conjointe de l'eau aurait permis d'obtenir un
rendement attendu acceptable de 20 tonnes de pommes de terre par hectare.
Sources :
a) La pomme de terre innove pour stopper la faim dans le monde !
15/03/2016, http://mccain.begooddogood.fr/la-pommes-de-terre-arme-secrete-pour-eradiquer-la-faim-dans-le-monde/
La salinisation
des sols menace l’équilibre alimentaire de la planète. La solution vient des
Pays-Bas : cultiver des pommes de terre dans de l’eau salée.
b) Growing salt-tolerant potatoes in Pakistan, https://www.potatopro.com/news/2017/growing-salt-tolerant-potatoes-pakistan, c) Texel Salty Farm web site , https://www.saltfarmtexel.com/
d) Dutch Farmer Invents Salt Resistant Potato Miss Mignonne,
03/12/2014, http://vanhijfte.com/dutch-team-is-pioneering-development-of-crops-fed-by-sea-water/
|

Mark van Rijsselberghe avec sa variété expérimentale de pomme
de terre, Miss Mignonne, tolérante au sel.
|

Pommes de terre de la Salty Potato Farm,
expérimentées au Pakistan.
|

Des spécialistes de la pomme de terre de la Salt Farm Texel
(Pays-Bas) testent des pommes de terre prometteuses, tolérantes au sel, au
Pakistan, depuis 2014.
La moutarde éthiopienne ou moutarde d'Abyssinie pourrait avoir une
grande importance agricole, dans les plantes du genre Brassica.
Bien que B. carinata soit cultivé
comme oléagineux en Ethiopie (Alemayehu
et Becker, 2004), il contient, en général, des glucosinolates et
de l’acide
érucique indésirables (Getinet et al., 1997), ce qui en fait un mauvais
choix cultural comme culture oléagineuse, en comparaison à la étroitement
liée Brassica
napus
(colza).
La plante est aussi cultivé comme légume-feuilles,
ayant une saveur douce. Certaines variétés, dont la Texsel, sont
particulièrement adapté aux climats tempérés. Les fleurs sont très attrayantes
pour les abeilles qui collectent du pollen et de nectar. Cette plante fait
également partie d'une recherche visant à développer du biocarburant pour les
moteurs à réaction. Le 29 Octobre 2012, le premier vol d'un avion à
réaction alimenté à 100 pour cent de biocarburant, fabriqué à partir de Brassica
carinata, a été réalisé. Il est sensible au sel mais les graines peuvent
germer dans les sols avec un niveau de salinité supérieure à la moyenne. Il
peut être trouvé dans les régions montagneuses jusqu'à 2600 m avec un climat
frais, mais aussi dans les plaines avec des conditions relativement chaudes et
sèches. Il ne tolère pas l’engorgement (l’asphyxie racinaire).
La lignée de B. carinata à graines brunes est plus tolérante au
sel que la lignée à graines jaunes. L’étude récente ci-dessous
montre l’utilité de cette plante pour la culture en sol salin et le bio-raffinage.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_carinata,
b) http://database.prota.org/PROTAhtml/Brassica%20carinata_En.htm,
c) http://database.prota.org/PROTAhtml/Brassica%20carinata_Fr.htm, d) Differential metabolite profiles and
salinity tolerance between two genetically related brown-seeded and
yellow-seeded Brassica carinata lines, Canam, T., Li, X., Holowachuk, J., Yu, M., Xia, J., Mandal, R.,
Krishnamurthy, R., Bouatra, S., Sinelnikov, I., Yu, B., Grenkow, L.F., Wishart,
D.S., Steppuhn, H., Falk, K.C., Dumonceaux, T.J., et Gruber, M.Y., lant
Science, 198(January 2013), p. 17-26.
C’est une plante de la famille des Aizoacées,
originaire du sud-est africain (zone de climat méditerranéen). Elle est
cultivée pour l'ornement, ses feuilles semblant couvertes de cristaux de glace,
et parfois pour la consommation. C'est une espèce succulente au
port rampant, dont la hauteur ne dépasse généralement pas 7 ou 8 cm, mais dont
les tiges peuvent atteindre de 20 à 60 cm de long. Ces tiges, ramifiées et
tombantes, sont couvertes de minuscules "perles" scintillantes,
vitrifiées, contenant de grandes quantités d'eau. Les feuilles, de 2 à 10 cm de
long, ont une surface fortement ondulée et sont en forme d'ovale ou de spatule.
Les feuilles sont comestibles cuisinées à la manière des épinards ou crues
en salade [et les tiges cuites]. Elles ont un goût iodé qui n'est
pas sans rappeler la salicorne, voire certains fruits de mer. Elle peut être
annuelle, bisannuelle ou vivace, mais son cycle de vie est généralement terminé
en quelques mois, selon les conditions environnementales. M. crystallinum
se trouve sur une large gamme de types de sols, de sols sableux et bien drainés
(y compris les dunes de sable), à limoneux et argileux. Elle pousse à l'état
sauvage en terrain aride et caillouteux ou sablonneux. Elle peut tolérer des
sols pauvres ou salins. Comme avec beaucoup d'espèces introduites,
il pousse aussi dans les sites perturbés, tels que les routes, les
décharges et les chantiers. Ses feuilles
sont comestibles, comme avec certains autres membres de la famille
des Aizoaceae. Ses
graines peuvent également être consommées. Les feuilles broyées
peuvent être utilisées comme substitut du savon et a des utilisations
médicinales. La plante est dédaignée par le bétail et les limaces. En
raison de ses capacités à accumuler le sel, M. crystallinum
peut être utile pour la bioremédiation. Pour sa culture, elle nécessite une
exposition ensoleillée, un sol riche en humus, bien drainé. Elle supporte
parfaitement la sécheresse et la chaleur. Elle déteste le froid et
l’humidité. Elle n’aucun ennemi connu. Elle a un petit goût frais entre
mentholé et acidulé. Elle peut être un peu invasive.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Mesembryanthemum_crystallinum,
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesembryanthemum_crystallinum
|

|

Une jeune plante à Lanzarote.
|

|
|

|

|

|
Pour mention : La Chourbe,
encore appelé le crambé maritime ou chou marin,
est l'un des deux représentants européens du genre Crambe, avec Crambe hispanica. Cette plante de la famille
des Brassicacées (ou Crucifères), pousse sur le littoral de la Baltique, de la Manche et de l’Atlantique (sable, galets, falaises). Cette plante est cultivée pour l’ornement et la consommation.
Surexploitée, l’espèce est devenue rare et est protégée.
Plante vivace vert grisâtre,
robuste, à tige épaisse, ligneuse à la base. Elle forme souvent des touffes
importantes. Grandes feuilles arrondies et charnues, pennatilobées, celles du sommet de la
tige plus étroites que celles de la base. Fleurs blanches en grappes serrées, avec, comme pour toutes les crucifères, quatre sépales, quatre pétales séparés et six étamines. Les fruits sont des siliques globuleuses de couleur jaunâtre.
Le crambé maritime est
facile à cultiver. Poussant
naturellement en bord de mer du nord de l’Europe, elle préfère les sols
légers à Ph neutre ou alcalins et les positions plein-soleil, mais n’aime
pas les climats trop chauds. Bien que préférant les sols riches, elle
tolère parfaitement les sols pauvres mais toujours bien drainés car elle ne
supporte pas l’humidité stagnante. Elle résiste au froid jusqu’à −20
°C. En bonnes conditions, elle peut produire jusqu’à trois récoltes par an et
un même pied peut vivre plusieurs dizaines d’années. Les fleurs sont très
attractives pour les butineurs.
Le semis est effectué de
préférence en place en mars-avril ou alors en godets transplantés lorsque la
plante a quelques feuilles. Les graines lèvent à 15 °C, en 3 semaines, mais
peuvent parfois mettre 2 mois. La première récolte peut avoir lieu 12 mois
après. La plante peut également être multipliée par division de souches ou par
morceaux de racines.
Toutes les parties de la
plante sont comestibles.Les
feuilles et les boutons floraux avant éclosion sont consommées crus ou cuits
comme le chou et le brocoli. Bien que très ressemblant, le gout
diffère de celui du chou. Plus charnues que celles du chou, les feuilles
tendent à être légèrement amères au moment de la floraison. Les racines peuvent
être consommées cuites et sont riches en sucre et amidon.
Source : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Crambe_maritime
|

Crambe
Maritima, ici
photographié en Estonie.
|

Vue sur son feuillage.
|

Crambe maritima à Saaremaa, Estonia.
|
Pour mention : Cette plante est utilisée comme condiment, le plus
souvent préparée au vinaigre blanc comme les cornichons. Ses feuilles
aromatiques à saveur légèrement piquante et salée peuvent être consommées
fraîches ou en salades ou cuites, comme les épinards. Outre sa résistance au
sel, la Criste de mer est aussi très résistante à la sécheresse.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Criste_marine,
b) http://nature.jardin.free.fr/vivace/ft_crithmum_mar.html
|

|

|
Pour mention : Les chercheurs tentent d'améliorer la résistance à
la salinité pour les plantes cultivées à des fins alimentaires. Ils travaillent
actuellement sur quelques plantes qui serve de modèle comme la tomate. En
principe, tomate et eau salée ne font pas bon ménage. Des chercheurs ont donc
pensé à introduire un gène qui permette à la tomate de pousser dans des sols
contenant du sel. En l'occurrence, ce gène provient d’Arabidopsis,
plante proche de la moutarde sauvage qui pousse dans nos jardins. Mais il est
également présent dans la plupart des plantes halophytes, comme la salicorne ou
encore les graminées des marais salants. Une fois le gène introduit dans la
tomate, l’excédent de sel est concentré dans les feuilles et non dans le fruit.
Ce changement laisse la tomate parfaitement comestible. De nombreuses
recherches se tournent maintenant vers le transfert de ces mécanismes de
résistance au sel chez le riz et le blé notamment.
Source : Des plantes qui supportent un régime salé, https://www.semencemag.fr/plantes-sols-sel.html
Et pour
d’autres usages. Elles permettent d’économiser l’eau.
|

Tournesol (Helianthus annuus)
|

Sorgho commun (Sorghum bicolor)
|
 
Arachide (Arachis hypogaea)
|
|

Lentille cultivée ou comestible (appelé dal en
Inde) (Lens culinaris)
|

Lentille cultivée ou comestible (appelé dal en
Inde) (Lens culinaris)
|

Diverses variétés de lentilles.
|
|

Mil ou millet (nom ambigüe)
Millet commun (Panicum miliaceum).
|

Millet commun (Panicum miliaceum).
|

Mil à chandelle, millet perle
ou mil (Pennisetum glaucum).
|
|


Fonio (nom ambigüe) (Digitaria sp.)
Fonio blanc (Digitaria exilis)
|


Lin cultivé
(Linum usitatissimum)
(Climat froid. Pour mention).
|
 
Cameline (lin bâtard)
(Camelina sativa). La
cameline est adaptée aux zones de climat semi-aride froid (steppes et
prairies).
(Climat froid. Pour mention).
|
Cette grande plante annuelle
(famille des Astéracées
(anciennement des Composées)) est très cultivée pour ses graines riches en huile (environ 40 % de
leur composition) alimentaire de bonne qualité. Le tournesol est, avec le colza et l'olivier, l'une des
trois sources principales d'huile alimentaire en
Europe.
Grâce à la sélection, la teneur des graines en huile atteint 40 %
d'huile.
Ses fleurs sont
groupées en capitules de
grandes dimensions. Le genre Helianthus comprend une
cinquantaine d'espèces, toutes originaires d'Amérique du Nord, dont le topinambour (Helianthus
tuberosus L.). La culture du tournesol est aujourd'hui largement
répandue sur tous les continents. Le tournesol est une plante dépolluante
des métaux lourds. La racine principale est pivotante. Elle peut atteindre
jusqu'à 4 m de hauteur. Peu gourmande en eau, sa racine pivot
lui permet de capter l'eau en profondeur. Elle résiste à la sècheresse.
C'est une plante plus sensible à la qualité du sol (profondeur,
structure) qu'à l'ajout d'engrais.
Ces besoins en azote sont
faibles (80 unités/ha contre 180 pour du maïs), mais il faut prévoir
une bonne fumure de
fond (80 unités de phosphore et
depotassium) et du bore. Elle est peu sensible aux
insectes (sauf en début de cycle) et les variétés commerciales ont des
résistances importantes aux attaques fongiques, de fait elle n'a quasiment pas
besoin d'être traitée. Elle est sensible à certains variants du mildiou, favorisé par les monocultures intensives.
L'huile de
tournesol est appréciée pour son équilibre en acides gras. La plante
entière récoltée avant maturité est utilisée comme fourrage. De plus, les résidus
de trituration, appelés tourteaux, sont riches en protéines, dont un acide aminé très
recherché dans l'alimentation du bétail, la méthionine. Les graines
entières sont appréciées pour nourrir les perroquets et
autres oiseaux de
volière. C'est aussi une plante mellifère, mais elle a
l'inconvénient de fleurir tard en saison.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Tournesol,
b) http://simple.wikipedia.org/wiki/Sunflower,
c) http://simple.wikipedia.org/wiki/Sunflower
Millet est
un terme générique qui désigne en français plusieurs espèces de plantes de
la famille des Poacées (graminées).
Ce sont des céréales vivrières, à très
petites graines, cultivées principalement dans
les zones sèches, notamment en Afrique et
en Asie. Elles
sont souvent appelées aussi mil.
Millet sans autre précision désigne souvent le millet commun, mais
le millet le plus cultivé est le « millet perle ». Moins
exigeantes et plus rustiques que le sorgho commun, ces espèces sont bien
adaptées aux zones tempérées ou tropicales sèches où la saison des pluies est
brève.
Cette
plante produit plusieurs épis au
sommet de la tige.
Ses graines sont très petites
(1-2 mm de diamètre). Ses besoins en eau sont légèrement supérieurs à
ceux des autres espèces de mil. L'éleusine,
appelée « ragi » en Inde, est une culture vivrière importante
en Afrique orientale et en Asie (Inde, Népal), où
elle se cultive jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
Source : Eleusine, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89leusine
|

Epis d’éleusine
|

Graines d’Eleusine
coracana
|

Eleusine
coracana
|
Ce terme
regroupe plusieurs espèces de céréales mineures cultivées
en Afrique de l'Ouest dans les
régions sèches sub-sahéliennes (voir ci-après) :
·
« Fonio
blanc » (Digitaria exilis), culture très
importante en Afrique de l'Ouest : Mali, Nigeria, Niger, Burkina
Faso, Sénégal et Guinée.
·
« Fonio noir » (Digitaria iburua), présent au Nigeria, au Togo et
au Bénin.
·
« Fonio
à grosses graines » (Brachiaria
deflexa ou Urochloa deflexa), culture pratiquée seulement dans le
massif du Fouta-Djalon en Guinée et en Sierra Leone.
|

Digitaria exilis – Fonio blanc
moissonné et entassé au champ (Mali)
|

Digitaria iburua - Fonio noir (Jardin
botanique de la Charme).
|

Brachiaria deflexa – Fonio à grosse
graine.
|
Plante de 1,3 m environ, à inflorescences en panicules lâches,
ramifiées et tombantes. Cette céréale est cultivée dans des régions tempérées,
en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, aux États-Unis, en Argentine et en
Australie. Diverses variétés, avec des grains de couleur blanche, jaune, brune
et même noire, étaient cultivées en France jusqu'à l'époque contemporaine. La
plupart ont disparu des cultures, mais certaines se sont maintenues, à l'état
d'adventices, notamment dans les champs de maïs. Source : Millet commun, https://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_commun
|

Millet commun arrivé à
maturité.

Millet séché.
|

Port général de la
plante.
|

Panicule à maturité.
|
Plante de 1 à 1,5 m environ, à inflorescences longues, cylindriques,
assez compactes, autrefois semée dans les prairies temporaires. Remis au gout
du jour dans toute l'Europe grâce aux nouvelles normes visant à favoriser la
biodiversité aux abords des champs. Le premier pays producteur est la Chine.
Espèce cultivée également en Inde, en Indonésie, en Corée, dans le Sud de
l'Europe et en Afrique orientale. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_des_oiseaux
Culture répandue en Inde, au Népal, au Pakistan, au Sri Lanka, dans
l'est de l'Indonésie et l'ouest de la Birmanie. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89leusine_des_Indes
|

Inflorescence (Eleusine
indica).
|

Tige feuillée et
fleurie (Eleusine indica).
|

Graine de millet des
oiseaux (Serata italica).
|
Deux espèces de « millets japonais » sont cultivées en Asie :
Echinochloa esculenta, le millet du Japon, est une plante
herbacée, pouvant atteindre 1,5 m de haut, est cultivée notamment au Japon
comme céréale pour l'alimentation humaine ou comme plante fourragère pour
l'alimentation animale. Elle peut aussi se comporter comme une mauvaise herbe,
en particulier dans les rizières.
Echinochloa frumentacea, panic d'eau, pied-de-coq cultivé ou
millet japonais, plante herbacée annuelle d'une hauteur de 50 cm à 1 m, est
cultivée comme céréale secondaire dans les pays chauds (Inde, Asie du Sud-Est,
etc.). Elle préfère les sols humides et les expositions ensoleillées. De
croissance rapide, elle peut donner une récolte en six semaines dans les
régions les plus chaudes.
C’est une culture importante dans les régions subtropicales de l'Inde.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Echinochloa_esculenta,
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Echinochloa_frumentacea
|

Tête de millet
japonais.
|

Echinochloa
esculenta
Inflorescence à maturité.
|

Echinochloa
frumentacea
|
C'est la plus cultivée de toutes les espèces de mil, il représente la
moitié de la production mondiale de mil ; parmi celles-ci, c'est celle qui a le
potentiel de rendement le plus élevé en conditions de sécheresse. Il croît sur
des sols sableux et pauvres, là où on ne pourrait pas cultiver le maïs, le
sorgho ni même l'éleusine. Les graines se forment sur un faux épi compact de 10
à 150 cm de long (chandelle). Culture traditionnelle en Afrique, surtout au
Sahel, en Asie (Inde, Pakistan). Introduit récemment comme culture céréalière
aux États-Unis, où il est utilisé comme fourrage d'été.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_Perle,
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_%C3%A0_chandelle
|

Millet perle (Pennisetum
glaucum)
|

|

Mil à chandelle ou mil
(Pennisetum glaucum)
|
Céréale à graines très petites, cultivée dans les régions montagneuses
de l'Éthiopie, où sa production dépasse celle de la plupart des autres
céréales. Tolère les sols lourds, mal drainés. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Teff
|

|

Champ de teff en
Éthiopie.
|
|
C'est une céréale très secondaire, surtout cultivée dans le sud-est
asiatique.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coix
|

Inflorescence (Coix
lachryma-jobi)
|

Port de la plante.
Feuillage.
|

Graines
|
C'est une céréale spontanée en Afrique occidentale et en Inde,
abondante le long des chemins, dans les fossés et les dépressions. En Inde,
cette espèce a été domestiquée il y a environ 3000 ans.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe_%C3%A0_%C3%A9p%C3%A9e
|

Herbe à épée (Paspalum
scrobiculatum). Port de la plante.
|

Graines de Paspalum
scrobiculatum
|
|
Intérêt alimentaire : Le millet est un aliment énergétique,
nutritif, recommandé pour les enfants et les personnes âgées ou en
convalescence. La teneur en protéines des différents mils, et leur qualité, se
compare à celle du blé ou du maïs. Une des principales espèces de millet,
l'éleusine a une teneur relativement élevée en méthionine, acide aminé qui
fait souvent défaut dans les céréales tropicales. Il est consommé surtout sous
forme de bouillies et de galettes. La farine de mil devient rapidement rance et
ne peut pas être conservée longtemps. Traditionnellement, le grain est pilé
dans un mortier. De plus en plus, on mécanise cette préparation : le grain est
alors passé dans une décortiqueuse et un moulin à farine, ce qui évite un
travail laborieux et améliore la qualité de la farine.
Source : Millet (graminée), https://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_(gramin%C3%A9e)
C'est
une plante herbacée annuelle (ou vivace
à courte durée de vie, traitée comme une annuelle), qui peut atteindre
3 mètres de haut. Elle est cultivée soit pour ses graines, le sorgo
grain, soit comme fourrage, le sorgho fourrager. C'est une plante qui ressemble au maïs et à la canne à sucre.
Le sorgo
est la cinquième céréale mondiale
par le volume de production, après le maïs, le riz, le blé et l'orge. C'est la
principale céréale pour de nombreuses populations à faible revenu vivant dans
les régions tropicales semi-arides d'Afrique et d'Asie. Cette plante est aussi
la sixième source de calories alimentaires pour la population mondiale, après
le riz, le blé, le sucre (de betterave et
de canne), le maïs
et la pomme de terre. Elle est également largement utilisée en alimentation animale sous
forme de fourrage vert, de paille sèche ou de concentré de céréales.
Le sorgho commun a un système
racinaire fibreux, caractéristique des graminées,
qui peut atteindre une profondeur de 1,5 à 2,4 m. Ce système racinaire est très étendu
et a la capacité de devenir dormant dans les périodes de stress hydrique, ce
qui contribue à la résistance à la sécheresse de la plante et en fait une culture
adaptable dans les systèmes agricoles marginaux des zones arides.
Les feuilles, qui ressemblent à celle du maïs, ont un limbe plat,
linéaire à lancéolé, largement arrondi à la base, de 30 à 100 cm de long sur 5 à 10 mm de large. Dans des conditions très sèches, les
feuilles s'enroulent vers le haut et vers l'intérieur, réduisant ainsi la transpiration et la perte d'humidité en diminuant la surface exposée. Elles
présentent en surface des dépôts de silice de forme irrégulière qui agissent comme une barrière physique
atténuant le stress hydrique en diminuant la transpiration et contrariant la
pénétration physique dans les tissus végétaux de ravageurs tels que la mouche
du sorgho (Atherigona
soccata). L'inflorescence est une panicule terminale ouverte ou contractée, lancéolée,
ovale ou globuleuse, non verticillée, de 4 à 50 cm de long sur 2 à 20 cm de large.
De nos jours, il est
cultivé, et parfois subspontané, dans tous les continents. C'est une plante de
climat chaud, mais comme pour le maïs, la sélection a permis de créer des
variétés cultivables en pays tempérés. En Europe, sa culture reste cependant cantonnée aux pays
méditerranéens. En France il est cultivé sur plus de 60 000 ha, principalement dans le sud-ouest en
alternative au maïs car il est moins exigeant en eau.
Utilisations : Alimentation humaine :
le sorgo à grain est une culture
vivrière dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie.
Le sorgo peut se consommer en grain à l'instar du riz, ou être réduit en farine.
Les sorghos fourragers sont utilisés en alimentation animale en grain, ou comme
fourrage en ensilage ou à la pâture principalement dans les pays
occidentaux et en Afrique du Nord.
Production de sucre et
sirop : des tiges du sorgo bicolore est extraite une mélasse ou un sirop sucré
(sirop de
sorgo). Les tiges de sorgo bicolore se mâchent
tout comme la canne à sucre.
Alcool, notamment au Burkina Faso, mais aussi et surtout en Chine avec le maotai, alcool de sorgo, considéré en Chine, comme le
meilleur alcool.
Agrocarburant : le sorgo à sucre pourrait être une solution pour produire un
agrocarburant tel que le bioéthanol, avec le risque quasi-certain cependant de mettre en péril les
cultures vivrières locales. L'accaparement de surfaces potentiellement
destinées à l'alimentation va devenir un problème crucial.
Le sorgo fibre permet grâce
à la méthanisation de sa biomasse la fabrication
de biomatériaux destinés à la fabrication de films plastiques ou de balais
biodégradables.
Toxicité : Intoxication par le cyanure d'hydrogène :
Le sorgho commun contient de la dhurrine, glucoside toxique qui produit à parts
égales de l'acide cyanhydrique (HCN) et du p-hydroxylbenzaldéhyde lorsqu'elle
est hydrolysée sous l'action d'enzymes présents dans les cellules. Cela se
produit lorsque les tissus végétaux sont perturbés (broyage, mastication,
etc.). La teneur en dhurrine diminue au fur et à mesure de la croissance et
surtout après la floraison, elle dépend aussi des conditions environnementales.
Les sorghos à grains et les sorghos sucriers ont des teneurs en dhurrine plus
élevées que les sorghos fourragers. Le risque
d'intoxication par le cyanure concerne les animaux en particulier en cas
d'ingestion de plants jeunes ou de repousses, en particulier s'il s'agit de
plantes stressées ou endommagées. Il est faible lorsque les animaux consomment
des plants au stade de la floraison ou de la mise à graines, ou sous forme d'ensilage.
Intoxication par les
nitrates : A
l'instar d'autres espèces de graminées, telles que le mil (Pennisetum
glaucum) et le Sudan Grass (herbe du
Soudan, Sorghum
×drummondii),
le sorgho à grains ou le
sorgho fourrager peuvent dans certaines circonstances accumuler des nitrates, potentiellement toxiques pour les ruminants. Les nitrates
sont convertis dans le rumen en nitrites. Ceux-ci absorbés dans le sang réagissent avec l'hémoglobine
pour former la méthémoglobine, ce qui bloque le transport de l'oxygène. L'accumulation des
nitrates dans les plantes se produit lorsque leur teneur dans le sol est élevée
et que les conditions environnementales (sécheresse, temps froid, application d'herbicides, etc.) freinent leur conversion en protéines. On considère que les
plantes contenant plus de 1,5 % de nitrate
de potassium (KNO3) par rapport à la matière sèche sont
potentiellement dangereuses pour du bétail affamé.
Culture : Le semis se fait
vers mai-juin : les graines de sorgho se sèment à environ 3−4 cm de profondeur en espaçant les pieds de 40 cm et les rangs de 60 cm, l'objectif de peuplement étant de 150 000 à
180 000 plantes par hectare. Les
graines se récoltent à l'automne lorsqu'elles sont dures, idéalement avant les
gelées. Il faut ensuite les faire sécher et les décortiquer pour enlever le
son. En France, son rendement moyen est de 53 quintaux/hectare.
Nutrition : Le millet et le
sorgo ne contiennent pas de gluten. On peut maintenant trouver les farines et
les grains certifiés sans gluten de ces céréales dans des endroits spécialisés
pour les allergies alimentaires. Il existe également de la bière certifiée sans
gluten.
Variétés cultivées : Il
existe plus de 128 variétés de sorgho grain inscrites dans le Catalogue
européen des espèces et variétés. Environ 145 variétés de sorgho grain
sont inscrites au Catalogue officiel français.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgo_commun
|

Sorgo commun
(panicule au stade maturation).
|

Tige feuillée.
|

Panicule.
|
|

Sorgo dans
la zone d'irrigation de la rivière Adaja (Ávila).
|

Graines de
sorgo rouge et de sorgo blanc.
|

Sorgho AL Precioso.
|
Cette plante annuelle, herbacée, de 20 à 72 cm de haut, est largement cultivée pour ses graines, comestibles, riches en protéines. Les tiges sont dressées et très rameuses. Ses
feuilles, alternes, composées pennées, comptent de 10 à 14 folioles opposées,
oblongues, et sont terminées par une vrille généralement simple ou bifide. Les
fleurs, à la corolle papilionacée, sont de couleur blanche ou bleu pâle et
groupées par petites grappes de deux à quatre. La floraison estivale intervient
entre mai et juillet. Les fruits sont des gousses aplaties, courtes, contenant deux graines rondes, aplaties,
en forme caractéristique de disque faiblement bombé (ou de lentille).
En tant que culture
vivrière, la majorité de la production mondiale provient du Canada et de
l'Inde, produisant ensemble 58 % du total mondial.
Sous-espèces : L'espèce
comprend quatre sous-espèces principales :
·
Lens culinaris subsp. culinaris (la lentille
cultivée), classée parfois comme espèce distincte (Lens esculenta Moench) ;
·
Lens culinaris subsp. odemensis ;
·
Lens culinaris subsp. orientalis ;
·
Lens culinaris subsp. tomentosus.
Exigences du sol : Les
lentilles peuvent pousser sur différents types de sols, du sable au limon
argileux, poussant mieux dans les sols de limons sableux profonds avec une
fertilité modérée. Un pH du sol autour de 7 serait
l’idéal. Les lentilles ne tolèrent pas les inondations, les sols gorgés
d’eau ou détrempées.
Exigences climatiques : Les conditions dans lesquelles les lentilles sont cultivées diffèrent
selon les régions de culture. Dans les climats tempérés, les lentilles sont plantées en hiver et au printemps à basse
température et la croissance végétative se produit plus tard au printemps et en
été. Les précipitations pendant cette période ne sont pas
limitées. Dans les régions subtropicales, les lentilles sont plantées à des températures relativement
élevées à la fin de la saison des pluies, et la croissance végétative se
produit sur l'humidité résiduelle du sol pendant la saison estivale. Les
précipitations pendant cette période sont limitées. En Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord, certaines lentilles sont plantées comme culture d'hiver avant
les chutes de neige. La croissance des plantes se produit pendant la fonte
des neiges. Dans une telle culture, les rendements en graines sont souvent
beaucoup plus élevés.
Besoins du lit de semence et des semis : La lentille a besoin
d'un lit de semence ferme et lisse avec la plupart des résidus de récolte précédents incorporés. Pour le placement des
graines et pour la récolte ultérieure, il est important que la surface ne soit
pas inégale avec de grosses mottes, des pierres ou des résidus de culture
saillants. Il est également important que le sol soit friable et exempt de
mauvaises herbes, afin que l'ensemencement puisse être fait à une profondeur
uniforme.
Les densités de plantes pour
les lentilles varient entre les génotypes, la taille des graines, le temps de plantation et les
conditions de croissance et également d'une région à l'autre. En Asie du
Sud, un taux de semis de 30 à 40 kilogrammes par hectare (27 à 36 livres par
acre) est recommandé. Dans les pays d'Asie occidentale, un taux de semis
plus élevé est recommandé et conduit également à un rendement plus
élevé. Les graines doivent être semées sur 3 à 4 centimètres (1+1⁄4 to 1+1⁄2 pouces) de profondeur. Dans les pays mécanisés, les lentilles sont
plantées à l'aide de semoirs à graines, mais dans nombreuses autres régions, elles continuent à être semées à la main.
Gestion de la culture, fertilisation : Dans les systèmes
de culture intercalaire –
une pratique couramment
utilisée dans la culture des lentilles – des herbicides peuvent être nécessaires pour assurer la santé des cultures.
Comme beaucoup d'autres cultures de légumineuses, les lentilles peuvent fixer
l'azote atmosphérique dans
le sol avec des rhizobiums spécifiques. lentilles poussent bien dans
des conditions de faible apport d' engrais, bien que le phosphore, l'azote, le potassium et le soufre puissent être utilisés pour les sols
pauvres en nutriments.
Maladies : Une des principales maladie est la rouille (Uromyces vicia-fabae). Mais il existe des variétés résistante à la rouille.
Usages : Les lentilles peuvent être consommées trempées,
germées, frites, cuites au four ou bouillies – la méthode de préparation la
plus courante. Les plats de lentilles sont les plus répandus dans toutes les
régions méditerranéennes, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Ouest. Dans les cuisines du sous-continent indien, où les lentilles sont un aliment de base, les lentilles fendues (souvent avec leurs coques enlevées)
connues sous le nom de daal sont souvent cuites dans un curry /sauce épais qui est
généralement consommé avec du riz ou des rotis.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_cultiv%C3%A9e,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Lentil
|

Lentilles du Puy (à gauche), vertes et rouges (à droite).
|

Différents types de lentilles.
|
|

Plantes de lentilles, avant la floraison.
|

Lentille « beluga ».
|

Salade de
lentilles agrémentée d'échalote.
C’est une espèce de plantes de la famille des Fabaceae et du genre Vigna originaire d'Afrique tropicale, dont plusieurs sous-espèces
sont cultivées comme plantes alimentaires pour leurs graines, proches des haricots, ou pour leur gousses. C'est la principale légumineuse alimentaire d'Afrique tropicale, fournissant une source
économique de protéines de grande qualité. Le niébé est produit principalement
dans les régions intérieures arides de l’Afrique de l’Ouest en raison de sa
tolérance à la sécheresse et de la pression moins forte des insectes dans ces
zones, et le commerce bien développé le mène au Sud, vers les principaux
marchés côtiers. C’est une
culture précieuse pour les agriculteurs pauvres en ressources et bien adaptée à
la culture intercalaire avec d'autres cultures.
Économie : La
production mondiale de niébé est estimée à 3,7 millions de tonnes
annuelles dans la décennie 1990-1999, sur une surface de 8,7 millions
d'hectares. Elle est située pour l'essentiel en Afrique (87 % des
surfaces cultivées), puis loin derrière en Amérique (10 % des
surfaces) et le reste en Europe et Asie.
Le Nigeria étant le
premier producteur mondial de niébé (45 % du total) mais également le
plus grand importateur. Il est suivi par le Brésil (avec 17 %). Le Niger compte
pour 8 %. Les autres producteurs de Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont, par
ordre d’importance, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin,
le Ghana,
le Togo,
le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
Ecologie : Les types
sauvages de Vigna unguiculata poussent parmi la végétation de savane,
souvent dans des milieux perturbés, ou bien comme adventice, jusqu’à 1500 m
d’altitude ; mais on peut en trouver dans les savanes herbeuses soumises à des
brûlis réguliers, dans des endroits sablonneux proches des côtes, dans des
étendues boisées, des lisières des forêts ou dans les zones marécageuses,
parfois jusqu’à 2500 m d’altitude.
Culture : Le niébé prospère dans des conditions sèches médiocres,
poussant bien dans des sols contenant jusqu'à 85 % de sable. Cela en fait une
culture particulièrement importante dans les régions arides et semi-désertiques
où peu d'autres cultures pousseront. En plus d'être une importante source de
nourriture pour les humains dans les régions pauvres et arides, la culture peut
également être utilisée comme aliment pour le bétail. Le niébé peut être
utilisé efficacement dans les culture intercalaire, avec le sorgho, le mil, le maïs, le manioc ou le coton.
La température optimale pour la croissance du niébé est de
30 °C (86 °F), ce qui le rend disponible uniquement comme culture d'été pour la
plupart des pays du monde. Il pousse mieux dans les régions où les
précipitations annuelles se situent entre 400 et 700 mm (16 et 28 pouces). Les
sols idéaux sont sablonneux et il a une meilleure tolérance aux sols infertiles
et acides que la plupart des autres cultures. Généralement, 133 000 graines
sont plantées par hectare (54 000/acre) pour les variétés dressées et 60 000
par hectare (24 000/acre) pour les variétés grimpantes et rampantes. Les
graines peuvent être récoltées après environ 100 jours ou la plante entière
utilisée comme fourrage après environ 120 jours. Les feuilles peuvent être
cueillies à partir de 4 semaines après la plantation.
Le moment de la plantation est crucial, car la plante doit
mûrir pendant les pluies saisonnières. La culture est principalement
intercalée avec le mil chandelle et les plantes sélectionnées fournissent à la fois de la
nourriture et du fourrage, au lieu des variétés plus spécialisées.
Ravageurs et maladies : Les insectes sont un facteur majeur dans les faibles
rendements des cultures africaines de niébé, et ils affectent chaque composant
tissulaire et stade de développement de la plante. En cas de mauvaises
infestations, la pression des insectes est responsable de plus de 90 % de perte
de rendement. Le foreur des gousses des légumineuses, Maruca vitrata, est le principal
ravageur pré-récolte du niébé. D'autres ravageurs importants comprennent
les punaises suceuses de gousses, les thrips et le charançon du niébé post-récolte, Callosobruchus maculatus, Aphis craccivora (puceron du niébé), un ravageur du niébé en Inde, aux Philippines, en Thaïlande, dans le sud des États-Unis, en Afrique tropicale et en Amérique latine, Helicoverpa armigera (ver africain de la capsule), qui s’attaque au
coton, au niébé, etc. Les infestations graves de C. maculatus peuvent
affecter 100 % des pois stockés et causer jusqu'à 60 % de pertes en quelques
mois. Le niébé est sensible aux nématodes, aux maladies fongiques (brûlures, pourriture des racines, flétrissement, oïdium, nœud racinaire, rouille et tache foliaire), bactériennes et virales, ce qui peut entraîner une perte
substantielle de rendement.
Moyens de lutte : Le contrôle biologique a eu un succès limité, donc la plupart des
méthodes préventives reposent sur l'utilisation de produits agrochimiques (phytosanitaires). Des niébés génétiquement
modifiés sont en cours de
développement pour exprimer la protéine cry de Bacillus thuringiensis , qui est toxique pour les espèces de lépidoptères dont le Maruca.
La sécheresse abaisse le taux de croissance et le
développement, réduisant finalement le rendement, bien que le niébé soit
considéré comme plus tolérant à la sécheresse que la plupart des autres
culture. L’Institut
international d'agriculture tropicale (IITA), le Nigeria et l'Institut de l'Environnement et de
Recherches Agricoles travaillent sur des espèces sauvages apparentées au niébé
pour exploiter la diversité génétique et la transférer dans des cultivars afin
de les rendre plus tolérants à différents stress et adaptatifs au changement
climatique. Le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO)
de la Banque mondiale a soutenu la recherche agricole au service d’une agriculture
climato-intelligente, contribuant à la mise au point de 14 nouvelles variétés
de millet, de sorgho et de niébé à haut rendement, à maturation précoce et
résistantes à la sécheresse.
Conservation des semences / Stockage des graines : Il est important de bien faire sécher les graines
au soleil avant de les stocker à l'abri de prédateurs comme la bruche du niébé (Callosobruchus). Le stockage des graines peut être
problématique en Afrique en raison d'une infestation potentielle par des
ravageurs post-récolte. Les méthodes traditionnelles de protection des
céréales stockées comprennent l'utilisation des propriétés insecticides
des extraits de Neem, le mélange des céréales avec de la cendre ou du
sable, l'utilisation d'huiles végétales, la combinaison de cendres et d'huile
dans une solution savonneuse ou le traitement des cosses de niébé avec de la fumée
ou de la chaleur. Les méthodes plus modernes incluent le stockage dans des
conteneurs hermétiques, en utilisant une irradiation gamma, ou en chauffant ou
en congelant les graines. Des températures de 60 °C (140 °F) tuent les larves
de charançon, ce qui a conduit à une récente poussée pour développer des formes
bon marché de chauffage solaire pouvant être utilisées pour traiter le grain
stocké. L'un des développements les plus récents est l'utilisation d'un système
de double ensachage bon marché et réutilisable (appelé PICs) qui asphyxie les charançons du niébé.
Taxonomie : Sous-espèces : Selon
Bernard Verdcourt, les sous-espèces, distinguées par lui, sont :
1. Plante
volubile, de 2−4 m, à gousses de 30−80 cm pendantes, renflées à
l'état jeune, graines de 8−12 mm ............ subsp. sesquipedalis.
2. Plantes
érigées/rampantes, de 15−80 cm, à gousses de 7,5−30 cm non renflées
à l'état jeune, graines de 6−9 mm :
2.1. Gousses
de 20−30 cm, pendantes .........................subsp. unguiculata.
2.2. Gousses
de 7,5−13 cm, érigées ou étalées .............subsp. cylindrica (la
dolique mongette ou cornille).
Il existe
aussi d’autres sous-espèces : baoulensis, burundiensis, dekindtiana,
letouzeyi, mensensis, pubescens, stenophylla, tenuis.
Cultivars : Il existe en Afrique, un certain nombre de cultivars liés à
une remarquable diversité dans les usages : suivant le cas, on consommera les
feuilles, les gousses vertes, les graines vertes ou sèches, et le feuillage ira
éventuellement alimenter le bétail. Au sein de l’espèce Vigna unguiculata
cultivé, on admet généralement 5 groupes de cultivars _ unguiculata, biflora, sesquipedalis,
Melanophthalmus et textilis _, qui se recoupent et qui peuvent
par ailleurs facilement se croiser :
l Le Groupe Unguiculata (Vigna
unguiculata subsp. unguiculata, niébé commun, pois à vache) : types de légume sec et de légume frais,
cultivés pour leurs grains secs ou immatures, leurs jeunes gousses ou leurs
feuilles. Plante au port prostré à érigé, atteignant 80 cm de haut, floraison
tardive, gousses de 10–30 cm de long, pendantes, dures et fermes, non renflées
à l’état jeune, contenant de nombreuses graines non espacées, de
6−10 mm, à tégument épais; la plupart
des cultivars africains appartiennent à ce groupe. En Afrique, il existe un
grand nombre de variétés locales et de cultivars améliorés au sein du Groupe Unguiculata.
Des types spéciaux à port érigé ou à tiges prostrées à longues pousses tendres
sont cultivés comme légume-feuilles et parfois aussi pour leurs grains
immatures ou leurs jeunes gousses. L’utilisation des types à double fin
(graines et feuilles) devient très courante dans certains pays, parce que les
feuilles sont le principal légume au début de la saison des pluies.
l Le Groupe Sesquipedalis (Vigna
unguiculata subsp. sesquipedalis, cornille, haricot kilomètre ou dolique asperge, synonymes : Dolichos sesquipedalis, Vigna
sesquipedalis) : cultivé pour ses jeunes gousses ; plante
grimpante, tige atteignant 4 m de long, gousses de 30–120 cm de long,
pendantes, renflées à l’état jeune, contenant de nombreuses graines espacées,
souvent noires ou brunes ; important légume en Asie du Sud-Est, mais
d’importance secondaire en Afrique tropicale, où seuls des cultivars introduits
d’Asie sont cultivé. Différents cultivars de haricot-kilomètre sont proposés
par les firmes semencières asiatiques, qui offrent tout un éventail de
caractéristiques de la plante.
l Le Groupe Biflora (catjang) (niébé proprement dit,
cornille ou dolique mongette) : cultivé pour ses graines sèches, ses gousses
vertes et tendres et pour le fourrage ; port prostré à érigé, atteignant 80 cm
de haut, floraison précoce, gousses de 7,5–12 cm de long, dressées ou
ascendantes, dures et fermes, non renflées à l’état jeune, à graines de
3−6 mm, peu nombreuses et non espacées ; important en Inde et en Asie du
Sud-Est, et également dans certaines parties d’Afrique (par ex. en Éthiopie).
l Le Groupe Melanophthalmus : originaire d’Afrique de
l’Ouest ; plante photosensible pouvant fleurir précocement à partir des
premiers nœuds sous conditions inductives, gousses de 10−30 cm contenant
relativement peu de graines, tégument fin, souvent ridé, partiellement blanc.
Suivant les cultivars, les graines peuvent être séparées ou serrées les unes
contre les autres dans la gousse, d'où le nom de crowder pea aux
États-Unis pour ces derniers.
l Le Groupe Textilis : petit groupe cultivé
seulement au Nigeria pour ses fibres extraites des longs pédoncules qui
atteignent 60 cm voire un mètre de long ; au début du XXe
siècle, ce groupe était réparti du delta intérieur du fleuve Niger jusqu’au bassin
du lac Tchad, mais il disparaît progressivement.
Au Nigeria, on fait pousser
des cultivars spéciaux pour leur fibre, extraite des pédoncules ; la fibre
solide est particulièrement adaptée aux équipements de pêche et elle produit un
papier de bonne qualité.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigna_unguiculata, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Cowpea,
c) https://uses.plantnet-project.org/fr/Vigna_unguiculata_(PROTA), d) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornille
|

Un plant de
niébé avec quelques gousses prêtes à être récoltées.
|

La foliole
terminale est symétrique; les latérales sont dissymétriques.

Les gousses
sont cylindriques.
|


Gousses de
diverses variétés.
|
|

Fleurs
|

Stipule
lancéolée de 1 cm, muni d'un éperon.
|

Le Niébé, le
haricot à l'œil noir.
|
|

Niébé
cultivés (les plus gros) et niébé sauvages.
|

Graine
(variété rouge).
|

Le pois rouge des îles de la mer est un cultivar de niébé cultivé
par le peuple
Gullah (sud des USA).
|
|

Cuisson des
graines au Ghana.
|

Le charançon
du niébé (Callosobruchus maculatus) infeste les graines de niébé stockées, entraînant des
pertes post-récolte importantes.
|

La larve
de Maruca
vitrata, communément appelée maruca foreur des
graines, est l'un des ravageurs le plus nuisible du niébé.
|
L’arachide, dont le
fruit s'appelle cacahuète ou cacahouète, pois
de terre, pistache de terre et pinotte, au
Canada, est une plante de la famille des légumineuses (Fabaceae) originaire du nord-ouest de l'Argentine et du sud-est de la
Bolivie et cultivée dans les régions tropicales, sub-tropicales et tempérées
pour ses graines oléagineuses. Elle présente la particularité d’enterrer ses fruits après la fécondation.
Il en existe 3 principaux types : Virginia (Arachis hypogae hypogae),
aux graines les plus grosses, Spanish (Arachis fastigiata vulgaris) et
Valencia (Arachis fastigiata fastigiata), ainsi que des hybrides telles
que « Runner », hybride de Virginia et de Spanish.
Source d’azote : Comme la plupart des autres légumineuses, les arachides
abritent des bactéries (Rhizobium) symbiotiques fixatrices
d'azote dans
les nodules
racinaires. La capacité de fixer l'azote signifie que
les arachides nécessitent moins d'engrais contenant de l'azote et améliorent la
fertilité du sol, ce qui les rend précieuses dans les rotations de cultures. Les arachides peuvent satisfaire la totalité ou presque de
leurs besoins en azote. Il faut inoculer ce rhizobium sur un sol
qui en est dépourvu, à raison de 9 kg/ha pour obtenir une bonne nodulation (l'inoculant doit
être épandu directement sur la semence dans la raie de semis). Les petits
exploitants africains plantent souvent les cacahuètes avec une ou deux autres
cultures, telles que le sorgho, le millet ou les pois sauvages.
Culture : Les
cultures se font en buttes (surélevées) séparées d'un mètre environ ; ce
qui permet d'améliorer le drainage et facilite l'arrachage. Dans les régions
de savane au nord de l'Afrique occidentale, plus sèches, elles sont généralement
plantées en juin et récoltées en septembre ou octobre. Les cacahuètes ne
poussent que dans des sols bien drainés, plutôt sableux
et pas trop argileux pour éviter les pertes au moment de la récolte
(arrachage). Le pH idéal est de 5,8. La récolte doit se faire dès la maturité
(lorsque la pellicule qui recouvre la graine se détache facilement). Pour protéger le sol contre l'érosion par
le vent et par l'eau, on y installe normalement une culture couvre-sol d'hiver (CIPAN)
qui sera ensuite enfouie vers
la fin avril, afin de lui laisser le temps de bien se décomposer avant les
semailles de l'arachide.
Maladies : Un point important est d’éviter le
développement de moisissures qui peuvent produire des aflatoxines, dangereuses pour le bétail, qui consommerait les tourteaux contaminés, et pour l’homme. Moisissures pouvant être évitées
avec a) des variétés/cultivars résistants à ce champignon,
b) des conditions de stockage avec un faible taux d’humidité dans les graines
et l’air extérieur. À signaler, une maladie virale, la « rosette de l'Arachide »,
transmise par un puceron. Cette maladie provoque le rabougrissement des pieds et fait
baisser sensiblement le rendement surtout si elle apparaît tôt (moins de 40
jours après le semis). Deux autres maladies fongiques, la cercosporiose (tavelure des feuilles) et la rouille (spores sur la face inférieure des feuilles), sont présentes
sur l'arachide surtout en climat humide, où elles provoquent une chute des
feuilles entraînant une baisse des rendements en gousses.
Toxicité / allergie : Certaines personnes (0,6 % de la
population des États-Unis) éprouvent des réactions allergiques à l'exposition
aux arachides; les symptômes sont particulièrement graves pour cette noix et
peuvent aller du larmoiement au choc anaphylactique, qui est généralement
mortelle si elle n'est pas traitée. La lecture des ingrédients et des
avertissements sur les emballages des produits est nécessaire pour éviter cet
allergène. Éviter la contamination croisée avec les arachides et les produits à
base d'arachides (ainsi que d'autres allergènes graves comme les crustacés) est
une pratique promue et courante dont les chefs et les restaurants du monde
entier prennent conscience.
L'huile d'arachide raffinée
ne provoquera pas de réactions allergiques chez la plupart des personnes
allergiques aux arachides, contrairement aux huiles d'arachide brutes (non
raffinées) contenant les protéines provoquant les réactions allergiques.
Variétés : Les
variétés cultivées sont très nombreuses et regroupées en deux grands types
(voir ci-dessous :
·
Virginia, à port rampant et à cycle
végétatif long (120 à 140 jours) ; les graines ne germent pas
prématurément ; cette variété est plus résistante à la tavelure des
feuilles ;
·
Spanish et Valencia, à port érigé et à
cycle végétatif court (90 à 110 jours) ; le rendement est plus élevé,
mais la germination rapide après maturité peut poser problème.
Le cycle
de culture dure de 90 à 150 jours. La floraison intervient environ un mois
après le semis.
Cultivars
résistants à la sécheresse : 1) types de Baol et Spanish,
2) accession ICG 8431 [fastigiata vulgaris Spanish (VUL). Source : 2MWI,
Donneur : IAC], 2) taxon Fastigiata
et accessions ICG 8352 et ICG 9991, 3) 03/40/1/3/2,
06/32/1/1/1, 017/55/1/1/2, 018/16/1/1/1,017/69/1/1/2, et 018/16/1/1/1,
4) 47-16.
Usages : La graine, communément appelée cacahuète
(de l’aztèque « cacahouate ») est consommée après torréfaction. On obtient de
l’huile par pression à froid ou à chaud, à partir de laquelle on fabrique du
beurre, de la margarine. Les tourteaux sont surtout destinés à l’alimentation
du bétail. Les graines les plus grosses, décortiquées puis triées à la main,
constituent l’arachide de bouche. Les petites graines ou les brisures sont
utilisées en confiserie (biscuits, enrobage dans du chocolat, etc.).
Il existe énormément de plats à base d’arachide, dans le monde.
Lutte
contre la malnutrition : Les cacahuètes sont utilisées
pour lutter contre la malnutrition. Plumpy Nut, MANA Nutrition,
et Medika Mamba sont des pâtes à base d'arachides riches en protéines, en
énergie et en nutriments, développées pour être utilisées comme aliment
thérapeutique pour aider à soulager la famine. L'Organisation
mondiale de la santé, l'UNICEF , Project Peanut Butter
et Médecins sans
frontières ont utilisé ces produits pour aider à sauver des enfants malnutris
dans les pays en développement .
Les
arachides peuvent être utilisés comme les autres légumineuses et
les céréales pour faire un lait sans lactose, comme
boisson, le lait d'arachide, qui est
promu en Afrique comme moyen de réduire la malnutrition chez
les enfants.
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut
|

Culture de
l'arachide à la Direction de la recherche sur l'arachide, région de Junagadh en Inde occidentale
|

Développement de gousses d'arachide.
|

Fleur d'arachide.
|

Récolte de cacahuètes.
|
|

Deux ovaires d'arachide après la chute des fleurs. L'ovaire fécondé
est plus épais et plus clair que la tige, et terminé par un bout pointu de
couleur violette, qui permet de creuser la terre lors de sa croissance.
|

Gousses déterrées pour examen.

Récolte des cacahuètes à la main.
|

Récolteuse d'arachides à chenilles.

Détail de la texture.

|

Cacahuètes bouillies.

Un bol
de sev mamra, composé de riz soufflé, de
cacahuètes et de nouilles assaisonnées frites.
|
|

Dépistage/contrôle de la qualité des arachides.
|

Cacahuètes grillées comme collation.
|
|

Huile d'arachide.
|

Beurre de cacahuètes.
|

Bonbon aux arachides connu sous le
nom de chikki à base d'arachides et de sucre
de canne.
|
|

La colle pistache, friandise créole ou nougat
d'arachide.
|

Avertissement « Attention - cacahuète et poussière de
cacahuète omniprésentes ».
|

Les graines ovoïdes sont enveloppées dans un tégument sec
rose à rouge.
|
(Pour
mention). C’est une plante annuelle, de 30-60
cm de hauteur avec une forte racine, spontanée dans le bassin
méditerranéen, connue pour ses graines également appelées Gesse.
Ses graines sont des légumes secs consommés depuis le début du néolithique en Europe
du Sud, en Inde du nord et dans la corne de l'Afrique. Elle est couramment cultivée pour la consommation humaine et
l’alimentation du bétail en Asie et en Afrique de l'Est. C'est
une culture particulièrement importante dans les zones sujettes à la sécheresse et à la famine, et est considérée comme une « culture d'assurance »
car elle produit des rendements fiables lorsque toutes les autres cultures
échouent. De nos jours, la gesse est largement cultivée sur de vastes
régions en Asie (en particulier le Bangladesh, l'Inde, le Népal, le Pakistan et
le Proche-Orient), en Europe méridionale et en Afrique du Nord, et dans une
moindre mesure en Amérique, en Australie et en Afrique du Sud. En Afrique tropicale,
elle est surtout cultivée en Ethiopie (guaya), mais également au Soudan,
en Erythrée, au Kenya, en Tanzanie, en Angola et à l'île Maurice. On estime à 1
million d'hectares la surface ensemencée en gesse actuellement.
Description : Elle produit des gousses de 30-35 mm contenant des
graines appelées également gesse. Leurs tiges sont couchées ou grimpantes, et
mesurent 15 à 60, rarement 100 cm de long. Elles sont fortement ramifiées,
s'étalant de 0,5 à 1,5 m de large. Les pétioles sont largement ailés (1 à 2,5
mm). Les folioles mesurent de 2,5 à 15 cm de long, de 3 à 7 mm de large, et
sont au moins 3 fois plus longs que larges. Leur forme est linéaire-lancéolée à
elliptique, ils ont 5 à 7 nervures longitudinales minces distinctes. Les
stipules mesurent de 10 à 20 mm de long et de 2 à 5 mm de large.
Culture : Elle pousse mieux à des températures moyennes
situées entre 10 et 25 °C avec une pluviométrie moyenne de 400-650 mm par an.
Comme d'autres légumineuses, elle améliore la teneur en azote du sol. Sa
culture peut survivre à la sécheresse ou à des inondations, mais elle pousse
mieux dans les sols humides. Elle tolère une gamme de types de sols pauvres,
acides, neutres, lourds ou alcalins, allant du sable limoneux à l'argile
compacte . Elle tolère l'asphyxie racinaire et une salinité modérée.
Elle ne tolère pas l'ombre. Elle pousse bien dans les régions subtropicales
comme culture d'hiver. En Ethiopie, la gesse est souvent cultivée en saison
sèche sur l'humidité résiduelle dans les sols noirs argileux lourds, à
1700–2700 m d'altitude. En Inde, c'est une culture de saison froide, jusqu'à
1200 m d'altitude. Souvent, la gesse ne reçoit pratiquement aucun soin après
avoir été semée, bien que pour des rendements optimaux, il vaut mieux enlever
le gros des mauvaises herbes.
La gesse se cultive soit en culture pure, soit en association, par ex.
avec de l'orge, du lin ou des pois chiches. Dans de nombreux pays, la gesse est
produite dans des systèmes de riziculture, avant ou en alternance avec le riz.
En Inde, la gesse est souvent cultivée comme culture de relais : elle se sème à
la volée dans une culture de riz sur pied, 2 semaines environ avant la récolte
du riz, et on la fait pousser sur l'humidité résiduelle. En Ethiopie, la gesse
se cultive en rotation l'orge ou parfois un légume sec, tel que pois ou pois
chiche, semé en avril et après en juillet.
Multiplication et plantation : La gesse se multiplie par
graines. Le poids de 1000 graines est de 30–300 g. En Ethiopie, le lit de semis
n'a pas besoin d'être fin. On sème les graines à la volée ou en sillons après
les avoir éventuellement fait tremper dans l'eau pendant une nuit. Des densités
de 200 000–250 000 plantes/ha sont courantes. En Ethiopie, la gesse est
généralement semée en septembre–novembre et recueillie en janvier–avril.
Rendements : Le rendement moyen en graines de gesse est
de 350–700 kg/ha ; en Ethiopie, il avoisine les 700 kg/ha. Lors d'essais menés
récemment dans différents pays, on a obtenu des niveaux de rendements de 1500 à
3000 kg/ha.
Toxicité : La
gesse contient un neurotoxique, le βODAP, acide aminé
β-N-oxalyle-L-alpha β-diaminopropionique qui provoque une paralysie
douloureuse et irréversible des jambes accompagnée de tremblements, d'incontinence,
le lathyrisme, évoquant la sclérose
en plaques, en cas de forte consommation (plus de
30 % de l'alimentation).
Depuis
les années 2000, diverses recherches sont conduites pour améliorer la gesse et
en réduire le niveau de βODAP, et pour comprendre le mécanisme
d'adaptation à la sécheresse de la gesse. Une publication parue dans
Russian Journal of Genetics 48, numéro 2 (2012) laisse penser que des mutants
homogènes sont sur le point d'être sélectionnés, les ressources du génie
génétique devraient permettre d'aboutir rapidement, les facteurs affectant le
contenu en β-ODAP ont été décrits en 2011 par des universitaires chinois,
le principal est le stress hydrique.
La gesse
cultivée est maintenant considérée comme une plante d'avenir, elle peut être
produite dans des conditions climatiques moins exigeantes que les céréales.
Des essais sont réalisés pour incorporer la farine de gesse dans le pain.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_sativus,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_sativus,
c) https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Lathyrus+sativus+L.
|

Fleurs
|

Gousses
|


Graines
|
|

Champ de gesse à maturité.
|

Fleurs
|
|
C’est une espèce de plantes
herbacées annuelles,
de 1 à 2 m de haut, de la famille des Amaranthaceae (selon la classification
phylogénétique) ou de celle des Chenopodiaceae (dans la classification
de Cronquist). C'est
une pseudocéréale, botaniquement apparentée à l’amarante,
plutôt qu'une véritable céréale, n’étant pas une graminée.
Cette plante traditionnelle
est cultivée depuis plus de 5 000 ans, sur les hauts plateaux andins d'Amérique
du Sud, pour alimenter le bétail et pour la consommation humaine. La teneur en saponine de l'enveloppe de ses graines les rende amères. Sa farine qui en est tirée n'est pas panifiable en raison de l'absence de gluten.
Sa culture s'est répandue dans plus de 70 pays, dont le Kenya, l'Inde,
les États-Unis et plusieurs pays européens.
Description : Les feuilles sont
larges, lobées, généralement poudreuses, poilues, normalement disposées
en alternance. Les feuilles du bas sont
grandes jusqu’à 15 cm sur
12 cm, et de forme rhomboïdale ou triangulaire, celles du haut sont petites, d’environ
10 mm sur
2 mm, lancéolées ou triangulaires. La couleur des feuilles varie, en fonction des
variétés, en général vertes, lorsqu’elles sont jeunes, puis virant au jaune,
rouge ou violet. L’inflorescence est une panicule, une grappe de grappes, d'une
longueur de 30 à 80 cm. La fleur peut être hermaphrodite ou unisexuée femelle. La pollinisation
se fait par autofécondation, bien que des pollinisations croisées peuvent se
survenir. Le fruit est un akène, comportant trois couches : périgone (un tépale de fleur), péricarpe (l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines) et épisperme (le tégument qui recouvre
la graine).
Le périgone, vert, rouge ou
pourpre, se détache en général facilement à maturation, par lavage ou par
frottement à l’état sec. Le péricarpe du fruit, lui aussi de couleur variable
(translucide, blanc sale, jaune, rose, rouge etc.), adhère à la graine et est
éliminé par décorticage abrasif avant la consommation. L’épisperme entoure la
graine en formant une membrane très mince. L’embryon, constitué de deux cotylédons et de la radicule (forme embryonnaire de la racine), est à la périphérie de la graine. Les graines, très petites, mesurent
environ 2 mm (1 ⁄ 16° de pouce), de diamètre, et sont de différentes
couleurs _ du blanc au rouge ou au noir, selon le cultivar.
Culture
: Exigences climatiques : La croissance
de la plante est très variable, en raison du nombre de différentes sous-espèces,
variétés et variétés locales (plantes sauvages ou espèces cultivées,
adaptées au milieu dont ils sont originaires). Cependant, elle est
généralement peu exigeante et résistante à l'altitude; elle est cultivée dans
les régions côtières, jusqu'à plus de 4 000 m (13 000 pi) dans les
Andes, près de l'équateur, la plupart des cultivars étant cultivés entre
2 500 m (8 200 pi) et 4 000 m (13 000 pi). Selon la
variété, les conditions de croissance optimales sont dans les climats frais,
avec des températures variant entre -4 °C (25 °F), pendant la nuit, à près de
35 °C (95 °F), pendant la journée. Certains cultivars peuvent supporter
des températures plus basses sans dommage. Les gelées légères n'affectent
normalement pas les plantes à aucun stade de développement, sauf pendant la
floraison. Les gelées estivales pendant la floraison, fréquentes dans les
Andes, entraînent la stérilisation du pollen. Les besoins en précipitations
sont très variables entre les différents cultivars et la saison de croissance. La croissance est optimale avec des précipitations bien
réparties, au début de la croissance, puis une absence de pluie pendant la
maturation des graines et la récolte.
Récolte : Traditionnellement, le grain de
quinoa est récolté à la main, et rarement à la machine, car l'extrême
variabilité de la période de maturité, de la plupart des cultivars de quinoa,
complique la mécanisation. La récolte doit être chronométrée, avec
précision, pour éviter les pertes élevées de graines, dues à l'éclatement, et
que différentes panicules sur la même plante mûrissent à des moments différents.
Le rendement
des cultures dans la région andine (souvent autour de 3
t/ha jusqu'à 5 t/ha) est comparable aux rendements du blé. Aux États-Unis,
les variétés ont été sélectionnées pour l'uniformité de la maturité et sont
récoltées mécaniquement à l'aide de moissonneuses-batteuses conventionnelles à
petits grains.
Traitement des graines : Les plantes sont
laissées au repos, jusqu'à ce que les tiges et les graines soient sèches et que
le grain ait atteint une teneur en humidité inférieure à 10 %. La
manipulation implique le battage, pour séparer les têtes
de graines (panicules) de la paille, et le vannage de la graine pour enlever son enveloppe. Avant le stockage, les graines doivent être séchées afin
d'éviter la germination. Les graines sèches peuvent être stockées crues jusqu'à ce
qu'elles soient lavées ou traitées mécaniquement pour éliminer le péricarpe (l’enveloppe) afin d'éliminer la couche amère contenant des
saponines. Les graines doivent être à nouveau séchées avant d'être
stockées et vendues en magasin.
Types de sol : Le quinoa a attiré l'attention
pour son adaptabilité à des environnements contrastés, tels que les sols
salins, les sols pauvres en nutriments et les agroécosystèmes marginaux
stressés par la sécheresse. Les rendements sont maximisés lorsque 170-200 kg/ha
(150-180 lb/acre) d' azote sont disponibles. L'ajout de phosphore n'améliore
pas le rendement.
Ravageurs : Dans l'est de l'Amérique du Nord,
il est sensible à une mineuse des feuilles qui peut réduire fortement le rendement de la culture. La
mineuse affecte également le quinoa et le parent proche Chenopodium album, mais C. album est beaucoup plus résistant.
Semis
: Les plants de quinoa poussent mieux dans des sols sablonneux et bien drainés
avec une faible teneur en éléments nutritifs, une salinité modérée et un pH du
sol de 6 à 8,5. Le lit de semence doit être bien préparé et drainé pour éviter
les sols gorgées d’eau.
Résistance au sel : Des études ont suggéré que la réduction
de la densité des stomates (des feuilles)
en réaction aux niveaux de salinité représente un instrument de défense
essentiel pour optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les conditions
données auxquelles elle peut être exposée.
Recherches génétiques : Grâce à la reproduction sélective traditionnelle et,
potentiellement, au génie
génétique, la plante est modifiée pour avoir un rendement plus élevé, une meilleure tolérance à la chaleur, au stress biotique et une plus grande douceur, grâce à l'inhibition de la
saponine.
Saponines et acide oxalique : Dans leur état naturel, les graines ont un enrobage,
contenant des saponines au goût amer, ce qui les rend désagréables au goût. La
plupart du grain vendu commercialement a été traité pour enlever ce
revêtement. Cette amertume a des effets bénéfiques pendant la culture, car
elle dissuade les oiseaux et, par conséquent, la plante nécessite une
protection minimale.
Bien que l'abaissement de la
teneur en saponine, par le biais d'une reproduction sélective pour produire des variétés plus sucrées et plus agréables au
goût, soit compliquée par une pollinisation croisée ≈ 10 %, c'est un objectif majeur du programmes
de sélection des quinoas, qui peuvent inclure le génie
génétique.
En Amérique du Sud, ces
saponines ont de nombreuses utilisations, notamment comme détergent pour les
vêtements et le lavage, et comme antiseptique, en médecine populaire, pour les lésions cutanées.
De plus, les feuilles et les
tiges de toutes les espèces du genre Chenopodium et des genres apparentés de la famille des Amaranthaceae contiennent des niveaux élevés d'acide oxalique. Les risques associés au quinoa
sont minimes, à condition que ces parties soient correctement préparées et que
les feuilles ne soient pas consommées en excès.
Plante clé : Selon l’ONU, en 2013, le quinoa pourrait jouer dans la sécurité
alimentaire, la nutrition et l'éradication de la pauvreté, allant dans le sens de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Mais certains commentateurs universitaires ont souligné que
la production de quinoa pouvait avoir des inconvénients écologiques et sociaux
dans ses régions d'origine, et que ces problèmes devaient être d’abord résolus.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinoa,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Quinoa
|

Quinoa, feuilles triangulaires, lobées
|

Plant de quinoa avant la floraison.
|

|
|

Champ
de Quinoa près de Cachilaya, Lac Titicaca, Bolivie.
|

Un plant de quinoa en graines.
|

Champ de
quinoa à Cusco (Pérou).
|
|

Champ-école d'agriculteurs sur l'agriculture et la production
de quinoa, près de Puno, Pérou.
|

Inflorescence.
|

Labourage d’un champ en préparation d’un semis de quinoa. Cette
pratique peut conduire à une dégradation du sol, comme le montre la maigre
performance de la culture à gauche (Chacala, Uyuni).
|
|

Récolte en Équateur
|

Gerbes de quinoa mises à sécher, près du lac Titicaca.
|

Battage du quinoa au Pérou.
|
|

Vente de quinoa real, Altiplano sud.
|

Vendeuse de quinoa au marché de Calca, Pérou.
|

Quinoa rouge, cuit.
|
|

Graines de quinoa
|

Graine de quinoa.
|

Enveloppe de la graine de quinoa noir
|
|

Fleur de quinoa
|

Intérieur d’une fleur de quinoa.
|

Taille du quinoa en millimètres
|
C’est une espèce d'aloès, cultivée
de longue date en région méditerranéenne, Afrique du Nord, aux îles Canaries et
au Cap-Vert. Utilisé depuis l'Antiquité, l’Aloe vera a été adopté
dans les médecines traditionnelles de nombreuses régions chaudes du monde,
d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord d'abord, puis d'Inde, de Chine
et d'Asie essentiellement après le xe siècle et d'Amérique après le xviie siècle. Cette plante xérophile, croissant en région sèche sur des sols arides, s'est naturalisée dans de nombreuses
régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes.
Description : L’Aloe vera est
une plante
succulente, aux feuilles persistantes, aux racines peu
profondes, poussant en touffes et même en colonies, en raison de son aptitude à
produire des drageons. La tige à base ligneuse, est courte (au plus 50 cm de haut) et porte à l'extrémité des
feuilles alternes, enchâssées les unes dans les autres, distiques (particulièrement pour les jeunes plants) puis en vieillissant
en rosette.
La feuille succulente
et sessile est érigée, vert pâle à glauque (parfois tachetée de blanc),
de forme linéaire-lancéolée, se rétrécissant régulièrement de la base à l'apex,
relativement longue (jusqu'à 10 × 80 cm, mais plus courte en Asie). L'inflorescence terminale est une grappe cylindrique, érigée, en général non ramifiée, de 100–150 cm de haut.
Utilisations : Aloe vera est largement cultivé comme
plante ornementale et plante médicinale. Actuellement, le gel d'aloès entre principalement dans la composition de
cosmétiques ou de boissons.
Utilisation culinaire
: Sa pulpe est comestible et être utilisée entre autres dans les yaourts, les
desserts et les boissons.
Usages médicinaux,
dermatologiques et cosmétiques : Il est cultivé pour l'action calmante du suc de ses feuilles coupées
appliqué sur les brûlures. Cicatrisation : plusieurs études ont montré que le gel frais obtenu à partir
de la partie centrale de la feuille diminue le processus inflammatoire et
accélère la cicatrisation.
Le suc d'aloès, par les
propriétés laxative de aloïne,
est indiqué pour le traitement symptomatique de la constipation.
Il entre dans la composition
de nombreux cosmétiques et produits d'hygiène ou pharmaceutiques.
Toxicité : La présence de dérivés hydroxyanthracéniques,
potentiellement cancérigènes et la dangerosité du latex de la plante ont été
soulignés par l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA).
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS classe l'Aloe Vera parmi les
substances possiblement cancérigènes, dans la catégorie 2B, quand elle est consommée sous forme
d'extrait de feuilles entières. La consommation excessive de la feuille
complète d’Aloe peut causer des symptômes de toxicité dus à l'aloïne. Il faut s'assurer que l’Aloe vera consommé
ne soit que la pulpe (sous forme de jus ou de gel), avec une proportion très
minime d'aloïne. Seul
le gel mucilagineux (issu du cœur de la feuille) est
véritablement bon à être consommé.
Culture : Peu exigeante en eau, elle est
facilement cultivable. L'espèce a besoin d'un terreau sablonneux bien drainé et
de conditions lumineuses et ensoleillées. Il lui faut une température
supérieure à 17°C. Elle supporte mal le gel.
Soins : Durant sa croissance, il faut
l'arroser parcimonieusement tous les 10 à 15 jours.
Maladie : Les cochenilles (amas farineux ou
caparaçonnés) apparaissent parfois sur les feuilles.
Multiplication : Bouturer les feuilles ou de jeunes
rosettes latérales en les laissant sécher auparavant plusieurs jours. Placer
dans un mélange très sableux (sable grossier) et placer à la lumière.
Aspects économiques : Selon le producteur US Farms, qui
cultive plus de 250 000 plants d’A. vera au Canada, le marché américain des
produits à l’A. vera représenterait 34 milliards de dollars, en 2008.
Les principaux pays producteurs de gel sont le Mexique, la République dominicaine
et le Venezuela. L'Asie (Chine, Thaïlande) et l'Australie fabriquent
l'essentiel du reste des produits commercialisés dans le monde.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera,
c) Ethiopie : De l’aloe vera pour l’autonomie des femmes [le trésor
des femmes éleveuses], 12/08/2021, https://sossahel.org/ethiopie-de-laloe-vera-pour-lautonomie-des-femmes/
d) Fiche de culture : l'aloès commun (Aloe vera), https://www.rustica.fr/plantes-vertes/aloes-commun-aloe-vera,5114.html
e) Risques liés à la consommation de feuilles fraîches d’Aloe vera,
Ministère des Solidarités et de la Santé, https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/risques-lies-a-la-consommation-de-feuilles-fraiches-d-aloe-vera
|
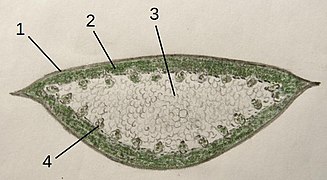
Schéma de la feuille : 1 cuticule, 2 parenchyme
chloroplastique, 3 tissu interne, 4 faisceaux vasculaires
|

Culture villageoise d’Aloe vera (Ethiopie) (SOS Sahel).
|
|

Plante avec incrustation de la fleur
|

Formes tachetées, également appelées Aloe vera
var. chinensis.
|

Fleur
|
|

Feuille et
gel intérieur.
|

Jus réalisé à partir du gel.
|

Feuille coupée.
|
|
|
|
|
Plante
herbacée assez haute aux fleurs blanches, originaire d'Europe et
d'Asie. C'est une excellente plante mellifère,
atteignant 2 m de hauteur.
Il a été utilisé en phytothérapie. Il contient du dicoumarol,
un anticoagulant. Il
a également une forte teneur en sucre.
Il a été introduit en Amérique du Nord au 17e siècle, comme plante fourragère
pour les bovins
et est maintenant répandu à travers le Canada et les États-Unis, où il est
devenu envahissant,
en particulier dans les zones riveraines, et
peut supplanter les espèces de plantes indigènes. Aux USA, les mélilots font
partie d'une communauté d'espèces exotiques envahissantes.
Il est favorisé pour la production de miel et pour sa capacité
à fixer l'azote dans la préparation des sols agricoles.
Il produit des quantités abondantes de graines qui flottent facilement
et se dispersent dans l'eau.
Un cultivar mélilot annuel (Melilotus albus Medik.)
nommé "Jota" a été mis au point en Australie. Il est destiné
aux sols neutres à alcalins où il peut être utilisé comme un légume
d'accompagnement pour le blé ou comme fourrage pour les moutons. La
zone cible doit être des sols salins qui reçoivent plus de 500 mm de
précipitations annuelles et ont un pH de 6 ou plus.
M. officinalis est apparemment plus tolérant
au sel que M. alba, bien que les deux
peuvent pousser sur des sols très alcalins.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lilot_blanc, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Melilotus_albus
c) “Jota” annual sweet clover (Melilotus
albus Medik.): a new salt tolerant legume for the high rainfall
zone of southern Australia, Pedro Evans & AN Thompson, 2006, http://www.regional.org.au/au/asa/2006/poster/soil/4423_evansp.htm,
d) http://wiki.bugwood.org/Melilotus_officinalis
|

|

|

Mélilot blanc, aspect général.
|
Plante
herbacée assez haute aux fleurs jaunes, originaire d'Europe et d'Asie.
Le mélilot jaune est une plante annuelle ou bisannuelle de 10 à 50
centimètres de hauteur (rarement un mètre), avec des fleurs jaunes. On le
trouve dans les jardins, les bords de routes, les champs, les lieux incultes,
les lieux perturbés, les marais salants côtiers, les zones humides d'eau douce,
les habitats riverains et les champs cultivés.
Il a une aire de répartition naturelle large, allant de la
Macaronésie et le nord de l'Afrique ,
à travers l'Europe, et en Asie tempérée et tropicale. Elle est naturalisée
dans la plupart du reste du monde, y compris le Royaume-Uni,
le Etats-Unis, Amérique
du Sud, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande.
Il est utilisé comme une source de nectar pour les abeilles, comme
fourrage, et comme amendement de sol. Il est également utilisé dans la
médecine traditionnelle. Il est toxique pour certains mammifères (chiens
…). Les feuilles séchées peuvent être toxiques, bien que les feuilles fraîches
soient tout à fait sûres. Cela est dû à la présence de coumarine.
En tant qu’adventice, il a un potentiel contaminant dans les cultures
de semences.
Melilotus indicus (L.) All., ou mélilot jaune, qui se
reproduit comme une mauvaise herbe dans les différents habitats en Egypte, pousse
dans les zones modérément salines, où les légumineuses fourragères
traditionnelles ne peuvent pas être cultivées.
Des cultivars à faible teneur en coumarine ont été développés et
sont souvent cultivées comme plante fourragère.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Melilotus_indicus,
b) https://www.kau.edu.sa/Files/857/Researches/58292_28460.pdf
c) http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Melilotus+indicus
d) http://www.feedipedia.org/node/273
La luzerne cultivée ou alfalfa ou alfa-alfa,
aussi appelée « grand trèfle » ou
« foin de Bourgogne », est une plante herbacée fourragère de la famille des fabacées, riche en
vitamines et en sels minéraux et utilisée en diététique.
Cette vivace par
ses tiges souterraines ramifiées, de 30 à 80 cm de hauteur,
originaire de l'ouest de l'Asie (Afghanistan, Iran, Turquie), est très cultivée
pour sa richesse en protéines (pour
un taux compris habituellement entre 15 et 25%) et ses qualités d'amélioration
des sols.
Abondamment répandue dans les contrées tempérées, tant à l'état sauvage que
cultivée, la luzerne est très utilisée pour l'alimentation du bétail car elle
est une véritable source industrielle de protéines et de carotène. Elle préfère
les climats de type méditerranéen, mais se présente à l'état subspontané, dans
tous les continents, dans les régions tempérées, jusqu'à 2 000 m
d'altitude environ. La luzerne nécessite un sol sain,
au pH neutre.
L'inoculation des semences avec une bactérie du
type Rhizobium (par
exemple Rhizobium meliloti) est recommandée.
La luzerne a des pathogènes ou des prédateurs naturels (autochtones ou
importés) peu actifs chez la luzerne sauvage, mais qui en contexte de culture
intensive peuvent poser problème : Fonte de semis, Pythium ; Verticilliose, jaunisse
et nanisme, Verticillium albo-atrum ; Dessèchement de plantes
isolées, Sclerotinia trifoliorum ; Anthracnose de la
luzerne, Colletotrichum trifolii ; Ascochytose, Ascochyta
pinodella, taches brunes sur tiges et feuilles. etc.
Des cultivars de luzerne _ Luzerne CkSltn 15-2, 11-1 BC79,
DK166 _ résistent mieux au sel, jusqu’à 4,0 dS m-1 (+).
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Luzerne_cultiv%C3%A9e,
b) Agronomic, physiological, and molecular
characterization of salt tolerant alfalfa, W Mott, MD
Peel, M. Anower et Y. Wu, http://www.naaic.org/Meetings/National/2012meeting/T6-Mott.pdf (+)
c) Effects of salinity and drought stress
on germination, biomass and growth in three varieties of Medicago sativa L.,
Castroluna, A.; Ruiz, O. M.; Quiroga, A. M. y Pedranzani, H. E., http://www.ucol.mx/revaia/portal/pdf/2014/enero/4.pdf
|

M. sativa sativa: fruit en hélice senestre.
|

Fleurs violettes.
|

Champ de Luzerne.
|
|

|

Fleurs blanches et jaunes.
|

Champ de Luzerne (Medicago sativa).
|
Vétiver désigne plusieurs espèces du genre Chrysopogon. La
plante se présente sous forme de grandes touffes vertes, dont la racine, se développant
verticalement, peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à trois
mètres.
La racine de
vétiver distillée fournit une essence résineuse très épaisse utilisée en parfumerie.
Les haies de
vétiver permettent également aux sols de conserver leur humidité, stabilisent
les digues, réhabilitent les terrains vagues et peuvent même empêcher la pollution des ressources
naturelles. Très peu cher, résistant à la plupart des maladies, le vétiver peut
être planté y compris dans les terrains peu humides, contrairement à ce que
l'on croyait auparavant.
Le vétiver permet aussi d'obtenir à peu de frais du chaume et de la paille, et peut aussi servir
d'aliment pour le bétail.
Elle sert de plante médicinale dans le traitement de certaines
affections de peau et les fagots, de ses racines, d’insecticide.
Son système racinaire massif et bien structuré atteint une profondeur
de 2 à 3mètres au cours de la première année. Ce réseau racinaire massif et
épais fixe les sols et les compacte de la manière la plus solide. Ce réseau
de racines très profondes confère également au Vétiver une grande tolérance à
la sécheresse comme cela a été prouvé lors de la pire sécheresse survenue
dans la province du Queensland, en Australie, au début des années 90 : la
plante n’a pas seulement survécu mais elle a continué de pousser. En outre, le
Vétiver dispose de caractéristiques enviables telles que :
Une tige rigide et droite, pouvant résister à des niveaux d’eaux
courantes (de 0,60 à 0,80 m).
Constituer des haies très denses; lorsque les plants sont rapprochés,
réduisant ainsi la vitesse des eaux de ruissellement et constituant des filtres
très efficaces.
De nouvelles pousses émergent de la base, résistant ainsi aux
piétinements et à la pression du broutage.
De nouvelles racines se développent à partir de modules contenus dans
les terres arables piégées. Le Vétiver continue de pousser sur les nouveaux
niveaux du sol, formant éventuellement des terrasses, si la terre arable piégée
n’est pas enlevée.
Une tolérance à des variations climatiques extrêmes, des périodes
prolongées de sécheresse, d’inondation, de submersion et des températures
extrêmes allant de –10°c à 48°c (en Australie) et même plus élevées en Chine,
en Inde et en Afrique.
Une capacité à repousser très rapidement après avoir été affecté par
la sécheresse, le gel, la salinité et autres conditions défavorables des
sols et ce, dès que cessent ces effets défavorables. C’est une plante pionnière
pour les terres à problèmes.
Une gamme étalée de pH du sol (de 3.0 à 10.5).
Un niveau de tolérance élevé à la salinité des sols et à leur
teneur en sodium et acide sulfurique.
Par contre, il ne supporte pas l’ombre et le manque de lumière.
L’ombrage réduit sa croissance.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9tiver,
a) Protection des infrastructures par le vétiver, Paul Truong, Traduction par
DynaEntreprises (Dakar), http://www.vetiver.com/TVN_infra_fr.pdf,
b) manuel technique application du système vétiver, http://www.vetiver.org/TVN_French%20manual%20v1opt.pdf
|
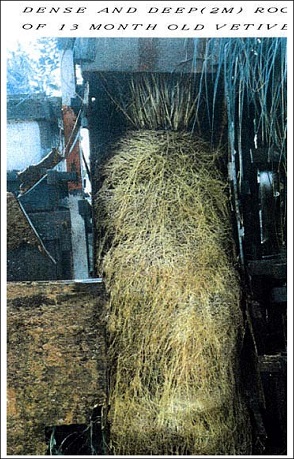
Racines denses et profondes (2 mètres) d'un vétiver de 13
mois.
|
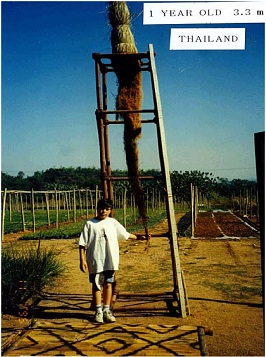
Racines d’un an : 3,3 m
|
|

Coupe verticale sur un remblai montrant une croissance
racinaire de 3,6m pour un vétiver de 8 mois.
|


Projet de haies de vétivers anti-érosion, au Sénégal.
|
Pour lutter
contre l’érosion, mieux vaut utiliser le vétiver que le figuier de barbarie :
|

↑ Cette photo, montrant des cactus [des figuiers de barbarie,
semble-t-il] plantés dans le cadre d’un projet de la FAO en Tunisie, a été
prise en 1970 pour illustrer les mesures de lutte contre l’érosion.
Actuellement, la FAO conduit un programme destiné à restaurer 12 000 hectares
de terres dégradées, à l’aide de techniques similaires.
|


|
|
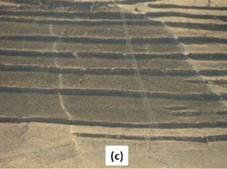
|
Observation :
Or à cause du caractère invasif des figuiers de barbarie, il aurait
mieux valu planter du « vétiver noir » (Chrysopogon
nigritanus)
(voir pages suivantes sur cette espèce de vétiver, résistant à la
sécheresse). A moins que la zones de plantation soit très aride et sèche,
avec des périodes de sécheresse longues de 6 à 10 mois et des précipitations
de 100 mm-300 mm.
|
Elle mesure de 1 à 2,5 mètres de haut. Elle est originaire d'Asie. Elle est naturalisée dans
d'autres régions (sub-)tropicales, notamment aux États-Unis. Elle est
notamment cultivée en Inde et dans l'île de la Réunion.
Cette espèce est utilisée pour lutter contre l'érosion du sol et n'est
en aucun cas invasive. On extrait de la racine de cette plante par distillation à la
vapeur une huile
essentielle aromatique à l'odeur forte et tenace utilisée en
parfumerie ou savonnerie. Elle est d'ailleurs parfois qualifiée de
« faux-patchouli ». Elle sert de note de fond aux parfums ou à
préserver les vêtements de laine ou de fourrure des attaques des insectes.
Cette espèce est la principale espèce de vétivers.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysopogon_zizanioides,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysopogon_zizanioides,
c) Le vétiver (Chrysopogon
zizanioides) une méthode de conservation des sols, http ://www.vetiver.com/TVN_GreenFrench.pdf

Le vetiver noir, est une espèce d’herbe
vivace (de la famille Poaceae). Plus
précisément, Vetiveria nigritana est un type d’herbe très
dense et de grande taille, profondément enracinée dans le sol et est
généralement utilisé pour protéger les cultures et empêcher l’érosion
des sols [1]. Vetiveria
nigritana est également une espèce indigène à l'Afrique et est le plus
souvent observée au Nigeria , Afrique
du Nord , Afrique
de l'Est et les régions tropicales de l’Afrique
du Sud.
En outre, la plante, comme d'autres vétivers,
a été utilisé dans ces régions en raison de son extrême tolérance
à la sécheresse, sa capacité à croître dans le sol infertile et le fait
qu'il peut vivre sous la submersion complète. En fait, Vetiveria
nigritana peut prospérer dans un très large éventail de conditions
environnementales et climatiques.
Vetiveria nigritana est une plante très bénéfique
dans l'agriculture
de subsistance, en particulier en Afrique, en raison de sa capacité à
préserver les sols et à réduire le ruissellement de l'eau, finalement en
corrélation avec des rendements plus élevés. En outre, la plante est
également bénéfique dans la protection des récoltes stockées et les plantes,
parce que la plante peut être utilisé comme un répulsif ou un moyen de détruire
les larves de parasites avant qu'ils aient la capacité d'influer sur le stock
d'un agriculteur. Vetiveria nigritana a également diverses
applications médicales rentables pour les agriculteurs de subsistance et peut
être utilisé comme alimentation pour maintenir l’élevage en
l'absence d'autres aliments les plus courants.
Source : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysopogon_nigritanus
Cette espèce de vétiver indigène est très répandue dans les montagnes
de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam et le plus probable au Cambodge et au
Myanmar ainsi. Il est largement utilisé en Thaïlande pour faire de la
chaume. Cette espèce n'est pas stérile, les principales différences
entre C.nemoralis et C. zizanioides, sont que
cette dernière est beaucoup plus grande et plus dense et possède des tiges
raides. C. zizanioides a un système racinaire beaucoup plus épais et
plus profond et ses feuilles sont plus larges et a une superficie vert clair le
long du milieu des côtes, comme indiqué sur les photos.
Source : a) http://www.vetiver.org/TVN-Handbook%20series/TVN-series1-1-vetiver%20plant.htm
|

Différence entre les racines de C. zizanioides (supérieure)
et C. nemoralis (en bas).
|

|
|

C. nemoralis à Quang Ngai (Vietnam).
|

Feuilles de vétiver, graines.
|

Feuilles de vétiver : C nemoralis (en
haut), C. zizanioides (en bas)
|
|
|
|
|
C’est une céréale sauvage,
une plante vivace rhizomateuse, autrefois très
répandue aux États-Unis,
présente sur tout le territoire (sauf sur la frange littorale du Pacifique) (famille des Poaceae).
Herbacée consommée par les bisons nord-américains.
Elle est très rustique, adaptée à de nombreux sols (sableux, graviers
…) et climats (ubiquiste),
Le Gouvernement des États-Unis la considère depuis 2006 comme une
source potentielle d'agrocarburant, plus respectueuse de l'environnement que
d’autres, et qui pourraient réduire la dépendance des États-Unis à l'égard
du pétrole. Parce
que très efficace pour produire de grandes quantité de cellulose, cette poacée
pourrait constituer une source alternative de pâte à papier ou selon plusieurs
études récentes publiée en 2008 une source intéressante d'agrocarburants; grâce à
un bilan écologique et énergétique bien meilleur que celui du maïs selon
Hen Vogel et ses associés (il produit 540% d'énergie par rapport à l'énergie
fournie pour le produire), en tant que source d'éthanol
cellulosique. Elle offre un abris et favorise le développement du
gibier.
Son système racinaire très développé, sa hauteur et sa croissance
tardive lui permettent de bien protéger les sols contre l'érosion par le vent
et l'eau tout en conservant un bon ensoleillement pour d'autres espèces
plus printanières.
Habitats : prairies sauvage, le long des chemins ruraux et pâturages. Ses touffes
atteignent 1.8 à 2.2 m de haut.
Elle résiste à la sécheresse et
aux hautes températures. Multiplication : graines (elle
s’auto-ensemence).
Cette plante est considérée comme un puits de carbone et
réputée capable de "pomper" une partie des métaux lourds du sol. Certaines
variétés de cette plante sont résistantes au sel (mais pas toutes).
Tolérance au sel modérée (tous les cultivars), limite supérieur des
pH 7,5.
Le panic érigé est une adventice parfois utilisée comme plantes fourragères de
moyenne qualité ou comme plante ornementale.
Elle peut provoquer photosensibilité et
des dommages au foie, chez les chevaux, les moutons et les chèvres.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Panicum_virgatum, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Panicum_virgatum,
c) Evaluation of Salinity Tolerance and Genetic Diversity of Thirty-Three
Switchgrass (Panicum virgatum) Populations, BioEnergy
Research, May 2014. d) Relative Salt Tolerance of Switchgrass
(Panicum Virgatum), www.etaflorence.it/proceedings/?detail=6773
|

Système racinaire de panic cultivé au Land
Institute.
Le système racinaire très dense de P. virgatum contribue
à fixer le sol et à y améliorer les interactions sol-racines-microbes ainsi
que la circulation verticale de l'eau et son épuration. Cette plante a pour
cela été expérimentalement réintroduite, avec succès dans
certaines zones-tampon à
vocation d'épuration des eaux et des sols en milieu agricole aux États-Unis.
|

Panicum virgatum peut atteindre une taille
importante.
|
Originaire d'Amérique du Nord (régions côtières le long de la côte Est
et la côte du Golfe des Etats-Unis et dans le nord-est du Mexique, Bahamas et
à Cuba),
cette plante vivace à rhizome,
a des tiges jusqu'à 2,5 mètres de haut et est couramment utilisé pour dune projets
de stabilisation. Elle est utilisé pour prévenir l'érosion.
Les racines poussent à six pieds de profondeur.
La variété Panicum
amarum 'Dewey Blue‘ est
tolérante à la sécheresse et au sel.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Panicum_amarum,
b) http://www.bluestem.ca/panicum.htm
C’est une espèce de plante herbacée de
la famille des Poaceae, graminée à rhizome caractéristique des
lieux humides des régions méditerranéennes. Elle a de grandes feuilles
effilées, retombantes, glauques, et des panicules terminales d'épillets de
couleur vert pâle à violacé. Elle ressemble à un roseau ou à un bambou, avec ses tiges creuses
de 2 à 3 cm de diamètre, notamment avant l'apparition des épillets. Sa hauteur
varie de 1 m à 8 m selon les variétés et les conditions de culture .
Avec l'hiver elle prend un aspect desséché.
Même si elle supporte très bien la sécheresse une fois installée, la
canne de Provence se cultive idéalement sur terrains humides et bien drainés.
Elle peut avoir tendance à devenir invasive si les conditions sont adaptées.
Elle se multiplie par prélèvement de rhizomes au printemps ou par bouturage dans l'eau. rundo
donax est assez rustique une fois installée (jusqu'à -10 °C pour les
chaumes et -15°C pour les rhizomes) et est peu sensible aux parasites ou
maladies. Elle se plaît en situation abritée et bien ensoleillée, avec un sol
humide et plutôt sablonneux, mais bien drainé l'hiver. Elle supporte la
salinité des sols.
Sur le plan industriel, la canne de Provence est l'une des cultures les
plus prometteuses pour la production de bioénergie sous climat
méditerranéen où elle est déjà adaptée à l'environnement, donne des rendements
importants et durables, et résiste à des périodes de sécheresse. Plusieurs
études sur le terrain ont mis en évidence ses faibles besoins en travail du sol, engrais et pesticides. Elle a l'avantage
de ne pas rivaliser avec les cultures alimentaires car ses faibles besoins lui
permettent de pousser là ou aucune culture alimentaire ne serait envisageable.
En outre, Arundo donax offre une protection contre l'érosion des sols, l'un des
processus les plus importants de dégradation des terres dans le bassin
Méditerranéen. A. donax a un potentiel impressionnant pour plusieurs processus
de conversion en matières premières bioénergétiques. Ce roseau peut aussi
alimenter l'industrie de la pâte à papier.
Sa chaume était utilisée pour couvrir toitures, ses tiges comme tuteurs, cannes
à pêche, pour la fabrication de toutes les anches de tous les instruments à
vent (à anche), pour le palissage, le treillages à faire des paniers et des
claies ou panneaux utilisées comme panneaux décoratifs et pare-soleil. Jeune,
il peut servir de fourrage, de faible appétence.
Sources : a) http://nature.jardin.free.fr/vivace/mc_arundo_donax.htm,
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Arundo_donax
c) http ://www.feedipedia.org/node/502
L'alfa est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, originaire de l'ouest du bassin
méditerranéen. C'est
une plante
herbacée vivace qui pousse dans des régions arides et qui
sert notamment à fabriquer des papiers d'impression de qualité. Par
extension, le terme « alfa » ou « alfamousse » désigne
aussi le papier fabriqué à partir de cette plante. L’alfa pousse dans des
sols secs, rocheux et basiques.
C’est une plante
cespiteuse (poussant en touffes) aux tiges dressées de 60 à 150 (voire 200) cm
de long. Le limbe foliaire (la feuille), de 30 à 120 cm de long sur 1 à 3 mm de
large, est enroulé sur lui-même, pubescent et se termine en pointe dure.
L'inflorescence est une panicule contractée de 25 à 35 cm de long.
L'alfa pousse en touffes
d'environ un mètre de haut, formant de vastes « nappes » dans les
régions d'aridité moyenne. La plante couvre notamment de vastes zones des hauts
plateaux algériens. Son aire
de répartition s'étend
en Afrique du
Nord, du Maroc à
la Libye, et en Europe du Sud (Espagne (dont les Baléares), Italie, Portugal, France
(dont lCorse)), ainsi que dans les îles de Macaronésie (archipels des Açores et de Madère, des îles Canaries, des îles du Cap-Vert).
Utilisations : Les
graines germées d'alfa peuvent être consommées par l'homme. Les plus
jeunes feuilles d'alfa peuvent être pâturées par les chevaux, les dromadaires, mais
la plante est trop riche en lignine pour constituer un fourrage pour
les autres herbivores. Cette plante présente également un intérêt écologique
pour lutter contre l'érosion dans les régions de
steppes arides.
L’alfa a été géré par des hommes pendant des siècles.
L'alfa
est une plante utilisée pour ses fibres. On
en tire une pâte à papier recherchée. Les
fibres tirées de ses feuilles peuvent, une fois filées, s'employer pour la
fabrication de cordages, filets, espadrilles. Au printemps, la feuille est
tressée pour confectionner divers objets de sparterie : paniers,
nattes, couffins, passoires... Il existe aussi une
fabrication de tapis traditionnels en Alpha (Algérie) qui méritent d'être
valorisés dans le cadre d'une revitalisation des territoires ruraux. Source :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Stipa_tenacissima
|

|

Peuplement
d'alfa sur le littoral espagnol à Marina de Cope (Murcie).
|
|

Graines
|
|
Cette plante, de la famille des Géraniacées, produit des
tubercules comestibles, légèrement sucrés, dans le désert. Son aire de
répartition naturelle s'étend de l'Afrique du Nord à Israël. Elle n’est pas une
succulente.
Dans les déserts d'Arabie et du Sahara, on peut trouver cette très
belle plante dont les fleurs s'ouvrent tôt le matin.
Erodium crassifolium, « décore » les pentes nues des
collines pendant quelques heures mais laissera tomber ses pétales avant midi.
La floraison a lieu entre janvier et avril, avec un pic de mi-février à mars.
C'est une plante vivace, qui produit de petits tubercules racinaires,
sur ses racines fibreuses. Cette structure lui permet de croître et de fleurir
les années avec suffisamment de pluie, tout en restant sous terre les années
sèches.
Les feuilles sont peu nombreuses, souvent poilues et charnues. Les
populations les plus au nord ont des feuilles glabres. Les fleurs varient en
couleur du rose au violet avec une tache noire frappante au centre, la taille
de cette tache variant selon les plantes. Cette tache contraste nettement avec
le pollen très orangé.
Les graines portent une arête en forme de plume qui les aide à se
disperser par le vent et à la fin de la saison des pluies, on les trouve
presque n'importe où sur le sol, entre les rochers et les pierres.
En Israël, c'est une plante commune dans toute la partie sud et aride
du pays. L'espèce se trouve généralement sur les pentes pierreuses, les bords
de plans d’eau (lacs …) et les plaines.
Les carpelles
de ces plantes ressemblent à la tête et au bec d'un héron, d’où le nom de la
plante.
Sources : a) Erodium crassifolium, a Unique
Desert Species, Dr. Ori Fragman-Sapir, Head Scientist, Jerusalem Botanical
Garden, Israel, https://www.botanic.co.il/wp-content/uploads/2017/12/Erodium_crassifolium_2009.pdf
b) Assessment of the Nutritional and Medicinal
Potential of Tubers from Hairy Stork’s-Bill (Erodium crassifolium L’Hér), a
Wild Plant Species Inhabiting Arid Southeast Mediterranean Regions, Shabtai
Cohen, Hinanit Koltai, Gopinath Selvaraj, Moran Mazuz, Moran Segoli, Amnon
Bustan and Ofer Guy, 20 August 2020, Plant Biodiversity and Genetic Resources,
Volume 9, Issue 9, https://www.mdpi.com/2223-7747/9/9/1069/htm
c) https://flora.org.il/en/plants/EROCRA/, d) http://www.flowersinisrael.com/Erodiumcrassifolium_page.htm
|

Desert Stork’s bill — Erodium crassifolium.
(Eitan Ferman, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
|

Gros plan sur les fleurs.
© Dr. Ori Fragman-Sapir
Lieu de la prise de vue : partie centrale du désert du Néguev dans le
sud d'Israël, à une altitude de 600 m sur le mont Retamim.
|

Les tubercules. © Flora of Israel.
|
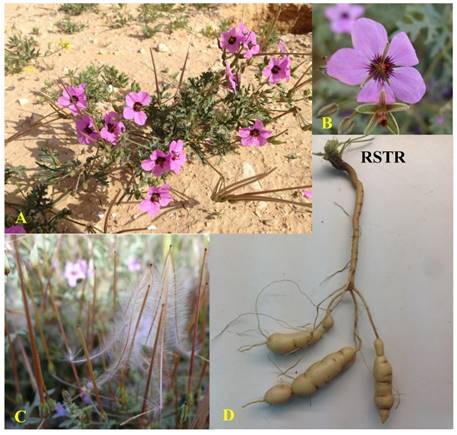
Figure 1. "Bec-de-héron velu" [Hairy
stork’s-bill] (E. crassifolium). (A) Buisson à fleurs et gousses; (B)
fleur; (C) graines avec des arêtes velues ressemblant à des plumes; (D)
tubercules racinaires, reliés à la région de transition racine-pousse (RSTR),
l'organe de la plante vivace.

Le nara est une
espèce de melon sauvage (famille des Cucurbitacées) qui pousse dans
des régions désertiques de Namibie. L’aire de répartition du nara est limitée à la partie côtière
du désert du Namib où il pousse exclusivement dans les dunes de sable, des lits
de rivières asséchés la plupart du temps, où de l’eau est disponible sous la
surface. La plante se présente sous forme de buisson épineux plus ou
moins dense. Seules les jeunes tiges présentent des feuilles, les plus âgées en
sont dépourvues. Un pied de nara peut vivre 100 ans et couvrir jusqu'à
1 500 m2.
Sa longue racine pivotante va chercher l'eau dans la nappe
phréatique. Si le nara est recouvert par du sable
apporté par les vents, il est capable de se dégager et de poursuivre sa
croissance. Ce melon comestible, à l’écorce coriace et épineuse, pèse
environ 900 g. A maturité, il a un goût acidulé
délicieux.
Les fruits du nara sont
récoltés par les populations locales et notamment les Topnaar, de février à
avril et août à septembre. Chez les Topnaars, chaque famille de la basse vallée
du Kuiseb à proximité de Walvis Bay possède un certain nombre de sujets qui sont considérés comme
propriété privée, ce qui n'est pas le cas de la terre où ils poussent. Une
famille n'a le droit de récolter que les plantes qui lui appartiennent. Les
besoins écologiques très particuliers de la plante ne permettent pas de la
cultiver, mais des recherches en ce sens sont en cours en Namibie. Des scientifiques collaborent avec les Topnaars pour
développer de façon durable les populations existantes de nara. Certaines
populations tirent une sorte de bière à
partir du fruit. D'autres utilisent les racines pour élaborer des médicaments.
Les nombreuses graines du fruit peuvent être consommées sèches (un peu comme
des noix). On peut aussi en tirer de l'huile. Les fruits du nara sont récoltés
par les populations locales et notamment les Topnaar, de février à avril et
août à septembre. Les fruits sont également consommés par les hyènes et les chacals. Un insecte de genre cigale, Diadematus acanthoproctus se nourrit de la plante, en se déplaçant la nuit entre les
différents buissons.
Le melon nara peut
aider à fixer les dunes. Le nara est souvent orthographié !nara,
à cause de la langue à clic locale.
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthosicyos_horridus,
b) https://uses.plantnet-project.org/fr/Acanthosicyos_horridus,
c) https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Acanthosicyos+horridus+Welw.+ex+Hook.f.
d) Strategies of Acanthosicyos horridus (!nara) to exploit
alternative atmospheric moisture sources in the hyper-arid Namib Desert [Stratégies
d'Acanthosicyos horridus (!nara) pour exploiter d'autres sources d'humidité
atmosphérique dans le désert hyper-aride du Namib], M. Gerber, S. Piketh, E.
Marais, South African Journal of Botany, Volume 109, March 2017, Pages
335-336, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629917301618?via%3Dihub
|
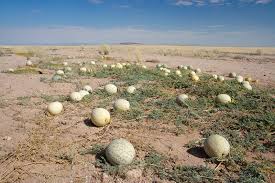
|

|

Fruit épineux.
|
|

|

Fruits en développement sur une plante femelle.
|

Fleur mâle, épines et tige. © Plantnet project.
|
|

Les fruits mûrs d'A. horridus sont récoltés par la communauté
locale de Topnaar pour la consommation ou les graines sont vendues et
constituent une source de revenus (crédit : Reyk Borner).
|

|
|
|
|
|
|
|
L’ers ou vesce amère, est une légumineuse
à graines et plante fourragère, anciennement cultivée, de la région méditerranéenne.
Noms : bitter vetch (Anglais), gavdaneh (persan), kersannah
(arabe), yero (espagnol), rovi (grec), et Burçak (turc).
Elle continue à être cultivée, à cause de sa valeur nutritive pour les
ruminants, au Maroc,
en Espagne
et en Turquie.
La plante est facile à cultiver et à stocker et peut être cultivée sur des
sols alcalins très peu profonds ou salins (jusqu’à 12 grammes de sel /litre
d’eau).
Le grain fendu ressemble à une lentille
rouge. Pour la consommation humaine l'amertume des graines doit être enlevé par
lessivage avec plusieurs changements d'eau bouillante. En raison de cette
amertume, il est peu probable que quelqu'un puisse accidentellement confondre
cette vesce avec les lentilles rouges. Selon Zohary et Hopf, seuls les humains
des classes économiques les plus pauvres consomment cette culture, ou en temps
de famine.
Ses grains constitue un excellent aliment concentré pour ovins et les
bovins. Il a été tenu en haute estime par les agriculteurs dans le Vieux Monde,
depuis le début de l'agriculture, pour améliorer la valeur nutritionnelle des
aliments en vrac.
Pline
l'Ancien stipule que la vesce amère (Ervum) a une valeur médicinale,
comme la
vesce (Vicia), citant les lettres d’Auguste,
où l' empereur
a écrit qu'il a retrouvé sa santé grâce à un régime à base de vesce amère (NH
18.38).
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Vicia_ervilia
L’algoculture ou phycoculture désigne
la culture en masse des algues dans un
but industriel et commercial. Ce domaine concerne aussi bien les micro-algues (également
appelées phytoplancton, microphytes, algues planctoniques) que les macro-algues (que l’on
désigne aussi par le terme goémon en
français).
Le but de
cette activité aquacole est de produire aussi bien des aliments (pour la
consommation humaine ou animale), des compléments alimentaires, des produits
vétérinaires et pharmaceutiques, des cosmétiques, des
matières bioplastiques, des fertilisants ou encore
des sources d’énergies renouvelables (algocarburant, biogaz) ou en phytoremédiation. Des
usages plus récents portent sur les nanobiotechnologies ou
bien le génie génétique.
Selon la
FAO, 145 espèces d’algues seraient régulièrement consommées dans le monde.
Sauvages ou cultivées, elles sont utilisées directement ou indirectement sous
forme de compléments alimentaires ou d'additifs.
Depuis le développement de l'algoculture et de la mariculture pour beaucoup d'espèces d'intérêt commercial,
elle est devenue largement plus importante que la cueillette : 14,8 millions de tonnes produites en 2005
contre 1,3 million de tonnes collectées. La quasi-totalité de ces cultures se
fait en Asie. En 2005, les algues brunes sont les macro-algues les plus
cultivées (7,8 millions de tonnes), suivies des algues rouges (4,8 millions de
tonnes). Les algues vertes ne représentent alors que 13 000 tonnes. L'essentiel
de la production se fait en Asie.
Les algues brunes les plus cultivées sont Saccharina
japonica (4,9 millions de tonnes par an) et Undaria
pinnatifida (2,7 millions de tonnes par an). Parmi les algues rouges,
les plus cultivées sont Pyropia tenera (1,39 million de
tonnes), Euchema sp. (1,38 million de tonnes) et Gracilaria
sp. (1,03 million de tonnes).
Leur production est écoulée principalement sous forme
d'aliments pour les marchés de la Chine et la Corée du Sud et du Japon. Elles
sont aussi cultivées pour leurs phycocolloïdes : les carraghénanes extraits de l'algue rouge Chondrus crispus servent
de gélifiants, de même que l'agar-agar. Les carraghénanes sont utilisés dans diverses
applications commerciales comme la formation de gels, agent d'épaississement et
de stabilisation, en particulier dans les produits alimentaires tels que
desserts glacés, lait chocolaté, cottage cheese, crème fouettée, produits instantanés, yaourts, gelées,
aliments pour animaux et sauces. Les carraghénanes sont aussi utilisés dans des
formulations pharmacologiques, cosmétiques, et dans des applications
industrielles comme l’extraction minière.
« Les carraghénanes générés par les algues rouges
Kappaphycus alvarezii représentaient, en 2009, un marché annuel de 527 millions
USD avec une production annuelle totale de 50.000 tonnes ».
Elles sont aussi utilisées comme tourteaux pour l'alimentation animale.
Dans cet
ouvrage nous n’aborderons que la culture des macro-algues, en eau salée, en
pleine mer et en bassin, en culture de masse, dont celles cultivées dans des « champs marins », comme
les algues brunes Laminaria japonica (4,9 millions de tonnes
par an) et Undaria pinnatifida (2,7 millions de tonnes par an).
« Outre les retombées économiques, la culture des
algues constitue une alternative à la surpêche et présente de grands avantages
environnementaux. Les algues aident à désacidifier les eaux océaniques en
éliminant le carbone et créent un environnement sain dans lequel les
coquillages prospèrent ».
« A
Madagascar, les algues sont cultivées en utilisant la technique “off-bottom” ou
“piquets- cordes”. Cette technique est la plus communément utilisée de par le
monde et reste simple à mettre en place, peu coûteuse et efficace.
Ces
algues ont un mode de reproduction végétatif. Le fermier sélectionne des
boutures d’environ 100g qu’il viendra ensuite fixer sur une corde à l’aide d’un
système appelé “Made Loop” du nom de son inventeur. Les cordes bouturées sont
ensuite tendues entre deux piquets de bois solidement enfoncés dans le sable et
positionnées au-dessus du substrat. L’ensemble des cordes bouturées formant des
champs de culture bien ordonnés dans l’eau disposés et orientés dans des sites
spécifiques propices à l’algoculture. Le cycle de culture varie entre 30 et 45
jours selon la saison et la taille des boutures, période durant laquelle le
fermier passe dans ses champs à marée basse, pour effectuer les travaux
d’entretien nécessaire au bon développement de ses algues. Le fermier récolte
donc les algues matures à marée basse qu’il mettra ensuite à sécher sur des
tables, en s’assurant d’en conserver une partie pour le renouvellement de ses
cultures. Une partie du travail s’effectue à terre avec le séchage et la mise
en sac des algues après contrôle. L’algoculture est véritablement un métier à
part entière, rythmé par le cycle des marées.
C’est une
activité difficile, soumise aux conditions climatiques qui apportent leur lots
de désagréments (cyclones, algues parasites, ice-ice
…) mais c’est une activité qui offre aussi de nombreux avantages et bienfaits
pour les fermiers et l’environnement ».
Pour mention : C’est une espèce d’algue brune marine, de
mers froides, rangée sous le genre Saccharina en 2006, majoritairement cultivée en Chine, au Japon, et en Corée du Sud. C’est une des espèces commercialisées sous le nom
de konbu. S. japonica est aussi
appelé ma-konbu en japonais, dasima en coréen et hǎidài en chinois.
L'espèce a été cultivée en Chine, au Japon, en Corée, en
Russie et en France. C'est l'une des deux espèces de varech les plus consommées en Chine
et au Japon. Saccharina japonica est également utilisé pour la
production d'alginates, la Chine produisant jusqu'à dix mille tonnes de produit
chaque année. De grandes récoltes sont produites par la culture de cordes qui
est une méthode simple de culture d'algues en les attachant à des cordes
flottantes dans l'océan.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharina_japonica, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharina_japonica

Pour
mentions : C’est une espèce d'algues brunes, de mers
froides, de la famille des Alariaceae. C'est
une des macroalgues qui est commercialisée sous le nom de wakame,
proposée comme ingrédient alimentaire (par exemple dans des pâtes). Elle aurait
des propriétés médicinales : Certains des composants moléculaires (Fucoxanthines) de
cette algue auraient un effet anti-obésité et anti-tumoral. Cette algue
contient aussi une peptide qui est un Antihypertenseur. Elle
contient aussi une molécule qui présente des propriétés antivirales, qui
pourrait peut-être permettre de mieux lutter contre l'herpes simplex virus.
Cette
espèce d'origine asiatique a été volontairement ou involontairement introduite hors
de son aire naturelle de
répartition, elle est aujourd'hui par exemple trouvée dans des zones aussi
variées que l'Europe (observée depuis le début des années 19901 de la Bretagne au
littoral sud-anglais) , la Tasmanie et
Nouvelle-Zélande ou en Argentine. Elle est
signalée depuis le début des années 2000 dans le pacifique nord. Selon une
étude faite en Tasmanie, là où elle est introduite, elle s'installe plus
facilement dans les environnement déjà perturbés par l'homme. Cette espèce pourrait aussi être étudiée pour extraire
certains polluants de l'eau (cuivre et nickel par
exemple, par biosorption).
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Undaria_pinnatifida,
|

Undaria pinnatifida (ici en Australie
où elle a été introduite).
|

|

|
|

Wakame
|

Wakame bouilli (cuit).
|

|
Pour mention : C’est une espèce d'algue rouge du genre Pyropia,
de mers froides à tempérées (voire chaudes). Le nom spécifique, tenera,
signifie "délicat" et fait allusion à sa petite taille. Il
atteint généralement des longueurs comprises entre 20 et 50 cm. On le
trouve le plus souvent dans l'océan Pacifique occidental et l'océan Indien.
Au Pays de Galles et
au Japon, P. tenera (et P.
yezoensis) est un composant
principal de la nourriture à base d'algues séchées et est activement cultivé
depuis l'Antiquité. C'est un ingrédient de choix dans les sushis. Au Pays de Galles (et dans
une certaine mesure, en Angleterre), il est utilisé dans la nourriture traditionnelle, le laverbread.
Habitat : L'espèce habite les
rochers, et parfois même s'installe sur des mollusques et d'autres espèces
d'algues. Elle habite entre les niveaux de marée, de la mi-marée à la zone
d'éclaboussure. Elle est généralement abondante, surtout sur les côtes
exposées.
L'algue s'épanouit en hiver à des températures comprises
entre 4 et 9°C. La température chaude de l'eau limite sa distribution dans les
régions tropicales. Distribution : Pacifique nord-ouest : Japon,
Chine. Océan Indien : Maurice.
Comme de nombreuses espèces d'algues comestibles, elle est sensible à l'infection par l'oomycète parasite Pythium porphyra.
Culture : Les pêcheurs ont
planté du bambou dans les eaux peu profondes pour augmenter le substrat pour la
culture du nori. La culture moderne (industrielle) de Porphyra n'a pas eu lieu
avant les années 1960, à la suite de la découverte de la phase Conchocelis.
En Chine et au Japon, il existe 7 espèces principales utilisées en culture
commerciale (Porphyra yezoensis , Porphyra tenera, Porphyra haitanensis, Porphyra
pseudolinearis, Porphyra kunideai, Porphyra arasaki et Porphyra seriata).
Intérêt : Certaines données
statistiques disponibles des années 1960, donnent une production annuelle
séchée de Porphyra tenera cultivé, d’environ 5000 tonnes. En 1977,
quelque 300 000 t de poids humide de Porphyra spp. ont été récoltés au
Japon et le volume de production a augmenté de 25 % par an dans les années
1970.
Pour la nourriture, consommée sous diverses formes. Le nori
est, par exemple, vendu en feuilles, une fois grillés, ils sont émiettés et
ajoutés aux sauces, soupes et bouillons. Il a une teneur élevée en protéines
(25-35% du poids sec), en vitamines (par exemple vitamine C) et en sels
minéraux, en particulier l'iode.
Sources : a) https://en.wikipedia.org/wiki/Pyropia_tenera,
b) Porphyra tenera, http://www.fao.org/fishery/species/2790/en
Eucheuma est
un genre d’algues rouges, mais qui peut prendre une couleur brune, rouge ou
verte, communément connu sous le nom Gusó. Les espèces d’Eucheuma sont
utilisées dans la production de carraghénanes, un ingrédient contenu dans les cosmétiques, ou utilisé dans la transformation des aliments,
ainsi qu’une source de nourriture pour les gens en Indonésie et aux Philippines.
Eucheuma
cottonii, cultivée aux
Philippines, est une espèce connue sous le nom de guso. Les autres
espèces de guso comprennent Betaphycus gelatinae, Eucheuma
denticulatum et plusieurs espèces du genre Kappaphycus, y
compris Kappaphycus alvarezii. Depuis le milieu des années 1970, Kappaphycus et Eucheuma ont
été les sources principales de l’expansion de l’industrie des carraghénanes.
Bien que commercialement importantes, les espèces d'Eucheuma sont
difficiles à identifier sans l’aide d’un examen scientifique approfondi, car différentes
espèces peuvent avoir des morphologies similaires. Quelque dix-huit à vingt
espèces relèvent à elles seules du genre Eucheuma, représenté par
les groupes Cottoniformia, Gelatiformia, et Anaxiferae.
Habitats : Eucheuma se
trouve généralement en dessous de la marée basse, poussant sur des zones de
sable jusqu’à des fonds marins rocheux le long d’un récif corallien, où le
mouvement de l’eau est lent à modéré.
Culture (et
précautions) : Les informations basées sur les caractéristiques morphologiques, l’empreinte ADN, et la
croissance, pendant les différentes saisons de culture, sont utilisées pour
faciliter la gestion des cultures, pour laquelle les espèces à forte croissance
sont utilisées et collectées pour les stocks de semences, principalement des
Philippines. Une fois que les jeunes algues ont été obtenues dans la nature,
elles sont nettoyées afin de les débarrasser de la saleté et d’autres
contaminants, puis elles sont transférées vers des sites de pépinières dans des
boîtes de polystyrène avec des
trous d’aération dans la partie supérieure, sans exposition au vent ni au
soleil.
Le choix
du site est important pour le développement de l’exploitation d’algues marines,
et certains critères doivent d’abord être respectés afin d’optimiser la
production. Ces critères comprennent le courant et les vagues pour permettre
l’absorption des nutriments, une lumière suffisante mais non excessive pour
permettre une photosynthèse optimale, une profondeur d’eau suffisante non
entravée par une faible exposition à la marée, une température optimale de
l’eau entre 27 et 30 degrés Celsius, des niveaux de salinité de 30-35 0/00 et
des zones avec une faible présence d’herbivores, de micro-organismes, de limon
en suspension et d’épiphytes. Les stocks de jeunes algues sont ensuite
préparés en liant des boutures d’Eucheuma avec des matières plastiques
souples puis en les accrochant à deux mono-lignes, une au fond et une
flottante, reliées par des lignes de nylon parallèles les unes aux autres à des
intervalles d’un mètre pour permettre aux courants d’eau de s’écouler.
L’algue est ensuite récoltée 10 à 12 semaines après la plantation afin de
permettre à la culture de pousser et d’augmenter sa teneur en carraghénanes.
La
culture d’Eucheuma a soulevé certaines questions environnementales,
principalement centrées sur l’écologie et la biodiversité des milieux côtiers.
L‘écologie des sites de culture d’Eucheuma peut être caractérisée
par le surpeuplement, car d‘autres fermiers peuvent être attirées par le site
de culture, ce qui finit par dépasser la capacité de l’environnement. Cela peut
à son tour modifier l’hydrologie globale de la région, et avoir des
répercussions sur d’autres espèces présentes. La pollution domestique due à
l’élimination des déchets agricoles peut également avoir un impact sur
l’environnement proche.
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucheuma, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Eucheuma
|

Eucheuma en culture dans
une ferme d’algues.
|

Femme
ramassant des algues Eucheuma à Jambiani (Zanzibar).
|

Ferme
d’Eucheuma, Tanzanie.
|
|
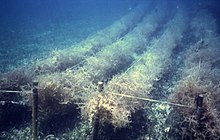
Eucheuma, vue
sous-marine, Philippines.
|

Gusô
frais dans un marché aux poissons, consommés frais trempés dans du
vinaigre et des épices dans la cuisine philippine.
|
|
Gracilaria est
un genre d'algues rouges de la famille des Gracilariaceae. Certaines
espèces du genre sont utilisées dans la cuisine japonaise et
la cuisine hawaïenne sous
le nom vernaculaire ogonori.
A Hawaii, il existe
une recette de salade contenant des ogonori appelée poke. Elles
sont aussi consommées sur l'île de Guam, où le
nom chaguan tasi désigne le genre. Aux Philippines où elles
sont aussi consommées, les algues sont appelées gulaman ou guraman.
Ces
algues font l'objet d'une aquaculture importante, notamment pour pouvoir
produire de l'agar-agar, un
gélifiant notamment utilisé dans les produits Hallal. C’est une
algue prisée en aquariophilie, appréciée par les poissons de la familles des Acanthuridae
(poissons chirurgiens) et de nombreux autres poissons herbivores.
Distribution : Les gracilaria se
trouvent dans les eaux chaudes du monde entier, bien qu’elles se produisent
également de façon saisonnière dans les eaux tempérées. Il ne peut pas
tolérer des températures inférieures à 10 °C (50 °F). Les Gracilaria se
trouvent dans tous les océans à l’exception de l’Arctique. Son centre de diversité est le Pacifique occidental, où il est traditionnellement cultivé comme source
d’agar-agar.
Toxicité :
La mort de certains consommateurs sur cette île a entraîné diverses études
portant sur une potentielle toxicité du genre ; l’hypothèse la plus
probable reste la présence de Cyanobactéries toxiques épiphytes ayant
poussé sur les algues consommées avant les décès.
Maladie : Les Gracilaria sont
sensibles à l’infection par l’oomycète parasite Pythium porphyrae.
Sources :
a) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Gracilaria, b) https ://en.wikipedia.org/wiki/Gracilaria
|

Gracilaria
|

Ogonori.
|

Kkosiraegi- muchim (gracilaria
assaisonné)
|
Pour
mention : C’est une petite espèce d'algues rouges de la
famille des Gigartinaceae, des mers froides. Elle est (non-cultivée et) récoltée pour
produire des carraghénanes. Très polymorphe d'aspect, elle mesure en général
entre 7 et 15 cm de long, parfois 20 cm. Sa
couleur varie de pourpre à vert en passant par le brun, avec de nombreuses
nuances intermédiaires. À l'état sec, elle prend un aspect presque
corné. Elle s'attache au substrat par un petit crampon, surmonté d'un stipe fin, qui s'élargit en ramifications très lobées, aplaties, et
en partie translucides. Ces lobes, de forme variée, peuvent se subdiviser en
lobules, ce qui donne à l'algue un aspect "frisé" (d'où le
terme "crispus"). Une espèce très ressemblante, Mastocarpus stellatus, a un stipe enroulé sur les bords et a un aspect
plus rugueux.
Répartition
et habitat : Cette algue pousse au niveau de l'étage infralittoral, sur la roche de la zone intertidale médiane à la zone subtidale, jusqu'au fond de l'océan, et
capable de survivre avec un ensoleillement minimal.
En Europe, elle pousse dans l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord ; elle est rare en mer Baltique.
Il existe
également d'autres espèces du même genre dans l'océan Pacifique, par exemple,
C. ocellatus, C. nipponicus, C. yendoi, C. pinnulatus et C. armatus.
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Chondrus_crispus, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Chondrus_crispus
|
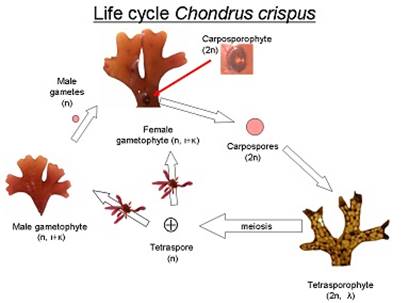
Cycle
de vie de Chondrus crispus
|

Chondrus crispus
|
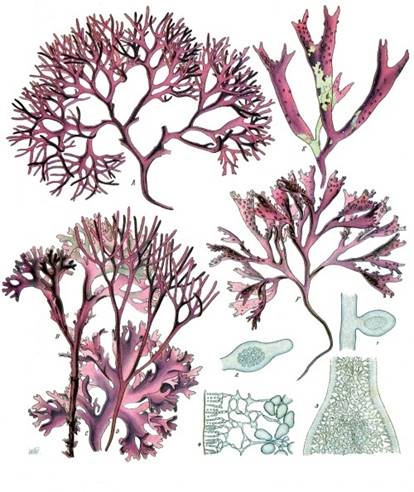
Planche présentant des détails morphologiques de Gigartinaceae :
De A à D (à gauche) : Chondrus crispus. E
et F : Mastocarpus stellatus.
C’est une espèce d’algues rouges de la famille des Solieriaceae, présente dans les mers chaudes (nom en anglais : elkhorn
sea moss [mousse de mer elkhorn]).
Cette algue atteint deux mètres de long et est de couleur
verte ou jaune. Elle est à croissance très rapide, connu pour doubler sa
biomasse en 15 jours. Elle est considérée comme une mauvaise herbe aquatique à Hawaï.
Intérêt commercial : C’est
l’une des plus importantes sources commerciales de carraghénanes, une famille de polysaccharides extraits d’algues
rouges servant d'agent d'épaississement et de stabilisation. Les méthodes de
culture a une influence sur les caractéristiques des carraghénanes que l’on
peut extraire des algues.
Méthodes d’extraction : Les
carraghénanes peuvent être extraits de ces algues par deux méthodes. Dans celle
d’extraction dite « native », les algues sont mises en solution aqueuse
et le résidu est filtré, laissant des carraghénanes presque purs. Celle
alcaline modifiée est moins chère et plus facile : les algues sont broyées dans
une solution alcaline, laissant un mélange de carraghénanes et de cellulose qui
peut être commercialisé comme carraghénane semi-raffiné.
Maladie : Elle peut être
affectée par l’ice-ice, une maladie qui réduit énormément son rendement.
Deux variétés cultivées : Kappaphycus alvarezii
var. tambalangii
Kappaphycus alvarezii var. ajakii-assii
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Kappaphycus_alvarezii,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Kappaphycus_alvarezii
c) https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=2811&sk=0&from=results
|

Ilha Grande Bay -
Rio de Janeiro State – Brazil © Miguel Sepulveda
|

Souches brunes, vertes et rouges de Kappaphycus
alvarezii plantées dans des filets tubulaires, cultivées à Florianópolis,
Santa Catarina, Brésil. 2009. © Leila Hayashi.
|

Shrimp Farm (Ferme
de crevettes) – Ecuador (Equateur). 2011. © Miguel Sepulveda
|
|

Zanzibar, île de Pemba, 2018. 11 Juin
2020. ©
Miguel Sepulveda
|

Mousse de mer (Kappaphycus
alvarezii) sur les lignes de culture, en eau peu profonde à Saint-Kitts
©FAO/Stankus.
|

Prainha, Baie de Sepetiba, État de
Rio de Janeiro, Brésil, 2009. © Renata Reis.
|
Spiruline est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de cyanobactéries filamenteuses, originaires
des eaux chaudes peu profondes et saumâtres de la ceinture intertropicale. La spiruline prospère naturellement dans les lacs
salés et alcalins des régions chaudes du globe. La spiruline correspond
à de nombreuses espèces de forme spiralée (d'où son nom). Il existe près de
2000 espèces de cyanobactéries et seulement 36 espèces d'Arthrospira sont
comestibles. Le plus souvent toutefois, en disant « spiruline »,
les francophones font référence au complément alimentaire produit majoritairement à base d’Arthrospira platensis (synonyme Spirulina platensis), l'espèce la plus cultivée et consommée, et d’Arthrospira
maxima (syn. Spirulina
maxima ou Limnospira maxima), également consommée dans une moindre
mesure.
L'aliment
nommé spiruline est un
produit à base de cyanobactéries du genre Arthrospira, des
bactéries photosynthétiques microscopiques bleues, généralement séchées et
broyées. Ce n'est donc ni une plante, ni une algue. Traditionnellement, cet
aliment est consommé en galettes, par les Kanem du Tchad dès
le ixe siècle, mais
les Aztèques en
faisaient aussi une sorte de fromage. La spiruline a été redécouverte au xxe siècle en tant
que complément alimentaire, et sa
commercialisation développée dans les années 1970 par les pays industrialisés,
avec la mise en culture de souches de ces mêmes cyanobactéries.
L'espèce
la plus fréquemment offerte sur le marché au début du xxie siècle
est Arthrospira platensis, cultivée
principalement en Chine (50 %
de la production mondiale de 5 000 tonnes en 2013), aux États-Unis (Californie et Hawaï), en France (environ
250 producteurs artisanaux), ainsi qu'en Afrique : Côte d'Ivoire (Adzopé), Mali (Mopti, Ségou…), Burkina Faso (Koudougou).
Note : Le genre Spirulina existe toujours, mais englobe d'autres cyanobactéries, assez
éloignées du point de vue taxinomique et sans
valeur alimentaire pour les humains. Le nom actuel « spiruline »
est donné à des espèces alimentaire du genre Arthrospira et non à
celles du genre Spirulina.
Principes
et méthodes de production en algoculture : La culture (algoculture) de la
spiruline alimentaire se pratique principalement en milieu ouvert, en bassins
aquatiques de quelques décimètres de profondeur,
couverts ou non, et exposés à la lumière du soleil, dans une eau alcaline (pH proche
de 10) et maintenue à une température comprise entre 30
et 35 °C. Elle
peut également se pratiquer en photobioréacteurs, c'est-à-dire
en systèmes fermés. En conditions réelles, la productivité de bassins ouverts
de type raceway (en hippodrome), tourne généralement autour de
6 g m−2 j−1 (équivalent
sec). Après filtration, égouttage, lavage, éventuellement extrusion, puis
séchage, on obtient un produit
déshydraté, qui peut se présenter sous différentes formes et notamment une fine
poudre verte (après séchage par atomisation ou une étape supplémentaire de
concassage et de broyage).
La
culture est facilitée par le fait que cette espèce est extrêmophile et qu'il
est possible de trouver une fenêtre de culture où le milieu est
suffisamment basique et salin pour que la spiruline s'y trouve seule à
se développer, débouchant sur une situation de monoculture. Le risque de
contamination des cultures par d'autres espèces d'algues ou de cyanophycées est
alors considérablement réduit.
Les
exploitations cultivent la spiruline, dans un milieu artificiel simplifié, réunissant une base (généralement grâce à un apport de bicarbonate de soude), une source de salinité (sel marin/chlorure de sodium), ainsi que des intrants azotés (par exemple de l'urée), phosphatés (acide phosphorique), potassiques, ou mixtes (nitrate de potassium).
Pour le
brassage de l'eau : a) il faut d'agiter énergétiquement au balai le bassin au moins
une fois par jour, surtout s'il est assez profond, b) ou bien, pour les grands
bassins industriels, très longs, ce dernier seront toujours munis d'une chicane
médiane et agités par roue à aubes.
Ombrage :
La spiruline a besoin de beaucoup de lumière mais pas d’exposition directe au
soleil fort. Par températures froides, il faut recouvrir la culture d’un voile
d’ombrage.
Productivité
et produits : La spiruline permet de produire une grande quantité
d'éléments nutritifs essentiels sur un espace très réduit. Dans une ferme,
le rendement annuel est en effet de 9 tonnes de protéines à l'hectare,
contre 1 tonne pour le blé ou le soja. La spiruline est commercialisée
sous plusieurs formes : comprimés, poudre, gélules et liquide, brindilles,
paillettes, micro-aiguillettes, pâtes.
Précautions
d’emploi : « Par mesure de précaution, la spiruline est déconseillée chez les femmes enceintes ou qui allaitent. » Elle
l'est également chez les personnes sujettes à la goutte, aux calculs rénaux ou ayant un taux sanguin élevé d'acide urique.
Le danger
d’empoisonnement : Cette cyanobactérie peut accumuler l'arsenic (un
métalloïde), les métaux lourds comme le plomb, le mercure, d'autres toxines. « Il
est donc important de se renseigner sur son origine et sa qualité ».
Note : Des millions de personnes au Bangladesh, en Inde, à
Taïwan et en Chine sont à risque d’empoisonnement chronique à l’arsenic via
l’ingestion de fortes concentrations d’arsenic dans l’eau (des
nappes phréatiques). Il semblerait que des
extraits de spiruline additionnés de zinc consommés quotidiennement pourraient
être utiles pour le traitement de l’empoisonnement chronique à l’arsenic.
Sources :
a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiruline, b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiruline_alimentaire,
c) La
spiruline: de sa découverte à nos jours, https://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/9900/bin37/histo.htm
d) «
Cultivez votre spiruline », manuel de culture artisanale, J.P. Jourdan, https://www.antenna.ch/wp-content/uploads/2017/04/Manuel_Cultivez_votre_spiruline_REVISION_2013.pdf
e) https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Culture_de_la_spiruline
|

Bassins en hippodrome.
|

Bassins en hippodrome,
avec une roue à aube pour le brassage de l’eau
|
|

Récolte
|

Filtration
|
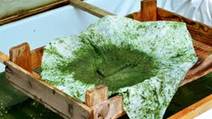
Essorage pour obtenir
une pâte verte.
|
|

La pâte est étalée sur
des plateaux mis dans des séchoirs (solaires ou au gaz).
|

Pose d’un filet
d’ombrage, si les conditions météo sont problématiques (froid, soleil
intense).
|

Bassins (en tissu
polyamide enduit PVC) de l’Ecopark, Madurai, Tamil Nadu (Inde), 18 m², 1998.
© J.P.
Jourdan.
|
|

La spiruline Paracas vient du
lac de l'oasis d'Huacachina dans la région d'Ica au Pérou. Encerclé du sable
blanc du désert, cette oasis doit son origine aux afflux des courants
souterrains.
|

La spiruline Lonar, vient du
cratère de Lonar dans l'État de Maharashtra en Inde. Il est le plus grand
cratère creusé par une météorite dans des roches de basalte et est
partiellement rempli par un lac d'eau « saumâtre ».
|
|
|
|
|
Sous ces
latitudes, la température de l'eau est comprise entre 20 et 40°C. Les nombreux
oiseaux et mammifères qui fréquentent ces plans d'eau depuis des millénaires
ont créés par leurs déjections et leur agitation un environnement adapté au
développement de la spiruline (Cf. Culture de la spiruline de Haute
Saintonge, https://www.spiruline-fr.com/Culture-de-la-spiruline.htm).
|

Le Gaberoun est une oasis située près de Sebha dans
le désert Libyque. Son lac est extrêmement salé. Les moustiques y sont
abondants, surtout en été, preuve d’une vie biologique active.
|

Lac
salé d’Oum El Ma au pied des dunes de l’Erg Oubari. Il mesure près de
800 mètres de long, il est situé dans la partie libyenne du Sahara à Awbari,
dans la région du Fezzan. Il contient 35 g.L-1 de sel © Philippe
Crochet.
|
Les lacs
Ayata, Mégarine et Témacine sont parmi les rares plans d’eaux salés et
permanents du Sahara algérien. Mégarine est le plus salé avec un maximum de
35,00 ± 0,28 g.L-1. Ayata et Témacine sont considérés comme
saumâtres-salés. La température de l’eau est similaire dans les trois lacs et
varie entre 15,70 et 34,25 °C. Le pH est alcalin et varie entre 7,23 et 8,05.
Les trois lacs sont fortement minéralisés avec une dominance des chlorures, des
sulfates et du calcium. La température serait le principal facteur influençant
les variations de la salinité, de la conductivité et de l’oxygène dissous.
Suggestions :
Normalement, la spiruline se développe plutôt dans une eau salée et basique,
avec un pH10, mais l’on pourrait malgré tout essayer d’ensemencer avec la
spiruline les lacs ayant un pH8.
Et pourrions-nous essayer d’y planter des palétuviers
résistants à un taux de salinité élevé (Avicennia marina, Bruguiera
gymnorrhiza, Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, Lumnitzera racemosa,
Sonneratia alba) ?

C’est un arbuste médicinal à feuilles persistantes ou un petit arbre de
~ 6-7 m. L'arbre produit des fruits minuscules en grappes; ces drupes une
graine sont comestibles; ils sont juteux (chacun avec une ou deux gouttes de
jus), mais légèrement piquants. Originaire du Moyen-Orient.
S. persica est très répandue, notamment dans les bosquets épineux,
les plaines inondables du désert, rivières et la végétation des berges, et les
savanes herbeuses. Il préfère les zones où l'eau souterraine est facilement
disponible, sur les berges, sur les périmètres de points d'eau, dans des sites
humides saisonnières, et le long des lignes de drainage dans les zones arides.
On trouve également dans les vallées, sur les dunes et sur les termitières.
L'arbre est capable de tolérer un environnement très sec avec des
précipitations annuelles moyennes de moins de 200 mm. Très tolérant au sel, il
peut se développer sur les régions côtières et les sols intérieurs salés.
Altitude: 0-1 800 m
Type de sol: argileux, mais préfère les bonnes terres, les terres
noires et le sable. Il est adapté aux sols alcalins ou très salins, généralement
des sols riches en argiles, et les sols sans sel.
Le siwak (en arabe سواك), appelé
aussi souek, souak, miswak ou bois d'araq (bâton d’arak), est la racine de
l'arbuste Salvadora persica utilisée
comme « brosse à
dent » naturelle. Le simple fait de se frotter les dents avec un objet
fibreux tel que le siwak permet de se débarrasser de la plaque dentaire. Par
ailleurs, des recherches scientifiques suggèrent un effet bénéfique dans le
renforcement de la gencive1. Une étude
américaine menée en 2003 par le National
Center for Biotechnology
Information a conclu que l'usage du siwak est plus efficace que
l'usage d'une brosse à dents2,3. L'Organisation
mondiale de la santé en recommande l'usage en 1986 puis en 20004. Il comporte aussi
une substance qui facilite la digestion et qui protège les dents contre letartre1,3. Ses propriétés
seraient bénéfiques médicalement parlant, y compris abrasives, antiseptiques, astringentes ,détergentes,
inhibitrices
d'enzymes …
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Siwak,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Salvadora_persica,
c) http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Salvadora_persica.pdf,
d) http://en.wikipedia.org/wiki/Miswak
L'arbre à myrrhe ou balsamier est un arbuste ou
petit arbre d’environ 3 m de haut, aux petites feuilles ovales caduques,
originaire de l'Afrique
de l'Est et de la péninsule
Arabique, notamment de Somalie.
Il est aujourd’hui présent dans les régions sèches du nord-est de
l'Afrique (Djibouti, Éthiopie, Soudan, Somalie, Kenya) et de la péninsule
Arabique (Yémen et Oman), en Ethiopie, en Arabie Saoudite, en Inde, en Iran et
en Thaïlande.
Altitude : 250-1300 m. Précipitations annuelles moyennes : 230-300 mm.
La plante se reproduit dans les régions arides, où l’on trouve normalement l’Acacia
senegal. Les buissons de Commiphora sont dans les pentes et les
vallées sur des sols peu profonds, principalement calcaires.
À la fin de l'été, l'arbuste se couvre de fleurs rouge-orangé,
tandis que son tronc se boursoufle de nœuds. C'est de ces boursouflures que
s'écoule la myrrhe, en
petites larmes jaunes que l'on recueille une fois qu'elles ont séché.
Cet arbre a un usage médicinal et aromatique. La résine jaune, épaisse,
à l’odeur typique du Commiphora myrrha, la myrrhe, sève d'arbre séchée, est
récoltée commercialement. Cette résine, au contact de la chaleur et
de la lumière synthétise une huile essentielle riche en furanosesquiterpènes et
en engénol.
Les infusions de ses feuilles serviraient aux bains de bouches. On en
ferait une crème anti acnéique. Les Chinois feraient bouillir les feuilles de
l’arbre à myrrhe pour produire des arômes parfumés lors de rituels de
purification. Dans l’Antiquité, il servait à produire un parfum réputé, le Balsama,
dont la recette a été perdue.
L’huile essentielle de myrrhe serait immunostimulante,
anti-inflammatoire, anti-infectieuse & antiparasitaire. Composition de
la myrrhe : Gomme (30 à 60 %), Polysaccharides, Résine (25 à
40 %), Huile essentielle (3 à 8 %). Composition de cette huile
: a) 90% sesquiterpènes dont 71% furanique (ayant une action plus puissante que
la morphine), 4.5% Cétones, 3.5% hydrocarbures, 2% Aldéhydes, b) heerabolène, eugénol, divers
furanosesquiterpènes.
Note : La ville juive indigène de Ein Gedi était
une importante source de baume et de parfum, le balsama, pour le monde
gréco-romain, jusqu'à sa destruction par l'empereur byzantin Justinien, dans le
cadre de sa persécution des Juifs dans son royaume. Les méthodes d'extraction
et de préparation de cette résine balsamique très prisée ont été perdues. En
2003, le Dr Michael Avishai a rapporté les graines de l’arbre de l'Angleterre,
et les jeunes arbres plantés, au Kibboutz de Ein Gedi (Israël) ont germé à
partir de ces graines. Avec l'aide du personnel du jardin botanique d'Ein Gedi,
la plante est cultivée dans l'espoir de produire le parfum légendaire. Synonyme
: Commiphora Molmol.
Sources : a) http://www.sante-globale.fr/plantes-2/commiphora-myrrha-variete-molmol/
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%C3%A0_myrrhe,
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Commiphora_myrrha,
d) http://www.wisegeek.com/what-is-commiphora.htm
e) http://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Gedi,
f) http://www.llifle.com/Encyclopedia/TREES/Family/Burseraceae/11169/Commiphora_myrrha
g) After repeated failures, new effort to
revive the legendary balsam plant shows promise, Nir Hasson, Haaretz, Sep. 2, 2010, http://www.haaretz.com/print-edition/news/after-repeated-failures-new-effort-to-revive-the-legendary-balsam-plant-shows-promise-1.311617
|


Myrrhe, la résine durcie extrait de Commiphora myrrha
|
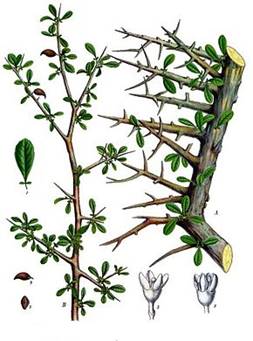
|
|

Culture de Commiphora myrrha. Photo: Valentino Vallicelli.
|

Selon l’auteur de cette photo, qui la cultive en Australie, la
plante pourrait se bouturer (?).
|

La culture du « Balsam » au kibboutz Ein
Gedi.
Source : Haaretz, 2 septembre 2010.
|
Ou Guggul ou Guggal. Cette plante arbustive épineuse,
originaire d'Inde et utilisée dans la médecine ayurvedique, est proche de l'arbre à myrrhe. On
la rencontre de l' Afrique
du Nord à l'Asie
centrale, mais la plante est plus fréquente dans le nord de l’Inde. Elle
préfère les climats arides et semi-arides et
tolère les sols pauvres.
La résine du guggul, connu sous le nom de gomme guggulu, a
un parfum semblable
à celui de la myrrhe et
est couramment utilisé dans l'encens et
dans des parfums. Sa
gomme résine
est récolté à partir de l'écorce de la plante à travers le processus de taraudage.
Le guggul a été surexploité dans une grande partie de son
habitat, et a été inscrit à la Liste
rouge de l'UICN des espèces menacées. L’India's National Medicinal
Plants Board a lancé un projet de culture de 500 à 800 hectares de guggul,
dans le district de Kutch, tandis
qu'un mouvement de conservation local,
dirigée par Vineet
Soni
associé à l'UICN, a commencé à éduquer les cultivateurs de guggul
et les récolteurs dans des méthodes de récoltes sûres et durables. Petites
fleurs rouges à roses. Petit fruits rond rouge à maturité.
Usages médicinaux : Maladie de la peau, suppuration et abcès,
plaies, maladies des gencives et de la bouche, fumigation de salle d'opération
…. Les composants de sa gomme (Guggulstérone
…) se sont révélés très actifs pour soulager les douleurs rhumatismales et pour
faire baisser les taux excessifs de cholestérols et triglycérides dans le sang.
On peut donc l'utiliser pour soigner l'arthrose lorsqu'elle est associée à un
taux de cholestérol élevé.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Commiphora_wightii,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Commiphora_wightii

Myrrhe de guggul.
|

Commiphora wightii : Bhandari, une plante
médicinale en danger. Source : Botanical survey of India,
|

Source image.
|
|

Commiphora wightii.
|

Source : http://www.dmapr.org.in/MandCrop
|
Cet arbre épineux à feuilles
caduques, d’environ 5 m de haut, est largement répandu dans les
régions sèches de l’Afrique subsaharienne
_ Angola,
Botswana, Burkina
Faso, au Tchad,
en Erythrée ,
en Ethiopie,
au Kenya,
au Mali,
en Mauritanie,
au Mozambique, en
Namibie, au
Niger, au
Sénégal, en
Somalie, en
Afrique
du Sud, au Soudan,
au Swaziland,
en Tanzanie,
en Ouganda,
en Zambie,
au Zimbabwe.
Il est commun dans la brousse d’Acacia-Commiphora et
habituellement présent dans les savanes sèches et le Sahel.
Sur les sols sablonneux, cette espèce forme parfois des peuplements
purs. L’écorce est gris-vert, parfois brillante, pelant en lambeaux rougeâtres.
L’intérieur d’une entaille dans l’écorce est rougeâtre, et exsude une gomme
claire, le bdellion,
aromatique et comestible. Les fruits rouges comestibles ont
environ 6-8 mm de diamètre. Les racines douces, succulentes sont souvent mâchés
par les humains. Les nouvelles feuilles sont recherchés par les chameaux et les
chèvres, en particulier au début de la saison sèche. Cet arbre est extrêmement
sensible à l'humidité atmosphérique et développera ses bourgeons à la première
trace de des vents chargés d'humidité. Par conséquent, il est le premier
arbre à entrer en feuille avec l'arrivée de la saison des pluies, et demeure
remarquablement vert pendant toute la période des pluies. Au Sahel,
cette apparence fraîche frappante n’est partagée qu’avec le Salvadora
persica.
Il est particulièrement approprié pour constituer des haies vives. Altitude :
300 à 1900 m. Précipitations annuelles moyennes : 150 – 900 mm. Multiplication
: par bouturage.
Les feuilles apparaissent au moment de la saison des pluies ou un peu
avant. Il perd ses feuilles au début de la saison sèche. Cette plante hôte est
la nourriture préférée du coléoptère Diamphidia,
dont la larve est utilisée comme un puissant poison de flèche (N).
Toutes les parties de l'arbre sont utilisées pour traiter un large
éventail de maladies, les fruits pour la fièvre typhoïde et les problèmes
d'estomac, l'écorce pour le paludisme, la résine pour convulsions et pour
couvrir et désinfecter les plaies, la résine brûlée comme insecticide et
aphrodisiaque. Le bois tendre, résistant aux termites, est utilisé pour
sculpter des ustensiles domestiques, instruments de musique et des articles
d'usage général. Une huile comestible est également extraite et parties de
l'arbre présentent de fortes propriétés fongicides.
Haie, clôtures, cuillères de bois. Fourrage à chameau et chèvre,
surtout pendant la saison sèche. Branches utilisées comme brosse à dents.
L'écorce est
riche en flavonoïdes, tanins, anthraquinone, glycosides
cardiaques, triterpénoïdes, saponines, alcaloïdes et sucres
réducteurs . Des études d'un extrait
hydro-éthanolique de
l'écorce ont révélé la présence d’un anti-convulsivant puissant.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Commiphora_africana,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Commiphora_africana
,
c) http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Commiphora_africana.PDF
L'arbre à encens (Boswellia sacra) est un petit
arbre d'une hauteur de 2 à 8 m, qui comporte un ou plusieurs troncs.
L'écorce à texture de papier pèle facilement.
Utilisations : Le Boswellia sacra est l'une des
principales espèces de Boswellia dont on tire l'encens. La
résine est récoltée en pratiquant une incision peu profonde dans le tronc ou
les branches de l'arbre et en retirant une étroite bande d'écorce. Il s'en
écoule un sève laiteuse, qui coagule au contact de l'air et que l'on ramasse
ensuite à la main. La résine du boswellia contient un anti-inflammatoire
puissant.
Habitat : Cet arbre pousse dans les régions sèches du nord-est
de l'Afrique et du sud
de la péninsule Arabique
(en Somalie, en Éthiopie, au Yémen et à Oman). Il tolère les situations
très exposées et on le retrouve souvent sur les pentes rocheuses et dans les
ravins, jusqu'à une altitude d'environ 1 200 m. Il préfère les
sols calcaires. Les individus qui croissent sur des pentes escarpées
développent un renflement en forme de coussin à la base du tronc qui adhère au
rocher et leur assure une certaine stabilité. Les arbres dans la zone
étroite, chargée de brouillard, où le désert rencontre chaîne de montagnes du
Dhofar, une région connue sous le Nedjd,
grandissent très lentement et produisent un résine de très haute qualité, dans
de grands massifs blanches.
Les arbres commencent à produire la résine quand ils sont vieux
d'environ 8 à 10 ans.
Menaces : Des études récentes ont indiqué que les populations
d'arbres d'encens sont en baisse en raison de leur surexploitation. Les
arbres fortement taraudés produisent des graines qui ne germent qu’à seulement
16%, tandis que les graines d'arbres qui n’avaient pas été exploitées germent à
plus de 80%. Les herbivore à Oman souvent broutent
le feuillage, les fleurs et les semis, entraînant peu de
régénération; les arbres matures qui restent sont apparemment en train
de mourir. Statut IUCN : Near Threatened (IUCN 2.3) quasi
menacée.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Boswellia_sacra, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Boswellia_sacra,
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Encens_(r%C3%A9sine_oliban)
Boswellia serrata est un arbuste qui produit l’encens
indien.
Il est originaire d'une grande partie de l'Inde et
de la région
du Punjab pakistanais.
Usage : Il est utilisé, par la médecine
ayurvédique, pour le traitement de l'arthrite.
Des extraits de Boswellia serrata ont été cliniquement
étudiée pour l'arthrose et
de la fonction articulaire, en particulier pour l'arthrose du genou, montrant
une légère amélioration à la fois de la douleur et de la fonction par rapport à
un placebo. Les effets positifs de Boswellia dans certaines maladies
inflammatoires chroniques y compris la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme
bronchique, l'arthrose, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn ont été
rapportés. Certains considèrent Boswellia serrata comme une alternative
prometteuse aux AINS,
justifiant une enquête plus approfondie dans les études pharmacologiques et
cliniques.
Constituants actifs : L’acide
boswellique et
d'autres acides pentacycliques triterpéniques sont
présents. L’acide bêta-boswellique est le constituant principal. Le Shallaki
serait un analgésique puissant et aurait des effets anti-inflammatoires pouvant
réduire la douleur et l'inflammation des articulations.
Source : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Boswellia_serrata
b) http://pl.wikipedia.org/wiki/Boswellia_serrata
La « griffe du diable », « Sengaparile »,
« Devil's Claw », « Duiwelsklou » ou « racine de
Windhoek » est une plante herbacée vivace,
dont la tige rampant sur le sol (Procumbens) portent des feuilles
alternes au limbe ovoïde, et des fleurs en forme de trompette, de couleur
rouge-violacée. Substrat : sablonneux, drainant. Température
mini. : 5°C.
Cette espèce pousse dans l'hémisphère Sud (Afrique du Sud, Namibie, Botswana...) et plus
particulièrement dans les régions semi-désertiques de l'Afrique australe, plus
particulièrement de Namibie.
Le fruit est une capsule ligneuse munie d'une couronne garnie de
plusieurs crochets acérés lui permettant de s'accrocher aux animaux voire de
s'enfoncer dans leur chair, ce qui vaut à la plante d'être surnommée « la
griffe du diable ». Chaque fruit contient jusqu'à 48 graines noires et
allongées (7 à 8 mm de long). Sa racine principale, lignifiée, a un important
développement vertical en profondeur (jusqu’à 50 cm de long) ; De cette
racine principale partent des racines secondaires formant des tubercules de réserve,
bulbeux et parfois énormes, pouvant peser jusqu'à 1,5 kg. Ils s'étendent sur
environ 1,5 m et sont trouvés jusqu’à 2 m de profondeur, servant de stock d'eau
et de nutriments à la plante qui peut ainsi résister aux périodes de sécheresse.
Usages : Seuls ces tubercules (qui constituent jusqu’à 90% du poids de la
plante) sont utilisés depuis longtemps partie de la pharmacopée
traditionnelle du sud de l'Afrique et dans le monde, depuis les années 1970-1980, comme
anti-inflammatoire et pour atténuer ou guérir certaines douleurs (rhumatismes, arthrites
ou lombalgies).
Principes actifs : harpagoside,
beta-sitosterol,
8-p-coumaroylharpagide, 8-féruloylharpagide, 8-cinnamoylmyoporoside, pagoside,
ctéoside, isoactéoside, 6'-O-acetylacteoside, acide cinnamique, acide caféique.
Etudes : En Allemagne et
au Royaume-Uni,
plusieurs études ont utilisé le « Doloteffin » (une
préparation standardisée d'harpagophytum), qui ont conclu que H.
procumbens a été plus efficace que le Vioxx dans le
traitement de la lombalgie chronique31 et a
été bien toléré après plus de quatre ans de traitement de H. procumbens seul.
Menaces : La convoitise des laboratoires pharmaceutiques met en
danger la plante. Constatant une augmentation de 700 tonnes en 2001 à plus de
mille tonnes exportées en 2002 par la seule Namibie (l'harpagophyton pousse à
l'état sauvage dans le désert du Kalahari),
le Comité pour les plantes réuni à Genève en 2003 dans le cadre de la CITES
s'inquiétait pour la « durabilité » de cette ressource et le
caractère équitable de son commerce. L' Harpagophytum procumbens est
aujourd'hui cultivé et cueilli sous protection d'une charte et
d'un quota pour garantir sa pérennité en tant que ressource naturelle.
Le gouvernement namibien encadre sa culture et sa cueillette, par un cahier des
charges précis. Source : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Harpagophyton,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Harpagophyton
|

Système liman : par cette levée de terre,
les eaux de ruissellement sont détournées vers des canaux (Kenya).
|

Negarim : petite cuvette polygonale (voir plus
loin).
|
|

Système de limans israéliens. En gris vert, l’arrivée de
l’inondation d’un orage, retenue par les cuvette en demi-lune.
|

Lavogne, une petite retenue collinaire (Causse de
Sauveterre, Lozère, France).
|
Un Liman en Israël est le nom d'une
levée artificielle de terre, souvent en demi-lune, servant à recueillir les
eaux de crue d'un oued du
désert. L'eau de
ruissellement est ralenti par le barrage, inondant ainsi une petite
zone et permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Un petit bosquet
d'arbres peut y être maintenue dans le désert.
Les limans ont été construits afin de lutter a) contre la désertification sans
épuiser les eaux
souterraines, dans les écosystèmes arides, b) les crues soudaines, cause
d’érosion, et pour maintenir des espèces d'arbres résistants à la sécheresse.
La hauteur du remblai doit
être 3-4 fois la profondeur de l'eau retenue. Un déversoir régule le
niveau de l'eau [...] pour empêcher la destruction du barrage [4].
Un canal d'écoulement régule le niveau de l'eau accumulée et permet à l'excès
de s'échapper. Les brouteurs devraient
être exclus du site pour éviter le compactage du sol qui,
à son tour, diminue l'infiltration de
l'eau [3].
Y ont été plantés des espèces résistantes à la sécheresse sont adaptés, comme
le tamarin, la gomme arabique [l’acacia
Sénégal], le prosopis, le
pistachier, l’eucalyptus, le palmier dattier et
le caroubier. Sources :a)
http://en.wikipedia.org/wiki/Liman_irrigation_system
,
b) Les
structures antiérosives en relation avec les modes de gestion de l'eau, http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0q.htm
c) http://www.kkl.org.il/eng/water-for-israel/water-in-the-desert/limans/
|

Exemple de liman israélien.
|

Exemple de liman israélien.
|

Les Amandiers, les oliviers, les palmiers et les figuiers
sont parmi les arbres les plus aptes à être cultivées dans les milieux secs.
|
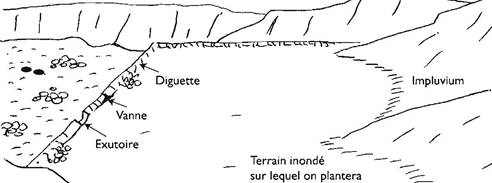
Malgré une entrée en sel relativement élevée, les données obtenues
montrent que les limans ne souffrent pas de la salinisation. Dans tous les
limans examiné, le sol, jusqu'à une profondeur de 3 m, a été trouvé non salin.
Les liman : digues de stockage :
A la confluence de deux vallées secondaires, une digue en terre, de 1 à
2 m de haut, est construite pour capter le ruissellement et sa charge solide :
elle permet une culture dans une bonne terre alluviale qui a absorbé une
réserve d'eau suffisante pour produire une céréale (500 mm) ou une culture de
légumineuse à croissance rapide. Pour évacuer une crue exceptionnelle, un
exutoire est prévu, généralement protégé par un mur de pierres cimentées. La
pente du talus de la digue dépend de la texture du matériau, elle est de
l'ordre de 50 % pour des alluvions argilo-sableuses.
Ce système peut être trouvée dans la zone de précipitations de 200 à
400 mm. sur les terrains accidentés. Pour le moment, il a encore d'environ
300.000 ha de terres agricoles dans les Meskats, principalement planté
d'oliviers.
Le système se compose de deux parties distinctes (voir figures pages
suivantes) :
- L'impluvium ou "Meskat", est la partie la plus élevée et
est utilisé pour la promotion de ruissellement. Cette zone peut être rocheux
avec une forte pente et a une faible capacité d'infiltration.
- La superficie cultivée ou "Mankaa" est la partie la plus
basse et a la plupart du temps un sol profond de limono-sableux avec une
capacité d'infiltration élevée. Ici, le ruissellement de l'impluvium s'infiltre
et permet de pousser des cultures. Les aires cultivées consistent
principalement en différentes terrasses séparées par des barrages en terre avec
déversoirs de pierres.
Les agriculteurs ont fait ces barrages assez élevés (0,5 m) pour être
sûr que la pluviométrie la plus élevée possible, pour tous les jours (370 mm),
peut être stocké dans le Manka et ne détruit pas les barrages et l'ensemble du
système.
Malheureusement, de nos jours, ce système se détériore très
rapidement. Ceci est principalement dû à la faiblesse des prix de l'huile
d'olive, qui érode la base économique du système et conduit à l’émigration des
agriculteurs. En outre, les oliviers sont plantés de plus en plus sur
l'impluvium, ce qui crée un déséquilibre entre impluvium et terre cultivée (le
rapport de l'impluvium de terres cultivées a changé de 2: 1 à 1: 2).
L'efficacité du système est en diminution de cette façon et les rendements
diminuent. Son non-entretien provoque une érosion sévère. Cela provoque dans
des inondations sur les plaines, qui causent beaucoup de dégâts et l'abaissement
de la nappe phréatique dans la zone des jardins. Il y a de nombreux signes que
la dégradation des meskats va changer tout l'équilibre hydrologique de la
région.
|
Avantages
- Permet une production fruitière relativement stable dans les zones semi-arides
- Appoints en eau aux plantations
- Amélioration de la productivité des terres
- Réduction des risques de ruissellement, d'inondation et d'érosion à
l'aval
|
Inconvénients
- Coût relativement important
- Exige beaucoup de main d'œuvre
- Réduction de l'eau disponible dans les barrages à l'aval
- Réduction de la surface cultivable sur l'impluvium
|
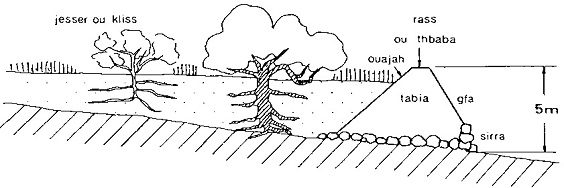
Tabia et déversoir
|
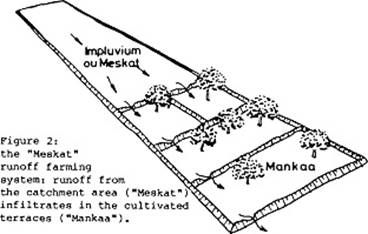
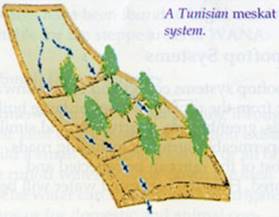
Le "Meskat", système d'exploitation des eaux de
ruissellement: les eaux de ruissellement de la zone de capture ("Meskat")
s'infiltre dans les terrasses de culture ("Mankaa").
|
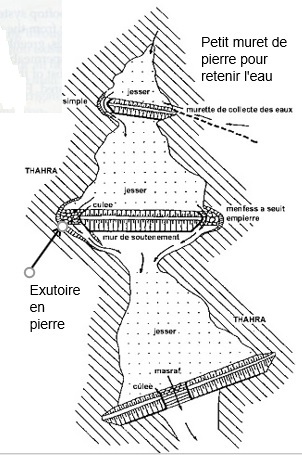
a) Exutoire en pierre, b) Petit muret de pierre pour
retenir l'eau.
|
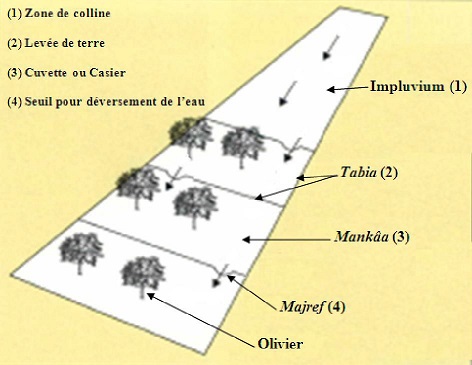
|
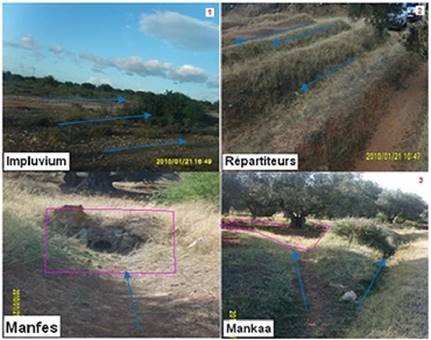
|

Système meskat supportant une plantation d’oliviers.
|
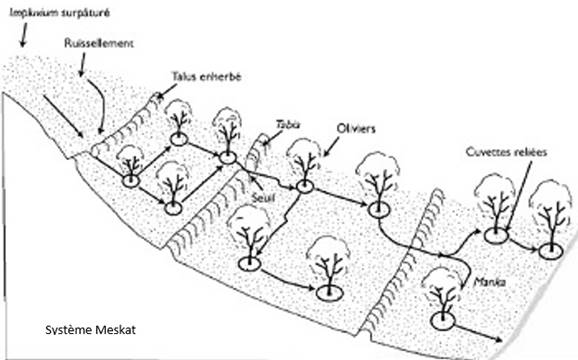
Légende :
·
Impluvium
surpâturé
·
Ruissellement
·
Talus
enherbé
·
Tabia
(levée de terre)
·
Oliviers
·
Cuvettes
reliées
·
Manka
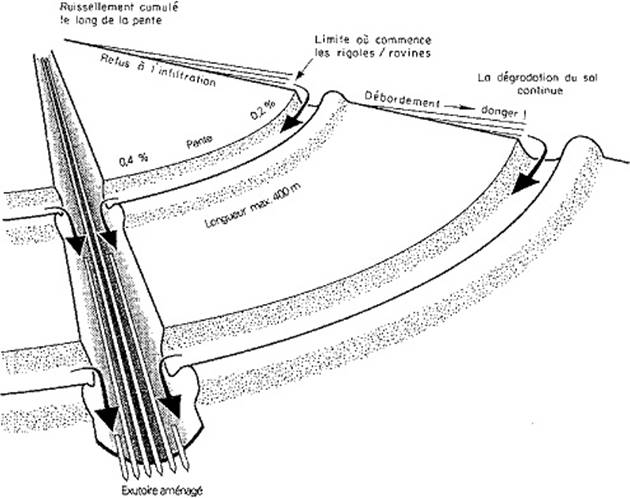
|
La
diversion des eaux de ruissellement: principes, pratique et inconvénients :
L'érosion
est fonction de :
- l'énergie
des pluies (constante tout le long de la pente)
- l'énergie du ruissellement (qui croît avec la pente (MV2)/2. E =
f (longueurn x pente)m
Les
banquettes :
- peuvent
évacuer l'énergie du ruissellement accumulée
- ne peuvent pas réduire l'énergie des pluies ni la dégradation du sol
|
Iconvénients:
1. Nécessité d'équipes
de topographes experts (coût élevé)
2. Important travail d'installation et d'entretien d'où généralement;
• digues non
protégées
• canaux encombrés de sédiments
• exutoires non enherbés ni protégés (surcreusés ou ensablés)
3. Perte de 5
à 15 % de la surface cultivée sans augmentation de rendement.
4. Perte d'eau et nutriments pour les champs cultivés en aval.
5. L'aménagement doit rompre s'il advient une pluie de fréquence inférieure à
1/10.
6. Variation de largeur des champs cultivés (mécanisation difficile).
7. N'arrête pas l'érosion en nappe ni la dégradation.
8. Finalement, risques graves de ravinement s'il y a rupture des digues (1
fois en 4 à 10 ans).
9. Accélération du temps de concentration des eaux:
• gros débits
de pointe
• érosion marigots
• ravinement régressif
|
La diversion des eaux de ruissellement.
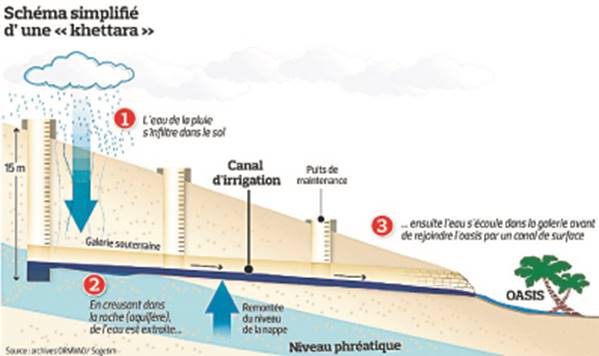
Les Qanats, développés dans l'ancienne Perse vers 800 avant notre ère, sont parmi les
plus anciennes méthodes d'irrigation connues encore en usage
aujourd'hui. On les trouve maintenant en Asie, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Le système comprend un réseau de puits verticaux et de
tunnels en pente douce creusés dans les flancs des falaises et des collines
escarpées pour capter les eaux souterraines.
Principe C’est un ouvrage pierreux construit au travers d’une
zone de ruissellement fort. Il doit être toujours être ancré dans le sol
(fondation). D’une hauteur moyenne de 0.5 à 0.8m, la largeur de la digue dépend
du débit maximal du ruissellement qui doit la traverser. Plus le courant est
important, plus il faut prévoir d’enchaînement de digues.
Prérequis Maîtrise technique, prendre en compte l’ensemble du
bassin versant, disponibilité de blocs de pierre, transport et disposer
d’équipement de concassage et gabionnage.
Effets concrets favorise le passage non érosif de l’eau et une
sédimentation en amont des matériaux transportés. C’est principalement un
ouvrage d’épandage des crues et de protection des terres situées en aval. La
digue étant poreuses elle se charge progressivement d’alluvion facilitant sa
fixation et réduisant l’érosion.
Coût dépendant de la largeur à traiter mais un ouvrage renforcé
en gabion (grillage, photo ci-contre) coûtera au moins 450 €/u (expertise
technique comprise).
|
 
Hiver Eté.
Bandes enherbées constituées d’Andropogon sp.
|

|
|

Bandes de ruissellement.
|

Une baissière fraîchement creusée (elles sont plus
adaptées aux régions humides, sauf exception).
|
Principe une tranchée de 30 cm de profondeur, rectiligne ou
incurvée, permet de conserver l’eau de ruissellement auprès d’arbres plantés au
milieu de cette même tranchée. Les arbres (espacés d’1m) résistent mieux à la
sécheresse. A utiliser pour de l’embocagement, la fixation biologique de
terrains pentus et comme source de production de bois de service.
Prérequis main d’œuvre disponible
Effets concrets permet la croissance des arbres dans un contexte
aride, favorise l’infiltration et protection des champs de culture en tant que
brise vent. Effets concret après 3 ans.
Coût matériel et main d’œuvre pour le creusage des tranchées,
production de plants. Environ 200 €/ha.
|

© CILSS/IREMLCD-2008
|

|


© CILSS/IREMLCD-2008
|
Le Système Vallerini (VS) utilise la
charrue Delfino inventées et brevetées par le Dr. Venanzio Vallerani avec le
fabricant Nardi. La charrue crée dans le sol un système de micro-bassins et de
sacs enterrés pour recueillir l’eau de pluie autant que d’autres ressources
disponibles (terre fine, matière organique, semences, etc.). Le VS adopte le
semis direct de plantes indigènes (éventuellement intégré par la
transplantation d’espèces provenant de pépinière) dont la germination et la
croissance sont dues à l’eau recueillie dans les micro-bassins. Source : http://www.vallerani.com/
Les jessour (sing. jesser) : Dans les zones arides de montagnes,
des petites digues en terre (ou en pierre) sont construites en série dans les
vallées secondaires pour capter le ruissellement et sa charge solide. Ces
digues permettent la formation progressive de terrasses plantées en arbres
fruitiers (palmiers, figuiers et oliviers dont les tiges supportent d'être
enfouies sous les sédiments) et semées en céréales et légumineuses (BoNvAunr,
1986). La digue (tabia) en terre compactée se construit soit manuellement, soit
avec des tracteurs.
Ce système peut être trouvé dans les régions plus arides (100 -. 200 mm
de précipitations) et les zones montagneuses.
Dans le lit des rivières saisonnières, des petits barrages de terre et
de pierres sont construits. Les substrats s'accumulent devant ces barrages
ainsi que dans les terrasses : du sol se forme progressivement sur 1 à 2 m
d’épaisseur. Sur les terrasses, l'eau d'inondation est retenue et filtrée dans
le sol. Cette eau supplémentaire fait que l'agriculture dans ces régions arides
est possible. Sur les terrasses, différents arbres fruitiers _ oliviers,
amandiers, dattiers, figuiers _, céréales et légumineuses sont cultivés.
Dans la région de Marmata où de nombreux jessours peuvent être
trouvés, la pluviométrie est très variable (80-700 mm/an) avec des intensités
de précipitations possibles de 220 ??mm/jour. Avec ce genre de pluie forte dans
les montagnes, le coefficient de ruissellement peut être très élevé (jusqu'à
0,9, avec une moyenne de 0,4). En fonction de ce coefficient, un impluvium est
nécessaire, qui est, en moyenne, 5 fois plus grand que la surface des terres
cultivées.
Les déversoirs sont en maçonnerie sèche et ont généralement une hauteur
d'un tiers de la hauteur des barrages. Les barrages et les déversoirs doivent
être construits très solides et l'entretien doivent être très cohérent pour
rendre le système agricole possible.
Également dans la région de Marmata, des agriculteurs émigrent,
recherchant de meilleures opportunités économiques. Les jessours, qui
ont besoin d'un apport très élevé de la main-d'œuvre, sont abandonnés avec les
mêmes conséquences que pour les meskats.
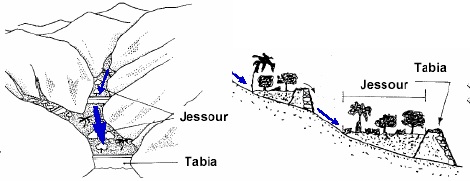
Vue et profil du "jessour", système
d'exploitation des eaux de ruissellement : le ruissellement de l'eau et des
sédiments de la campagne vallonnée sont capturés derrière les barrages («Tabia»)
dans le fond de la vallée.
|

Barrage détruit à cause d’un déversoir
[« spillway »] insuffisant.
|

Tabia à large digue.
|
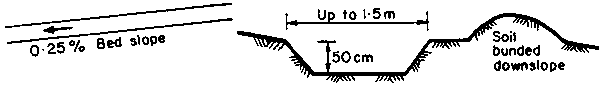
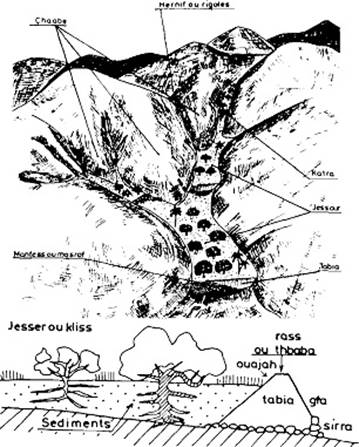
Vue et profil d’un "jessour", système d'exploitation
des eaux de ruissellement: le ruissellement de l'eau et des sédiments des
collines sont capturés derrière les barrages («Tabia») dans le fond de
la vallée.
|
Légendes :
·
Hernif ou rigoles
·
Chaabe
·
Katra
·
Jessour
·
Mantess ou masraf
·
Tabia
|
·
.Jesser ou kliss
·
Sédiments
·
Rass ou thababa
·
ouajah
·
tabia
·
gfa
·
sirra
|
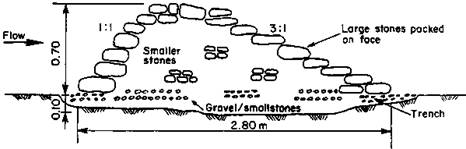
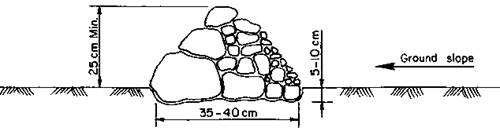
Johad (hindi : जोहड) :
cuvette
de stockage des eaux
de pluie utilisée principalement dans l'état de Rajasthan, en
Inde, qui recueille et stocke l'eau tout au long de l'année, à des fins de
consommation par les humains et le bétail. Dans de nombreuses parties de
l'état , la pluviométrie annuelle est très faible (entre 450 et 600 mm) et
l'eau peut être désagréable à boire. La pluie qui tombe en juillet et Août
est stockée dans les johads et utilisée tout au long de l'année. Ce sont des
barrières de boue et de gravats simples construits à travers le contour d'une
pente pour arrêter l'eau de pluie. Ces barrages de
terre sont destinés à capturer et à conserver l'eau de pluie, ce qui conduit à
l'amélioration de la percolation et la recharge des nappes. Ils sont
construits sur une pente avec un haut remblai sur les trois côtés tandis que le
quatrième côté est laissé ouvert pour laisser l'eau de pluie y
pénétrer. Ils sont très communs dans le désert
du Thar du Rajasthan. Les Johads ont été largement diffusés et
utilisés par l'ONG « Tarun Bharat Sangh ».
Sources: a) Traditional Practice of
Rainwater Harvesting, http://www.nepjol.info/index.php/HN/article/download/4229/3590
b) http://www.ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/india-rajasthan-rainwater-harvest-restoration-groundwater-johad.html
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Johad

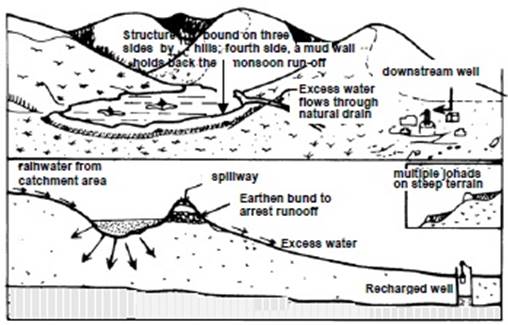
Légendes :
·
Structure liée sur trois côtés par des collines, le quatrième
côté étant un mur de boue retenant le ruissellement due à la mousson
·
Puits en aval
·
L'excès d'eau s'écoule naturellement vers une vidange
·
L'eau de pluie du bassin versant
·
Déversoir
·
Digue en terre pour arrêter le ruissellement
·
L'excès d'eau
·
Le puits rechargée
·
Multiples Johada sur un terrain escarpé
Une lavogne ou lavagne désigne
une petite dépression aménagée par l'Homme sur les causses (« plateaux calcaires ») pour collecter l'eau de pluie et abreuver le bétail, voire
lui-même à une époque plus ancienne. Appelées sotchs ou dolines, ces excavations naturelles ont été étanchéifiées par un
tapis argileux destiné à capter et à retenir les eaux
de ruissellement, puis pavées de pierres calcaires afin que
les onglons des brebis ne percent pas la couche d'argile. Les lavognes étant
essentiellement alimentées par les eaux de pluie et de ruissellement, leur
niveau varie en fonction des saisons.
Les retenues collinaires sont des ouvrages de stockage de l'eau
qui sont remplies par les eaux de surface, les eaux de ruissellement. Elles
peuvent être assimilées à des micro-barrages.
Lac collinaire : lac artificiel de petite ou moyenne
dimension, aménagé au dévers d'une colline, afin de recueillir les eaux de
ruissellement. Note : plutôt, les zones du « subhumide », où
la pluviométrie est supérieure à 500mm.
L'ouvrage, constitué d'une digue en terre ou maçonnée permet de retenir
l'eau dans un talweg,
une combe, un ravin, un vallon et de stocker une
part des écoulements d'eaux. Ces eaux sont utilisées ensuite dans les domaines
de l'irrigation agricole, la protection
incendie, les loisirs, la pisciculture et l’eau
potable. Ces petits barrages permettent d’accroître les ressources en eau
disponibles au cours de l'année. Ils doivent respecter certaines normes pour
leur construction (voir lien ci-dessous).
Les lacs collinaires (petits barrages), tout en étant un moyen courant,
efficace et économique de mobilisation des eaux de surface, sont destinés
généralement à développer l’agriculture locale. Ils peuvent avoir différents
objectifs tels que :
·
La création de points d’eau à usage domestique ;
·
L’amélioration de la nappe phréatique ;
·
La protection contre les inondations .
Le lac collinaire est un petit barrage en terre dont la hauteur de la
digue est généralement inférieure à 12 m et la capacité moyenne de la retenue
peut varier de 50000 m3 à un million de m3 pour les réalisations destinées
spécialement à l’exploitation agricole.
Sources :
a) http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/RDV/RDV13retenuescollinairessupports.pdf
,
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Retenue_collinaire
c) Evolution des techniques de conservation des eaux et des sols en
Tunisie, Mohamed BOUFAROUA, http://www.slire.net/download/1313/23-625-635.pdf
|

|

|
|

|

|
|

|

|
|

|

|
|

Retenue collinaire.
|

Lac collinaire dans la région nord Marocain installé pour
contrer le problème d'envasement d'un barrage en aval.
|
|

Ravin aménagé dans un champ de céréale : seuils en
pierres sèches.
|

Série de seuils.
|
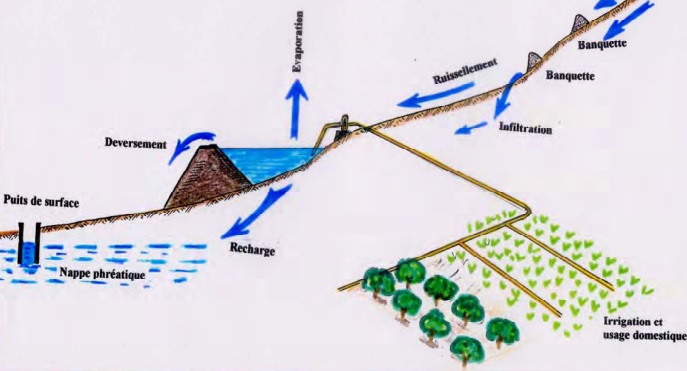
Schéma d’un lac collinaire (très semblable à un johad).
|

Le déversoir empierré absorbe l'énergie de l'eau en mouvement. Mais
il faut être attentif à l'eau qui se creuse un chenal sous les descentes enrochées
ou autour de celles-ci. Source : MAAARO.
|

La chute en arc de cercle fait franchir à l'eau une dénivellation
importante sans provoquer d'érosion. Source : MAAARO.
|
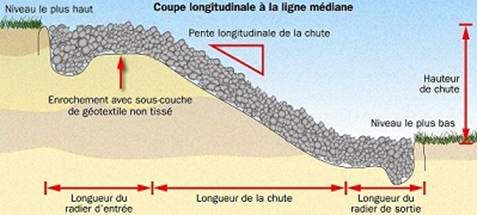
Déversoir enroché (coupe longitudinale). Source :
MAAARO.
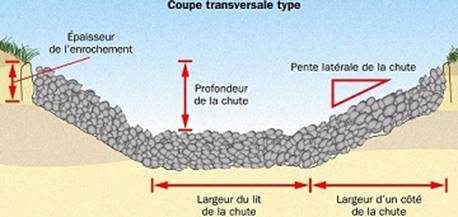
Déversoir enroché (coupe transversale). Source :
MAAARO.
Le gabion est un mur de pierre, très souvent dans une cage en grillage,
installé perpendiculairement à l’écoulement des eaux, la plupart du temps
utilisé dans les climats secs, voir aride et permettant de stopper l’érosion
des sols, les sédiments venants s’accumuler contre lui. Le gabion piège alors,
au fil des inondations ou des pluies importantes, d’énormes quantités de
sédiments. Ces couches de sédiments se superposent jusqu’à atteindre le haut du
muret et à former une terrasse. Une fois cette terrasse formée, elle sera
ombragée par une plantation d’arbres sur ses bordures. Plusieurs gabions
successifs sont possibles et ils existent sous de nombreuses formes. Le coût
d’une telle installation est faible et a permis de transformer des lieux arides
en oasis, en quelques années. Il est assez facile de fabriquer un gabion, voici
une méthode possible (source : http://www.permaculturedesign.fr/terrassement-en-permaculture/).
|

Fabrication des cages en grillages, n’oubliez pas les
grillages intercalaires. Source Milkwood Permaculture.
|

Remplissage avec des cailloux, source Milkwood
Permaculture.
|
Description : La matfia collective est composée de :
·
Un impluvium naturel plus ou moins aménagé : il coïncide avec le
versant qui surplombe la matfia. Dans le Rif, le toit de la matfia
(70 à 150 m2) est bétonné et utilisé comme impluvium, mais le plus
souvent ce sont les eaux ruisselant des pistes et d'un petit versant qui sont
captées ;
·
Un canal (assarou, séguia) de raccordement entre
l'impluvium naturel et la citerne ;
·
Un bassin de décantation des sédiments, une conduite d'eau
reliant le bassin de décantation à une ouverture perçant la dalle de la citerne
et un orifice pour puiser l'eau, muni d'un couvercle en fer ;
·
Une citerne (réservoir souterrain) creusée dans le sol,
construite en pierre et étanchéifiée par de la terre battue, de la chaux ou du
ciment. Les dimensions de cet ouvrage varient de 100 à 300 m3 en fonction du
nombre d'habitants et de la taille du troupeau à abreuver. Le toit est
construit avec des pierres moyennes ou avec des troncs d'arbres recouverts
d'une couche de terre ou de ciment pour former une toiture étanche. Un puits
muni d'une pompe ou d'un seau permet de puiser l'eau filtrée.
La matfia individuelle ou familiale est plus modeste : le toit
de la maison joue le rôle d'impluvium. La citerne prend la forme d'un réservoir
souterrain (joub) creusé dans la cour de la maison. Il est
imperméabilisé avec de l'argile battue mélangée à la chaux ou avec du ciment.
Objectifs
Les eaux stockées dans la matfia, collective ou individuelle,
sont destinées aux usages domestiques, à l'abreuvement de la famille et du
troupeau et parfois à l'irrigation d'appoint d'un petit jardin en zones
semi-arides et arides. Lorsque la saison sèche dure longtemps, la matfia
ne suffit pas, et il faut la remplir à l'aide de camions citernes. De façon
indirecte, la matfia réduit les risques de ravinement en aval.
Coût d'installation
L'installation d'une matfia demande un investissement important. Le
coût varie en fonction de la taille de l'ouvrage et des matériaux utilisés. Les
travaux sont généralement réalisés dans le cadre d'une entraide sociale ou avec
les subsides de l'État. Le coût de construction d'une matfia collective d'une
capacité de l'ordre de 350 m3 varie de 10 000 Dm (en terre battue + chaux +
toit en bois) à 20000 Dm dans le cas de l'utilisation de matériaux modernes (ciment,
barres en fer à béton). Les citernes familiales traditionnelles (50 à 100 m3 de
volume) coûtent nettement moins cher.
Suivi et entretien de la matfia collective (voir ci-après) :
- Déviation des eaux des premières pluies qui sont souvent polluées et
trop chargées de sédiments.
- Nettoyage de la vase qui s'accumule au fond des citernes (fréquence:
1 fois par an pour les citernes à impluvium constitué de formations tendres, 1
fois tous les 3 ou 4 ans pour les citernes cimentées).
- Changement du seau utilisé pour puiser l'eau (fréquence 1 fois par
an) et entretien de la pompe.
Pour les matfia individuelles qui captent seulement l'eau des
toitures, le toit est régulièrement nettoyé avant les périodes pluviales. Le
curage se fait une fois tous les 3 ou 4 ans.
Avantages
- Stockage de l'eau et utilisation différée
- Approvisionnement en eau domestique
- Amélioration des conditions d'hygiène de la famille
- Rôle majeur dans la pérennisation des activités pastorales
- Permet la fixation de la population dans le milieu rural
- Diminution des risques de ravinement et d'inondations
- Ouvrages enterrés donc discrets, à faible emprise foncière
- Réduction de la corvée de l'eau.
Inconvénients
- Volume insuffisant pour les besoins annuels
- Problème sanitaire: stockage trop long ou puisage par les enfants peu
soigneux
- La corvée d’eau prive les filles de l'école
- Entretien difficile si accès difficile
Sources : a) Les techniques traditionnelles de gestion de l'eau, de
la biomasse et de la fertilité des sols, Mohomed SABIR, Éric ROOSE &
Jomol AL KARKOURI, Chapitre 6, page 139, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-09/010054917.pdf
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Citerne
(voir aussi définition d’une citerne dans le glossaire).
|

|

|

|
|

Matfia dans l'Atlas.
|

Matfia dans l'Atlas
|
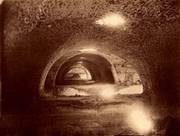
Citerne traditionnelle collective (ici à La Malga).
|
|
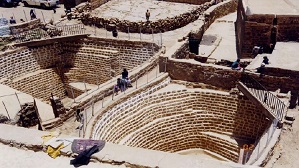
Citerne
traditionnelle au Yémen
|

Construction d’une
citerne en Syrie
|
|
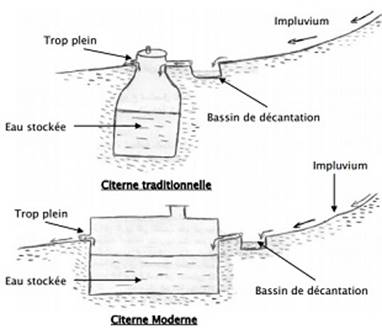
Construction de citernes de quelques m3 à quelques dizaines de m3 de
capacité pour collecter et stocker les eaux pluviales pour l’alimentation en
eaux potables et pour l’abreuvement du cheptel dans les zones rurales et dans
les parcours.
|

Citerne pour la collecte des eaux pluviales pour
l'alimentation en eau potable (zone de Ksar Jedid - Medenine - Tunisie).
|
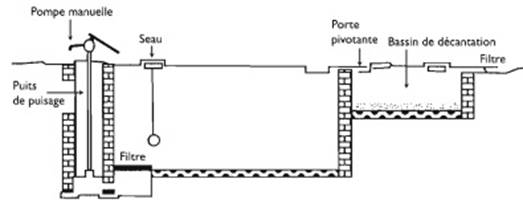
Une matfia étatique (makhzen) (d'après EL FASSKAOUI,
2007).
C’est une diguette en forme de demi-lune (diamètre de 2 m à 6 m) qui
permet de concentrer le ruissellement et sa charge en suspension sur des
arbustes ou des cultures en poquets. L’extrémité de la diguette peut être
protégée par des cailloux.
Le cordon pierreux et la demi-lune ont permis la recolonisation totale
du sol nu par une végétation herbacée, au bout de deux ans (Van der Pool et
Kaya, 1991, cités par DRSPR, 1992).
Une autre technique de piégeage des eaux de surface consiste à creuser
des cuvettes de plantations d'arbres (fruitiers ou autres) et de les entourer
de bourrelets en demi-lune faits de terre tassée, souvent recouverte de
pierres. Leurs diamètres varient de 0,50 à 2 m et la profondeur de 15 à 25 cm.
Les bourrelets ont une hauteur de 15 à 25 cm et une largeur moyenne de 25 cm.
Ils peuvent être renforcés par des pierres issues de l'épierrage du champ. Les
cuvettes sont disposées en quinconce et espacées de 4 à 10 m. Elles sont
ouvertes face au sommet de la pente pour capter le ruissellement produit par
les impluviums souvent constitués de terrains peu perméables, incultes ou
rocheux, voués au parcours extensif des troupeaux. Les espacements entre les
lignes sont variables (de 7 à 15 m) selon le type d'arbre, la pente du terrain
et l'aridité.
Source : L'eau et les hommes au Maghreb: contribution à une politique
de l'eau en Méditerranée, Jean Jacques Perennes, KARTHALA Editions, 1993.
Principe on creuse une cuvette en demi-cercle. La terre de
déblais est déposée en un bourrelet qui récupèrera l’eau de ruissellement. On
dispose les demi-lunes en quinconce avec 4m d’entrelignes. Mélangée à de la
fumure, la terre de la cuvette conservera l’humidité.
Pré requis disponibilité de main d’œuvre, fumure et petit
matériel agricole. Déconseillé au-delà de 600 mm de précipitations.
Effets concrets remise en culture de terres pauvres (céréales,
pâturages, forêts). Effet dès la première année. La combinaison demi-lune et
fumure produit d’environ 1T/ha de sorgho grain.
Coût petit matériel pour creuser, niveau à eau et charrette pour
amener le fumier. Environ 75€/ha.
|

Les micro-bassins : demi-lunes et cuvettes.
|
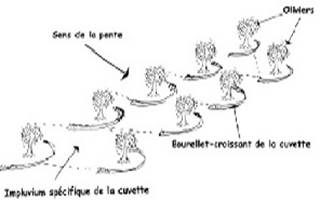
Cuvette individuelle avec impluvium (système Meskat ou Meskal).
Légendes : Sens de la pente, Oliviers, Impluvium spécifique de
la cuvette, Bourrelet croissant de la cuvette.
|
Ce sont micro-bassins versants, en forme de diamant, fermés par de petites
digues de terre, avec un puits d'infiltration dans le coin le plus bas.
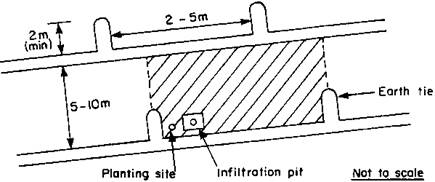
Légende : Site de plantation, Fosse d'infiltration,
butte de terre (pas à l’échelle).

C’est une seule rangée de pierres plantées dans le sol pour ralentir le
ruissellement, piéger des particules (limon et matière organique) transportées
par le ruissellement ainsi que des sables éoliens.
Des pierres dégagées par les labours sont empilées sans structure particulière
sur de gros rochers, puis alignées en cordons le long des courbes de niveau. De
tailles très variables, elles sont parfois également déposées directement sur
le sol et empilées progressivement selon leur disponibilité. Ces empilements
donnent naissance à des cordons continus ou discontinus selon l'importance de
la charge caillouteuse des champs. Ils ont une largeur de 30 à 70 cm et une
hauteur variable selon la pente (de 30 à 100 cm), et peuvent former des
terrasses progressives qui tendent vers l'horizontale sans jamais l'atteindre.
Cordons pierreux
Principe de petits murets de pierre de 25 cm de haut sont
construits suivant les courbes de niveau de la parcelle, pour des pentes
faibles à moyenne sur sols sablo-argileux ou gravillonnaires, à moins de 800mm
de pluies. Le ruissellement des eaux est ralenti, l’infiltration augmente et
l’eau est mieux répartie. Cela favorise aussi la sédimentation et la
conservation des amendements.
Prérequis disponibilité de main d’œuvre et de pierres d’au moins
1 dm3 en quantité et à une distance raisonnable.
Effets concrets couplé à la fumure organique, améliore de 20% au
moins les rendements de céréales. Améliore la production de fourrage d’au moins
20%.
Coût matériel de concassage des pierres & de mesure de la
pente, camion et charrettes pour transport des pierres, Selon la distance des
carrières, le coût à varie de 130 à 250 €/ha.
Le cordon pierreux a un effet positif sur les débits de pointe,
l’étalement des écoulements et les risques d’érosion (Roose, 1994). Son influence
sur le ruissellement global reste mitigée.
Avantages
- Valorisation de la terre par le déblaiement des grosses pierres de
surface.
- Récupération des eaux et des sédiments à partir d'un impluvium.
- Amélioration de la productivité des terres.
Inconvénients
- Demande une main d'œuvre importante, mais construction progressive en
5 à 10 ans.
- Difficulté de circulation à l'intérieur des parcelles.
- Perte de surface de culture principale, mais diversification possible
par introduction d'arbres sur les cordons.
Murets ou murettes
Ils sont formés de deux à trois niveaux de pierres solidaires, de 10 à
50 cm de hauteur, disposés en courbe de niveau tous les 10 à 50 m. Ils peuvent
être consolidés par des herbes ou des haies vives. Ils permettent l’étalement
des eaux de ruissellement et la sédimentation (5 à 15 cm de sable, limon et
matière organique).
Les cordons et les murettes sont là les formes d’une technique élaborée
qui demandent un investissement humain important et qui répondent à des besoins
en terres cultivables dans des situations particulières de pénurie d’eau ou du
sol.
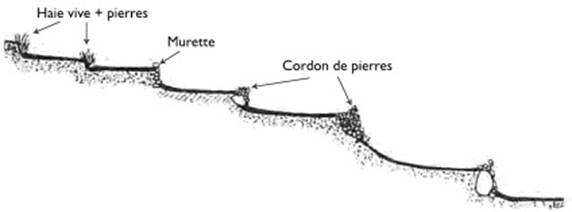
Légendes : Haie vive + pierre, Murette, Cordon de
pierres.
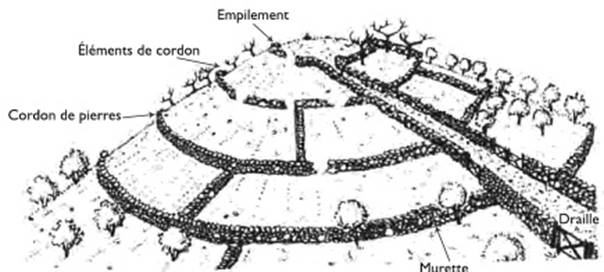
Légendes : Cordon de pierres, Eléments de cordon,
Empilement, Murette.
|


© CILSS/IREMLCD-2008
|

Murette.
|
|
 
Des participants au programme construisent un cordon de pierre pour
intercepter les eaux de ruissellement et les faire pénétrer dans le sol afin
qu'elles ne se perdent pas.
|

|
C’est une cuvette (20 cm à 40 cm de diamètre et 10 cm à 15 cm de
profondeur) qui capte le ruissellement à partir d’un impluvium de 5 à 20
fois la surface travaillée.
Les cuvettes sont creusées tous les 80 cm à 100 cm. Les trous étant
faits pendant la saison sèche, ils piègent des particules apportées par le vent
: sable, limon, matières organiques. Dès les premières pluies, une à deux
poignées de matière organique (1 t ha-1 à 3 t ha-1) apportées à chaque trou
favorisent l’activité des termites (du genre Trinervitermes), qui creusent
des galeries. Généralement, une douzaine de graines de sorgho sont semées
en poquet pour leur permettre de soulever la croûte sédimentaire, qui s’y forme
lors des premières averses (Roose et al. 1993).
Ce système a été utilisé avec succès pour réintroduire la jachère arbustive
et un système agro-sylvo-pastoral, disparu suite à l’usage intensif de la
charrue.
Le zaï + fumure améliore le rendement du sorgho au Burkina : 900 kg
ha-1 contre 300 kg ha-1 pour le témoin (Roose et al., 1993). Mais cette
technique est d’une grande pénibilité.
Principe des trous d’une trentaine de cm de profondeur sont
creusés en quinconces tous les mètres sur un sol dégradé (nu, endurci,
encroûté). Le trou est enrichi de fumure/compost. Ce trou ameubli va conserver
l’eau de ruissellement et permettra la croissance optimale des plantes et la
conservation de l’humidité.
Prérequis disponibilité de main d’oeuvre et de fumure. Ne
convient pas aux sols très sableux ni aux bas-fonds. Déconseillé au-delà de
800mm de précipitations.
Effets concrets récupération de terres nues (céréales, fourrage
ou boisement) et régénération du potentiel productif. Effet dès la première
année. Couplé aux cordons pierreux, permet de collecter 800 kg de grain/ha.
Coût petit matériel pour creuser et charrette pour le transport
du fumier. Environ 75€/ha.
|

|

© CILSS/IREMLCD-2008.
|

© CILSS/IREMLCD-2008
|
|

|

Sorghos plantés dans des poquets
|
Irrigation : Techniques permettant d’irriguer c’est-à-dire
d’apporter de l’eau aux cultures sur un territoire où elle manque. L’irrigation
nécessite donc l’utilisation de pompes, de tuyaux, de canaux, le creusement de
puits, etc. On parle aussi de cultures irriguées pour désigner les champs qui
apparaissent parfois dans les déserts, suite à l’apport d’eau.
On peut distinguer plusieurs
techniques d’irrigation, plus ou moins économes
en eau (ou à risque de salinisation, etc.), outre l'arrosage manuel (arrosoir, seau, etc.) réservé aux très
petites surfaces, dont les techniques par : a) écoulement de
surface, b) aspersion, c) micro-irrigation ou irrigation localisé (goutte à
goutte ...), d) submersion, e) abissage (dérivation d'un cours d'eau).
Écoulement de surface ou irrigation gravitaire
L'irrigation de surface (« irrigation par sillons », « à la raie » ou «
gravitaire »), utilise la gravité via un réseau de canaux et rigoles de taille
dégressive. L'arrosage lui-même s'effectue ensuite par ruissellement, par submersion
ou par infiltration dans le sous-sol proche des cultures.
Asperseur
Cette technique consiste à imiter l'effet des précipitations : l'eau,
acheminée sous pression par des tuyaux flexibles, est propulsée en l'air sous
forme de gouttelettes, lesquelles retombent sur les cultures autour de chaque
asperseur. La technique peut être déclinée en micro-aspersion, semblable à la
précédente mais plus localisée donc plus économe en eau.
Micro-irrigation ou irrigation localisée
La micro-irrigation consiste à acheminer l'eau jusqu'aux racines des
plantes, de manière très localisée et uniquement à la quantité nécessaire, ce
qui permet en outre d'éviter le ruissellement source de pertes de minéraux et
nutriments solubles. C'est un enjeu majeur en zone aride3 et d'oasis4. Dans le
contexte du réchauffement climatique, elle devient un enjeu important.
Submersion
L'irrigation par inondation ou submersion consiste, comme son nom
l'indique, à recouvrir d'eau la parcelle. C'est la technique appliquée dans les
rizières ; c'est aussi celle qui fertilisait l'Égypte par les crues du Nil.
Abissage
Cette technique consiste à dériver un cours d'eau dans une rigole en
vue de l'amener en amont des prairies à irriguer.
|

Irrigation
par aspersion d'un champ de maïs dans la vallée de la Méouge.
|

Irrigation
à pivot central du coton aux États-Unis.
|

La plaque
tournante d'un système d'irrigation à pivot central
|
|

Fuites
dans les lignes de goutte à goutte de micro-irrigation
|

Canal
d'irrigation à Osmaniye, Turquie.
|

Irrigation
par aspersion des bleuets à Plainville,
New York ,
États-Unis.
|
|

Irrigation
au Tamil
Nadu, Inde
|

À l'intérieur
d'un tunnel karez (appelé Qanats en Iran), à Turpan, Xinjiang, Chine
|

Irrigation par inondation du bassin du blé.
|
|
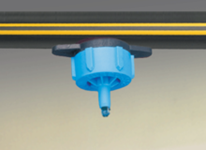
Irrigation
goutte à goutte – un goutteur en action.
|

Micro-arroseur.
|

Arroseurs
de cultures près de Rio
Vista, Californie ,
États-Unis.
|
|

Arroseur
applicateur à pivot de style rotateur.
|

Pivot
central avec gicleurs à goutte
|

Un
arroseur itinérant au Millets Farm Centre, Oxfordshire, Royaume-Uni.
|
|

Depuis des siècles ou millénaires, des canaux d'irrigation (ex. : «biefs») ont été construits presque
perpendiculairement aux pentes pour transporter l'eau, parfois dès la haute
montagne.
|

Canal
d'irrigation en Anatolie.
|

Technique plus économe en eau, par siphonage de l’eau
d’un canal d’irrigation gravitaire vers le champ.
|
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Irrigation
Nous nous intéresserons, dans notre ouvrage, uniquement aux systèmes
de micro-irrigation ou irrigation localisé (goutte à goutte ...), les plus économes
en eau (voir ci-dessous). Pour les autres techniques, voir l’article de
Wikipedia sur l’irrigation.
Chaque homme a besoin de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour. Or dans
certaines régions de l’Inde, l’eau est rationnée à 5 litres d’eau par femme du
foyer et par jour. Il faut donc savoir économiser l’eau. Il faut cultiver que
les plantes alimentaires qui vous sont indispensables et qui demandent peu
d’eau : tournesol, sorgho, lentille (appelé dal en Inde), mil, lin,
arachide, raisin (figuier) … Plutôt que d’utiliser l’irrigation gravitaire (ou
de surface), l’irrigation par aspersion ou de répandre l’eau dans le champ,
avec un seau ou une calebasse, mieux vaut utiliser des bidons percés, ou
mieux des arrosoirs, ou un système de goutte à goutte simplifié (utilisant
un bidon ou baril surélevé, contenant l’eau, et des tuyaux percés la diffusant
_ voir page suivante). Quand cela est possible, pailler le sol, pour
éviter qu’il se dessèche (voir page suivante) … Et mieux vaut arroser à la tombée
du jour.
|

Irrigation gravitaire (à éviter)
|
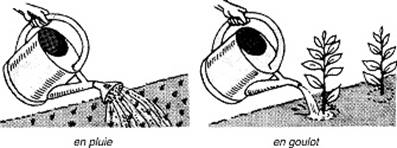
Arrosage avec et sans pomme
|
|

Calebasse (pénible).
|
  
a) à
gauche : Solution du seau ou du bidon percé
b) à
droite : Arrosoirs (image de droite : Thomas Koehler).
|
C’est une méthode d'irrigation utilisée
en zone aride car elle réduit au minimum l'utilisation de l'eau et de l'engrais. L'eau s'égoutte
lentement vers les racines des
plantes soit en coulant à la surface du sol soit en
irriguant directement la rhizosphère par
un système de tuyaux, on peut alors parler de goutte-à-goutte enterré. Sources
: a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-irrigation,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Drip_irrigation
La technologie moderne d'irrigation par goutte à goutte a été inventée
en Israël par Simcha
Blass et
son fils Yeshayahu. Au lieu de libérer l'eau par des trous minuscules,
facilement obstrués par des particules minuscules, l'eau est libérée par des
passages plus grands et plus longs en employant le frottement pour ralentir
l'eau à l'intérieur d'un diffuseur en plastique (buse).
La plupart des grands systèmes d'irrigation par goutte à goutte
utilisent un certain type de filtre à eau pour empêcher l'obstruction du petit
tuyau d'écoulement.
Ces systèmes « goutte à goutte » sont nettement plus
efficaces et économes que les méthodes d’irrigation traditionnelles, mais plus
coûteuses. Les systèmes de goutte à goutte « industriels », à grande
échelle, peuvent être complexes, dans leur organisation, montage et mise en
œuvre.
Pour comprendre les termes utilisés dans les techniques de l’irrigation
« goutte à goutte », voir ce lexique de ces termes : Cf. Termes
technique utilisé dans le domaine de l'irrigation, https://www.mon-irrigation.com/blog/16/Lexique-irrigation-professionnelle.html
|
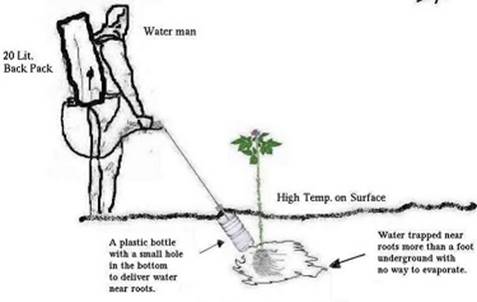
Goutte à goutte simplifié avec une bouteille enterrée.
Légendes : Un pack dans le dos avec 20 litre. Le porteur d’eau.
Une bouteille plastique avec un petit trou dans le bas, afin de délivrer de
l’eau près des racines. Hautes températures en surface. Eau piégée près des
racines, à un peu plus d’un pied sous terre, sans possibilité de
s'évaporer.
|

Goutte à goutte dans une vigne du Nouveau-Mexique, 2002.
|
|
 
Diffuseur ou buse en plastique.
|

|
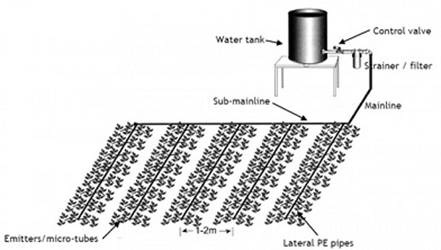
Un goutte à goutte faible coût
Légendes (voir image ci-avant) : Réservoir d’eau. Vanne de
contrôle. Filtre épurateur. Canalisation principale. Canalisation secondaire.
Micro-tubes émetteurs/diffuseurs/goutteurs. 142 m. Tuyaux PE latéraux.
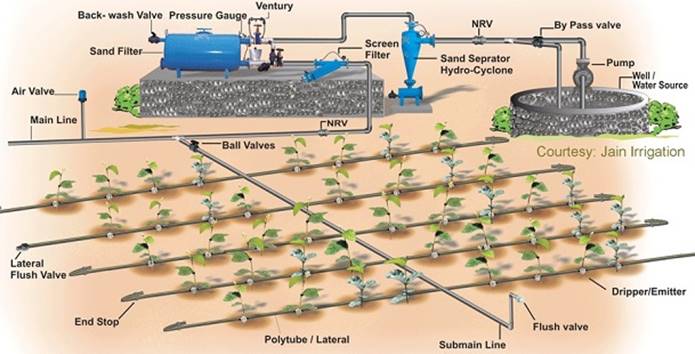
Système d'irrigation au goutte à goutte (plus élaboré.
Exemple).
Légendes : Soupape (valve) de contre-lavage. Jauge de pression.
Venturi (système pour accélérer le débit, par effet Venturi). Filtre à sable.
Valve (ou vanne ou robinet ?) aérienne (ou à air ?). Canalisation
principale. Filtre : crible. Robinet à tournant sphérique. Séparateur de
sable. Vanne de dérivation. Pompe. Puits / Source d’eau. Robinet d’évacuation
latérale (chasse). Bouchon d’arrêt. Polytube / latéral. Canalisation secondaire.
Robinet d’évacuation. Emetteur/goutteur (buse). Remerciement à Jain irrigation.

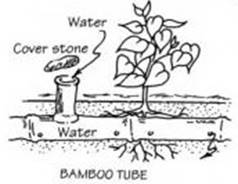
Un système d’irrigation maison en Afrique avec un seau à eau, réservoir
et tuyaux en plastique simples pour la distribution. Si bambou est disponible,
il peut être utilisé en tant que tuyaux de distribution. Source: STANDISH
(2009) et INFONET-BIOVISION (2010). Légendes : Pierre de couverture
(d’obturation). Tube en bambou. Eau.
Les systèmes de goutte à goutte très simples peuvent être construits
avec des matériaux locaux disponibles. L'aide de seaux ou des barils
d'eau, servant de réservoir et
le bambou ou des tubes en PVC, servant de tuyaux de distribution, tout le monde
peut construire un système d’irrigation
très efficace. Si les
eaux usées sont utilisés, une unité de filtration après
l'installation de traitement est recommandée pour éviter le colmatage des
émetteurs/goutteurs.
|

Différents modèles de buses d'arrosage goutte-à-goutte.
|
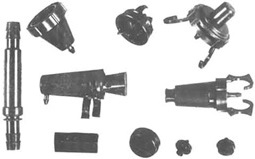
Divers modèles d’émetteurs, de diffuseurs
|

Un kit agricole, à bas coût, avec un réservoir 1000 litres d'eau peut
desservir jusqu'à un huitième d'acre ~ 500 m2. Source: IPTRID
(2008).
|
|
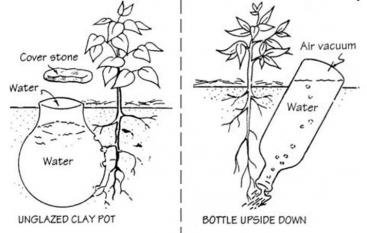
A gauche: méthode d’irrigation avec un pot en
terre. A droite: méthode d’ irrigation avec une
bouteille, qui est aussi efficace et simple. Les bouteilles peuvent être
trouvés partout dans le monde. Source: INFONET-BIOVSION (2010).
Légende : A gauche : Pierre d’obturation. Eau. Pot en terre cuite
non émaillé. A droite : Vide d’eau. Bouteille à l’envers.
|
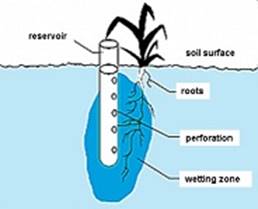
Procédé de manchon en plastique qui n'a pas été testé de manière
systématique et par conséquent il est difficile d'évaluer ses
performances. Source FAO-1997.
Légendes : Réservoir. Surface du sol. Racines. Perforations.
Zone humide.
|
|
|
|
|
|

Irrigation par bouteilles.
|

Irrigation par bouteilles.
|
 . .
Irrigation par bouteilles.
|
|

Micro-irrigation (goutte à goutte) par tuyaux et buses.
|

Irrigation par bouteilles.
|

Irrigation par bouteilles.
|
|

Chaussette d’irrigation Irrigasc.
|


La chaussette d’irrigation Irrigasc,
Micro-perforée.
|

Gaine ou chaussette d’irrigation Irrigasc.
|
|

Bidon placé en hauteur.
|

Irrigation au goutte-à-goutte utilisant un tonneau et
deux lignes d'irrigation par planche (source Agrodok 9).
|
Un filet capteur de brouillard consiste à récupérer
les fines gouttelettes d'eau contenues
dans les nuages et la brume grâce à un long filet constitué de mailles très
fines. Cette méthode est expérimentée pour le moment surtout dans des pays
comme le Chili et le Pérou, où l'accès à l'eau potable demeure difficile et le
brouillard, venant de la mer, régulier (Elle pourrait être expérimentée le long
de la Côte des Squelettes en Namibie). Un filet de polypropylène, possédant une
résistance aux rayonnements ultra-violets, est tendu horizontalement et
maintenu en place par deux montants verticaux fixés au sol, devant intercepter
le vent dominant. Lorsque les nuages rencontrent des capteurs de brouillard sur
leur passage, les gouttelettes d'eau qu'ils contiennent se déposent sur les
mailles du filet. L'eau est ensuite acheminée dans des canalisations, par
l'intermédiaire de gouttières placées en dessous du filet, avant d'être stockée
dans un réservoir. Les mailles de polypropylène des filets parviennent, en
moyenne, à capter 30% de l'humidité du brouillard, ce qui équivaut à un volume
de 17 à 42 litres d'eau par mètre carré de filet installé et par jour. Sources
: a) http://fr.ekopedia.org/Filet_capteur_de_brouillard,
b) www.naturalaqua.es
|

Des capteurs de brouillard au Pérou.
|

Filetàa nuage au Chili.
|
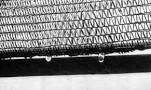
Vue de la goulotte qui recueille l’eau condensée.
|
|

Un filet à brouillard installé dans le village de Danda
Bazzar (Népal), à 2130 mètres d'altitude. Les filets alimentent trois
réservoirs de 1000 litres.
|

La gouttière ou goulotte permettant de récolter l’eau
gouttant le long du filet,
|


Il faut que les filets soient solidement arrimés au sol.
Des filets à nuages sur la crête d’El Tofo (Chili)
[un mauvais choix], Stephen Dale, IDRC.
|
|

La gouttière ou goulotte (grise) récoltant l’eau gouttant
du filet.
|

© Association Dar Si Hmad pour le développement,
l’éducation et la culture (Maroc).
|

Attrape-brouillard à Tenerife, pour l’alimentation en eau
d’une étable.
|
|

Natural Aqua (Canaries).
|

Le projet est composé de 600 m² de filets capteurs,
deux citernes de 500 m3, un puits de forage, 9.000 m de
canalisation et 20 branchements domestiques, au sommet du Boutmezguida
(Maroc).
|
De vastes régions dans le monde contiennent beaucoup de sel dans le
sol, du fait de la brise marine salée, parce que ce sont d’anciens bassins
océanique ou des lacs asséchés. Très peu de plantes peuvent tolérer des sols
salés. Si le sel, enfoui sous les racines, y demeurait, le problème serait
moindre. Mais deux processus peuvent le conduire à la surface, a) la
salinisation par irrigation et b) la salinisation des terres sèches.
Le sol est considéré comme salé si la concentration en sel dépasse 1 à
2 %, dans ses 20 cm supérieurs.
Salinisation par irrigation :
•
La salinisation par irrigation peut survenir dans les régions
sèches ou les pluies sont trop faibles ou trop peu fiables pour l’agriculture ;
l’irrigation y est nécessaire.
•
Si un agriculteur pratique le « goutte à goutte », de sorte que
coule seulement l’eau que l’arbre ou les racines de la culture peuvent
absorber, l’eau est peu gaspillée, sans effet néfaste.
•
Mais si l’agriculture suit la pratique courante de « l’irrigation
par émission », c’est à dire noie la terre ou utilise un tourniquet qui diffuse
l’eau sur une vaste zone, le sol est vite saturé du fait qu’il reçoit plus
d’eau que les racines n’en peuvent absorber. L’eau excès s’infiltre vers la
couche plus profonde de sol salé, ce qui crée une colonne continue de sol
humide [capillarité] par laquelle le sel situé en profondeur peut remonter
jusqu’aux racines et à la surface, interdisant la croissance de plantes autres
que celles qui tolèrent le sel, ou bien encore descendre vers les eaux
souterraines, et passer de là dans les rivières.
Salinisation par assèchement des sols :
•
Elle apparaît dans les zones où les pluies sont suffisantes pour
l’agriculture. Tant que le sol reste recouvert par la végétation primitive et
permanente, les racines des plantes absorbent la plus grande partie de la pluie
en sorte qu’une faible quantité s’infiltre à travers le sol jusqu’aux couches
salées profondes.
•
Si l’agriculture défriche cette végétation et la remplace par des
cultures récoltées à certaines saisons, cela laisse le sol à nu une partie de
l’année : la pluie qui trempe le sol nu pénètre jusqu’au sel en profondeur,
lequel en retour, se diffuse à la surface. Source : Effondrements, J. Diamond,
Gallimard, 2006, page 459.
•
Les terres peuvent aussi se saliner, si l’on pompe dans une nappe
aquifère trop proche de la mer (ce qui attirera l’eau salée dans la nappe
phréatique).
•
Le monde perd en moyenne 10 hectares de terres cultivables par
minute dont 3 ha (plus de 1,5 Mha par ans) à cause de la salinisation
(Kovda, 1983).
•
Aujourd’hui, on estime à près de 400 Mha les terres
affectées par la salinisation (Bot, Nachtergaele & Young, 2000).
•
En Afrique: Près de 40 Mha sont affectés par la salinisation,
soit près de 2% de la surface totale.
•
Au Proche-Orient: Près de 92 Mha sont affectés par la
salinisation, soit environ 5% de la surface totale.
Source : http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Salinisation_irrigation.pdf
|
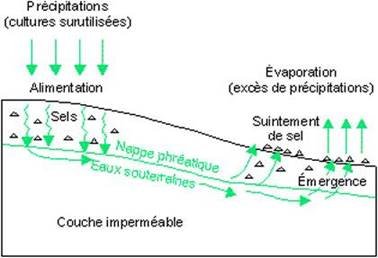
Mécanisme de salinisation des sols des terres basses (en
bas de pente), due à une irrigation excessive © Claire König, www.futura-sciences.com

|


Efflorescence de sels, à la surface du sol (remontée de
sels).
© AGRIRESEAU, Canada.
|
Solutions au problème de la salinisation
1) Bonne gestion des eaux et des écoulements
Une bonne gestion des ressources en eau implique à la fois que l'on
empêche l'eau reçue dans les aires d'alimentation de percoler (diffuser) dans
les eaux souterraines et que l'on maintienne à un niveau bas et sûr la nappe
phréatique dans la zone d'émergence.
Les coûteuses solutions mécaniques, tel l'aménagement de réseaux de
drainage souterrains, doivent être réservées aux terrains les plus touchés.
2) Bonnes techniques culturales
Le choix de méthodes culturales, visant la restauration de sols
salinisés, dépend de la gravité de la salinisation, de son étendue et des
caractéristiques locales. Il faut généralement privilégier une approche
biologique, en faisant appel à des régimes particuliers d'assolement et de
travail du sol.
On peut empêcher l'eau de s'infiltrer dans le sol des zones d'émergence
en dérivant l'eau de surface vers des étangs situés au bas des pentes. Les
cultures fourragères et les plantes vivaces, la luzerne, peuvent jouer un rôle
utile, en raison de leur saison de croissance plus longue et de leur capacité
d'absorber une plus grande quantité d'eau que les plantes annuelles et ce, à
une plus grande profondeur. Ainsi, les cultures fourragères empêchent
l'accumulation d'eau souterraine, abaissent la nappe phréatique et assèchent le
sous-sol. En outre, elles accroissent la teneur en matière organique du sol et
en améliorent la structure, ce qui réduit le risque d'érosion.
Ensemencer des cultures tolérantes au sel dans les terrains ou la
gravité de la salinisation est raisonnable.
Réduire la mise en jachère par la culture continue (terrains peu
salins) ou par l'établissement d'une couverture végétale permanente et de
cultures tolérantes au sel (secteurs à risque élevé ou salinisation grave).
Réduire le travail profond du sol par l'adoption de non-labour. Planter
des cultures fourragères ou des arbres près des plans d'eau pour
favoriser l'absorption de l'eau du sol. Retourner au sol le fumier et les
résidus de culture : un sol riche en matière organique pourra retenir
davantage d'eau. Prévenir la formation de flaques au printemps. Installer
des réseaux de drainage artificiels en certains endroits si nécessaire.
Eliminer les infiltrations d'eau dues aux canaux d'irrigation, aux mares
artificielles et aux étangs. Inciter les agriculteurs à établir un couvert
végétal permanent sur leurs terres marginales ou à transformer ces dernières en
habitats pour la faune.
Source : Cours
d'hydrologie
du Prof. Musy, EPFL, Lausanne, http://echo2.epfl.ch/e-drologie/general/tdmchapitres.html
Elles sont constituées de deux ou trois lignes d’herbes (Andropogon ou
Pennisetum) ou d’arbustes plantés en quinconce.
Les haies vives permettent :
·
De délimiter des parcelles (par exemple, composées d’arbres
fruitiers (jujubiers …), de cactus …).
·
De protéger des cultures contre le broutage par des herbivores,
si elles sont défensives et épineuses.
·
De protéger des biens contre le vol, si elles sont défensives et
épineuses.
·
De fournir de la nourriture, si les arbustes, qui la constituent,
sont fruitiers.
·
De fournir du nectar aux polinisateurs (abeilles …), si les
arbustes sont mellifères (Senna corymbosa …) …
Principe On réalise tout autour des parcelles des plantations en
quinconce sur deux lignes avec des écartements de 0,25m ou 0,30m. Les espèces
les plus aptes et les plus couramment utilisées dans le Sahel sont Acacia
nilotica, Acacia senegal, Ziziphus mauritiana, Bauhinia
rufescens, Cassia sieberiana (photo), voire Acacia
nilotica ...
Prérequis disponibilité d’un point d’eau permettant l’arrosage et
d’une mobilisation de la population contre la divagation animale.
Effets concrets diminution du ruissellement et des érosions hydrique
et éolienne; protection des champs de culture contre les animaux au bout de 3-4
ans (embocagement) et production des biens et services (bois, fourrage, fruit).
Coût petit matériel de pépinière et plants. Environ 350 €/ha.
Avantages et inconvénients
Impacts environnementaux positifs de la plantation des haies
•
Amélioration du microclimat (effet de brise-vent).
•
Réduction de l'érosion hydrique et éolienne.
•
Amélioration de l'infiltration d'eau de pluie.
•
Augmentation de la biodiversité des plantes et des animaux (de
nombreuses espèces spontanées dans la haie qui est l'habitat de différentes
espèces).
•
Fait partie de la diversité du paysage.
•
Amélioration de la gestion et la rotation des pâtures.
•
Certains types de couverture peuvent inclure des espèces
économiquement productives, arbres fruitiers (par exemple pruniers
(Europe), sisal, agrumes (pays chaud) etc.) …
Les impacts environnementaux négatifs
•
Concentration des oiseaux prédateurs (dans certaines régions).
•
Présence de serpents et autres animaux nuisibles ou dangereux
(pays chauds).
Impacts sur la productivité du bétail
•
Optimisation de la gestion des pâturages, donc une meilleure
production de viande.
•
Amélioration du confort des animaux de pâturage, avec un impact
positif sur leur santé et leur croissance (la haie offre de l’ombre, de la
nourriture au bétail etc.).
•
Réduction des risques de conflits entre éleveurs et agriculteurs,
mais la haie réduit légèrement les superficies en herbe ou des cultures.
Ampleur et conséquences de la destruction des haies et bocages
La modernisation et l'intensification de l'agriculture _ le désir
d’augmenter la taille des parcelles par soucis de rationalisation » _, la
vulgarisation de l'emploi de la tronçonneuse, le manque de considération pour
le patrimoine paysager ont entraîné partout en Europe une importante régression
des bocages depuis le début des années cinquante. En France, 600.000 km de
haies ont été arrachées entre les années 60 et 90, soit la moitié du linéaire
de notre pays (Baudry, 2003), et cela malgré les conséquences déjà bien connues
à cette époque (érosion des sols, pollution des cours d'eau par les pesticides
d'origine agricole, inondations, etc.). Depuis, un mouvement se dessine pour
replanter les haies arrachées lors des remembrements passés.
Source: http://www.haiesvives.org/html/la%20haie%20champetre/haie_champetre.htm
Exemples de haies :
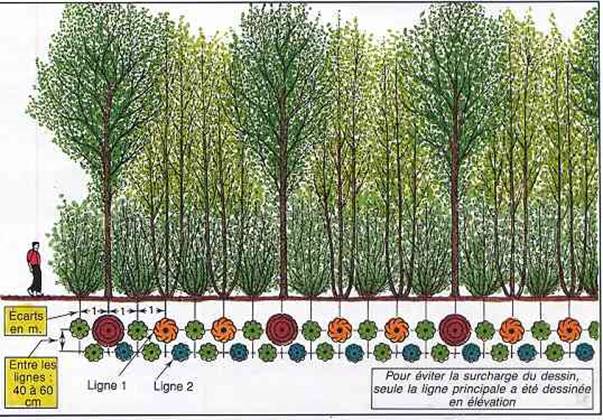
Exemple de haie à 3 niveaux. Source « Planter des
Haies », Dominique Soltner.
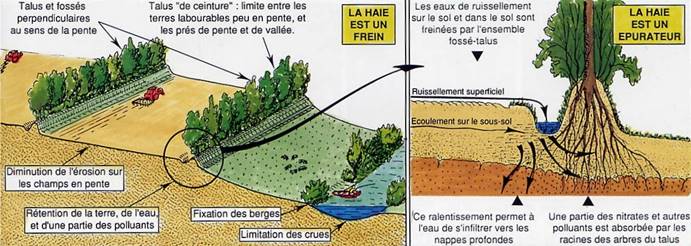
Source du schéma : « Planter des Haies » de
Dominique Soltner.
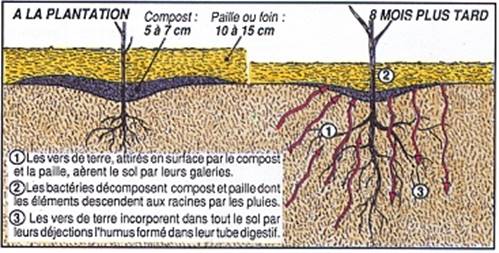
Disposition du compost et du paillis © Dominique Soltner.
Haies en
zones tropicale
La FAO propose
les espèces suivantes, pour les haies d’épineux en région tropicale :
|
Espèces
|
Pluviométrie
400 - 700 mm
|
Pluviométrie 700
- 1000 mm
|
Pluviométrie
1000 - 1300 mm
|
|
Acacia
mellifera
|
X
|
X
|
|
|
Acacia
nilotica
|
X
|
X
|
|
|
Acacia
senegal
|
X
|
X
|
|
|
Agave
sisalana
|
|
X
|
X
|
|
Bauhinia
rufescens
|
X
|
X
|
X
|
|
Citrus
lemon
|
|
X
|
X
|
|
Commiphora
africana
|
X
|
X
|
|
|
Dichrostachys
cinerea
|
|
|
X
|
|
Euphorbia
balsamifera
|
X
|
X
|
|
|
Haematoxylon
brasiletto
|
|
|
X
|
|
Jatropha
curcas
|
X
|
X
|
|
|
Moringa
oleifera
|
|
X
|
X
|
|
Prosopis
juliflora
|
X
|
X
|
|
|
Ziziphus
mauritiana
|
X
|
X
|
X
|
Espèces d’arbres recommandées pour les haies vives dans les aires
sèches et semi-arides de l’Afrique de l’Ouest.
Sources : a) Louppe, 1999, b) Live Tree Fences and Ligneous
Windbreaks, FAO, http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Tech/22Livef.htm
Note : bémols : a) Les espèces Prosopis juliflora et Ziziphus
mauritiana sont invasives.
Il n’est pas
certain que le citronnier (Citrus lemon) résiste à la sécheresse.
Ressource documentaire : a) Haies épineuses défensives : Climat
tempéré et climat tropical (format papier A4 couleur) (paysagisme),
Benjamin Lisan, Amazon KDP, 147 pages, 22,69€, https://www.amazon.fr/dp/1729533450
b) Version PDF
gratuite : http://www.doc-developpement-durable.org/livres/Haies_epineuses_dfe_Interior_for_Kindle.pdf
|

Haie vive mixte constituée d'une clôture à moutons
installée entre deux rangs de Cassia sieberiana, au Burkina Fasso.
|

Yucca, expérimenté par la SNCF
|

Epine du Christ (Euphorbia milii).
|
|

Clôture à cactus épineux jaunes (Opuntia
monacantha - Cactaceae) et sisal © Lionel Allorge.
|

Epine du Christ (Euphorbia milii).
|

Haie de figuiers de barbarie (Opuntia ficus-indica).
|
Principe c’est un ensemble d’interventions qui consiste à
stimuler/provoquer/protéger/entretenir les repousses ligneuses sur les
parcelles. La mise en défens physique ou la surveillance sont nécessaires hors
des zones de culture.
Prérequis apprentissage technique, résilience de pousses ou de
racines d’arbres locaux sur les zones ciblées.
Effets concrets reconstitution d’un système agro-forestier
autochtone voire d’une forêt en 3-4 années. Les arbres régénérés assureront un
complément de fertilité aux terres de culture ainsi que du fourrage, des fruits
et du bois.
Coût petit matériel (coupe-coupe, piquets de repérage,
sécateurs, pioche, etc.). Environ 200 €/ha. Statistiquement plus efficace que
le reboisement classique et moins coûteux.
Souvent les sols dans les régions tropicales sèches (sols latéritiques
etc.) sont peu fertiles. Mais il existe de techniques agronomiques, permettant
d’améliorer leur fertilité par des moyens naturels, comme celles-ci :
- Semis direct (sous couvert végétal permanent) ou « mulch
» (°),
- Compostage organique et paillage (technique proche de la
précédente),
- Bois raméal fragmenté (B.R.F.),
- Terra preta (technique utilisant le résultat de la
combustion incomplète de ressources ligneuses et de déchets organiques
afin de le mélanger avec la terre du sol).
- Le Zaï (technique africaine des zones sahéliennes) (nous en
avons déjà parlé, plus haut dans cet ouvrage).
- Divers :
a) La
rotation des cultures + La jachère (comme en agriculture biologique),
b) Le
sous-solage (pour améliorer la fertilité des sols argileux et lourds).
Nous n’aborderons dans ce document que la technique du compostage
organique (voir ci-dessous).
Si vous désirez des informations sur les autres techniques, consultez
cette ressource documentaire, ci-après :
Ressource documentaires : Amélioration de la fertilité des sols, Par
des moyens naturels, B. LISAN, 11/05/2014, 177 pages, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/AmeliorationFertiliteDesSols.ppt
Point de départ de la récupération de tous les sols :
Principe des résidus organiques et minéraux sont compostés dans
une fosse stabilisée de 9m3, retournés et arrosés périodiquement.
Pré-requis disponibilité fèces d’animaux, de cendres, de
matériaux organique (paille, herbe, tiges de céréales) et d’eau pour arroser le
compost (200 L par semaine).
Effets concrets amélioration des rendements des cultures, dès la
première année, et maintien de la fertilité.
Coût une fosse permet de fertiliser 0.5 ha/an. Pour les
céréales, l’application se fait tous les 2 ans. Le coût de construction total
varie de 45 € (sol compact) à 90 € (sols sableux).
N.B. cet aménagement pour la restauration de la fertilité est à
utiliser en synergie avec les dispositifs décrits dans ce document.
Un avis de Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny : « La bouse de
vache est vraiment un élément important de la régénération des sols , soit au naturel
où elle se mélange aux racines et restes de tiges non ramassées, soit comme je
l’ai pratiqué 15 ans comme élément du compost sahélien prôné par Pierre Rabhi
depuis les années 80 . On peut mettre des feces de chevres ou mouton, ou des
fientes de volaille mais de mon expérience c’est plus efficace avec la bouse de
vache, à cause de la rumination et de bactéries spécifiques qui enrichissent
mieux les sols ».
|
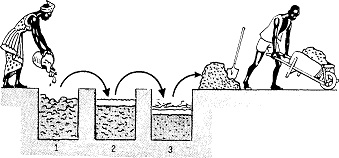
Comment faire un bon compost, avec transfert d’une fosse
l’autre, tous les 2 mois (Source : Agrodok n°9).
|
 
© CILSS/IREMLCD-2008.
|
|
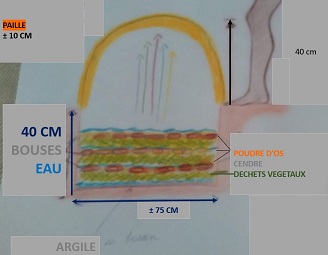
Composition des couches dans la composteuse.
© Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny
Utilisation du compost prêt directement au jardin
Ou sèchage au soleil et mise en sac =>
|
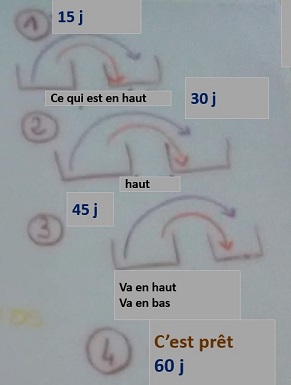
Cycle de vie du compost, dans les 2 fosses.
© Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny
|

Formation au compost des maraîchers de Tengandogo, quelques
km au sud de Ouagadougou, à la demande des jeunes de RJS (rassemblement de la
jeunesse solidaire) © Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny.
POUR 4 FOSSES
de 2m x 50cm x 30cm, IL VOUS FUT :
Pour des fosses
de 3 m x 0,75 x 0,40 => 17 + 7b.
1) 11 brouettes
de déchets végétaux secs (°).
2) 5 brouettes
de bouses de vaches sèches (°).
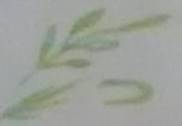
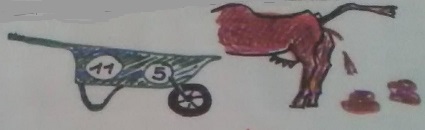
3) 3 x 20
poignées de :
a)
cendre : 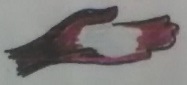

b) arrêtes de
poisson ou os pilé à sec : 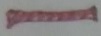

c) peau de
bananes sèches pilées : 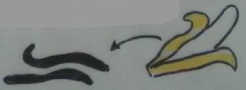
(°) à tremper
48 h avant utilisation.
Source : ©
Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny.
Paillis : En agriculture et jardinage, le paillis ou mulch est une couche
de matériau protecteur posée sur le sol, principalement dans le but de modifier
les effets du climat local (le paillis ou le paillage permet de mieux retenir
l’humidité du sol).
Les effets
du paillage :
a: l'eau de
pluie ou d’arrosage ne tasse pas le sol et pénètre mieux.
b: le sol est
protégé du soleil: l'évaporation est réduite.
c: les
mauvaises herbes sont étouffées. Les paillis se transforme en humus.
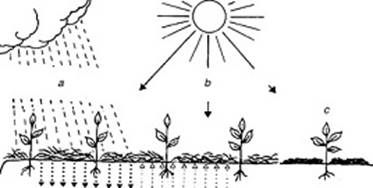
Rapide à installer, mais coûteuse.
|
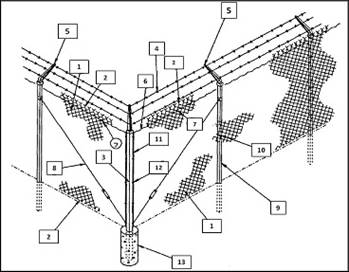
Exemple : Composants généraux de la clôture
Chain-Link.
|
Légendes :
1. Tissu (anglais : Fabric).
2. Lisière (anglais : Selvage).
3. Poteaux d'angle (anglais : Corner Post)
4. Fils barbelés / ruban barbelé (anglais :
Barbed Wire / Barbed Tape).
5. Bras stabilisateur/ Fil de fer barbelé (anglais : Outrigger /
Barbed Wire Arm)
6. Fil de tension (haut et bas) (anglais : Tension Wire (Top and
Bottom)).
7. Anneau d’attache (anglais : Hog Ring).
8. Tige de renfort (anglais : Truss Rod).
9. Montant de la ligne (anglais : Line Post).
10. Fils d'attache (anglais : Tie Wire).
11. Barre de tension (anglais : Tension Bar).
12. Pince de tension (anglais : Tension Clip).
13. Semelle en béton (anglais : Concrete Footing).
|
|

Unified facilities criteria (ufc),
security fences and gates, ufc 4-022-03.
|

|
|

|

Posé par une machine à grillage, pour clôturer le futur
Centre d’Education de Base Non Formelle (CEBNF), à Tougouzague au Burkina
Fasso
© Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny..
|
Cette barrière est plus longue à installer. Il faut attendre au moins 5
ans que les arbustes ont bien poussés. Voir le chapitre « Haies
vives : … », ci-avant.
Voir ci-après :
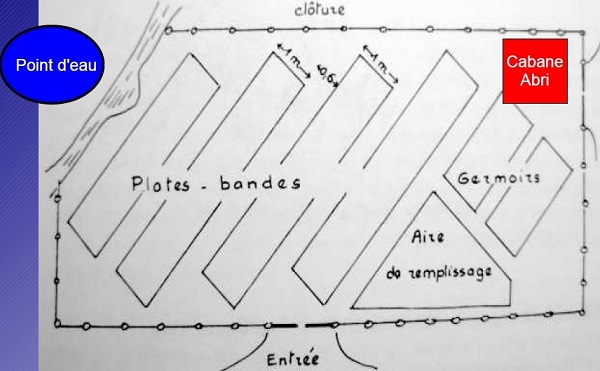
Source : Module 1.0 : Formation des pépiniéristes,
Formad environnement, juillet 2010.
Pépinière 15 m x 15 m 32 planches de 2mx1m, 1 an, 1/3 fumier, 1/3 sable
(à Madagascar. Prix en Ariary) :
|
Activités / produits
|
Nombre
|
Pu
|
Prix total
|
Euros
|
|
x20cm 25 kg=50 000
pots (1200000 Ar)
|
10000
|
24
|
240000
|
83
|
|
Remplissage 10000 pots (300 pots/jour)
|
10 personnes x 3jours
|
3000
|
90000
|
31
|
|
Clôture de gaulette 30 x 1 m pour 50 m
|
1500
|
100
|
150000
|
52
|
|
Installation clôture
|
4
|
3000
|
12000
|
4
|
|
Puits
|
1
|
30000
|
30000
|
10
|
|
Fût pour le puits
|
2
|
10000
|
20000
|
7
|
|
Arrosoir plastique 15 I
|
2
|
9000
|
18000
|
6
|
|
Pelle
|
3
|
5000
|
15000
|
5
|
|
Bêche (Angady)
|
3
|
6 000
|
18 000
|
6
|
|
Corde plastique (diamètre 3 mm) rouleau
|
1
|
3 500
|
3 500
|
1
|
|
Support ombrage
|
12 gaulettes par planches
|
100
|
32000
|
11
|
|
Ombrage typha (joncs) ou phragmite
|
Forfait
|
|
50000
|
17
|
|
Fumier
|
10 charrettes
|
5000
|
50000
|
17
|
|
Argile
|
10 charrettes
|
5000
|
50000
|
17
|
|
Ramassage graines (50 à 30000 Ar/kapok)
|
20 espèces (500 par espèce)
|
|
200000
|
69
|
|
Salaires pépiniéristes x 7 mois
|
2
|
60000
|
840000
|
290
|
|
Sous total
|
|
|
1818500
|
627
|
|
Supervision association Projecteur (30%)
|
|
|
545550
|
188
|
|
Total
|
|
|
2364050
|
815
|
Quelle que soit la technique choisie, il faut toujours une pépinière
munie d’un hangar qui protègera les futurs plants contre les intempéries.
Le site choisi pour abriter cette pépinière doit être accessible, le
relief ne doit pas être accidenté, il doit être le plus proche possible de la
zone d’écoulement des plants (point de vente, plantation), il doit être le plus
proche possible d’une source d’eau permanente.
La pépinière doit être clôturée, de préférence en haie vive afin de
réduire les coûts et d’accroître la durabilité) pour éviter la destruction par
les animaux (l’utilisation d’Acacia nilotica est régulière).
Le site doit être protégé contre les feux de brousse dans des zones
sensibles, par la construction des pare-feu (10 m de large).
Une pépinière est composée d’un hangar avec tout son contenu (plants en
rééducation, châssis, …), une source d’eau permanente, un magasin, un point de
stockage des plants, un point de stockage des substrats…
- Le hangar : Sa taille n’est pas fixe. Il doit être construit de
façon à permettre la pénétration indirecte des rayons solaires. Pour une
pépinière qui doit comporter un châssis d’enracinement de 1m x 3m, un châssis
géant de 2m x 1m de surface de base, un hangar de deux pentes de 4m x 6m
(surface de base) est suffisant. La plus petite hauteur est de 2m et la plus
grande de 3 m (voir image ci-dessous).
- Matériel nécessaire pour construire le hangar : piquets,
lattes/bambou/perches, pointes, nattes/tôles/ou tout autre matière non
perméable à l’eau, …
Source : Domestication
de l’Acacia senegal, World Agroforestry Centre, http://www.fao.org/forestry/download/28906-05e0933c5c592e5a21f736554c35a4897.pdf
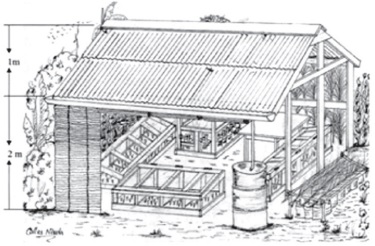
Le hangar de la pépinière
Ces zones sont souvent trop sèches, pour être adaptées à l’agriculture
ou aux programmes de reforestations intensives. Elles sont constituées de
prairies, brousses ou savanes naturelles, dans lesquelles on trouve une énorme
diversité d'espèces herbacées évoluant à la lumière, des essences d'arbres
adaptées au passage des incendies ...
« Raisonnablement, les conditions économiques de l’Afrique
actuelle ne permettent pas de concevoir un élevage rural à base de cultures
fourragères, même dans la zone humide. La culture la plus économique, la
prairie permanente en association graminée-légumineuse, reste encore très
chère, et doit être limitée à quelques hectares par éleveur pour constituer un
complément fourrager, destiné à améliorer quelques performances du troupeau.
La base de l’alimentation restera encore longtemps le pâturage
naturel. C’est pourquoi notre objectif doit être en priorité de protéger et
d’apprendre à gérer ce qu’il reste du pâturage naturel de chaque pays. Ce ne
sont pas les cultures fourragères qui sauveront l’élevage en Afrique, mais la
gestion intelligente du patrimoine naturel ».
Si la ressource (herbe, ligneuse …) est bien gérée _que les troupeaux
ne surpâturent pas, que l’on choisisse les bonnes races adaptées à cet
environnement, avec une bonne gestion des parcours _, le pastoralisme sous
climat sec et chaud a un rôle socioéconomique important. En effet, il offre à
l’homme de nombreux biens et services : produits de haute valeur commerciale et
nutritive (lait, viande, cuirs, peaux…), source d’énergie (traction, transport
animal, combustible…), fumure pour les cultures, support des relations
socioéconomiques (emploi, entraide sociale…), instrument d’épargne, etc. Une
part significative des populations (1/6 dans certains pays) vit du pastoralisme
et une part encore plus importante en tire des revenus tout au long de la
filière économique jusqu’au consommateur. Le pastoralisme contribue ainsi à la
sécurité alimentaire des pays producteurs et importateurs. Il permet la mise en
valeur de vastes surfaces de territoires dans ces régions qui n’ont guère
d’autres possibilités de valorisation économique.
« Contrairement aux idées reçues, l’élevage mobile est bien
plus productif que l’élevage sédentarisé dans cette région aride [du Nord de
Djibouti]. En réalité, plus le bétail est mobile, plus sa production est forte.
Dans le contexte du climat sahélien, c’est aussi une réponse efficace contre de
nombreux risques pour les éleveurs comme la sécheresse ou même l’insécurité
civile. De plus, cet élevage extensif permet également d’entretenir les
ressources naturelles grâce à la régulation du pâturage. De même, il participe
à la régénération de nombreuses espèces végétales grâce à la dispersion des
semences ».
« Il n'est pas douteux que ce sont les Peuls du Ferlo sableux
qui, en maintenant un nomadisme limité vers les mares naturelles pendant la
saison des pluies, assurent eux-mêmes une certaine conservation de
l'environnement ».
Au cours des trois dernières décennies, ces mouvements ont tendance à
s’allonger et à se disperser, notamment vers le sud. Cette évolution peut être
attribuée à l’accroissement du cheptel, l’aridification du milieu,
l’expansion des zones agricoles dans les couloirs de transhumance et à la
diversité des marchés transfrontaliers à bétail, contraignant ainsi les
éleveurs à créer des itinéraires alternatifs. Au Tchad, la limite sud des
troupeaux de dromadaires est passée en vingt ans du 13ème parallèle au 9ème parallèle.
Certains transhumants bovins descendent aujourd’hui jusqu’en République Centre
Africaine. Les aires protégées sont de plus en plus fréquentées par le cheptel
transhumant, malgré la réglementation en vigueur dans les pays.
« Les mouvements de transhumance sont […] constitués d’une
série d’étapes soigneusement choisies à partir des informations collectées
auprès d’informateurs et de l’expérience personnelle de l’éleveur. Pour le
choix des itinéraires, les éleveurs recherchent des informations relatives à la
présence et à la qualité des pâturages, la disponibilité de l’eau d’abreuvement
et des résidus des récoltes en zone agricole, aux termes d’échange pratiqués
dans les marchés à bétail et la présence des forces de défense et de sécurité.
Aussi l’amélioration de la couverture du réseau téléphonique et radiophonique
en zone pastorale a considérablement modifié les pratiques des éleveurs ces dix
dernières années, leur permettant de juger à distance des ressources
disponibles dans les zones d’accueil, les termes de l’échange et les points de
passage transfrontalier. Ces décisions sont aussi dictées par des informations
correspondant à la situation sécuritaire et sanitaire du bétail fournies par le
réseau d’éleveurs. Ces itinéraires peuvent changer durant le déplacement en
fonction de l’actualisation de ces informations ».
« Les pasteurs déplacent leurs animaux afin de les protéger des
sécheresses, des maladies ou des conflits. Selon la plupart des modèles
climatiques, les précipitations deviendront de plus en plus irrégulières et
imprévisibles au cours des décennies à venir. Dans un tel contexte, la mobilité
des troupeaux sera cruciale pour permettre aux pasteurs de s’adapter au
changement climatique ».
|

Caravane longeant un champ de sésame au Salamat (Tchad) ©
Projet Almy Bahaïm (2008).
|

Borne de transhumance en plein champ au nord de la région
de Tahoua (Niger).
|
Les zones autour des points d’eau (créé par forage et fournissant de
l’eau par pompage mécanique) sont le souvent surpâturées.
« On peut, à titre d'exemple, citer le cas du Koya défini
encore en 1945 comme zone de parcours sans eau et sans chemin de parcours,
perçu avant 1952 comme une réserve infinie de pâturages inutilisables et devenu
avec la mise en fonctionnement des forages une zone de surpâturage — à certains
endroits tout au moins ».
Ces points d’eau peuvent aussi attirer des agriculteurs, pouvant rentrer
en conflit avec les éleveurs.
Pour éviter cela, les « points d’eau sont aménagés et les
organisations d’usagers sont renforcées pour la gestion de cette ressource ».
Des couloirs de tri peuvent être créés. Les bouses seront collectées pour les
fermes à proximité ou pour leur utilisation comme combustible. Dès que les
troupeaux seront abreuvés, Il est préférable qu’ils ne stationnent pas et
repartent immédiatement etc.
|

Forage de Widou Thiengoli dans la région du Ferlo au
Sénégal. © CNRS images / Photothèque.
Le forage de Widou Thiengoli, dans la région du Ferlo au Sénégal,
fournit l'eau aux hommes et au bétail dans un rayon de 20 km. Durant la
saison sèche, c'est l'unique source d'eau potable. Widou Thiengoli fait
partie des villages retenus pour mettre en œuvre le projet de la Grande
Muraille verte (GMV), une ceinture de végétation pour lutter contre la
désertification, impliquant les onze pays frontaliers de la zone
saharo-sahélienne entre Dakar et Djibouti.
|

Ranerou Ferlo a soif : Le forage en panne, 3 jours sans eau (25/05/2014) :
« Les habitants de la capitale du Ferlo vivent un véritable
calvaire. En effet, Ranérou manque d’eau depuis trois jours. La faute, à une
panne de la pompe du forage. Le camion-citerne du service des eaux et forêt,
qui alimente la ville en eau, ne peut satisfaire la demande des populations.
Les habitants cette ville, peuplée d’éleveur, sont obligés de faire chaque
jour la navette entre leur localité et Dar Salam, un village situé à huit
kilomètres à l’ouest. Le seul puits de ce village menace de tarir. Et comme
un malheur ne vient jamais seul, le bétail commence à succomber de soif ».
|
|

Forage de Widou Thiengoli dans la région du Ferlo au Sénégal. © Axel
DUCOURNEAU/CNRS Photothèque
|

Abreuvoirs dans le Ferlo (Sénégal) © FFEM
|
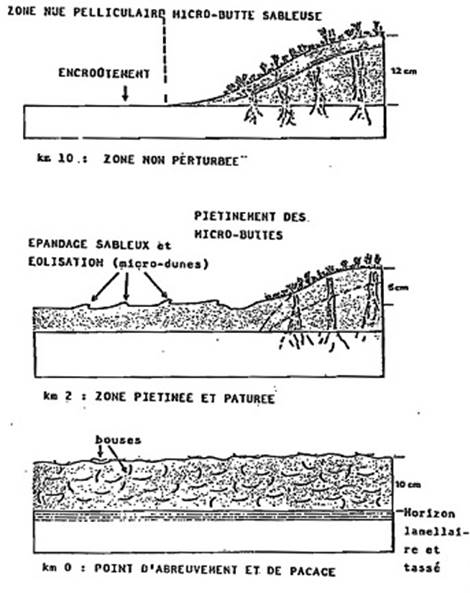
Evolution de la surface du sol en fonction de la distance
au fourrage (FERLO SABLEUX).
« Ces dernières années, certains gouvernements ont pris
conscience de l’importance de la mobilité du bétail pour les écosystèmes des
zones arides. De nouvelles législations au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et
en Mauritanie affirment le droit des pasteurs de déplacer leurs animaux à
l’intérieur et à travers les frontières nationales. Mais les autorités
gouvernementales ont une compréhension limitée des systèmes pastoraux ; ces
législations risquent donc d’être appliquées de manière excessivement
technocratique et centralisée, et de continuer, en pratique, à entraver la mobilité.
En outre, même si les divers processus d’intégration régionale à travers
l’Afrique permettent la libre circulation des personnes et des biens, les
pasteurs sont encore confrontés à de nombreuses difficultés pratiques lors des
déplacements transfrontaliers de leurs animaux ».
[Par exemple, ] La Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a adopté en 1998 la décision A/DEC.5/10/98 pour encadrer et faciliter
les transhumances transfrontalières, renforcée localement par des accords entre
pays (Mauritanie-Sénégal-Mali, Niger-Burkina-Faso). Quinze ans après, ces
textes de lois restent difficilement applicables sur le terrain et les éleveurs
continuent de rencontrer des difficultés aux frontières.
|

Certificat international de transhumance (CEDEAO).
|

Des pasteurs du Kordofan Sud (Soudan) arrivent dans les
pâturages de la saison des pluies au Kordofan Nord.
|
|

Un jeune éleveur peul mène un troupeau au pâturage à Dakoro, au nord
du Niger.
|

Des femmes mènent le bétail vers les pâturages et les ressources en
eau à flanc de montagne le long de la frontière entre le Kenya et l’Ouganda à
Oropoi, au Turkana.
|
« Traditionnellement, les pasteurs et agriculteurs du Sahel ont
bénéficié d’arrangements réciproques : les troupeaux transhumants enrichissent
les champs des agriculteurs avec leur fumier ; le bétail des agriculteurs est
élevé dans les zones pastorales environnantes ; les troupeaux des pasteurs
constituent souvent la principale source d’animaux de traction. Ce sont des
mouvements de bétail négociés avec soin qui rendent possibles de tels liens ».
Ils surviennent dans les zones rurales où les communautés d'agriculteurs
et d'éleveurs se chevauchent territorialement. Les conflits résultent
généralement de la destruction des récoltes par le bétail et sont exacerbés
pendant les périodes où l'eau et les terres à pâturer sont rares.
Certains conflits territoriaux sont liés à l’accès, de plus en plus
difficile, aux ressources _ à la nourriture et à l’eau _, entre agriculteurs et
pasteurs nomades, peuvent déboucher sur du terrorisme, de vraies guerres, voire
des massacres génocidaires de tribus par d’autres.
Les dix pays les plus touchés par le terrorisme sont tous engagés dans
au moins un conflit armé.
Le désert, au
Sahel, avance d’environ 3626 km2 par an, contribuant à la dégradation des
terres et à l’exacerbation des conflits agriculteurs et pasteurs.
De 2005 à 2013,
il y a eu, au Sahel, 3871 conflits avec 55 morts, 12 blessés et 181 sinistrés
(MRAH, 2013).
Au Mali
Au centre du Mali, il existe depuis longtemps des conflits entre le
peuple dogon, plutôt des agriculteurs sédentaires animistes, vivant depuis des
siècles dans les falaises de Bandiagara, et les éleveurs peuls nomades, en
général musulmans. Ces derniers vivent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest
(le Sénégal, Mali, Guinée, etc.) et d'Afrique centrale (Centrafrique, Cameroun,
etc.). Les heurts entre Dogons et Peuls sont devenus de plus en plus violents
depuis l'avènement des mouvements djihadistes dans le nord du pays en 2012.
Au Mali, les Dogons accusent souvent les Peuls de dévaster leurs champs
et de détruire leurs récoltes pour nourrir leur bétail. L'histoire du voisinage
entre Peuls et Dogons est jalonnée de tensions, qui sont quelquefois violentes.
Mais ces heurts causés par la course aux ressources naturelles (terres, forêts,
tec.) ont souvent été atténués par la négociation. Les Dogons, victimes des
attaques djihadistes, accusent les Peuls de soutenir les groupes islamistes, ce
que ces derniers démentent. Les Peuls, eux, soutiennent que les groupes
d'autodéfense dogons bénéficient du soutien du gouvernement. Ils accusent les
Dogons d'être responsables des atrocités dont ils sont victimes, ce que
démentent les mis en cause. Le 23 février 2019, une attaque aurait fait au moins
130 morts parmi les Peuls. En 2018, 202 civils ont été tués dans des violences
communautaires, lors de 42 attaques, dans la région de Mopti, au Mali, selon
Human Rights Watch (HRW).
Au Nigéria
Le plus emblématique de ces conflits entre
éleveurs et agriculteurs se situe au Nigéria, impliquant des différends, sur les ressources, foncières, entre
des éleveurs peuls musulmans pour la plupart et des
agriculteurs chrétiens pour la plupart à travers le Nigeria, mais plus
dévastateurs dans le Middle Belt (« ceinture centrale », centre-nord) depuis le
retour de la démocratie en 1999. Mais plus récemment, il s'est détérioré en
attaques terroristes contre des agriculteurs, par des bergers peuls – Les
extrémistes Peuls serait le quatrième groupe terroriste le plus meurtrier au
monde selon l'indice mondial du terrorisme.
En général, on distingue les extrémistes
Peuls du groupe djihadiste Boko Haram, qui a été le groupe terroriste le plus
actif du pays au cours de la dernière décennie.
Si le conflit a des raisons économiques et environnementales
sous-jacentes, il a également acquis des dimensions religieuses et ethniques.
Des milliers de personnes sont mortes depuis le début de ces attaques : La
violence entre agriculteurs et éleveurs a tué plus de 19 000 personnes et
déplacé des centaines de milliers d'autres. Les communautés rurales agricoles
sédentaires sont souvent la cible d'attaques en raison de leur vulnérabilité. On craint que
ce conflit, souvent minimisé par les gouvernements de la région, ne s'étende
(face tache d’huile) à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.
République
centrafricaine
Lors de la guerre civile en République centrafricaine, une grande
partie des combats a opposé des groupes rebelles, a) le groupe ex-Séléka
composé de personnes issues de groupes nomades, tels que les Peuls, Gula et
Runga, majoritairement musulmanes, et b) le groupe anti-balaka composé de
groupes d'agriculteurs majoritairement chrétiens et animistes.
Causes
Les causes de ces conflits sont liées à :
a) la croissance démographique et une expansion de la population
agricole et des terres cultivées, aux dépens des pâturages.
b) la détérioration des conditions environnementales, la désertification
et la dégradation des sols.
c) la rupture des mécanismes traditionnels de résolution des conflits
liés à la terre et à l' eau.
d) la prolifération des armes légères et de la criminalité dans les
zones rurales.
e) des hostilités ethnoreligieuses préexistantes, qui se sont
exacerbées, avec les mouvements jihadistes.
L'insécurité et la violence ont conduit de nombreuses populations à
créer des forces d'autodéfense et des milices ethniques et tribales, aux
actions incontrôlées (ce qui a favorisé la prolifération des armes. Cercle
vicieux).
Sources :
a) Nomadic conflict [Conflit nomade], https://en.wikipedia.org/wiki/Nomadic_conflict
b) Conflits
entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria [Conflits entre éleveurs et
agriculteurs au Nigeria], https://en.wikipedia.org/wiki/Herder%E2%80%93farmer_conflicts_in_Nigeria
On observe, dans certaines régions arides, dont la plus emblématique,
le Sahel :
Une dégradation des écosystèmes (et des rendements des sols, des
pâturages et des cultures), qui s’expliquent par :
Ø La croissance
démographique non contrôlée
et les flux migratoires des populations, liés aux sécheresses.
Ø Une déforestation
liée : a) à la culture itinérante sur brûlis, b) au charbonnage et aux
prélèvements du bois, pour le feu, la cuisine et le chauffage, au détriment des
arbres et forêts.
Ø De mauvaises
pratiques agricoles, avec de faibles rendements, liés :
·
A l’absence ou la faible utilisation de fertilisants (d’intrants)
naturels ou artificiels,
·
A la culture itinérante sur brûlis, fournissant peu de
fertilisants et destructrice des forêts,
·
A la croissance des besoins en terre, à cause de la croissance
démographique,
·
A la disparition des jachères, qui permettaient aux sols de se
regénérer, toujours à cause de la croissance démographique.
De mauvaises pratiques pastorales, liées :
·
A la croissance non contrôlée du cheptel (Par exemple : 1989
= 3 860 000 bovins, 2003 = 7 311 544 (MRAH),
au Burkina Fasso) [liée à la croissance démographique et au désir de
s’enrichir], qui provoque le surpâturage.
·
A la croissance des besoins en parcours des bêtes, à cause de
l’augmentation du cheptel et du surpâturage.
· Années 70 - 80
- Création de zones à vocation pastorale (ZP) par l’Etat afin de
sécuriser l’activité pastorale.
- échanges directs (fumier, denrées agricoles) entre agriculteurs et
éleveurs
· Années 90 à nos jours
- Incapacité de l’Etat à protéger les ZP, face aux cultivateurs =>
échec de la politique des ZP.
- Augmentation dramatiques des conflits meurtriers agriculteurs –
éleveurs.
- Appauvrissement des éleveurs et cultivateurs.
- dégradation et désertifications des terres.
Leurs objectifs étaient (voir ci-après) :
·
Sauver et sécuriser le bétail : respectivement 25 et 12% du
cheptel décimés, lors des grandes sécheresses de 1972-1973 et 1983-1984.
·
Sédentariser l’élevage pastoral transhumant et intensifier les
productions animales (lait et viande).
Note : Cette politique avait été influencée par la Banque
Mondiale et le modèle des ranchs américains.
Les actions pour mettre en place cette politique :
·
Définition et mise en place des ZP.
·
Idem pour les pistes à bétail (piste de parcours ou de
transhumance), avec accès payant à l’eau et aux pâtures.
·
Ediction de lois et de règlements, avec des amendes, pour les
contrevenants.
Les problèmes posés par cette politique (voir ci-après) :
·
Elle a été décidée d’en haut, sans concertation directe avec les
éleveurs et cultivateurs (vision non partagée).
·
Les textes (des règlements et des lois) étaient inappropriés et
ont été non-appliqués.
·
Il y avait une insuffisance de moyens financiers et des
investissements, pour la mettre en œuvre (pour la pose de bornes délimitant ces
zones et les pistes, pour la construction des points d’eau, le contrôle, par
des agents, du respect des nouvelles règles locales par les agriculteurs et
éleveurs etc.).
·
Les agriculteurs sont expulsés des ZP et réinstallés ailleurs
(déplacements forcés pouvant être mal perçus par ces derniers).
·
L’insécurité foncière (liée à une politique cadastrale
« laxiste » et/ou peu rigoureuse et à la corruption) peut favoriser
les conflits fonciers et les violences.
Constat d’échec : On constate alors que les ZP (zones
pastorales) et les pistes à bétail sont occupées par des champs, d’où les
conflits persistants entre agriculteurs et éleveurs.
Comment réguler l’accès aux mêmes ressources naturelles (RN), entre
usagers (agriculteurs et éleveurs) de celles-ci, sans conflits entre ces
derniers ?
Dans la même région, comment faire cohabiter agriculteurs et éleveurs,
si possible, sans impact négatif sur l’environnement ?
Voici quelques suggestions :
Il a certainement à faire un état des lieux des RN :
Il y a un certain nombre de questions à se poser :
·
La pression foncière permet-elle de supporter à la fois les
agriculteurs (autochtones et migrants) et les éleveurs ?
·
Quelle est la capacité de charge du territoire et comment
répartir la charge animale pour qu'elle ne soit pas dépassée ?
·
Quelles stratégies mobilisent chaque groupe d’acteur afin
d’adapter sa charge animale à la disponibilité des ressources ?
·
Quels sont les différents modes de régulation de l’accès aux
ressources dans le territoire ?
·
Quels types d’accords sociaux sont-ils nécessaires pour
consolider un mode commun de régulation ?
Un certain nombre d’enquêtes peuvent être mener sur le terrain. Un
exemple de ce type d’enquête :
·
Enquête préliminaire (interview semi structurée (ISS)) :
entretiens avec tous les acteurs institutionnels et organisations
socio-professionnels locales.
·
Enquête zootechnique (ISS) : systèmes d’élevage, dynamique des
troupeaux, productions, races des animaux élevés ...
·
Enquête agricole (ISS) : systèmes de culture, productivité,
...
·
Enquête sur les modes de gestion endogène des RN (ISS) : modes de
régulation, perceptions des acteurs, ...
·
Cartographie de l’occupation des sols (SIG).
·
Etudes socio-économiques : démographie, données sur les conflits,
les transhumances, l'accroissement du cheptel, la pression foncière ...
·
Évaluation de la biomasse fourragère : carré de rendement /
placette, récolte intégrale et pesée.
·
Capacité de charge du territoire (en nombre UBT/ha) et évolution
dans différents scénarios (surpâturage, pâturage modéré, faible pacage,
pâturage interdit ...).
·
Etudes écologiques du surpâturage, de la dégradation du couvert
végétal, des épisodes de sécheresse, de la baisse de la fertilité des sols ...
·
Etc.
Voici les inventaires à réaliser pour le diagnostic socio-économique :
-
Typologie des acteurs : rôles, systèmes d’organisation et leurs
fonctionnements, relations sociales ou économiques.
-
Description des systèmes de culture.
-
Description des systèmes d’élevage.
-
Description des modes d’accès aux ressources.
-
Différents types d’usages des RN : terres agricoles , parcours, bois de
feu, cueillette, pêche, …
-
Modes de règlement des conflits.
Voici quelques solutions à développer ou expérimenter pratiquement (sur
le terrain) :
·
Créer des fermes caprines ou ovines modernes pour l’amélioration
génétiques et la production de races ovines et caprines de qualité. Par
exemple, trouver ou mettre au point des races caprines plus productives
que les races caprines sahéliennes actuelles (dont la chèvre sahélienne). Par exemple,
en race ovines : la dorper
(résistante à la chaleur et la sècheresse). Par exemple, en races
caprines : la sélection de races locales sur leur capacité d’adaptation
aux conditions arides locales [celles du Nord de Djibouti].
Pour améliorer la mobilité du bétail à long terme, nous pensons qu’il
convient d’aborder les thèmes clés suivants
:
·
Une plus grande volonté politique : des attitudes mieux informées
et plus positives envers le pastoralisme, et surtout une meilleure
compréhension des bénéfices économiques qu’il présente.
·
Des organisations de la société civile pastorale plus fortes,
qui puissent articuler et défendre les intérêts de leurs membres et travailler
avec les gouvernements pour concevoir et mettre en œuvre des politiques qui
soutiennent la mobilité du bétail [Par ex., aider à mettre en place des
organisations, des syndicats représentatifs des éleveurs].
·
Un système juridique et administratif plus efficace, qui facilite
un système de pastoralisme mobile pacifique mais dynamique, basé sur des
principes de négociation et de réciprocité avec les autres groupes.
·
Des moyens d’existence forts et adaptables et une meilleure
intégration aux marchés pour garantir que les communautés pastorales puissent
répondre au changement climatique et aux demandes régionales croissantes en
bétail et en produits de l’élevage.
·
Un meilleur consensus sur l’importance de la mobilité du bétail
et les stratégies les plus appropriées pour la sécuriser ce consensus sera
atteint par l’intermédiaire de réseaux d’apprentissage comprenant des
décideurs politiques, des organisations de la société civile et les pasteurs
eux-mêmes.
Le projet est
divisé en trois composantes
:
·
Appui à la gestion collective des pâturages par les « Unités
pastorales » ou UP : appuyer environ 26 Unités Pastorales dans la zone
d’intervention du projet), qui ont pour but d’organiser la concertation entre
les acteurs et la gestion collective des ressources sur un territoire (ex :
mise en place d’un code local définissant des règles d’usage [dans chaque UP]).
·
Organisation et mise en réseau des acteurs du territoire pour
une meilleure gestion des ressources : les UP et organisations
professionnelles impliquées dans le projet sont renforcées sur les aspects de
gestion organisationnelle et financière ; on les incite également à se
regrouper en fédérations communales et régionales afin d’augmenter leur
influence de plaidoyer et d’améliorer la coordination entre elles. Ces
organisations sont appuyées autour d’un projet concret : la mise en place de 4
centres d’alerte et d’information, permettant aux éleveurs de prendre des
décisions éclairées pour leurs déplacements de transhumance, grâce à des
informations telles que la pression d’utilisation des forages et leur
fonctionnement, la situation des pâturages, les cas de foyers de maladies
infectieuses, les données météorologiques, les prix du bétail sur les
principaux marchés, etc. Ils permettent de mieux organiser la lutte contre les
feux de brousse.
·
Appui technique et diversification des activités économique
: le projet forme des responsables sur les pratiques durables d’élevage et de
gestion durables des pâturages. Il détecte et appuie les initiatives locales de
diversification économique (aviculture, embouche, lait, etc.). Ces deux activités
vont in fine de diminuer la pression sur les pâturages.
But :
Le projet permet la mise en place de modes de gestion durables et in
fine de conserver l’état du couvert végétal actuel dans la zone du Ferlo. Les
éleveurs, mieux organisés, sont à même de revendiquer des territoires dédiés à
l’élevage.
Le Projet de développement rural intégré (PDRI), financé
notamment par l’Agence française de développement (AFD) et lancé en 1991 dans
trois provinces de l’Ouest burkinabè, arrive à Barani. L’idée de sauvegarder la
vocation pastorale historique de la grande plaine du Seeno par l’instauration
d’une zone pastorale est née des premiers échanges entre la population et
l’équipe du projet. Le projet finance alors l’aménagement d’une zone de près de
50 000 hectares.
Voici le parcours autour de Barani : À l’est du village, une vaste
plaine sableuse (seeno) est pâturée en saison des pluies. En saison sèche, les
troupeaux sont conduits dans les pâturages de décrue du Sourou. Les migrants
agricoles s’installent notamment dans la grande plaine sableuse (seeno) entre
Barani et le Sourou, et cultivent du riz dans les pâturages de décrue du
Sourou.
La zone pastorale de Barani peut être considérée comme un commun à
vocation pastorale territorialisé. Elle en remplit les trois critères :
Des ressources, qui sont réhabilitées et reconnues pour leur vocation
pastorale première. Les pâturages de saison des pluies sont délimités par
des balises en béton et des pares-feux sur le pourtour de la zone. Les
agriculteurs installés dans la zone depuis les années 1970 sont expulsés. Les
puits et forages pastoraux rénovés.
Des règles de gestion, qui sont formalisées dans un cahier des charges
rédigé dans le cadre du PDRI au milieu des années 1990 et réécrit en 2010. Ce
cahier des charges entérine les limites de la zone, les règles d’usage,
détaille l’organisation des instances de gestion de la zone, prévoit des
sanctions en cas de non-respect des règles. Des comités villageois de gestion
des ressources naturelles (CVGRN) ont un pouvoir de gestion : ils surveillent
la zone, perçoivent les droits d’entrée dans la zone, sont chargés des travaux
d’entretien dans leur périmètre. Un comité départemental de gestion des
ressources naturelles (CDGRN), basé à Barani, détient le véritable pouvoir sur
la zone : il a des droits de gestion supérieurs à ceux des CVGRN et un droit
d’exclusion. Les recettes des droits d’entrée dans la zone sont centralisées
dans sa caisse. Il décide des dépenses : entretien de la zone et financement de
patrouilles de surveillance motorisées. Il est l’instance de résolution des
conflits et le garant de l’intégrité de la zone contre les tentatives de mise
en culture des pâturages. Il est l’interlocuteur privilégié des intervenants
extérieurs : services de l’État, organisations non gouvernementales (ONG)…
Une communauté d’ayants droit se partage la ressource. Le faisceau de
droits permet de distinguer différents types d’acteurs :
1.
Les simples usagers qui ont des droits d’accès et de prélèvement contre
le paiement d’un droit d’entrée ;
2.
Les membres des CVGRN qui ont des droits d’accès, de prélèvement et de
gestion ;
3.
Les membres du CDGRN qui ont des droits d’accès, de prélèvement, de
gestion et d’exclusion.
La zone pastorale respecte sept des huit critères de performances
institutionnelles identifiées par Ostrom (1990) : les limites de la communauté
d’usagers (ceux qui ont payé le droit d’entrée, ceux qui font partie des
groupes de gestion) et de la ressource (matérialisée par des bornes) sont
clairement définies ; les règles d’usage permettent le renouvellement de la
ressource fourragère (grâce aux dates d’entrée et de sortie) ; la surveillance
émane des comités d’usagers et non pas d’une autorité municipale ou étatique
extérieure ; des sanctions graduelles sont prévues et appliquées en cas de fraude
; les conflits se règlent à moindre coût devant le CDGRN et non devant des
autorités extérieures ; l’usage, la surveillance et la gouvernance sont
organisés selon des niveaux différents et imbriqués.
La pression foncière croissante impose de repenser les modalités de
cohabitation de l’agriculture et de l’élevage. Si de nombreuses synergies sont
en place entre les deux activités, une concurrence spatiale est à l’œuvre en
saison des pluies, et en saison sèche et chaude dans les espaces de transhumance.
Dans des espaces ruraux de plus en plus agricoles, il faut toutefois garder une
place pour l’élevage. Des territoires réservés à la pâture doivent être pensés
localement. L’échec des zones pastorales montre qu’ils ne peuvent être imposés
par les États.
Le but recherché est bien d’exclure l’agriculture (et non pas les
agriculteurs, qui sont souvent également éleveurs) des parcours ainsi protégés.
La question de l’intégration des transhumants à la gestion des
parcours, alors qu’ils sont par définition souvent absents du territoire et
qu’ils ont tendance à être exclus par les tarifications adoptées est difficile
à résoudre.
L’aménagement des tronçons de transhumance les plus conflictuels
permet une descente plus progressive des troupeaux transhumants à la fin de la
saison des pluies. C’est là un facteur important de limitation des problèmes
de dégâts champêtres.
La compétition foncière et le privilège accordé à l’intensification de
l’agriculture défavorisent l’élevage pastoral, et oubliant les mises en garde
contre les risques d’exclusion et de révolte des transhumants.
Elle renvoie à la gouvernance sociétale des ressources pastorales.
L'approche programme constituera un cadre plus pertinent sous réserve de la méthode
de gouvernance des acteurs étatiques, bailleurs et Etats nationaux. Dans ce nouveau
cadre d'intervention qui se met en place, quel acteur de développement portera
cette méthode à travers une décentralisation fragile et face au risque de
marginalisation des acteurs-clés de ces expériences que sont la société civile,
les ONG et les associations ?
Tableau 1.
Principaux pas dans le processus d’une gestion collective des ressources
naturelles.
|
Pas (étapes) importants
|
Sous-pas et contenu
|
Appui apporté par le projet
|
|
Mise en
confiance - lancement d'un partenariat effectif
|
Réflexion sur des questions clefs, les intérêts en
jeu, principes de base dans le cadre du partenariat.
|
Susciter le dialogue entre tous les acteurs (groupes d’intérêts) ;
Faciliter la tenue de réunions ;
Appuyer la
médiation
|
|
Réflexion,
analyses des contraintes et forces de la zone
|
Diagnostic de l’état et des modes de gestion des
ressources clefs, négociation des intérêts, esquisse de solutions.
|
Faciliter la
réflexion ;
Apport
technique
Appui
méthodologique
Informations
diverses.
|
|
Emergence de
la structure locale pour la GRN
|
Mandat et responsabilités représentativité et
composition de l'organisation, fonctionnement.
|
Informer sur
les textes en matière d'organisation au Burkina ;
Susciter la
réflexion sur les conditions / critères de viabilité d'une organisation.
|
|
Elaboration
d'un règlement intérieur en matière de GRN
|
Objectifs et
indicateurs d'impacts;
Propositions de règles à partir de
la base ; Harmonisation au niveau des organes de coordination ;
Accord entre producteurs,
partenaires techniques et l'administration Adoption/reconnaissance
administrative.
|
Appui à
l'adoption d'une démarche ;
Large
information sur les textes législatifs existants ;
Facilitation
des échanges ;
Consultant
juriste ;
Appui à la
traduction et rédaction des documents ;
Mise en
relation entre producteurs et les masses médias.
|
|
Mise en
œuvre, suivi, évaluation et réajustement
|
Modes d'organisation pour le
contrôle ;
Dispositifs de suivi des effets des règles ;
Reconnaissance juridique de la structure et des règles.
|
Appui à la mise en place du
dispositif de suivi et à la structuration de l’organe de suivi ;
Appui et suivi technique des effets.
|
Tableau 2. Règles de gestion dans 32
villages appuyés par le projet
|
Ressources
clefs
|
Villages (nombre)
|
Consensus adopté
|
|
Zones pastorales et
agricoles
|
22
|
Détermination des espaces
affectés au pâturage et aux cultures (zonage)
|
|
Aires de pâture
|
16
|
Droit de faire paître des
animaux sur les espaces de pâturages reconnus comme tels
|
|
|
10
|
Interdiction de l'exploitation
d'es aires de pâtures à des fins agricoles
|
|
|
23
|
Accès interdit aux animaux
atteints de maladie contagieuse
|
|
|
18
|
Signalisation auprès des cadres
de concertation avant toute installation
|
|
|
18
|
Interdiction de la fauche de
l'herbe (Panicum laetum) à des fins commerciales
|
|
Zones agricoles
|
8
|
Déguerpissement des zones
agricoles en saison pluvieuse
|
|
|
30
|
Détermination des périodes de
début et fin de la garde obligatoire des animaux
|
|
|
2
|
Institution de zones de
réserves agricoles
|
|
Pâturages post‑
culturaux
|
4
4
|
Exploitation sur autorisation
expresse du cadre de concertation Installation soumise à l’autorisation du
propriétaire du champ
|
|
Mares et autres points d'eau
|
20
30
|
Interdiction d'y rester avant
et après abreuvement Interdiction d'occuper les berges et les couloirs de
passage
|
|
|
8
|
Exploitation concertée des abords soumise à l'approbation des
cadres de concertation
|
|
|
1
|
Interdiction de toute action de
nature à souiller l’eau de la mare
|
|
Piste à bétail/ couloirs de
passage
|
30
|
Obligation de respect des
limites
|
|
1
|
Matérialisation obligatoire des
limites
|
|
Pâturage aérien, (Ligneux)
|
30
2
|
Interdiction de la coupe
abusive et exploitation des ligneux selon les normes Interdiction d'accès à
certaines espèces ligneuses en voie de disparition
|
|
|
4
|
Interdiction des feux de
brousse
|
|
|
5
|
Mise en défens partiel ou accès
subordonné à l’autorisation préalable
|
|
Cures salées
|
12
|
Interdiction d'y rester après exploitation
ou s’installer sur et en bordure
|
|
Faune et chasse
|
9
|
Obligation d’avoir une
autorisation préalable
|
Source : Gestion concertée des ressources agropastorales: cas
du Sahel Burkinabé, Boureima Drabo, Hermann Grell et Augustin Poda (Programme
Sahel Burkinabé PSB / GTZ, BP 280 Dori, Burkina Faso) in « Elevage et
gestion de parcours au Sahel, implications pour le développement », E.
Tielkes, E. Schlecht et P. Hiernaux (Verlag Ulrich E. Grauer Editeurs), 2001, https://rmportal.net/framelib/gestion-concerte.pdf
|

Avant/Après : terre aride récupérée par le contrôlé du
pâturage des troupeaux.
|
Un avis de Claire Marie Madeleine Péhi-Verny, qui a vécu 15 ans au
Burkina Fasso : « J’organiserai d’abord les paysans pour planter
des haies d’herbes et arbustes, appetées [appréciées] du bétail et, l’année
d’après, on organiserait une rencontre paysans/ éleveurs avec un calendrier
prévisionnel afin de ne pas laisser le bétail rentrer dans les champs avant
la fin des récoltes. Pour la partie « prairie », elle est rare et ne
subsiste que jusqu’à 2 ou 3 mois après la saison des pluies, ce qui
correspond au temps des récoltes, donc ça devrait s’équilibrer. D’autre part
il y a traditionnellement des accords éleveurs agriculteurs via les chefs
traditionnels et maintenant les agents de l’agriculture et de l’élevage,
c’est par eux qu’il faut passer.
Autrefois les bergers « suivaient la pluie » du Mali et du Nord
Burkina jusqu’au nord de la Côte d’Ivoire et amenaient ainsi une partie de
leur bétail plus au sud ».
|
|
|

Chambre à air utilisée pour le transport de l’eau.
© I. Touré (2002).
|

Citerne utilisée pour le transport de l’eau. © PAPF
(2010).
|
|

Construction d’une mare dans la région de Ouaddai ©
Projet Almy Bahaïm (2008).
|

Un puits pastoral dans le nord du Batha © Projet Almy
Bahaïm (2008).
|
|

Formation avec des éleveurs à Thiel (2003) © I. Touré.
|

Arbre coupé pour le bois de feu, au Sahel.
© Fousséni Ouattara.
|
|
|

Troupeau de chèvres région de Tataouine (Tunisie).
|
|
|
|
|
« L'élaboration d'un code foncier du Sahel paraît être une
étape nécessaire, indispensable même, car on peut craindre, si
les tendances actuelles se poursuivent, que les zones marginalement utiles pour
l'agriculture ne soient vite occupées au Sénégal par des agriculteurs
sédentaires fuyant les sols déjà épuisés, comme c'est le cas dans le Djoloff
maintenant.
Ce code, en reconnaissant des droits d'usage sur les chemins de
parcours, pourrait servir d'élément de base à l'élaboration d'un code pastoral
qui serait le fait des populations et qui envisagerait aussi les moyens de
faire exécuter les décisions prises dans le cadre de ce code pastoral ».
a) Mobilité pastorale et développement au Sahel, Ibrahima Diop
Gaye, Editions L’Harmattan, 2017.
b) Pastoralisme, résilience et développement, Amadou Ndiaye, Ed.
L'Harmattan, 2018.
Amadou Ndiaye analyse les interactions entre, d’une part, les pratiques
pastorales locales (appropriation des constellations, du climat, de
l’hydrologie et de la végétation, art vétérinaire, coutumes foncières, habitat,
sélection animale...) et d’autre part, les démarches (en régie, communautaires,
participatives) et actions (forages, santé et production animales, classement
forestier et reboisement, organisations d’éleveurs, jardins de femmes etc.) des
projets de développement des années 1950 à nos jours.
c) Impact
environnemental de l'élevage, https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_de_l%27%C3%A9levage
Impact sur
la biodiversité, https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_de_l%27%C3%A9levage#Impact_sur_la_biodiversit%C3%A9
d) Sall Alioune. Quel aménagement pastoral pour le Sahel ? In Tiers-Monde,
tome 19, n°73, 1978. Environnement et aménagement en Afrique (sous la direction
de Jacques Bugnicourt) pp. 161-169;
doi : https://doi.org/10.3406/tiers.1978.2785,
https://www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1978_num_19_73_2785
Brûlage dirigé : Application rationnelle du feu à
la végétation naturelle dans des conditions précises de terrain et de climat à
des fins de gestion bien définies à l'avance. Voir feu de forêt, écobuage,
pare-feu, coupe-feu. Synonyme de feu contrôlé. Source : Le feu,
outil d'aménagement forestier: Le brûlage dirigé dans le sud des Etats-Unis, www.fao.org/docrep/t9500F/t9500f07.htm
Contrefeu ou contre-feu : Feu qu'on allume
pour circonscrire un incendie (voir écobuage,
feux de forêt, coupe-feu).
Coupe-feux : coupe forestière linéaire,
ou une infrastructure linéaire créée et/ou spécialement entretenue pour freiner
l'extension rapide d'incendies de forêt
ou feux de brousse, plus ou moins efficacement (voir aussi feux de forêt,
écobuage).
Culture itinérante : a) Système agricole qui consiste à
cultiver une parcelle pendant quelques années avant de l’abandonner pour une
longue période de jachère. b) Méthode de culture consistant à déboiser un
terrain forestier, à y mettre le feu pour libérer les éléments nutritifs, à le
cultiver pendant quelques années jusqu'à ce que les sols soient épuisés et à
l'abandonner. Voir Culture sur brûlis, Ladang.
Culture sur brûlis : a) Technique consistant à brûler les
herbes et les broussailles, voire les arbres, sur une étendu de terrain pour en
améliorer la fertilité du sol (technique agricole non durable). b) Système
agricole qui consiste à essarter et brûler une surface de forêt avant la mise
en culture (voir aussi écobuage).
Écobuage : a) L'écobuage, ou débroussaillement
par le feu, est une pratique
agricole ancestrale pratiquée dans le monde entier. Originellement, le terme
désigne le travail d'arrachage de la végétation et de la couche superficielle
de l'humus au moyen d'une
"écobue", outil proche de la houe, l'incinération en petits tas
de ces éléments puis l'épandage
des cendres sur les terrains
afin de les enrichir en éléments nutritifs. Cette pratique coûteuse en main
d'œuvre, a progressivement disparu au profit de la technique qui consiste à
brûler directement les végétaux sur pied et qui a cependant conservé
l'appellation "d'écobuage".
Feu contrôlé : voir brûlage dirigé, feu de
forêt, écobuage, pare-feu, coupe-feu.
Feu de
forêt : Incendie qui touche un massif boisé. Voir pare-feu,
coupe-feu, écobuage.
Ladang : Mode de culture sur brûlis qui ne tue pas les
grands arbres, épargnés pour leur ombrage. Seul le petit bois et la strate
herbacée sont brûlés. On plante alors au plantoir les graines de plantes
annuelles dans la cendre tiède. Le ladang dure deux ans, après quoi il faut
changer d'endroit. Voir culture sur brûlis.
Pare-feu : Le but des pare-feu
est de créer une discontinuité dans le peuplement forestier afin de stopper ou
ralentir la progression d'un feu. Ils doivent être installés
perpendiculairement aux vents dominants pour ne pas au contraire devenir des
couloirs de propagation du feu. Un pare-feu mal conçu ou mal entretenu
risque aussi d'être un facteur d'érosion, voire de fragmentation écopaysagère
et de propagation du feu. Ceux qui sont enherbés et entretenus par des
herbivores (moutons en général) semblent les plus efficaces. Ils jouent
généralement aussi un rôle de cloisonnement.
Voir feu de forêt, incendie de forêt, écobuage (synonyme coupe-feu).
« Selon les zones agro-écologiques et les saisons, ils sont
considérés soit comme un fléau, soit comme un outil de gestion agricole
(défrichement agricole, écobuage, élimination des ennemis des cultures par
brûlis des résidus de récoltes) soit un moyen de gestion des ressources
naturelles (stimulation de la régénération de l’herbe, protection des
habitations, voire même une pratique culturelle). Le feu peut aussi survenir
par négligence, en raison de conditions climatiques favorables, ou de manière
criminelle. Malgré les avantages évoqués, les feux de brousse ne sont pas sans
effets négatifs sur les ressources naturelles : baisse de la biodiversité,
perte de la matière organique et d’azote, épuisement de la réserve de fourrage
utile, dégradation des sols, baisse de la productivité des cultures et des
pâturages ».
La plupart de ces feux de brousses sont volontaires et liées aux
pratiques agricoles (culture itinérante sur brûlis).
A Madagascar, la culture sur brûlis ne demande pas d’effort ou
d’éducation (la moitié des Malgaches étant analphabètes). Car dès qu’une
parcelle est épuisée, il suffit de brûler celle d’à côté et l’île est vaste _,
contrairement aux techniques alternatives, plus complexes, même pour les plus
simples comme le semis-direct.
A Madagascar, les raisons des feux de savanes ou de brousses (qui se
propagent aux forêts), en fin de saison sèche, sont :
a) avoir de jeunes et tendres pousses d’herbes vertes, plus appréciées
par les zébus que l’herbe sèche,
b) tuer les tiques (tapak’ahitsy) du zébu (vecteur d’une bactérie
mortelle, la cowdriose) car pas de solution alternative proposée ou
enseignée par le gouvernement (il existe bien des solutions biologiques et
médicamenteuses _ antibiotiques telles que tétracyclines notamment
l'oxytétracycline injectable _, mais il n’y a pas d’argent pour cela. A
contrario, il n’existe pas de vaccin. Quant à la solution de prairies cultivées
avec pesticides, elle demande de l’argent, plus de travail, est moins
écologique et demande un certain niveau d’éducation ...).
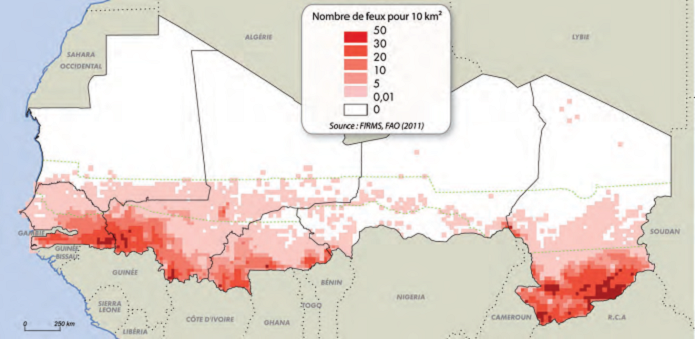
Densité moyenne des feux de brousse entre 2001 et 2010.
|

Exemple de feux de brousse au Mali © FAO (2010).
|

Culture sur brûlis à Madagascar (Tavy) © B. Lisan.
|
|

Création de pares-feux au Sénégal © PAPF (2004).
|
|
Sources : "Suivi des feux de brousse au Sahel",
I. Garba, I. Touré, A. Ickowicz, JD. Cesaro, B. Toutain, in "Atlas des évolutions
des systèmes pastoraux au Sahel 1970-2012", CIRAD, FAO, SILSS, http://www.fao.org/3/i2601f/i2601f.pdf
|

Déforestation à Madagascar : feux d’origine humaines dans
la forêt primaire des gorges de la Rivière Tsiribinhina (Madagascar). © B.
Lisan, septembre 2009.
|

Déforestation à Madagascar : feux d’origine humaines
Le long de la RN7 entre Antsirabe et Antananarivo
(Madagascar). © B. Lisan, septembre 2009.
|
|

Déforestation par incendies en Amazonie.
|

Feu de forêt (Tavy). Madagascar. © B. Lisan, 2009.

L’Amazonie en feu, à cause de la déforestation pour faire
place à des prairies ou des cultures rentables _ sojas etc. (source
Greenpeace).
|
•
Mise en place de tours de guet confortables, pour la
surveillance.
•
Instauration d’une surveillance assurée par population locale
(impliquée dans la lutte).
•
Avoir un stock de grandes pelles solides (pour éteindre les
flammèches, brandons et départs de feu).
•
Mise en place de :
Ø
De tranchées,
Ø
De coupe-feu, de pares-feux,
Ø
De réserves d'eau.
Ø
De plans de préventions.
·
Débroussailler régulièrement le couvert végétal dans les
sous-bois, soit par les ovins/herbivores, soit par des moyens mécaniques.
·
Utiliser les feux contrôlés, dirigés (écobuage), en brousse et/ou
dans les sous-bois, en période de saison des pluies, sans vent (avoir, avec
soi, des pelles pour limiter la zone brûlée). Cet acte doit être réalisé d’une façon
planifiée et contrôlée, sur une zone prédéfinie, et il dépend des conditions
climatiques.
·
Planter, peut-être, éventuellement, des espèces résistantes aux
feux.
·
Formation à la surveillance anti-incendie pour les guetteurs,
·
Création de chemins forestiers, largement dégagés, d’accès
rapides aux sites, sur les crêtes.
·
Véhicule 4x4 rapide de lutte anti-incendie, camion réservoir
de pompier (+ entretien) (si les moyens financiers le permettent).
·
Caméras et systèmes automatisés à infrarouge (si les
moyens financiers le permettent).
·
Utilisation de drones de surveillance (si les moyens
financiers le permettent).
Le plus important :
a) le débroussaillage, b) l’aménagement de coupe-feux.
|

Ne pas allumer des feux n’importe où.
|

Durant le feu, utilisation de pulvérisateurs individuels,
en plus des pelles.
|

Des feux contrôlés sont une stratégie préventive depuis
longtemps utilisée.
|
Les Feux
contrôlés peuvent cependant à terme appauvrir le sol et sélectionner des
plantes qui brûlent bien et dont les graines germent mieux suite aux incendies
(espèces pyrogènes/pyrophyles) (Ex.: ajonc, imperata…).
Attention ! Les écobuages sont loin d'être anodins. Mal maîtrisés,
ils peuvent conduire à des départs de feux catastrophiques, à la morts
d’humains (de promeneurs…) ou d’animaux …
|

Installer des coupes feux découpant la forêt en parcelles
(pour la lutte contre le feu).
|

Débroussailler régulièrement les sous-bois (pour la lutte
contre le feu).
|
|

Installer des réservoirs d’eau (pour l’irrigation et la
lutte contre le feu) . Étanchéité réalisée avec une couche d’argile ou
un géotextile étanche.
|
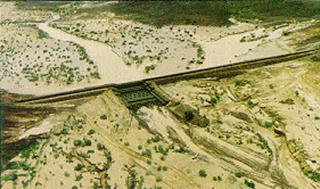
Construction de digues pour faire des retenues d’eau ou
des barrages (Tout dépend du régime des pluies, de celui des crues et de la
porosité du sol, localement).
|
|
  
Tours de guets.
|
 
Tours de guets.
|
|
 
Débroussaillement et pâturage par les moutons , ovins etc.
|
 
Chemins de crête, largement dégagés ,d’accès facile, souvent
servant de coupe-feux.
|
|
 
A gauche : Coupe-feux (Maroc).
A droite : Bulldozer pour aménager les chemins et
coupe-feux.
|
 
Caméra infrarouge système Artis Fire (efficace mais
coûteux).
|
Pour mention. En 2020, le ministère espagnol de l’écologie a mis en
place un système d’intelligence artificielle pour prédire les incendies. En un
an, le nombre d'hectares calcinés a baissé de 20%.
Des solutions sont aussi développées par des sociétés privées. C'est le
cas de Pyro, une start-up espagnole à l'origine de capteurs capables
d’alerter les habitants et les autorités en cas d'incendie. Les capteurs
mesurent en temps réel la température, l’humidité, le vent et les gaz contenus
dans l'air.
"Le capteur peut nous indiquer la force du vent de façon très
précise. Les pompiers savent quel capteur a déclenché une alerte et quand. Ces
informations sont accessibles sur un téléphone, on peut donc générer un
itinéraire jusqu'au capteur", explique au 19h30 José Luis Liz,
fondateur de Pyro.
|

Ce capteur, de la société Pyro, mesure, en temps réel la
température, l’humidité, le vent, les gaz contenus dans l'air, et, en cas de
problème, envoie une alerte vers une liste de destinataires, ce qui leur
permet d’agir le plus vite possible. 24h sur 24, les données sont analysées
dans un centre de contrôle. Le village d’Olocau, sur la côte méditerranéenne,
entouré par des forêts de pins, s’est équipé d’une soixantaine de capteurs de
la société Pyro.
|

Ce drone, de la société Drone Hopper, équipé de
capteurs thermiques, peut transporter 600 litres d’eau.
|
A Madrid, l'entreprise Drone Hopper travaille sur un drone faisant
office de canadair. Moins cher qu'un avion, ce drone peut transporter 600
litres d’eau. Grâce à ses caméras thermiques, il localise précisément les
points chauds. Un prototype pourrait être opérationnel dès la fin de l’année.
Selon Pablo Flores, fondateur de Drone Hopper, "Le pompier
pourra être près de l’incendie, mais pas en plein milieu. Il pourra se trouver
à 1km ou 2km du feu et donc ne pas prendre de risque."
Source : L'Espagne mise sur de nouvelles technologies pour
déjouer les incendies, 05/09/2021, https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/12449870-lespagne-mise-sur-de-nouvelles-technologies-pour-dejouer-les-incendies.html
•
Campagnes d'information sur les risques et la prévention auprès
du public :
•
Formation professionnelle et citoyenne, des habitants, par les
pompiers, à la lutte anti-feux.
•
Apprendre l'extinction des feux (tous les moyens d'intervention,
quels qu'ils soient).
•
Et la remise en état (les mesures prises après l'incendie, pour
en limiter les effets négatifs).
•
Programmes spécifiques destinés aux écoliers, avec interventions
de forestiers et de sapeurs-pompiers dans les écoles.
•
Spots télévisés, campagne d’affiches, annonces radio de
sensibilisation.
•
Représentations théâtrales sur les conséquences des feux avec
accent sur les risques.
•
Faire comprendre les enjeux économiques, écologiques (l’érosion
…) de ces feux etc.
•
Maîtriser le développement urbain, ne pas construire en zones
inflammables.
•
Cartographie des zones à risque (pyro-géographie).
•
Eviter les terres et forêts en fiches, non entretenues
•
Eviter d’assécher les tourbières.
•
Disposer en permanence d’eau, de réserve d’eau, d’extincteurs, à
proximité des zones à risques.
|

Ne pas allumer des feux n’importe où.
|

Un geste en apparence anodin.
Source : Tableau Bergère - départ de feu par
Aimée Rapin.
|

Le triangle
du feu :
Combustible (bois, essence …),
+ Oxygène
(l’air …),
+ Chaleur
=> donne le feu.
|
Pour éteindre un feu, on dit qu’il faut (voir
ci-après) :
|

Un verre d’eau à la première minute.
|
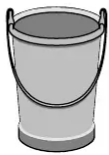
Un sceau à la seconde minute.
|

Une tonne d’eau à la 3ème minute.
|

Après …
|
D’où l’importance d’une action rapide !!!
•
Alerter immédiatement les secours ou pompiers (en France : 112 /
18) ou la communauté villageoise, en cas de départ de feux,
•
Éviter de fumer ou de faire un barbecue, un feu, en période
sèche.
•
S’entraîner ensemble à « des exercices incendie » dans les zones
sensibles.
•
Installer des panneaux de signalisation et d’alerte sur les
risques.
·
Législation forestière imposant aux propriétaires de nettoyer les
sous-bois, le long des routes, d'éclaircir les taillis (voire le reboisement
des zones brûlées).
·
Obligation du débroussaillement pour les propriétaires de forêt.
·
Peines sévères en cas d'incendies intentionnels (jusqu’à
l’emprisonnement à perpétuité en France).
•
Stratégie d'attaque immédiate des feux naissants (surtout ne pas
les laisser prendre de l’ampleur !).
•
Par exemple, apporter, avec soi, des pelles, un pulvérisateur ou des
extincteurs, des réserves d’eau, dans un sac à dos … Les solutions étant
toujours variées et flexibles, fonction du contexte, de la situation…
•
Attention au sens du vent et à la fumée (fuir si le vent change).
•
|

Utilisation de pelles.
|

Durant le feu, utilisation de pulvérisateurs individuels,
en plus des pelles.
|

Des feux contrôlés sont une stratégie préventive depuis
longtemps utilisée.
|
Consulter aussi cette page web : Lutte
contre les feux accidentels, http://www.fao.org/3/T0748F/t0748f0e.htm
•
Extraction et disposition de pierres et du bois brûlé, le long
des lignes de nivellement, pour retenir le sol et éviter l’érosion.
•
Ramassage des arbres brûlés, pour éviter qu'ils soient abattus
par le vent.
•
Abattage partie aérienne d'arbres non brûlés, pour accélérer leur
régénération.
•
Loi ordonnant le reboisement des zones brûlées.
Ce sont habituellement des layons,
chemins, allées
(éventuellement bordées d'un ou deux fossés) qui
doivent être aménagés et régulièrement entretenus.
Ce sont parfois aussi des tranchées déboisées pour le
passage de lignes
électrique (de moyenne ou haute tension) ou d'un pipe-line qui jouent ce
rôle avec plus ou moins d'efficacité.
Selon les contextes, ils sont désherbés, voire labourés ou au contraire
plantés d'herbacées fauchées et/ou pâturées.
Les coupe-feux visent notamment à interrompre la continuité des chaumes
secs de la strate
herbacée ou de la litière de feuilles sèches (des sous-bois), très
inflammables en saisons sèche.
Les pare-feux ont une efficacité très variable selon la saison, le vent, l'intensité du feu et le contexte biogéographique. En
zone aride ou sèche, les
pare-feux se sont souvent montrés vains contre les grands incendies de forêt
sauf si le feu et le vent sont modérés, et/ou si la forêt est assez humide et
si le feu s'est déclaré au bord du pare-feu et contre le vent. En dépit des
stratégies croissante de création et d'entretien de coupe-feux, les feux de
forêts continuent globalement à progresser et les incendies touchent des
surfaces de plus en plus grandes, malgré les coupe-feux. Ils semblent utiles
dans de nombreuses situations, mais doivent toujours être accompagnés de
stratégie plus globale de prévention du risque, et de formation, information…
On peut combiner plusieurs activités sur les pare-feux : sylvopastoralisme, viticulture, culture du figuier de Barbarie,
production d'olives et d'amandes etc. Plantation de
légumineuses sauvages autochtone enrichissant le sol et le paysage tout en améliorant
l'efficacité de la barrière contre le feu[7].
Pour son étanchéité, le fond du réservoir peut être tapissé d’argile,
d’un mélange d’argile et de pierres (moellons) ou d’un géotextile étanche (plus
coûteux).
Voire des réservoirs remplis d’eau, fermés, en plastique, en néoprène ,
en bois (ignifugé) ou métalliques (plus coûteux), peuvent être disposés à des
points stratégiques, pour la lutte anti-incendie.
A Madagascar, dans l’esprit des paysans pauvres, le problème de
déforestation aurait été « inventé » par le colonisateur occidental pour
justifier sa politique forestière répressive que continue le gouvernement
actuel => donc négation générale de l’ampleur du phénomène pourtant bien
réel et une désobéissance civile des paysans : 1) pour éviter les
arrestations, il mettent alors le feu aux forêts, la nuit, 2) pour être
entendus sur leurs conditions de vie, ils occupent des terres dans les forêts
(dans forêts de l’est …), 3) coupes pour le charbonnage en pleine forêt, pour
ne pas être vus, 4) feux dans les forêts, par les voleurs de zébus, pour les y
cacher et avoir de l’herbe jeune.
·
Education et Conscientisation des Acteurs locaux.
·
Création de Sources de Revenu de remplacement (pour les
charbonniers …).
·
Soutien des marchés locaux.
·
Etablissement d’un cadastre.
·
Planification de sa gestion et mise en place d’un système de
contrôle des objectifs.
·
Sécurisation juridique: 1) statut des zones pastorales, des zones
cultivées, des forêts, 2) des droits autochtones/locaux.
·
Contrôle des « front pionniers »
·
Redistributions foncières
•
Par des prélèvements dans la végétation locale. Prélèvements
(sous formes de surgeons, rejets, graines, boutures etc.) qui seront cultivés
ensuite en pépinières.
•
Dans les instituts agronomiques, horticoles ou agroforestiers
locaux (au niveau de leur jardin et de leur graineterie).
•
Dans des magasins de plantes et pépiniéristes locaux (mais
éviter les semences hybrides type F1, dont la faculté germinative n’est pas
assurée à la seconde génération).
•
Au frais (ou au froid) et au sec et dans un local frais (plutôt
ventilé).
•
Ne pas dépasser les dates limite de péremptions.
- le nombre de germes vivants au kg,
- la pureté du lot,
- l'état sanitaire,
- la faculté germinative.
Elles sont variées, dépendant des types de
graines. Voici les traitements que peuvent subir les semences : pré-nettoyage,
pré-séchage, dépulpage, séchage des fruits à la chaleur naturelle, séchage à
couvert (voire lyophilisation), séparation (des graines de leur enveloppe _ de
la capsule, de la balle de son ...), culbutage, battage, désailage (pour ôter
les ailes des fruits ailés), criblage, ventage (flottage des graines dans un
courant d'air de vitesse suffisante), flottation, triage par gravité, calibrage,
contrôle de la teneur en eau, stockage, tests de routine (contrôle visuel, test
du taux d’humidité etc.), ventilation ...
En général, les semences d’espèces végétales de milieux secs et arides
se conservent beaucoup plus longtemps (10 ans ou plus), que les semences
d’espèces de milieux tropicaux humides.
On peut avoir affaire à des semences récalcitrantes, par opposition aux semences orthodoxes, des graines,
ne survivant pas à la dessiccation et au froid pendant la conservation
ex situ. Leur stockage nécessite de les conserver
avec un degré d'humidité élevé. Mais cette humidité interne favorise l'attaque
des micro-organismes et le démarrage prématurée de
la germination, ces graines étant également endommagées par des températures
proches ou en dessous de zéro.
|

Graineterie © INRA - Avignon.
|


Graineterie, Pavlovk, Saint-Pétersbourg (Russie) © N.I.
Vavilov Institute of Plant Industry
|
|

La semence-othèque du Jardin des fraternités ouvrières de
Mouscron (Belgique).
|

La semence-othèque. Idem.
|
La bibliothèque de semences (banque de graines ou
"grainothèque") de cette association conserve environ 6500
variétés de semences de légumes, de céréales, de fleurs, de
plantes aromatiques, de plantes médicinales, d’arbustes et d’arbres,
d’engrais verts, des variétés peu connues de plantes rustiques, de plantes
anciennes, de plantes parfois oubliées, accessibles et produites par les
membres de l’association avec une multitude de variétés régionales,
résistantes, adaptées, exclues du marché et utiles pour l’alimentation de
l’homme, pour sa santé, celle du sol et de la Nature. De nombreuses
graines sont issues du jardin ou de ceux des passionnés de l’association.
Les autres proviennent de différents groupes de sauvegarde de semences à
travers l’Europe et le Monde (Kokopelli …). Elle occupe tous les murs du local
principal de l’association, du sol au plafond. Toutes les semences sont
répertoriées dans un catalogue, avec leurs caractéristiques principales, un
deuxième catalogue rassemble les arbres et arbustes. Le prix du sachet varie de
0.25 à 1€. Chacun dépose son dû dans la cagnotte déposée sur la table. Régulièrement,
autour d'une grand table, une douzaine de bénévoles trient, pèsent, ensachent
puis étiquètent les graines. Autour, sur les murs tapissés de rayonnages,
s'alignent de boîtes numérotées. Une pour chaque variété.
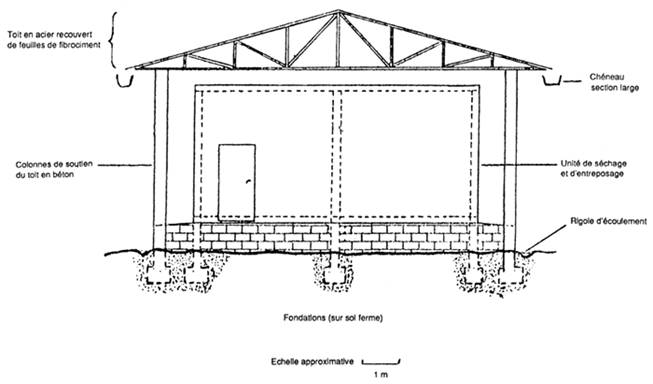
Plan d'une unité d'entreposage, à long terme, de semences,
vue de face (source FAO).
L'unité d'entreposage et de séchage pourrait comprendre les parties
suivantes:
·
Des fondations s'élevant de 50 cm (au moins) au-dessus du sol.
Des tubes en PVC de 2 pouces de diamètre, enfouis dans du gravier grossier
compacté sous la chambre froide à des intervalles de 50 cm environ, assurent le
drainage et la ventilation sous plancher.
·
Un toit séparé, constitué de feuilles de fibrociment (Ricalit ®)
posées sur une armature en acier et installé sur des colonnes en béton armé de
30 × 30 cm. Tous les côtés sont laissés ouverts, afin d'assurer une bonne
circulation d'air et d'éviter toute accumulation de chaleur sous le toit.
·
Un séchoir (de dimensions intérieures d'environ 7 × 3 × 3 m)
constituant une sorte d'antichambre de la chambre froide.
·
Voire une chambre fraiche froide.

Le stockage des lots en chambre froide ou frigo. Le
stockage des lots en congélateur.
Photo B. FAYE, GGE-MNHN Photo
B. FAYE, GGE-MNHN
- Enfin la
lyophilisation est destinée à la conservation à long terme.

|
Lyophilisation
des lots.
Photo B.
FAYE, GGE-MNHN
|
Stockages des lots lyophilisés en chambre froide ou frigo.
Photo P. GOETGHELUCK pour « Ca M'intéresse ».
|
|
Numéro de l'espèce: Numéro
de lot:
FICHE
DE TECHNIQUE SUR LA
COLLECTE DE SEMENCES
Famille:
Espèce: Nom
commun:
Date de collecte: Nom
de l'agent
de collecte:
No d'étiquette de l'arbre: Circonférence
du tronc:
Ramassées au sol [ ] ou coupées sur la branche de l'arbre [ ]
Localisation: Altitude:
Le type de forêt:
Nombre approximatif de semences collectées: Détails concernant
le stockage /transport:
Traitement de pré-semis: Date de semis:
Prélèvement de l'échantillon de feuilles et fruits [ ] Notes pour l'étiquette
de l'herbier:
|
Fiche descriptive de la semence
collectée.
Source : livre "restauration
des forêts tropicales", Stephen Elliott & al., Kew Book, 2013, page
158.

Vandana Shiva, militante écologiste
indienne, dans une des banques de graines, destinées à préserver la
biodiversité des semences (traditionnelles, « paysannes ») des
plantes alimentaires, qu'elle a contribuées à créer en Inde.
|
Date de collecte de semences:
|
No de l’espèce:
|
No du lot
|
|
Famille:
|
Nom commun:
|
|
Nom botanique:
|
|
Localisation:
|
|
Coordonnées du GPS: I Altitude:
|
|
Type de forêt
|
|
Collectées sur. Sur le sol [ ] Sur un
arbre [ ]
|
|
No d'étiquette de l’arbre:
Circonférence du tronc:
de l'arbre: cm
|
Hauteur de l’arbre: m
|
|
Collecteur:
|
Date d'ensemencement
|
|
Notes
|
|
[Spécimen de référence recueilli? [ ]
UNITE
DE RECHERCHE RESTAURATION FORESTIERE
ETIQUETTE DE L'HERBIER DU SPÉCIMEN DE RÉFÉRENCE
N.B.:
Toutes les dates sont écrites en jour/mois/année
|
|
FAMILLE: NOM
COMMUN:
NOM BOTANIQUE: DATE:
PROVINCE: DISTRICT:
LOCALISATION:
COORDONNEES
DU GPS: ALTITUDE:
HABITAT:
NOTES
DESCRIPTIVES: CIRCONFERENCE DU TRONC DE L'ARBRE: cm
HAUTEUR DE L'ARBRE: m
Ecorce
Fruit
Graine
Feuille
|
|
COLLECTE
PAR NO D'IDENTIFICATION DU SPECIMEN: NBRE DE DOUBLONS:
|
Informations enregistrées durant la
collecte de la semence. A1.3 Collecte de semences.
Source : livre "restauration
des forêts tropicales", Stephen Elliott & al., Kew Book, 2013, page
299.
Ressource
documentaire : Projet d’une banque de semences, Benjamin Lisan,
11/02/2014, http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/projet-banque-de-semences.pdf
& http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/projet-banque-de-semences.doc
La
catastrophe des « blizzards noirs » serait pour tout ou partie due
au surlabourage, c'est-à-dire
à un abus dans l'utilisation du labour occasionnant
une érosion très
importante.
Lorsque
l'érosion était trop grave et qu'elle concernait des sols vulnérables (limons
fins), la solution a souvent été, dans un premier temps, de faire une « culture en courbes de
niveau » (contour plowing) avec
des alternances charrue-instrument à dents, ou une « culture
alternée », consistant à distribuer le long des pentes des zones portant
des cultures différentes ou intégrant des bandes en jachère (« culture
en bandes », strip cropping).
Dès qu'il
a été possible d'assurer un contrôle efficace des mauvaises herbes,
la culture sans labour, voire le
semis direct, se sont développés.
Le
gouvernement américain a également prôné une réduction draconienne du bétail, afin
d'alléger la charge de culture.
Une vaste
campagne d'afforestation (de
reforestation) nommée « projet Shelterbelt »
a été lancée dans les Grandes Plaines, de la frontière canadienne au
Texas, afin de freiner l'érosion des sols.
Cette crise écologique provoquée
par le Dust Bowl a conduit le gouvernement américain à créer
le « Soil Conservation Service », appelé
aujourd'hui « Natural Resources Conservation Service », une
agence chargée de la sauvegarde des ressources naturelles et de l'environnement et
dépendant du ministère
de l'Agriculture.
|

Tempête
de poussière (semblable à un haboob) arrivant sur Spearman (Texas), le 14 avril 1935.
|

Ensevelissement
dû à une tempête de poussière à Dallas (Dakota du Sud).
|
Depuis 1900, le Sahara a progressé vers le sud de 250 kilomètres et ce
sur un front qui en fait plus de 6 000. C'est ainsi que la steppe du Sahel
connaît un dessèchement relativement brutal. Le Sahel a connu de grandes
sècheresses et famines, des années 70-80. Pour y remédier et lutter contre les effets du changement
climatique et de
la désertification en Afrique, le projet de la Grande muraille
verte pour le Sahara et le Sahel, communément appelée Grande
muraille verte (GMV), est l’initiative phare de l’Union africaine, lancée officiellement en janvier 2007.
Le projet, conçu comme un
moyen de lutter contre la désertification dans la région du Sahel et d’empêcher l'expansion du Sahara, par
la plantation d’un mur d'arbres qui s'étend sur tout le Sahel, se veut une
réponse à l'effet combiné de la dégradation des ressources naturelles et de la sécheresse dans les zones rurales. Il vise à
aider les communautés à atténuer et à s'adapter au changement
climatique ainsi qu'à améliorer la
sécurité alimentaire. La population du Sahel devant doubler
d'ici 2039, il cherche à maintenir la production alimentaire et de la
protection de l'environnement dans la région.
Initialement conçue comme un
long couloir de 15 km de large traversant tout le continent africain
sur 7 800 km en passant
par 11 pays, cette muraille devrait relier Dakar (Sénégal) à Djibouti ; cela représentera environ 117 000 km2, ou
11,7 millions d'hectares.
Depuis, il s'est depuis
transformé en un programme promouvant les techniques de collecte de l'eau et de
protection de la verdure et tout en améliorant les techniques indigènes
d'utilisation des terres, visant à créer une mosaïque de paysages (d’écosystème)
verts et productifs, à travers l'Afrique sub-saharienne (Sahel), L’Afrique du
Nord et la Corne de l’Afrique.
En tant qu’outil de
programmation pour le développement
rural, l’objectif global de ce partenariat
sous-régional est de renforcer la résilience des populations locales et des
systèmes naturels de la région , au Sahel et
au Sahara, grâce
à une gestion rationnelle des écosystèmes _ avec l’utilisation durable
des forêts, des pâturages et de l'ensemble des ressources naturelles dans les
terres arides _, à la protection du
patrimoine rural et à l'amélioration des conditions de vie des communautés
locales et de leurs revenus.
Selon l'Union Européenne, cette initiative
peut s'attaquer aux causes profondes [des problèmes de cette région, pauvreté,
malnutrition, révoltes en raison de ces problèmes] et peut œuvrer à la
prévention des conflits.
Cette couverture forestière devait apporter
de nombreux éléments positifs pour la population :
·
Une protection des champs et des
villages contre le vent et l'érosion.
Le mur végétal constitue un
filtre à poussière qui limite l'inhalation de poussières par les populations et
donc les maladies qui en découlent,
·
Un apport d'éléments nutritifs dans un
sol presque mort ; les feuilles mortes créent une litière qui protège et
régénère les sols des champs lorsque celles-ci y tombent et les arbres aident
également le sol à augmenter sa capacité à garder l'eau.
·
Une augmentation de l'humidité et
de la pluviométrie locale
grâce à l'évapotranspiration des arbres
plantés.
·
Une réserve de fourrage de qualité pour le
bétail car l'herbe pousse mieux à l'ombre des arbres.
Mise en œuvre : Pour la plantation, la technique utilisée, la régénération naturelle assistée, consiste en la sélection d'un rejet favorisé, et la coupe
des autres afin que la croissance se concentre sur un seul rejet.
Dans certaines régions très
sèches comme au Mali, on
optimise les plantations en pratiquant des sillons ou la technique ancestrale
du zaï qui permet de mieux concentrer l'eau
sur les jeunes plants.
Au Sénégal, la Grande Muraille mesure 545 km
de long sur 15 km de large, soit 8 175 km2 ou 817 500 hectares.
Le reboisement se fait pendant la saison des
pluies sur des parcelles de 600 hectares où des arbres sont plantés dans des
zones protégées par des clôtures grillagées des agressions du bétail des Peuls (aujourd'hui
sédentarisés). Une fois les arbres installés, on peut retirer les clôtures et
le bétail peut pâturer à l'ombre des arbres. On installe également près des
villages des jardins polyvalents exploités par des coopératives pour produire
des fruits et légumes frais.
Des bassins de rétention des eaux pluviales ont été également créés pour l'abreuvement du bétail, de même
que des jardins
circulaires, qui retiendraient mieux l'eau.
Essences utilisées pour le reboisement : On utilise des jeunes
plants d'essences préexistantes au niveau local qui résistent à la très faible pluviométrie locale (200 mm/an en 2015 contre 400 mm/an en moyenne dans
les années 60) et qui ont un intérêt économique. La gestion des pépinières de
jeunes plants et des jardins polyvalents (potagers) créés est confiée aux femmes créant ainsi des emplois et une
production alimentaire au niveau local.
Les espèces le plus souvent plantées sont
(voir ci-après) :
1.
Acacia Senegalia senegal (ou Acacia senegal), ou gommier blanc pour la
production de gomme arabique.
2.
Acacia Vachellia
seyal (ou Acacia seyal).
3.
Acacia albida,
kadd en wolof.
4.
Acacia Faux-gommier (Acacia
tortilis).
5.
Acacia Vachellia
nilotica (ou
Acacia nilótica), ou gommier rouge.
6.
Dattier du désert (Balanites
aegyptiaca), soump en
wolof.
7.
Hanza ou aizen (Boscia senegalensis), son fruit comestible, renforçant la sécurité alimentaire.
8.
Jujubier commun (Ziziphus
jujuba), pour ses fruits comestibles
(jujubes).
9.
Combretum glutinosum, utilisé en médecine traditionnelle, efficace contre la
toux.
10.
Marula (Sclerocarya birrea), pour ses fruits comestibles
(et la production d'alcool, de bioéthanol).
11.
Moringa oleifera (moringa,
neverdier ou nebeday), renforçant la sécurité alimentaire.
12.
Prosopis africana, résistant aux termites,
source d’alimentation avec ses graines.
13.
Detarium
senegalense ou Ditakh, pour ses fruits comestibles, renforçant la sécurité alimentaire.
Selon Wally Maene, membre de Timberwatch, ces
arbres pourraient réduire encore des ressources en eau déjà rares.
Selon Pierre Ozer, docteur en géographie à
l’université de Liège, les populations de ces régions sont trop dépendantes
de la biomasse pour respecter une nouvelle forêt.
Pour la représentante d’une
organisation de peuples indigènes dont les Réseaux d'information régionaux intégrés ont gardé l'anonymat, « la Grande Muraille Verte
pourrait interférer avec les circuits migratoires des communautés
pastorales ; elle devrait plutôt incorporer les systèmes ancestraux de
gestion des terres. Il vaudrait mieux protéger ce qui existe déjà dans la
région, arrêter de couper les arbres dans les vallées et les oasis, […] éduquer les communautés […] et remplacer
le bétail perdu. Je trouve que le projet est bon,
mais trop ambitieux. ».
Selon Mark Hertsgaard du Monde Diplomatique,
le phénomène de désertification n'est pas uniforme : « ce sont ces bandes de
terre qu’il faut viser, pas toute la bordure Sahel-Sahara ».
Selon l’agronome français Pierre Hiernaux, la dégradation des sols s'expliquerait
davantage par la surpopulation que par des facteurs climatiques. Plusieurs
études constatent que depuis la fin des sécheresses des années 1980, la
pluviométrie augmente, et avec elle le couvert
végétal, d'herbes ou d'arbres. La cause de la
dégradation des terres serait plutôt à chercher du côté de la pression
démographique et
de l'agropastoralisme.
En 2020, l'aménagement partiel de la
Grande muraille verte ne couvre que 4 millions d'hectares sur 100 millions
envisagés et le manque de coordination entre les services nationaux et les
collectivités locales empêche toute évaluation d'ensemble de ses résultats. En
raison de l'instabilité politique, certains des pays invités n'ont même pas mis
en place l'Agence nationale compétente.
Selon Robin Duponnois, directeur de recherche
à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), « Le tracé passe dans
des endroits assez instables (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Soudan) et des
zones de niveau orange et rouge en termes de risques sécuritaires et
terroristes. Les scientifiques ne sont donc pas autorisés à s’y rendre, en
particulier les étrangers. ».
Il a été démontré que la restauration des
terres nues a été faite avec succès au Burkina Faso, bien que la sécurité soit
un problème face aux activités terroristes.
Ce projet, dont un des but est justement
réduire les conflits et l’instabilité, dans certaines zones, ne peut y être mis
en œuvre efficacement, à cause de cette instabilité. C’est un cercle vicieux.
Seule la portion prévue au Sénégal a été réalisée en conformité avec les
objectifs initiaux.
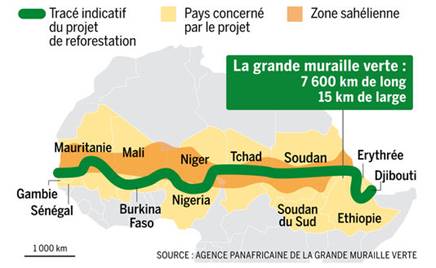
Tracé du Grand Barrage Vert en
Afrique.
Ressources documentaires : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_muraille_verte_(Afrique),
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Green_Wall_(Africa),
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_panafricaine_de_la_grande_muraille_verte
Le « Barrage vert », en Algérie, une initiative des années 70, a été un échec, en
raison de la fragilité de ses plantations monospécifiques, face aux maladies et
ravageurs (en particulier, le pin d’Alep vulnérable face à la chenille
processionnaire du pin) et au manque d’entretien et d’arrosages des plants, en
périodes de sécheresse.
Mais les ceintures vertes
construites en périphérie urbaine en Mauritanie et au Niger où selon le CSFD, « l’échelle de cette
régénération est évaluée à 4 millions d’hectares (soit 15 à 20 fois plus
d’arbres en 2005 qu’en 1975) », ont été une réussite.
Le GBM est
une organisation non gouvernementale citoyenne
et indigène kenyane basée à Nairobi et engagée pour l'écologie et l'écoféminisme, lancé par la
biologiste, professeure d'anatomie en médecine vétérinaire et militante
politique et écologiste, Wangari
MaathaiV, prix
Nobel de la paix en 2004, surnommée la femme qui plantait
des arbres. Le mouvement cherche à promouvoir une approche holistique du
développement qui associe la protection de l'environnement, le développement communautaire
(développement local) et le renforcement des compétences.
Succès : le mouvement convainc, en 1977, le gouvernement kenyan de lancer une campagne nationale de sensibilisation sur la désertification. Le mouvement des ceintures vertes
(GBM) est accueilli favorablement par les associations de femmes dans les
communautés rurales. Le bois est utilisé pour la construction ou sert de
combustible pour cuire les aliments, les feuilles servent de fourrage pour les
animaux. Alors que la déforestation contraignait les femmes à aller toujours
plus loin et à mettre toujours plus de temps pour trouver les ressources de
première nécessité, les plantations à proximité des villages améliorent leurs
conditions de vie. Les femmes s'impliquent alors très rapidement dans le
mouvement de la ceinture verte.
En 1977, les semis sont produits
par le mouvement de la ceinture verte à Nairobi qui, rapidement, n'arrive pas à
répondre à la demande de plants. Le GBM forme alors des femmes pour qu'elles
créent et gèrent elles-mêmes des pépinières. Les femmes gagnent en autonomie.
Les pépinières leur assurent un revenu par la vente des jeunes plants.
Le GBM mène également des
actions de sensibilisation sur la sécurité de la chaîne alimentaire et incite
les populations à se tourner vers l'agriculture
vivrière et la culture d'espèces autochtones. Il
les informe également sur les techniques de rotation des récoltes, ce qui évite
aux paysans l'achat d'engrais chimiques et permet d'amender les sols naturellement par le paillage et la fumure.
Pour ne pas dépendre
uniquement des fondations (étrangères), le GBM se tourne vers l'écotourisme, organisant des circuits de découverte des ceintures vertes.
Les touristes découvrent les activités des populations locales et y
participent. Ces circuits touristiques assurent une large diffusion au
mouvement.
En 1986, le GBM organise des sessions de
formations pour diffuser et essaimer le modèle dans d'autres pays africains. La
Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi, le Lesotho, l'Ethiopie, le Zimbabwe s'inspirent
de ce mouvement et lancent avec succès des initiatives semblables.
Dès l’origine, le mouvement
met les femmes au centre des processus. Dès 2003, il lance des programmes de
promotion des droits des femmes, abordant les questions de santé, alphabétisation et
sexualité.
Conflit avec le gouvernement : Le mouvement s’est toujours engagé contre la
cession des terres, par le gouvernement, à des investisseurs privés, et contre
la construction de centres commerciaux. Pour ces motifs, en 1993, Wangari
Maathai était arrêtée chez elle. Mais elle avait été libérée, en raison de la
pression internationale.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_la_ceinture_verte,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Belt_Movement
La Grande muraille
verte de Chine est le nom donné par la République populaire de Chine au projet
de plantation de
forêts, débuté en novembre 1978, destiné
ralentir le processus accéléré de désertification et d'érosion des sols, à
freiner la progression du désert de Gobi, à lutter contre le réchauffement climatique global et à
réparer les conséquences des déforestations passées. La mise en place du projet devrait se terminer, entre 2050 et 2074,
date à laquelle il devrait
s'étendre sur quelque 4 480 kilomètres de long. Cette ceinture
forestière sera plantée dans les régions des Trois-Nord (c'est-à-dire les
régions Nord-Ouest, Nord et Nord-Est de la Chine).
Mise en œuvre du projet : La phase la plus récente
— la 4e phase
qui a débuté en 2003 — comporte deux volets : d'une part l'ensemencement
aérien pour couvrir de larges étendues de terres où le sol est moins aride et
d'autre part la rétribution des agriculteurs pour la plantation d'arbres et
arbustes dans les zones qui sont les plus arides7. Un budget de 1,2 milliard de dollars a également été dévolu
à la mise en place d'un système de surveillance (cartographie et bases de
données de surveillance). La « muraille verte » sera constituée
d'une ceinture de végétation tolérante au sable dont les plantations seront
disposées en damier afin de stabiliser les dunes de sable. Les arbres devraient également servir de coupe-vent
contre les tempêtes
de poussière.
60 000 soldats de l'Armée populaire de libération ont
ainsi été affectés au projet au début de l'année 2018 ? pour planter des
arbres.
Premiers résultats : sur les 53 000 hectares plantés, en 2009, un quart est
mort et pour le reste, une bonne part est constituée de nombreux arbres nains,
qui n'ont pas la capacité de protéger les sols. En 2008, les tempêtes
hivernales avaient détruit 10 % du nouveau stock forestier.
La cause : probablement, la focalisation des autorités sur la quantité des
espèces et essences forestières replantées, sur les chiffres, que sur leur
choix, sur leur qualité et sur leur adaptabilité écologique à ces régions
arides.
En 2014, la surface de forêt chinoise était
de 2,08 M km2, soit environ 22 % du territoire.
Baisse des nappes phréatiques : si les arbres réussissent
à s'implanter, ils pourraient absorber de grandes quantités d'eau
souterraine, ce qui est extrêmement problématique pour
les régions arides comme le Nord de la Chine. Ainsi à Minqin, une zone dans
le nord-ouest de la Chine, des études ont démontré que le niveau des eaux
souterraines a baissé de 12 à 18 mètres.
Problèmes liés à la démographie humaine
(et son manque de sensibilisation au projet) :
L'érosion des terres et la surexploitation agricole ont interrompu les semis dans
de nombreuses zones du projet. L'essor de la démographie chinoise a également appauvri le sol, le rendant inutilisable.
Les niveaux croissants de pollution (liée aux centrales
à charbon …) ont également fragilisé les sol, les rendant inutilisables dans de
nombreuses régions.
Perte de biodiversité : Les autorités ont tendance à privilégier les
monocultures (les plantations monospécifiques), ce qui a des effets désastreux
pour la biodiversité locale.
Mauvais choix des espèces
et monoculture : Le
manque de diversité expose aussi plus les arbres aux maladies au point
qu'en 2000, un
milliard de peupliers du Ningxia furent détruits par celles-ci, réduisant à
néant vingt ans d'efforts. Les arbres plantés sont souvent des essences non-adaptées
aux climats locaux, rendant la forêt plus fragile et appauvrissant les sols.
Selon Jiang Gaoming, un écologiste de
l'Académie chinoise des Sciences et défenseur des barrières (en paille ou plastique), la terre fragile, de ces régions,
ne peut supporter de telles plantations massives à la croissance forcée.
Ressources documentaires : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_muraille_verte_(Chine),
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Green_Wall_(China)
c) https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%8C%97%E9%98%B2%E6%8A%A4%E6%9E%97.
Pour les chercheurs chinois, le but ultime du contrôle du sable n'est
pas d'éliminer les déserts, mais d'améliorer la biodiversité des écosystèmes
désertiques et de trouver un moyen pour les humains et les déserts de vivre en
harmonie.
Selon Zhao Yang, chercheur associé à la Shapotou Desert Research and
Experiment Station (SDRES) de l'Académie chinoise des sciences (CAS), « il
faut naturellement environ 10 ans pour former une croûte de cyanobactéries à la
surface du sable qui peut l'empêcher de bouger. Cependant, en hybridant une
souche bactérienne spéciale extraite de la croûte biologique du sol du désert
de Tengger avec les cyanobactéries cultivées, les chercheurs du SDRES ont
réussi à réduire le temps de formation de la croûte à un an seulement ».
Les croûtes de sols biologiques artificiels sont formées par inoculation des
cyanobactéries Microcoleus vaginatus et Scytonema javanicum, sur
la fine couche arable des dunes du désert, elle-même contenant des lichens (cyanobactéries
répandus par épandages aériens).
Il a été aussi mis en place des structures en paille, ressemblant à des
damiers, se révélant être le moyen le plus pratique, le plus écologique et le
moins coûteux d'arrêter l'empiètement du sable. A l'intérieur des damiers, la
surface du sable forme avec le temps une croûte dure qui empêche le sable de
bouger.
|

Photo, prise le 7/09/2020, montrant des travailleurs, fabriquant des
barrières de paille, disposés en damier, pour la lutte contre la
désertification, dans le désert de Tengger, le long du chantier de
construction de la section Qingtongxia-Zhongwei de l'autoroute Wuhai-Maqin
dans la région autonome du Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine.
(Xinhua/Feng Kaihua).
|
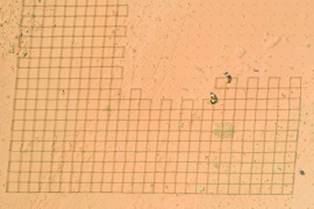
Une photo aérienne montre des ouvriers fabriquant des grilles
(barrières en paille) pour contenir les dunes de sable en mouvement, le long
du chemin de fer Linhe-Ceke, dans la région autonome de Mongolie intérieure
(nord de la Chine), le 14 avril 2021. (Xinhua/Liu Lei).
|
Watershed Organization Trust (WOTR). Lieu
d'implatation : Javele Baleshawar (38 familles, 330 ha). Sangar Jao
Jodai et Usar ou Ivar Bazar (240 familles, 900 ha), Inde, centre ouest.
Chrispino Labo, président de WOTR. Autres responsables : Peter
Weinert.
Source : a) http://www.wotr.org/, b)
http://www.3sat.de/page/?source=/ard/themenwochen/178089/index.html
c) Vidéo sur le projet : Pluie bénie, Des villages indiens face à
la sécheresse, Documentaire - 44 min, Réalisation : Peter Weinert, http://www.arte.tv/guide/fr/045948-000-A/pluie-benie
|

|

|
|
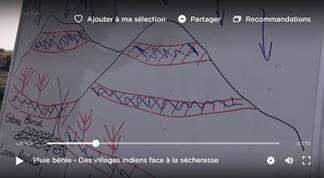
|
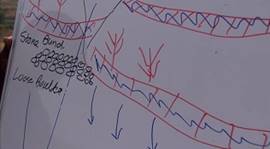
Enclos de pierre et blocs en vracs
|
|

|
ß ↖
Préparation du projet ↑
|
Le creusement d’un puits coûte environ 3000 €. Les paysans, cultivant
le millet etc, ne souffrent plus de la faim, grâce aux excédents de récolte.
Grâce au projet, la profondeur de la nappe phréatique est repassée de
-25 m à -10 m. Grâce au projet et à l'argent que les récoltes abondante ont
généré, tous les enfants vont à l'école, avec pourtant une région avec une
pluviométrie de 300 à 400 mm/an. Usar ou Ivar Bazar : 240 familles, 900 ha, 1
millions arbres, 50 barrages.
Parmi la diversification des cultures : Champs de fleurs, vergers de
grenadiers ....
|

Creusement de sortes de baissières.
|
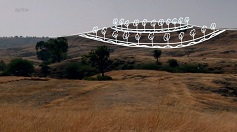
á Plan de la
préparation du terrain : baissières, réservoirs, canaux d’irrigation etc.
|
|

Remplissage des baissières à la saison des pluies.
|

Dessin des barrages (johads, retenues …), des gabions
(casier constitué de solides fils de fer tressés et rempli de pierres, pour
construire des murs de soutènement,
|

Plan de la préparation du terrain : baissières, réservoirs,
canaux d’irrigation etc.
Questions à poser aux agriculteurs intéressés à participer au projet :
Superficie exploitation, caractéristiques, emplacement alimentée en eau
nappe phréatique, nombre animaux, espèces élevés, composition famille.
Lors de l'élaboration du projet, l'ONG, qui apporte ses conseils, ne
doit pas imposer des décisions unilatéralement aux paysans. La règle : chercher
à convaincre les agriculteurs.
|

Succession de petits barrages.
|

Vérification du barrage.
|
|

Citerne
|

Puits
|
|

Johad (levée de terre).
|
|
↑ Construction de de puits, de réservoirs, barrages en pierre
consolidé et mortier, nécessitant la présence d’experts.
|

Creusement de la baissière ou du canal.
|

Plantation des arbres.
|
|

Plantation des arbres.
|

Plantation de grenadiers.
|
|

|

Irrigation par le goutte à goutte.
|
|

|

|
Sans lunette ou jumelle de chantier, on peut mesurer l’altimétrie et la
planimétrie pour les ouvrages à réaliser (baissières, canal d’irrigation …)
avec ce dispositif simple (à niveau d’eau et vases communicants (?)). On
pourrait aussi le réaliser avec le compas égyptien.
•
Des instituts comme « Salt Farm Texel », au
Pays-Bas, etc. essayent de créer des variétés résistantes au sel : pommes de
terre, carottes, betteraves, tomates …
•
Mais on peut, malgré tout, s’attendre à des rendements plus
faible qu’en agriculture conventionnelle.
Sources : a) http://www.saltfarmtexel.com/,
b) https://twitter.com/SaltFarmTexel,
c) Emission Xenus, Que faire contre la faim dans le monde ? ARTE-WDR,
2015.
La microbiologiste ouzbek Dilfuza Egamberdieva, chef de groupe à
l'Université nationale de l'Ouzbékistan, à Tachkent, a isolé des souches
bactériennes résistantes au sel qui vivent dans les sols salins-dégradé, où ils
aident le processus d'enracinement des plantes. Dans son enquête, Egamberdieva
a repéré des bactéries résistantes au sel, bénéfiques pour le sol, aidant les
plantes à mieux pousser, ne nuisant pas aux hommes. Ces bactéries se
retrouvent autour des racines des plantes. «Nous avons constaté que les
bactéries de la famille des Pseudomonas, en particulier Pseudomonas
extremorientalis, sont résistantes au sel et poussent à proximité des
racines, où elles sont en concurrence avec d'autres bactéries, pour la
colonisation. Au contraire, les bactéries pathogènes peuvent pas coloniser
activement les racines des plantes. Alors que les Pseudomonas produisent
des antibiotiques que les plantes utilisent pour se défendre contre les
champignons, déclenchant le processus d'enracinement et produisant des facteurs
de promotion de la nodulation, donnant ainsi à la végétation de meilleures
chances de fixer l'azote et de grandir ensemble ». En échange de ces
faveurs, les plantes sécrètent des exsudats utiles pour les bactéries.

Pseudomonas extremorientalis est semblable à cette
bactérie (ici photo de Pseudomonas aeruginosa).
Note : Elle a fait l’essai avec le haricot commun (Phaseolus
vulgaris), avec le chardon-marie (Silybum marianum) (une plante
médicinale).
Source : Salt-tolerant bacteria improve crop yields, TWAS,
October 6, 2013, http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131006142707.htm
La plantations de pins (en Chine) a provoqué l'épuisement des nappes
phréatiques. Le désert de Mu Us a été massivement recouvert d'arbres pour
lutter contre les tempêtes de sable. Une étude satellite américaine vient
d'établir que son sous-sol avait perdu 21 km3 d'eau ces deux dernières décennies.
La sécheresse a déjà tué la quasi-totalité des 11 millions de sapins
plantés, en novembre 2019, en Turquie, lors de son opération de reforestation
massive "Breath for the Future" ("Un souffle pour
l'avenir"), lancée en grande pompe par le ministère turc de
l'Agriculture et des Forêts, et par le président Recep Tayyip Erdoğan.
A cause de l’augmentation des épisodes de sècheresse et d’un mauvais
choix des espèces à planter, les initiatives de reforestation peuvent partir en
fumée, à cause des feux de forêts, ou être tuées dans l’œuf par la sécheresse.
Des incendies criminels peuvent être allumé, parce qu’il n’y a pas
adhésion des populations locales au projet et parce qu’elles n’ont pas reçues
les retombées (économiques, revenus etc.) qu’on leur avait promis (cas à
Madagascar ou des subventions pour aider les populations locales à préserver
leur environnement sont détournées par la corruption).
« Les risques liés au climat ne sont pas bien pris en compte
dans les initiatives de reforestation, alors que ça devrait être une priorité ! »,
s'alarme Anderegg, biologiste à l'université d'Utah. « Il est possible
que les impacts climatiques diminuent radicalement la capacité de puits de
carbone des forêts mondiale; les modèles ne s'accordent pas encore sur ce sujet.
» « Il me paraît beaucoup plus responsable de ne pas émettre de CO2 plutôt
que de tenter d'en stocker une partie dans cette biomasse pouvant partir en
fumée à tout moment », grince Pierre Friedlingstein, spécialiste de la
Modélisation mathématique des systèmes climatiques, à l'Université d'Exeter.
[…].
« Le plus grave, c'est qu'environ la moitié des engagements
nationaux de reboisement dans le monde concerne aujourd’hui de pures
plantations d'arbres. Des forêts artificielles qui prennent essentiellement
la forme d'alignements monotones d'eucalyptus, acacias, pins ou peupliers dont
la croissance ultrarapide promet une belle rentabilité en bois et carbone à
très (très) court terme. Mais avec une résilience et des impacts écologiques
souvent déplorables.
D'accord, ces plantations visent à occuper toutes les zones
sauvagement déforestées et dégradées de la planète. Seulement, l'obsession
pour les arbres est telle qu'une bonne partie des terrains considérés comme
propices dans les programmes internationaux (Défi de Bonn, AFR100, etc.)
s'avèrent en fait des prairies, brousses ou savanes tout ce qu'il y a plus
naturel ! « Vu de satellite, les savanes ressemblent beaucoup à des forêts
dégradées, s'inquiète Élise Buisson, écologue à l'université d'Avignon, alors
que cela n'a strictement rien à voir : dans la savane, on trouve une énorme
diversité d'espèces herbacées évoluant à la lumière, des essences d'arbres
adaptées au passage des incendies... ».
Les 10 pays du Sahel
s'étendent sur plus de 7 millions de kilomètres carrés et abritent près de 135
millions d'habitants. Certains des plus grands pays comprenant une part
importante de désert (le Mali et le Niger) ont de faibles densités de
population, de moins de 20 personnes par kilomètre carré. D’autres pays plus
petits, qui ont accès à la mer (comme le Sénégal), ont des densités de
population de 50 personnes ou plus par kilomètre carré. Le Burkina Faso, qui
est enclavé, a une densité de 65 personnes par kilomètre carré. Seule la Gambie
a plus de 150 personnes par kilomètre carré.

La région du
Sahel comprend 10 pays, qui diffèrent sur le plan démographique.
En Afrique subsaharienne, il
y a une tendance démographique lourde : la population devrait atteindre 1,2
milliard d’habitants en 2025, sans doute 1,8 en 2050.
Les indicateurs démographiques-clés des 10
pays du Sahel, 2014 (voir ci-dessous) :
|
Pays
|
Populations en millions
|
Taux annuel d’accroissement (%)
|
Densité de population (personnes par km2)
|
Indice de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme).
|
|
Burkina Faso
|
17,9
|
3,1
|
65
|
5,9
|
|
Tchad
|
13,3
|
3,3
|
10
|
6,6
|
|
Érythrée
|
6,5
|
2,6
|
56
|
4,7
|
|
Gambie
|
1,9
|
3,1
|
169
|
5,6
|
|
Guinée Bissau
|
1,7
|
2,5
|
48
|
5,0
|
|
Mali
|
15,9
|
2,9
|
13
|
6,1
|
|
Mauritanie
|
4,0
|
2,6
|
4
|
4,1
|
|
Niger
|
18,2
|
3,9
|
14
|
7,6
|
|
Sénégal
|
13,9
|
3,2
|
71
|
5,3
|
|
Soudan
|
38,8
|
2,5
|
21
|
5,2
|
Source : Carl
Haub et Toshiko Kaneda, 2014 World Population Data Sheet (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2014) (voir
ci-avant).
Note : Le Soudan ne comprend
pas le Sud Soudan.
Ce sont souvent les pays les
plus pauvres, les plus arides, qui ont l’indice de fécondité et le taux annuel
d’accroissement les plus élevés, occasionnant une pression humaine sur le
milieu, supérieure à ce que ce dernier peut supporter. Or on prévoir le
doublement de la population du Sahel d'ici 2039. Donc, on peut rationnellement
prévoir une augmentation du nombre de conflits, de rebellions contre les
gouvernements locaux, souvent incompétents et corrompus, à cause de la pauvreté
et de la malnutrition, de plus en plus de déplacés, à causes des guerres et
conflits locaux, et de migrants économiques (voire climatiques), vers les pays
riches (dont l’Europe). Donc on peut prévoir la persistance, voire
l’aggravation de l’immigration clandestine vers ces derniers pays.
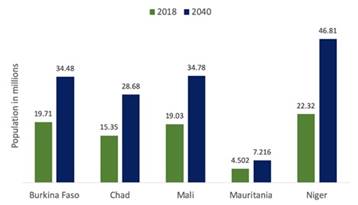
Population en
millions d'habitants.
Source : IF
version 7.36, données historiques de la Division de la population des Nations
Unies.
Les centres de planning
familial (PF) sont peu nombreux dans les pays pauvres (surtout au Sahel) et
sont plus concentrés dans les zones urbaines. Le manque d’électricité, d’eau
potable, de moyens financiers et souvent de routes praticables ne favorisent
pas l’implantation de ces centres dans ces zones.
Pour anticiper et résoudre
ces problèmes, plusieurs axes de solutions sont proposés :
Les zones rurales sont
sous-informées. La planification familiale connaît des résistances auprès des /
chez les femmes. Elles sont, le plus souvent, le résultat des conceptions «
morales » prônées par les confessions religieuses. Ce qui se disait aussi, chez
les femmes, était que « si vous vous mettez sous contraception vous ne
pouvez plus concevoir ».
Les résistances à la
contraception sont culturelles et religieuses. Dans des pays où les
assurances-retraites n’existent pas, les enfants (en nombre) sont censés être
l’assurance-retraite des parents, dans le sens que les parents espèrent que
leurs enfants s’occuperont d’eux, lors de leurs vieux jours. La contraception
peut aussi porter atteinte de l’image de virilité que l’homme a de lui-même. Beaucoup
d’homme se convainc de ce que la méthode contraceptive moderne est une porte
ouverte à l’infidélité pour leurs femmes. L’opposition des hommes aux
méthodes modernes de planification familiale constitue un grand frein pour les
femmes qui ont envie d’en adopter car l’avis de leur conjoint compte pour le
choix de la méthode. Des théories du complot, comme celles avançant
l’accusation que la contraception serait un moyen, pour les
« blancs », pour faire diminuer la population des noirs, afin de les
« recoloniser », peuvent être un autre frein.
Améliorer l’éducation des
femmes a été l’un des facteurs les plus significatifs du déclin de la
fécondité, mais éduquer la majorité des filles au Sahel va prendre du temps.
·
Il faut informer les
populations quant aux bénéfices d’une taille familiale plus réduite.
·
Il faut améliorer
l’accès aux contraceptifs.
·
Il faut relever l’âge
légal au mariage (politique volontariste du gouvernement).
·
Des investissements
accrus en soins de santé et en éducation peuvent améliorer tant la qualité et
que l’étendue des services fournis.
Ces changements peuvent
alors contribuer à réduire la pression humaine sur les ressources naturelles,
permettre plus d’investissements pour les jeunes en matière d’éducation et
créer la possibilité d’un dividende démographique à long terme.
·
Une gouvernance
transparente et stable est également cruciale au progrès de la région (source
de stabilité et de diminution de risques de conflits).
·
Enfin, tant le secteur
formel qu’informel doivent être mis à contribution pour augmenter l’emploi
de même que pour améliorer la productivité et l’efficacité. La mise en œuvre des
idées (ou une partie), contenues dans ce livre, devraient contribuer à augmenter
l’emploi et les sources de revenus.
Ces initiatives précédentes
devraient être mises en place simultanément. Trop souvent, les gouvernements et
leurs partenaires ne travaillent que sur un ou deux points en même temps. En
effet, étant donné l’urgence des défis démographiques du Sahel, il faudrait
agir très rapidement, sinon maintenant.
Quand cela est possible … En effet, au Bénin, quelques prêtres,
pasteurs et Imams se sont mis ensemble pour créer la plateforme « les religieux s’engagent pour le PF ». « C’est un canal qui leur permet
d’informer et de sensibiliser les fidèles sur les avantages du planning familial
». « Dieu a demandé d’aller nous multiplier, de procréer,
mais Dieu n’a pas dit de procréer en désordre. Il ne nous a pas dit de déborder
la terre. Si vous débordez la terre, vous
irez vivre dans les eaux » a déclaré
le pasteur Amos Agbindo-Bankolé de l’EPBM, ceci pour mieux sensibiliser les
chrétiens en utilisant les versets bibliques.
Ressources documentaires :
a) L'Afrique face à ses
défis démographiques : un avenir incertain, Sous la direction de Benoît
Ferry, AFD-CEPED-Karthala, 387 pages, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers20-05/010041742.pdf
b) Défis démographiques
du Sahel, 24/02/2015, https://www.prb.org/resources/defis-demographiques-du-sahel/
c) 1) Réalités
quotidiennes des femmes et filles d'Afrique : La condition de la femme
africaine (essai), Bérénice Micale Edaye & Benjamin Lisan, 183 pages,
11,50€, https://www.amazon.fr/dp/1986557456
2) Version PDF
gratuite : http://www.doc-developpement-durable.org/livres/Realites_quotidienneCSP_Size_Fix031518_bis.pdf
d) Contrôle
des naissances. Planning familial, B. Lisan, 2010, 82 pages, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/ControleDesNaissances.ppt
Les discours populistes ont tendance à opposer le « peuple »
à des ennemis réels ou imaginaires et/ou inventés, des boucs émissaires _ par exemple,
le colonialiste, la tribu ennemie, les tutsies face aux hutus (et inversement)
etc. _, désignés comme source de tous les maux (la pauvreté, la famine,
répression) du « peuple ». C’est souvent un moyen pour les ambitieux,
prédicateurs ou politiciens « populistes » de prendre le pouvoir ou
l’ascendant sur leurs concitoyens, croyants, électeurs, et/ou pour, quand ils
sont au pouvoir, détourner l’attention du peuple des vrais problèmes, en les
lançant contre des ennemis montés en épingles, objets de focalisation ou dans
des causes « glorieuses ». Le populiste cynique n’hésite pas à
mélanger faits véridiques et manipulations ou désinformations, afin que leurs
mensonges paraissent crédibles.
Ils mettent en opposition le « peuple » _ en fait, ceux qui
le suivent, les « bons » _, avec les « mauvais », ceux
envers qui il faut prendre de la distance et dont il faut se séparer, qui ne
sont plus vos amis, qu’ils faut rejeter, voire éliminer.
Certains prédicateurs ou politiciens, tels des apprentis-sorciers,
profitent de la frustration des citoyens, pour la détourner sur des boucs
émissaires, en excitant leur haine et déchainant la violence contre eux, voire
en appelant au terrorisme ou à la guerre (sainte …) contre eux, qu’ils
présentent comme la solution à tous leurs problèmes.
Il faut souvent remettre, en face des trous, les yeux des personnes
hypnotisées par ce genre de discours. Il faut déconstruire le discours qui
présente la guerre comme belle et souhaitable et la solution miracle à tous les
problèmes.
En effet, par ses discours enflammés, le populiste belliciste enferme
ses ouailles dans un imaginaire épique du sacrifice, de guerres glorieuses et
victorieuses, de l’héroïsme et de la mort, qui mènent au Paradis, en
occultant, par ces mythes guerriers, tous les crimes commis, durant les
guerres. Lors des celles-ci, la plupart des valeurs morales (solidarité,
amour, compassion, générosité …) sont sacrifiées et inversées/renversées,
jusqu’à présenter la vengeance comme sacrée, purificatrice et non pas
destructrice.
Ce discours populiste sacralise, présente comme rédempteurs, la guerre
le martyr, le sacrifice de sa vie pour la cause de la religion et du prophète,
le courage au combat (considérés comme purs, légitimes, …).
Derrière la présentation morale, légitime, sacrée, des guerres, se
dissimulent beaucoup d’actes « immoraux », peu « glorieux »
et une absence de garde-fous moraux : menaces, intimidations,
exécutions (extra-judiciaires), tortures, terrorisme, délations, trahisons,
ruses, espionnages, pillages, massacres, rackets, martyrs kamikazes, …
Les adeptes sectaires, agressifs, belliqueux se posent toujours en
victimes et sont enfermés dans une bonne conscience irresponsables, sans jamais
percevoir les souffrances qu’ils infligent aux autres.
Il faut alors faire comprendre aux adeptes de la « guerre
sacrée » que les guerres provoquent des souffrances morales et
physiques durables, de multiples syndromes de stress post-traumatiques, à vie,
des morts, des mutilations, des handicaps à vie, la perte d’êtres chers, des
pleurs, de douleurs, des ravages, des dégâts, des destructions souvent
irréversibles (de biens, de chefs d’œuvre, de l’environnement, de ressources
naturelles …), l’appauvrissement économique des pays, des régions, des
personnes, le ressentiment et l’humiliation des vaincus, leurs désirs de
vengeances et de rétorsion ou de vendettas, dans un cercle vicieux et dans une
escalade, sans fin.
Il a souvent la croyance irrationnelle que toute situation bloquée, de
désespoir, de crise, d'impasse pourra être résolue par la solution miracle d’un
bonne guerre, si possible rapide (un peu comme le joueur de casino qui croient
irrationnellement qu’en misant gros, il va se refaire).
Or « On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on
peut », Machiavel.
Kamel Daoud rappelle, dans un article, au sujet des guerres, 1) sur les
champs de bataille, "l'odeur de décomposition des entrailles à
l’air", 2) leurs immenses coûts humains et économiques (par leurs
destructions économiques, elles ne sont souvent aucunement bénéfiques et
économiquement rentables, à long terme).
Souvent, on fait la guerre contre des gens qu’on diabolise, mais qu’en
fait, l’on ne connait pas.
Que la balance entre avantages et inconvénients d’une guerre penche
régulièrement dans le sens de son désavantage. En fait, les guerres
hypothèquent souvent l’avenir des peuples et des pays.
Selon un ami, Yves Montenay, démographe, « le terrorisme rend
la guerre plus cruelle que la guerre "normale", mais comme c'est un
moyen puissant, on l'utilise. En Algérie, tous les camps en ont usé. J'étais
particulièrement navré par l'argument « l'autre me tue, donc j'ai raison [de le
tuer à mon tour] » et les représailles et contre-représailles à l'infini. Il
paraît qu'en Europe centrale, les troupes turques fracassaient la tête de bébés
sur les murs pour terroriser la population jusqu'au XVIIIe siècle ».
Cette arme de terreur et de vengeance de « fracasser la tête des bébés
contre les murs » a été employée dans de nombreuses guerres, par des
troupes coloniales (à Zaatcha, en Algérie, en 1849 …), durant la guerre civile
en Algérie (durant les années 90, ou années de plomb), par les nazis ou lors de
génocides etc.
Dans les massacres, génocides et « purifications ethniques »,
on observe souvent des cas « de violence ou de cruauté
jusqu’au-boutistes, extrêmes ou excessives » (en anglais, on parle aussi
« d’overkill », de capacité de « sur-extermination »,
d’acharnement jusqu’au-boutiste …), qui n’ont pas aucune motivation
rationnelle. Les bourreaux s’acharnent sur leur victimes, en continuant à les
mutiler, même après leur mort, à humilier, « salir » symboliquement
les cadavres. Le but « terroriste » est, en général, de terroriser
les ennemis. Mais certaines bourreaux prennent progressivement « goût au
sang » et se déchaînent dans la surenchère de l’horreur. Laurence
d’Arabie décrit ce processus, lié au désir de vengeance, dans les guerres,
conduisant au « pas de quartier ! pas de prisonnier ! ». La guerre
nourrit la guerre.
Il est donc important de réfuter ces discours
« va-en-guerre », cette désinformation sur la réalité des guerres.
Toutes les régions et tous les peuples victimes du terrorisme et de
guerres s’appauvrissent toujours à terme _ que cela soit au Sahel, en
Somalie, au Soudan du Sud, Afghanistan, et pendant longtemps, au Mozambique, en
Angola, en Erythrée …
Mais « On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix
et l'éducation », si l’on croit la militante de l’éducation des
filles, Malala Yousafzai.
A la date du 30 Juin 2021, le Burkina Faso connait une
croissance du nombre de déplacés internes estimé à 1 312 071 soit une
augmentation de 4,7 % par rapport au mois précédent. Cette augmentation du
nombre est due essentiellement à l’augmentation des incidents sécuritaires.
Tchad : Selon les derniers résultats de la matrice de suivi
des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations (Round
14), publiée en avril 2021, près de 460 000 personnes sont déplacées
dans la province du Lac à cause de l'insécurité causée par les groupes armés
non-étatiques (GANE) et les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les
inondations et la sécheresse. Une hausse de plus de 53% comparé aux résultats
d'avril 2020.
Le nombre de personnes déplacées internes (PDIs), au Mali, est
de 377 781 en juillet 2021. Cependant, entre mai et juillet 2021, des
violences variées ont continué à être signalées dans les régions de Mopti,
Ségou, Tombouctou et Gao. En effet, ces violences ont provoqué la fuite de
populations de leurs villages et hameaux pour trouver refuge dans des localités
desdites régions où la situation sécuritaire semble plus calme.
Au 25 août 2021, au Niger, il y avait 3,8 millions de personnes dans le
besoin, 2 millions en situation d'insécurité alimentaire, 313.000
personnes déplacées à l'intérieur du pays, 234.000 réfugiés.
Au 31 août 2021, 4 120 352 est le nombre de réfugiés, de
demandeurs d'asile, de réfugiés rapatriés, de personnes déplacées à internes
(PDI) et de PDI rapatriés, au Sahel, tel que rapporté par les autorités
nationales ou le HCR, dans le centre du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger), au
Tchad et en Mauritanie.
Message de Alif Naaba Safiath : « Ces dernières années, la
situation sécuritaire au Sahel s’est dégradée avec la recrudescence des
attaques armées.
Au Burkina Faso, Mali et Niger, l’insécurité et les déplacements
n’ont fait que croitre et les chiffres sont effrayants :
1, 4 millions de Personnes déplacées Internes et de réfugiés dont
55% représente les enfants. Entre 2015 et 2019, plus de 430 attaques ont été
enregistrées, entraînant la fermeture de plus de 4000 écoles (dont plus de 2400
au Burkina Faso), laissant plus de 16000 enseignants et des centaines de
milliers d'enfants incapables de continuer leurs cours. De nombreux enfants
n’auront plus la chance de retourner à l’école ; leur droit le plus élémentaire
ainsi bafoué, et seront exposés à toutes formes de pires violences avec le
risque d’être enrôler par les groupes armés.
Au Burkina Faso, Mali et Niger, 1 enfant sur 2, de 6 à 14 ans ne
partait pas à l’école à cause des problèmes structurels que connait le système
éducatif et les raisons socio-économiques des ménages dont la pauvreté, le
mariage d’enfant, etc. Toute chose qui met en risque l’avenir de nombreux
enfants dans la région du Sahel. En plus de la chaine de violence qu’enregistre
la région désormais du fait des multiples et récurrentes attaques, la Covid 19
est aussi venue exacerber la situation des enfants rendant encore plus complexe
leurs conditions d’apprentissage.
Malgré la volonté politique de mettre fin à ce cycle de violence qui
empêche les enfants d’apprendre, force est de constater que la situation des
enfants ne m’améliore pas significativement. Si la situation du Sahel perdure,
ce qui est fort probable, nous risquons de perdre une génération entière qui
n’aura pas été éduquée. Il est urgent d’agir !
Pour ces milliers d’enfants, il ne leur reste plus que ce cri de
cœur : « Je veux retourner à l’école », qu’ils lancent aux autorités du Burkina
Faso, du Mali et du Niger leur demandant de faire de l’éducation en urgence une
priorité, protéger les écoles et mettre en œuvre la déclaration sur la sécurité
dans les écoles afin de leur permettre d’apprendre dans un environnement sain
et sécurisé. Investir dans l'éducation pendant les situations d'urgence aide à
briser le cycle des conflits et à instaurer une paix à long terme. Elle permet
de promouvoir la tolérance, la paix et la réconciliation et constitue surtout
l’unique moyen de ne pas compromettre les chances des enfants d’acquérir les
connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour reconstruire leurs
sociétés, les développer et les maintenir pacifiques et prospères »
(Information transmise par Claire-Marie-Madeleine Péhi-Verny).
Cette insécurité endémique ne peut qu’accroitre le manque
d’instruction, voire l’analphabétisme, et la pauvreté.
« L’accaparement des terres » (en anglais, land grabbing)
désigne l'acquisition légale, souvent controversée, de grandes étendues de
terrains. Il s'agit souvent de terres agricoles dans des pays en développement,
par des entreprises transnationales et gouvernementales. Il s'agit principalement
d'achats ou de location [avec des baux de longue durée], à grande échelle, le
plus souvent par des entreprises étrangères, de terres. L'accaparement peut
avoir des buts économiques ou politiques, voire géopolitique.
Pour répondre à des crises écologiques, climatiques, alimentaires et
financières et parfois politiques, plusieurs dizaines de pays émergents (Chine,
Inde, Corée du Sud …) ou du sud (Afrique du Sud …) cherchent à louer ou acheter
des milliers à millions d'hectares dans d'autres pays (Ethiopie, Congo,
Madagascar, …), parfois très éloignés, souvent au profit d'investisseurs privés
étrangers mais au détriment de la forêt, de l'environnement, des populations
autochtones dont les petits paysans (qui y habitent et les cultivent, depuis
des générations, mais sans posséder de titre de propriété) sont expulsés de
leurs terres ou obligés de travailler pour exporter leur production.
La « colonisation des sols » s'est aggravé depuis la crise alimentaire mondiale de 2007-2008 mais aussi depuis la demande croissante en agro-biocarburants : entre 2000 et 2011, l'accaparement
des terres concerne 203 millions d'hectares dont 134 millions en Afrique subsaharienne qui
ont fait l'objet de négociations entre investisseurs privés régionaux ou
nationaux et principalement les États propriétaires des terres (selon le
principe de domanialité public).
A priori, le but de ces cessions de terres agricoles à des pays
étrangers est d’obtenir, en échange, pour pays, qui en manquent et qui cèdent
leurs droits fonciers, des devises.
Mais dans les fait, cet « accaparement » est favorisé par :
a) la corruption du gouvernement ou des hommes politiques locaux
puissants (dans leur pays),
b) l’insécurité foncière, endémique en Afrique _ cette dernière
étant favorisée par un manque de maillage cadastral précis de tout le
territoire d’un pays et par la corruption des responsables et officiers du
cadastre.
L'insécurité foncière peut aussi concerner
les aires protégées (parcs nationaux …).
Selon les données de la Banque mondiale, 37 %
de la surface sont consacrés aux cultures alimentaires, 21 % aux cultures
commerciales et 21 % à la culture des biocarburants. Les plantations
forestières dans le cadre de projets REDD, ou des projets de conservation de
biodiversité ainsi que de grands projets touristiques ont aussi était accusé de
faire partie d’accaparement de terres.
Les investissements en terre agricole
prennent souvent la forme de baux plutôt que d'achats. La durée de ces baux
varie de 25 à 99 ans, et ils sont généralement contractés entre des
gouvernements nationaux ou locaux et les investisseurs (la plupart de terres en
Afrique ne sont pas privées, en possession ou sous contrôle gouvernemental).
Ces immenses territoires agricoles cédés sont
cultivés, selon des techniques agricoles
modernes (avec une mécanisation maximum, l’utilisation d’intrants
chimiques …), ne nécessitant que peu de main d’œuvre locale (et peu de main
d’œuvre tout court). L’effet pervers est que les productions agricoles, obtenues
dans ces territoires, sont intégralement exportées vers les pays
« accapareurs », sans qu’une partie de ces productions serve à
nourrir les populations locales et à réduire l’insécurité alimentaire locale. Pour
leur irrigation, ces immenses projets agricoles peuvent aussi accaparer les
ressources hydriques locales. Ces accords sont souvent loin d’être «
gagnant-gagnant ».
Pour l’instant, les seuls moyens de luttes de
populations locales contre les effets pervers de ces politiques
« d’accaparement » sont les manifestations de protestation (de grande
ampleur) ou la médiatisation du problème.
Des manifestations ont visé
des groupes comme le groupe Bolloré ayant des investissements accusés d'être
des accaparements de terre. Des associations de paysans riverains des
plantations de Socfin au Cambodge, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Liberia et au Sierre leone mises en relation par l'association ReAct ont créé une alliance et ont cherché à négocier avec
Bolloré pour résoudre les conflits.
Le projet Daewoo Logistics ou l’affaire Daewoo concernait un accord
entre le gouvernement malgache et société coréenne Daewoo Logistics, sur un
bail emphytéotique contracté pour la location de 1,3 million d’hectares de
terrain, sur le plateau aride d'Ihorombe, au centre de Madagascar, pour en
faire des plantations (jatropha …) et des cultures de maïs. Or les
ressources hydriques de ce plateau sont limitées. De plus, les négociations
entre Daewoo et le gouvernement malgache avaient été loin d’être transparentes.
Cette affaire avait été un des éléments importants de la crise politique de
2009 qui avait conduit au renversement du président malgache Marc Ravalomanana. C’était
d’autant plus choquant qu’une partie de la population malgache souffre de malnutrition
chronique.
[En 2011] « Le Kenya est le quatrième producteur de haricots
au monde. Mais, alors que le pays est touché par la famine, la culture reste
principalement destinée à l'exportation. Selon un responsable d'Action pour
la Faim, les exploitations sont principalement achetées ou louées par des
compagnies étrangères qui chassent les habitants, avant d'engager une fraction
d'entre eux pour des salaires insuffisants, y compris pour acheter leur propre
production ».
Ces
acquisitions ou des concessions foncières sont considérées comme
problématiques, quand elles présentent une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :
·
Contraires aux droits de l’Homme et en
particulier aux droits des femmes à un traitement équitable ;
·
Ne reposant pas sur le consentement
préalable, libre et éclairé des usagers affectés ;
·
Ne reposant pas sur une évaluation
minutieuse, ou ne tiennent pas compte des impacts sociaux, économiques et
environnementaux ;
·
Ne faisant pas l’objet de procédures
transparentes définissant des engagements clairs et contraignants en ce qui
concerne les activités, l’emploi et le partage des bénéfices ;
·
Ne reposant pas sur une planification
démocratique efficace, une supervision indépendante et une participation
significative.
Cette information, ci-dessous, montre que les économies des pays en
voie de développement restent encore très vulnérables, face à n’importe quelle
forme de crises économiques :
« La pandémie a accéléré les fuites de capitaux des pays en
développement de 90 Md$ de début février à mi-avril, dont d’Afrique, alors que
les investissements directs étrangers (IDE) ont beaucoup faibli ».
A cause de la balance commerciale constamment déficitaire, au niveau de
leurs échanges avec les pays riches, les pays en voie de développement
recherchent désespérément des devises, pour tenter de réduire leur dette envers
les pays riches, par exemple, en exportant les productions alimentaires du pays
(ou en louant leurs terres agricoles à des pays étrangers en général riches), quitte
à augmenter le niveau de malnutrition d’une partie de leurs concitoyens.
Et cette politique ne permet de résoudre qu’une partie de la dette.
La persistance de la dette, envers les pays riches, empêchent beaucoup
de pays pauvres de recouvrir leur souveraineté économique. En apparence, cet
état de fait semble constituer un cercle vicieux négatif sans fin.
Plusieurs facteurs semblent entretenir cette dette chronique :
1)
La corruption et la fuite de grosses quantité d’argent vers des
paradis fiscaux (à la fiscalité réduite) et dans les pays riches (i.e. évasion
fiscale), qui aurait pu servir au développement des pays pauvres, lésés par
cette évasion fiscale.
2)
Les subvention agricoles à l’exportation des produits agricoles
européens et américains, constituant une forme de dumping face aux productions
des pays pauvres, ces dernières ne parvenant plus à être compétitifs.
3)
Des accords douaniers entre pays riches et pays pauvres, finalement
désavantageux, ne permettant à ces derniers de résorber leur dette.
4)
La conviction que tous les produits fabriqués dans les pays riches (USA,
Europe, Japon …) sont de meilleure qualité que ceux fabriqués en Afrique (y
compris pour les produits issus de l’élevage et de l’agriculture
locales !).
5)
Une certaine paresse intellectuelle, dont le recours trop fréquent à la
dette, a) pour de bonnes raisons, éviter les explosions sociales, b) pour de
mauvaises raisons, l’espoir que les pays créanciers apureront la dette des pays
débiteurs [envers ces les pays créanciers] et trop endettés.
6)
En Afrique, l’idée tenance que le statut d’agriculteur est dévalorisant
(socialement), contrairement au statut de fonctionnaire (ce dernier pourtant
ne générant aucune richesse ou développement économique pour le pays).
7)
La dépendance envers des produits (baguettes de pain …), dont les
ingrédients (blé…) sont importés. Les effets de mode pour des produits
considérés comme luxueux, parce que venant de l’étranger et de pays riches.
8)
L’absence d’unité et « d’OPEP » entre les pays producteurs de
matières premières agricoles (cacao, café …).
9)
Le manque de formations qualifiantes et de personnes qualifiés issus de
ces formations, afin de faciliter l’installation, avec l’aide d’investisseurs
étrangers, d’usines ou d’entreprises, nécessitant ce personnel qualifié, dans
le pays même.
Pourtant, des matières premières de qualités (cacao …) pourraient être
transformés en produits secondaires de qualité (chocolats …) et exportés. Car
il existe pourtant des produits transformés de qualité mais insuffisamment
exportés (comme le Chocolat Robert, les fruits de la passions, les physalis (« poc-poc »)
et autres fruits tropicaux délicieux … à Madagascar, les crevettes géantes
tigrées de Madagascar Label rouge, etc. …).
En luttant contre un manque de confiance en soi concernant la qualité
des produits élaborés sur place (produits laitiers, plats ou produits agricoles
transformés, …) et en incitant à une forme de « patriotisme
économique », l’on pourrait aider à développer un marché intérieur,
résistant à la concurrences des produits venant des pays riches.
Il peut être aussi bon d’utiliser certains mécanismes d’aides européens
au développement des exportations de pays en voie de développement vers l’UE _
favorisant l’autonomie économique des pays en voie de développement (voir
ci-après) :
Doté d'un fond d'un montant total de € 120 millions, financé par
l'Union Européenne _ issu du Fonds Européen de Développement (FED) _, le
Programme de la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP) vise à soutenir
un certain nombre de chaînes de valeur aux niveaux national et régional pour
promouvoir la transformation structurelle et un meilleur accès aux marchés
régionaux et internationaux, tout en tenant compte des préoccupations sociales
et environnementales. Il a pour objectif de renforcer la compétitivité des pays
ouest-africains, face à la « mondialisation » économique.
Le
programme – qui s’aligne avec les priorités des politiques et programmes
ouest-africains, y compris la Politique industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest
(PICAO), le Programme
de système de qualité pour l’Afrique de l’Ouest (PSQAO) et
la Stratégie de
développement du secteur privé de la CEDEAO –
contribuera à créer les bases et à promouvoir l’accès des pays d’Afrique de
l’Ouest au plan d’investissement extérieur (PIE) de l’UE.
Le
Programme comporte 16 composantes nationales et une régionale. Chaque pays est
individuellement responsable de la mise en œuvre de sa composante, tandis que
la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec
l’appui de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA), se charge de la composante régionale et de la coordination du
programme par le biais d’un comité de pilotage qui se réunit une fois par an.
Des partenaires techniques soutiendront la mise en œuvre au niveau national et
régional.
Ces
programmes aident, par exemple, à mettre en place les systèmes de traçabilité,
de contrôle qualité, pour une filière donnée, afin que les produits de cette
filière puissent satisfaire aux normes de qualités, qu’ils doivent respecter afin
de pouvoir entrer dans le marché de l’Union Européenne (UE) (la filière ananas
de Côte d’Ivoire a ou aurait bénéficié de cette aide, afin de permettre
l’entrée des produits de cette filière dans l’UE).
Via sa stratégie de développement du secteur privé, la CEDEAO
soutient aussi les Centres d’Excellence (centres de formation) pour les
projets d’entreprenariat agricoles en Afrique de l’Ouest (comme le Centre d’Excellence
Songhaï au Bénin).
Il existe des organisations reposant sur un modèle économique en même
temps capitaliste, solidaire et circulaire _ reposant sur un recyclage
(récupération) maximum _, comme les onze centres Songhaï en Afrique.
Encore faut-il être certain qu’ils sont bien économiquement bénéficiaires
(dégageant du profit, financièrement autonomes) et qu’ils ne reposent pas sur
l’aide permanente de donateurs étrangers (rendant alors artificiellement les
comptes de trésorerie positifs).
Quand des pays en voie de développement pourront sortir de la spirale
négative de la dette, revenir vers une balance commerciale positive ou
équilibré et la fin de la dépendance envers les pays riches et le FMI, alors l’
atteinte de ces objectifs (d’indépendance / d’autonomie financière) sera source
de fierté pour ces pays. Mais il ne faut pas, non plus, que la
recherche de ce but puisse mener à une politique d'autarcie et de fermeture
nationaliste (chauvine) alors que l’on sait que les échanges internationaux
(équilibrés) sont nécessaires pour le développement économique global du monde
entier, y compris pour celui des pays en voie de développement.
« La
souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et
culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des
peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires. La
sécurité alimentaire est un but, alors que la souveraineté alimentaire décrit
les moyens d’y parvenir. », selon l’ONG La
Via Campesina.
La souveraineté alimentaire
privilégie des techniques agricoles qui favorisent l'autonomie des paysans. Elle
est donc favorable à l'agriculture
biologique, à l'agriculture
paysanne et à la biodiversité locale. Mais
elle refuse l'utilisation des plantes transgéniques en
agriculture (un dernier
point de vue pouvant être critiquable, car ne reposant pas sur des arguments
scientifiques prouvés).
Craintes de perte de
biodiversité avec la mondialisation, justifiées ou non ?
Cas du maïs mexicain,
face au maïs américain avec l’ALENA :
« Avant son entrée dans l’ALENA
(Accord de Libre Echange Nord-Américain) en 1994, le pays protégeait son marché
intérieur par des barrières douanières, garantissait des prix élevés à ses
agriculteurs et subventionnait la consommation. Avec la libéralisation et
l'arrêt du soutien des prix aux agriculteurs, de nombreuses études annonçaient
un exode rural massif et l’abandon de la culture des variétés locales, donc une
perte de la biodiversité. Finalement, ces conséquences ne se sont pas
vérifiées, parce que 20 % des agriculteurs étaient déconnectés du marché,
produisant pour leur usage personnel, et que d’autres agriculteurs étaient
concurrentiels (donc non affectés par les changements de prix). Parmi les 40 %
d’agriculteurs qui se situaient entre ces deux catégories, beaucoup ont
poursuivi l'activité agricole et en particulier la culture des variétés
locales, même s'ils l'ont réduite, car elle correspondait au goût du marché
régional. Ils ont augmenté les surfaces en maïs hybride, pour s’adapter à des
prix plus faibles. Contrairement aux attentes, la biodiversité a donc été
préservée ».
Au Sénégal, le pain a remplacé la plupart des recettes locales pour le
petit déjeuner, sa consommation est exponentielle. Mais puisqu’il est fabriqué
à partir de farine de blé importée, le Sénégal dépend de cette importation. Le
prix du blé peut évoluer, les boulangers ne sont donc pas à l’abri d’un choc,
d’une hausse des prix. Remplacer le blé par des céréales locales permet d’avoir
plus d’autonomie alimentaire.
Grâce au projet porté par l’association SOL et par
la FONGS (Fédération
des Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal) :
·
Les femmes sont facilement parvenues à remplacer la farine de blé
par les céréales locales (mil et le maïs), dans leur alimentation.
·
Les boulangers arrivent à incorporer de 15 à 30% de céréales
locales dans leurs produits.
Le tout est de savoir
si cette filière sera viable sur le long terme.
Au Sénégal, gel de l’importation d’oignons étrangers pour protéger
la production locale d’oignons
« Au Sénégal,
la production locale d’oignon était fortement concurrencée par les
importations, surtout lors des pics de récolte. Des concertations au sein d’un
comité oignon, initié par l’Agence de régulation des marchés, permettent de
réduire cette concurrence, grâce à un gel temporaire des importations ».
Hors de ces périodes,
les oignons importés sont surtaxés à 20% (en 2019).
« Le gel des
importations d’oignons [a permis] aux nombreux producteurs sénégalais d’écouler
sans problèmes leur production qui arrive timidement sur le marché.
Cette mesure
décidée depuis plusieurs années par les autorités a permis de booster la
production d’oignons du Sénégal qui est passée de 40 000 tonnes en 2003 à 260
000 tonnes en 2013, soit une forte progression de 550% ».
La Gambie applique le
même type de mesure : « Des droits à l'importation additionnels
sont prélevés par la Gambie sur les oignons et les pommes de terre pendant la
période de récolte, afin de protéger les producteurs locaux ».
Nous ne pensons pas
qu’il existe des solutions miracles et simples dans ces domaines.
Elever des droits de
douane, autour d’un produit, peut aider à protéger sa production et ses agriculteurs,
mais cette action peut aussi provoquer des mesures de rétorsion. C’est donc une
mesure à utiliser avec prudence. Et mieux vaut alors en informer éventuellement
l’OMC et l’OCDE sur les raisons (le pourquoi) de cette mesure et sur son
caractère incontournable (inévitable).
Parfois, certains dictateurs ou politiciens, sans états d’âme,
n’hésitent pas à vendre à l’export les productions agricoles locales, à
augmenter durement les impôts, à supprimer les subvention agricoles aux petits
paysans, afin de réduire la dette publique et le déficit de la balance
commerciale,
au risque d’affamer la population et/ou de déclencher des émeutes.
En résumé, il n’existe pas de solutions simples, il y a lieu de
s’adapter selon les circonstance et à faire constamment des compromis entre des
objectifs souvent inconciliables.
Il n’est pas toujours facile de déterminer quel modèle économique choisir (?) :
·
Grandes exploitations en agriculture
intensive.
·
Mosaïques d’exploitations familiales,
modestes (de petites tailles), bio, mais bien gérées, avec utilisation de
techniques culturales innovantes et performantes (SVG, agriculture bio,
permaculture, synécoculture etc.).
·
Cohabitation des deux modèles.
·
Modèle Songhaï (capitaliste et en même
temps solidaire).
·
Autres modèles.
Le choix se fait souvent en fonction du contexte et des conditions
locales.
Dans beaucoup de sociétés de pays en voie de développement (et pas
que), l’on constate que les femmes souvent travaillent plus que les hommes,
s’occupant par exemple des enfants, de la cuisine, du ménage, de travaux dans
des champs et jardins, des corvées (d’eau, de bois …), de gérer l’argent du
foyer ... Et pourtant, elles restent mineures à vie, au niveau de leurs droits,
dépendante de l’autorité (voire de l’arbitraire) des hommes mâles de leur
communauté.
Actuellement, dans le monde, 836 millions de personnes vivent dans une
pauvreté extrême. Dans l’extrême pauvreté, il y a des plus mal loties, les
femmes. Et parmi elles, les femmes noires, les femmes indigènes, les réfugiées,
les immigrantes et les migrantes sont les plus marginalisées.
Plusieurs études récentes ont constaté que l'autonomisation économique
des femmes était fondamentale pour la réduction de la pauvreté. La mise en
place de coopératives des femmes productrices et transformatrices _ souvent par
de jeunes femmes du monde rural, elles-mêmes _ aide à lutter contre l’exode
rural et l’insécurité alimentaire et à améliorer leur niveau de vie et le
niveau des revenus de leur famille (une augmentation des revenus pouvant
permettre alors d’envoyer les filles et garçons à l’école).
Dans certains cas à cause des pesanteurs culturelles et sociologiques,
l’autonomisation des femmes rurales est facilitée grâce à un ou plusieurs
appui(s) extérieur(s), leur permettant de bénéficier de formations aux
techniques agricoles, à l’amélioration des semences et à l’utilisation de
machines permettant un gain de temps, tout en accordant des prêts et en
encourageant l’épargne.
On observe que les femmes rurales, via leur coopératives sont souvent
agent du changement au sein de leur communauté. Ce sont, par exemple, elles qui
mettront en place un système de micro-crédit local, de transport, de silos, de
banque de graines etc.
Donc, il est important que les femmes aient toute leur place dans tous
les projets de développement.
Par les analyses contenues dans ce livre, on constate que la lutte
contre la malnutrition, dans le monde, est un sujet complexe et multifactoriel
et qu’il n’y a pas de solution miracle clé en main, simple et facile à mettre
en œuvre. Alors que pourtant, les solutions existent.
Ce qui ne veut pas dire que ces solutions soient toujours aisées à
mettre en place _ en raison de résistance des mentalités, de facteurs d’instabilités
politiques, de méfiances liées à des théories du complot très répandues en
Afrique, de la corruption, de vols, du manque d’argent etc.
Pour aborder ces questions complexes, il faut les dans aborder au sein
d’une vision « holistique », « systémique », au sein un
tout global, qui fait intervenir un bon nombre de solutions adaptées à un
certain nombres de problèmes particuliers, décomposés en sous-ensembles ou sous-problèmes.
De plus, des solutions peuvent fonctionner à un endroit et dans un contexte
donnés et ne pas fonctionner à un autre endroit.
Il ne suffit pas de mettre en place certains programmes agronomiques,
culturaux et certains dispositifs d’économie (goutte à goutte …) et de retenues
d’eau (johads indiens, limans israéliens …). Il faut aussi provoquer un
changement de mentalité profond chez les populations bénéficiaires, leur
permettant de comprendre que la préservation de l’environnement n’est pas un
luxe ou une lubie occidentale, mais qu’elle garantit leur survie. Le
développement durable est un tout (ou package) global, qui comprend de nombreux
volets techniques.
Pour obtenir la réussite de projets de développement, il faut souvent
faire preuve de beaucoup diplomatie, posséder, dans ses relations, déjà un
réseau de personnes influentes, et/ou faire preuve de beaucoup de persévérance
_ savoir affronter et résister à de nombreuses épreuves, savoir remonter la
pente après des épreuves particulièrement dures ou destructrices et tenir sur
le temps.
Quand il n’y en a pas assez d’arbres dans les régions arides, plutôt
que de les couper, pour la construction des maisons, mieux vaut construire les
maisons en boue séchée (par la technique de la voute nubienne _ voir image
ci-après _ etc.).
Avoir conscience qu’il faut ne pas trop couper les arbres, leurs
branches ou prélever leurs feuilles, au risque de les faire mourir. Qu’il faut
savoir gérer raisonnablement la ressource ligneuse et savoir planter trois
arbres, à la place de l’arbre que l’on vient de couper. Qu’il est préférable,
pour la cuisson, quand cela est possible, d’utiliser des cuiseurs solaires et/ou
de la bouse de vache, que de recourir excessivement à du bois coupé sur des
arbres vivants.
Maisons réalisées par la
technique de la voute nubienne (qui conservent la fraicheur dans les
pièces, en son sein).
Qu’il faut (plutôt) planter des arbres utiles adaptés à la sécheresse,
servant de coupe-vent, de fixateur de dunes et limitant l’érosion et le
ruissellement. Et non pas des arbres choisis pour leur rentabilité financière
en sylviculture, à pousse rapide, très consommateurs en eau.
Qu’il faudrait mettre en place une gestion rationnelle des pâturages,
des parcours et des cheptels, avec l’aide des organisations d’éleveurs. Et quand
il y a trop de chèvres ou de moutons, dans les zones de pâturage et de
transhumance, il y a alors la nécessité de réduire les troupeaux et de se
séparer de bêtes.
Le but principal de ce livre est de trouver de multiples solutions,
face au changement climatique, dans les pays les plus pauvres et/ou les plus
vulnérables, avec la nécessité (urgente) de s’y adapter
(voir aussi le livre [2]).
Dans cet ouvrage, nous avons aussi insisté
sur l’importance de la préservation (protection) de la biodiversité et des
semences paysannes _une solution pour rendre les cultures plus résilientes,
face aux maladies et aléas climatiques, et pour ne pas être dépendant pieds et
mains liés envers des compagnies semencières.
Pour pouvoir mettre en œuvre tous idée, contenues dans ce livres, il
faudrait déjà résoudre les maux connues et endémiques à l’Afrique (déjà décrits
en 1962 par René Dumont) :
·
La corruption et le goût de l’argent
facile (sans effort), à tous les niveaux (via la grande et la petite
corruption), favorisant la pullulation des voleurs et escrocs (voir le chapitre
annexe « Préconisations pour lutter contre la corruption »,
situé à la fin de ce document).
·
La mauvaise gouvernance (dont se
plaignent unanimement tous les administrés, les ONG, les observateurs
extérieurs). Le manque de préoccupation du bien
public, par les politiciens et militaires locaux.
·
Le danger du populisme (des joueurs de
flûte d’Hamelin, des chants des sirènes, qui désignent des boucs émissaires et
promettent des miracles, des théories du complot), face à des concitoyens peu
instruits et donc crédules et manipulables. L’éducation et l’instauration d’une
vraie démocratie, avec une presse libre, peuvent y pallier.
·
La faiblesse du système éducatif (et
son manque de moyens chronique). Il faut y consacrer de l’argent. Il faut des
enseignants bien formés et bien payés. Il faudrait une ou plusieurs chaînes de
télévision scolaire.
·
Le problème du manque d’attractivité du
métier d’agriculteur et de l’attractivité du métier de fonctionnaire (en
Afrique). Il faut que l’accès à la terre, à des crédits ou micro-crédits à taux
zéro et aux formations de qualité soient facilitées, aux personnes aux faibles
ressources, intéressées par le métier. Il faut sécuriser les filières face aux
fluctuations du marché et celles climatiques.
·
Le problème ou l’urgence démographique
(dont la solution est certainement liée à l’éducation).
·
Le problème de l’inégalité homme-femme
et du statut de mineure à vie des femmes, dans certaines sociétés.
Ressources
documentaires :
a) La lutte
contre la corruption, 08/06/2015, 436 pages, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/LutteContreLaCorruption.pptx
b) version
PDF : http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/LutteContreLaCorruption.pdf
[1] Atlas du réchauffement climatique: un risque majeur pour la
planète, Frédéric Denhez, Krystyna Mazoyer et Michel Petit, Éditeur
Autrement, 2009, 88 pages.
[2] L'atlas du changement climatique. Les causes et les
conséquences. Des solutions pour agir, Collectif (Dan Hooke ...), Bruno Porlier
(Traduction), Éditeur Gallimard Jeunesse, 2021, 240 pages (âges de
lecture 9-18 ans).
[3] Africa : Scientists sound the alarm over drought in East Africa:
What must happen next [Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur la
sécheresse en Afrique de l'Est : que doit-il se passer ensuite ?], Chris Funk,
05/10/2021,
https://www.downtoearth.org.in/blog/africa/scientists-sound-the-alarm-over-drought-in-east-africa-what-must-happen-next-79520
The next five years will very likely bring a strong El Niño causing
more drought disasters [Les cinq prochaines années apporteront très
probablement un fort El Niño provoquant davantage de catastrophes liées à la
sécheresse].
[10] Environmental
issues in Florida [Problèmes environnementaux en Floride], https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Florida
[20] Les
forêts tropicales détruites en 2018 font la superficie du Nicaragua, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-forets-tropicales-detruites-en-2018-font-la-superficie-du-nicaragua_2074766.html
[21] Evaluation
des risques liés aux mangroves face au changement climatique (Madagascar),
ANDRIANIAINA Rindra Tsiory Patrick, thèse, 11 mai 2018, http://biblio.univ-antananarivo.mg/pdfs/andrianiainaRindraTP_PC_Lic_18.pdf
[22] Etat des lieux des Mangroves de Madagascar, ministère de
l’Environnement et du Développement Durable et ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, 2019-2020. Antananarivo, Madagascar.
224 pages, http://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/mangrove/etat_des_lieux_des_mangroves_madagascar_2020-01-29.pdf
[23] Salinization in Drylands (Photobooks of Dryland Series vol.
4), https://catalogue.unccd.int/1484_Salinization_in_Dryland_Yamanaka_Toderich_2020.pdf
[24] Salinization in Drylands, 18-05-2020, https://knowledge.unccd.int/publications/salinization-drylands
[30] Assèchement
des grands lacs et mers au XXe siècle, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%A8chement_des_grands_lacs_et_mers_au_XXe_si%C3%A8cle
[31] Turquie
: un millier de flamants roses sont morts dans un lac à cause de la sécheresse,
Chloé GURDJIAN, 20/07/2021, https://www.geo.fr/environnement/turquie-un-millier-de-flamants-roses-sont-morts-dans-un-lac-a-cause-de-la-secheresse-205552
[32] Les
larmes du Tigre, reportage le long du fleuve mésopotamien, alors que l’Irak vit
une nouvelle période de sécheresse destructrice, 11/07/2021, Figaro
Magazine, https://twitter.com/Aufildubosphore/status/1414127206322876416
[33] Sécheresse
: l’indispensable adaptation des forêts françaises, 21/01/2020, https://theconversation.com/secheresse-lindispensable-adaptation-des-forets-francaises-128404
[34] 'Desert': drying Euphrates threatens disaster in Syria,
Delil Souleiman & Alice Hackman, 30/08/2021, https://news.yahoo.com/desert-drying-euphrates-threatens-disaster-020729928.html
[35] Tout
comprendre aux violences provoquées par la crise de l'eau en Iran,
21/07/2021, https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/tout-comprendre-aux-violences-provoquees-par-la-crise-de-l-eau-en-iran_2155358.html
Des médias en
persan émettant de l'étranger ont parlé de manifestations réprimées par les
forces de l'ordre au Khouzestan, frappé par une sécheresse.
[36] Réchauffement
climatique : le Colorado bientôt à sec ? 20/02/2020, https://www.initiativesfleuves.org/actualites/rechauffement-climatique-colorado-bientot-a-sec/
[37] Ces
"guerres de l'eau" qui nous menacent, Richard Hiault, 30/08/2016,
https://www.lesechos.fr/2016/08/ces-guerres-de-leau-qui-nous-menacent-1112386
Réchauffement climatique, démographie galopante, urbanisation et
industrialisation croissante... Ce cocktail explosif annonce à coup sûr une
aggravation des tensions liées à l'approvisionnement en eau. Certains experts y
voient le principal risque de conflits dans les années à venir.
[38] World atlas of desertification (1,2 Go), https://wad.jrc.ec.europa.eu/download
[39] The land of Dryland, Thriving in uncertainty
through diversity, Jonathan Davies, IUCN, September 2017, https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/15.%20The%2BLand%2Bin%2BDrylands__J_Davies.pdf
[39bis] Dryland. Chap 12, https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20English_Ch12.pdf
[40] Réchauffement
climatique : Ces photos virales d’un glacier à un siècle d’intervalle sont «
l’illustration parfaite du recul des glaciers », Mathilde Cousin, 21/07/21,
https://www.20minutes.fr/planete/3088055-20210721-rechauffement-climatique-photos-virales-glacier-siecle-intervalle-illustration-parfaite-recul-glaciers
[41] Recul des
glaciers depuis 1850, https://fr.wikipedia.org/wiki/Recul_des_glaciers_depuis_1850
[42] La fonte des lacs glaciaires expose des milliers de personnes à
des risques d’inondation, Nina Pareja, 02/05/2021, http://www.slate.fr/story/208313/fonte-lacs-glaciaires-expose-miliers-de-personnes-risques-inondation-climat-environnement-changement-climatique
Plus de 12.000
décès dans le monde seraient d’ores et déjà liées aux inondations dues à la
fonte de lacs glaciaires.
[43] Planète Glace, Producteur délégué : Mona Lisa Production,
Coproducteurs : Arte France, Universcience, Productions Nova Media, CNRS, IRD,
Auteurs-réalisateurs : Thierry Berrod, Vincent Amouroux, Yanick Rose. Série de
4 documentaires de 52 mn : "Groenland, le voyage sous la glace",
"Alpes, des glaciers sous haute surveillance", "Andes,
la fin des glaciers ?", "Himalaya, royaume des neiges".
https://www.universcience.fr/fr/professionnels/catalogue-filmsmultimedias/fiches/planete-glace/
Les glaciers ont survécu pendant des millénaires, mais ont-ils encore
un avenir ? Menacés par le réchauffement climatique, ils fondent à un rythme
alarmant.
[44] Dans la Cordillère des Andes, les glaciers fondent, la menace
augmente, Alan Loquet, 09/02/2021, https://rennes.maville.com/actu/actudet_-dans-la-cordillere-des-andes-les-glaciers-fondent-la-menace-augmente_54135-4490985_actu.Htm
En Amérique du Sud, les vidanges brutales de lacs glaciaires, surnommés
Glof par les scientifiques, se multiplient, réchauffement climatique oblige.
Des centaines de milliers de personnes vivent dans des zones à risque .
[50] Chronologie
des grands incendies, https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_grands_incendies
[51]
Incendie. Les séquoias géants de Californie résisteront-ils aux flammes ?
17/09/2021, https://www.courrierinternational.com/article/incendie-les-sequoias-geants-de-californie-resisteront-ils-aux-flammes
[60] Réchauffement : un rapport préconise de planter un arbre par
habitant pendant 30 ans pour adapter la forêt, AFP, 17.09.2020, https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/rechauffement-un-rapport-preconise-de-planter-un-arbre-par-habitant-pendant-30-ans-pour-adapter-la-foret_147473
"Au-delà
des régénérations naturelles, il nous faudra planter 70 millions d'arbres par
an pendant 30 ans, soit un arbre par habitant", estime un rapport.
[61] The trees to plant or not, https://forestsnews.cifor.org/66150/trees-to-plant-or-not-to-plant
[62] Reboisement.
Environnement : planter des arbres, oui, mais pas n’importe comment,
23/06/2020, https://www.courrierinternational.com/article/reboisement-environnement-planter-des-arbres-oui-mais-pas-nimporte-comment
Deux récentes
études mettent en garde contre les programmes de reboisement conçus à la
va-vite. Selon celles-ci, certaines forêts replantées constituent un risque
pour la biodiversité et ne produiraient que des effets limités sur l’absorption
de dioxyde de carbone.
[63] Inverser
le cours de la déforestation pour préserver la biodiversité, Maxime
Lefebvre, 21/06/2020, https://www.podcastjournal.net/Inverser-le-cours-de-la-deforestation-pour-preserver-la-biodiversite_a27910.html
Le dernier
rapport sur la situation des forêts du monde, publié par le PNUE — le programme
des Nations unies pour l’environnement —, fait état de niveaux élevés de
déforestation et de dégradation. 420 millions d’hectares de forêts ont été
perdus depuis 1990.
[64] De
Dakar à Saint-Louis, une forêt de filaos en rempart contre les assauts de la
mer, Théa Ollivier (Dakar), 19 juin 2020, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/19/de-dakar-a-saint-louis-une-foret-comme-rempart-contre-les-assauts-de-la-mer_6043380_3212.html
Reverdir le
Sahel (3). Les maraîchers de la côte des Niayes, menacée par l’érosion,
bataillent pour préserver la bande d’arbres qui fixe les dunes de sable.
[65] Do forests function like 'biotic pumps' for rainfall,
10/02/2014, http://alert-conservation.org/issues-research-highlights/2014/2/10/do-forests-function-like-biotic-pumps
L'une des hypothèses les plus frappantes et les plus controversées à
émerger au cours de la dernière décennie est la notion selon laquelle des
étendues de forêt intactes, s'étendant des régions côtières aux régions
intérieures, peuvent aider à aspirer l'humidité océanique loin à l'intérieur
des terres - fonctionnant comme une "pompe biotique" géante.
[66] La pionnière du Néguev qui sème les graines qui défieront un
avenir sec, Sue Surkes, 20 August 202, https://fr.timesofisrael.com/la-pionniere-du-negev-qui-seme-les-graines-qui-defieront-un-avenir-sec/
Après avoir
planté les graines les plus vieilles du monde et apprivoisé l’arganier, Elaine
Soloway réfléchit dorénavant à faire fleurir les déserts en pleine évolution.
[66bis] After reviving ancient dates, a Negev pioneer plants
seeds against a dry future, Sue Surkes, 12 May 2021, https://www.timesofisrael.com/after-reviving-ancient-dates-a-negev-pioneer-plants-seeds-against-a-dry-future/
Having germinated the world’s oldest seed and domesticated the argan
oil tree, Elaine Soloway is now tinkering with how to keep a changing desert
blooming.
[67] Groasis
fait pousser des arbres dans le désert, Pierre Fortin, 28/06/2021, https://planete.lesechos.fr/solutions/groasis-fait-pousser-des-arbres-dans-le-desert-9770/
Un horticulteur
néerlandais a mis au point des cocons qui permettent aux arbustes de survivre
dans les milieux les plus arides. Son objectif : restaurer 2 milliards
d’hectares de terres dégradées.
[67bis] Groasis
Waterboxx, https://en.wikipedia.org/wiki/Groasis_Waterboxx
[70] Initiation
à l'agroforesterie en zone sahélienne: les arbres des champs du plateau central
au Burkina Faso, Daniel-Yves Alexandre, IRD Éditions/Karthala, 2002.
[71] Arbres,
arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'Ouest, Michel Arbonnier,
Ed. QUAE, 2002.
[72] Les
plantes sauvages du Sahel malien: les stratégies d'adaptation à la sécheresse
des Sahéliens, Gunnvor Berge, Drissa Diallo, Britt Hveem, Ed.
Karthala, 2005.
[73] Encyclopédie
des Plantes Alimentaires, Michel Chauvet, Belin, 2018, 880 pages, 69€.
Cette
encyclopédie décrit environ 700 espèces de plantes alimentaires du monde entier.
•
Rôle des acacias dans l'économie rurale des régions sèches
d'Afrique, G.E. Wickens & al., FAO, http://www.fao.org/docrep/v5360f/v5360f00.HTM
•
REVUE DU FAO : ACACIA (extraits), mercredi
1er mars 2006, Sarah
Toumi, http://satoumix.free.fr/paf/spip.php?article21
•
Quelques espèces ligneuses et herbacées utilisées pour la
fixation des dunes, FAO, http://www.fao.org/docrep/012/i1488f/i1488f10.pdf
•
Sélection d'espèces ligneuses adaptées à la fixation
biologique de dunes au Niger, LAMINOU MANZO O., CAMPANELLA B. & PAUL
R., Geo-Eco-Trop., 2009, 33, n.s. : 99 - 106, https://geoecotrop.be/uploads/publications/pub_331_08.pdf
•
AUBREVILLE, A. 1950. Flore Forestière Soudano-Guinéenne. A.O.F. - Cameroun - A.E.F. ORSTOM, 523 p.
•
WHITE, F. 1986. La végétation de l’Afrique. Mémoire
accompagnant la carte de végétation de l’Afrique. UNESCO/AETFAT/UNSO.
ORSTOM – UNESCO, 384 p.
•
Von Maydell, H.-J. 1990. Arbres et arbustes du Sahel. Leurs
caractéristiques et leurs utilisations. Verlag Josef Margraf, 531 p.
•
Thulin M. 1993. Flora of Somalia. Vol.
1., Royal Botanical Garden Kew, 493 p.
•
L'utilisation des eaux salées au Sahara, P. Simonneau, G.
Aubert, Ann. agron., 1963, 14 (5), 859-872, page 866, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_08-09/11033.pdf
•
Halophyte Database V 2.0 - Springer, http://extras.springer.com/2003/978-90-481-6256-7/V2_update.pdf
•
Les arbustes qui supportent un sol salé, http://fogeo.free.fr/flore/arbustes_halophiles.pdf
•
Écologie et régime hydrique de deux formations à Acacia
raddiana au nord et au sud du Sahara (Tunisie, Sénégal), R. Pontanier, M.
Diouf et M. S. Zaafouri, http://books.openedition.org/irdeditions/5263?lang=fr
•
Guide des Habitats Aride et Saharien - nature vivante, http://www.naturevivante.org/documents/typologie.pdf
•
http://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/396/salicorne
•
http://algues.pagesperso-orange.fr/salicorne.htm
•
http://www.deco.fr/jardin-jardinage/plante-potagere/salicorne/
•
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salicorne
•
Les Salicornes et leur emploi dans l'alimentation, http://www.persee.fr/docAsPDF/jatba_0370-3681_1922_num_2_16_1484.pdf
(7,3 Mo).
•
Salicorne, trésor nutritif et diététique, http://www.mr-plantes.com/2014/04/tresor-nutritif-et-dietetique/
•
Mechanisms of High Salinity Tolerance in
Plants. Narendra Tuteja. Methods in Enzymology,
Volume 428 (2007)
•
Roles of glycine betaine and proline in
improving plant abiotic stress resistance. M.
Ashraf et al.,. Environmental and Experimental Botany 59 (2007) 206–216
•
AtHKT1 is a salt tolerance determinant that
controls Na+ entry into plant roots. Rus
et al., PNAS, 2001. vol. 98 no. 24150–14155
•
Genes and salt tolerance: bringing them
together. Munns et al., 2005. N.
Phytol.167(3):645-63.
•
Expression of OsNHX1 gene in maize
confers salt tolerance and promotes plant growth in the field. Chen et al., 2007. PLANT SOIL ENVIRON., 53, (11): 490–498.
•
Effet des contraintes hydrique et saline sur la germination
de quelques acacias africains, Paul Ndour, Pascal Danthu, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010016071.pdf
•
Glenn, E. P., et al. (1999). Salt tolerance and
crop potential of halophytes. Critical Review in Plant Sciences 18(2),
227-55. doi:10.1080/07352689991309207
•
Glenn, E. P.; Brown, J. J.; O'Leary, J. W.
(1998). "Irrigating Crops with Seawater", Scientific American, Vol. 279, no. 8, Aug. 1998, pp. 56-61.
•
Glenn, Edward P.; Brown, J. Jed; O'Leary, James
W. (August 1998). "Irrigating Crops with Seawater" (PDF). Scientific
American (USA: Scientific American, Inc.) (August
1998): 76–81 [79]. Retrieved 2008-11-17.
•
"Fact
Sheet: Alternative Fuels". IATA. December 2013. Retrieved 2014-01-28.
•
Plant Responses to drought and Salinity
stress : Developments in a post-genomic era, Ismaël
Turkan, Academic Press,
•
Ecophysiology of
High Salinity Tolerant Plants, M. Ajmal Khan,
Darrell J. Weber, Springer Science, 2006.
•
Long term responses
of olive trees to salinity, J.C. Melgar, Y.
Mohamed, N. Serrano, P.A. García-Galavís, C. Navarro, M.A.
Parra, M. Benlloch and R. Fernández-Escobar, Agricultural
Water Management, 2009, vol. 96, issue 7, pages
1105-1113.
•
Best Management
Practices for Saline and Sodic Turfgrass Soils: Assessment and reclamation, Robert N. Carrow, Ronny R. Duncan, CRC Press, 2012.
•
Shalhevet, Joseph, 1994. "Using water of marginal quality for crop production: major issues," Agricultural
Water Management, Elsevier, vol. 25(3), pages
233-269, July 901-904 (article payant).
•
Corwin, Dennis L. & Rhoades, James D. &
Simunek, Jirka, 2007. "Leaching requirement for soil salinity control: Steady-state versus transient models,"Agricultural
Water Management, Elsevier, vol. 90(3), pages
165-180, June 901-904 (article payant).
•
Chartzoulakis, K.S., 2005. "Salinity and olive: Growth, salt tolerance, photosynthesis and yield," Agricultural
Water Management, Elsevier, vol. 78(1-2), pages
108-121, September 901-904 (article payant).
•
Ghrab, Mohamed & Gargouri, Kamel &
Bentaher, Hatem & Chartzoulakis, Kostas & Ayadi, Mohamed & Ben Mimoun,
Mehdi & Masmoudi, Mohamed Moncef & Ben Mechlia, Netij & Psarras,
Georgios, 2013. "Water relations and yield of olive tree (cv. Chemlali) in response to partial root-zone drying (PRD) irrigation technique and salinity under arid climate," Agricultural
Water Management, Elsevier, vol. 123(C), pages 1-11
901-904 (article payant).
•
Comparative Physiological Analysis of
Salinity Effects in Six n Six Olive Genotypes, Carolina Aparicio, Miguel
Urrestarazu, María del Pilar Cordovilla, HortScience July 2014 vol. 49 no. 7
901-904 (article payant). http://hortsci.ashspublications.org/content/49/7/901.full.pdf+html
•
Exploitation durable des tannes nues et des prairies à
halophytes : émergence de nouvelles filières alimentaires et non-alimentaires,
http://wwz.ifremer.fr/ncal/Biodiversite-et-ressources/Tannes-et-halophytes/Exploitation-durable-des-tannes-et-halophytes
•
Toderich, K.,Yensen, N., Kawabata, Y.,
Grutsinov, V., Mardanova,G., 2006. Khujanazarov.,T.,
Gismatullina, L.,6. Phytoremediation Technologies: using plants to clean up
the metal/salt Contaminated Desert Environments. J. Arid Land Studies:
15-4, pp. 455-458
•
Evaluation of Salinity Tolerance and Genetic
Diversity of Thirty-Three Switchgrass (Panicum virgatum) Populations,
Yiming Liu, Xunzhong Zhang, Jiamin Miao, Linkai Huang, Taylor Frazier, Bingyu
Zhao, BioEnergy
Research, May 2014.
•
Abdelli C., Oztûrk M., Ashraf M., Grignon C.,
2008. Biosaline agriculture and high salinity tolerance. Birkhauser
Verlag. 367p.
•
Chedly,A., Debez,A., Slama,Ines., Ghnaya,T., Barhoumi,Z.,
Grignon,C., 2006. Halophytes as a Bio Resource for Non Conventional
Water Resource Valorisation and Saline Zone Rehabilitation. Journal of Arid
Land Studies. Vol.15;n°4, pp.415-418.
•
De la Lanza, G; Rodriguez-Medina, MA; Soto, LA.,
1986. Experimental essay of detritus consumption
of halophytes by the penneids shrimp Penaeus vannamei and P.
stylirostris. Anales del Instituto de Biologia,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Serie zoologia. Mexico City.
Vol. 57, no. 1, pp. 199-212.
•
Glenn, EP, O'Leary, JW; Watson, MC; Thompson,
TL; Kuehl, RO., 1991. Salicornia bigelovii Torr.: An oilseed
halophyte for seawater irrigation. Science (Washington). Vol. 251, no.
4997, pp. 1065-1067.
•
Kauffmann, F. 2004. Le sel de la vie. Partenaires.
Dossier eau et agriculture. Helvetas n°177., pp. 18-21
•
Le Goff F., 1999. Analyse des paramètres biotiques et
abiotiques pour une exploitation maîtrisée des salicornes : de la plante
sauvage à la plante domestique. Thèse dr. Université Rennes. 241 p.
•
Martinez-Palacios, CA; Olvera-Novoa, MA; Luz
Vazquez, Made la; Parra, IAde la; Chavez-Sanchez, MaC; Ortega-Nieblas, M; Ross,
LG., 2003. The use of halophytic beach-bean meal Canavalia
maritima, as partial replacement for fishmeal in diets for juvenile Nile
tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus). Journal of
aquaculture in the tropics. Vol. 18, no. 2, pp. 171-180.
•
Masters,D.G., Benes.,S.E., Norman., H.C., 2007. Biosaline
agriculture for forage and livestock production. Agriculture,
Ecosystems and Environments 119: pp . 234-248
•
Pei Qina, Min Xiea and Yunsheng Jiangb,
1998. Spartina green food ecological engineering. Ecological
Engineering, Volume 11, Issues 1-4, pp. 147-156
•
Shaer (El)., H.M., 2006. Halophytes as cash
crops for animal feeds in arid and semi-arid regions. In biosaline
agriculture and salinity tolerance in plants. Ed. M.Oztürk, Y.Waisel, A. Khan
& G.Görk. pp. 89-100.
Pour rendre les plantes alimentaires plus résistantes au sel (travaux
de Madame Dilfuza Egamberdieva & al.) :
•
Use of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria
to Alleviate Salinity Stress in Plants, Dilfuza
Egamberdieva and Ben Lugtenberg, http://www.academia.edu/attachments/34722450/download_file?st=MTQxMDc1MzU5MSw3OC4xOTMuMS41MCwyMjk3NzU4&s=work_strip&ct=MTQxMDc1Mjg1MCwxNDEwNzUzNzE2LDIyOTc3NTg=
•
Alleviation of Salt Stress in Legumes by
Co-inoculation with Pseudomonas and Rhizobium, Dilfuza Egamberdieva,
Dilfuza Jabborova and Stephan Wirth, http://www.academia.edu/attachments/33108295/download_file?st=MTQxMDc1MzU5MSw3OC4xOTMuMS41MCwyMjk3NzU4&s=work_strip&ct=MTQxMDc1Mjg1MCwxNDEwNzUzODU0LDIyOTc3NTg=
•
Growth and Symbiotic Performance of Chickpea
(Cicer arietinum) Cultivars under Saline Soil Conditions, Dilfuza
Egamberdieva, Vyacheslav Shurigin, Subramaniam Gopalakrishnan and Ram Sharma,
J. Biol. Chem. Research, Volume 31 (1) 2014 Pages No. 333-341, http://www.academia.edu/attachments/33065385/download_file?st=MTQxMDc1MzU5MSw3OC4xOTMuMS41MCwyMjk3NzU4&s=work_strip
•
Salt-tolerant
bacteria improve crop yields, TWAS, October 6,
2013, http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131006142707.htm
•
Survival of
Pseudomonas extremorientalis TSAU20 and P. chlororaphis TSAU13 in the rhizosphere
of common bean (Phaseolus vulgaris) under saline conditions, D. Egamberdieva, http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/36137.pdf
•
Salinity:
Environment — Plants — Molecules, André Läuchli,Ulrich Lüttge, Kluwer
Academic Publishers, 2004.
•
Association mapping of salt tolerance in barley
(Hordeum vulgare L.)., Long NV1, Dolstra O, Malosetti M, Kilian B, Graner A, Visser RG, van der Linden CG, Theor Appl Genet. 2013 Sep;126(9):2335-51 (article payant).
•
The Study of Salt
Tolerance of Iranian Barley Genotypes in Seedling Growth Stages, Farhad Taghipour and Mohammad Salehi, American-Eurasian J. Agric.
& Environ. Sci., 4 (5): 525-529, 2008, http://www.idosi.org/aejaes/jaes4(5)/1.pdf
[80] Madagascar : Une algue marine comme matière première pour la
production d’un bioplastique, 18/11/2020, https://www.ares-ac.be/en/actualites/731-madagascar-une-algue-marine-comme-matiere-premiere-pour-la-production-d-un-bioplastique
[81] Culture
d’algues rouges: Des avantages économiques et écologiques [à Madagascar], http://www.tresorpublic.mg/?p=30971
[91] Espèces
de palétuviers dans les mangroves de Toliara, Serge Tostain, FORMAD
ENVIRONNEMENT,
www.formad-environnement.org/paletuviers_29dec11.pdf
[92] Le
Guide technique comment reboiser la mangrove ?, Oceanium de Dakar, http://www.oceaniumdakar.org/IMG/pdf/bd_guide_technique_reboisement_mangrove.pdf
[93] Structure
et fonctionnement des écosystèmes benthiques marins, Charles F. Boudouresque,
Centre d'Océanologie de Marseille, http://www.com.univ-mrs.fr/~boudouresque/Documents_enseignement/Ecosystemes_MPO_4_Mangrove_web_2010.pdf
[94] Écologie
de la Forêt de Palétuviers [une introduction], http://sxm.sea.free.fr/sea-Mangrov-ecologie.htm
[95]
The Code of Practice for Mangrove Harvesting [règles des bonnes
pratiques pour la gestion de la mangrove], http://www.gcca.eu/sites/default/files/catherine.paul/code_of_practice_for_mangrove_harvesting_2011.pdf
[96] Guyana
Mangrove Nursery Manual, March 2011 [Manuel de plantation en
pépinière des palétuviers, Guyana, mars 2011], http://www.gcca.eu/sites/default/files/catherine.paul/guyana_mangrove_nursery_manual_2011.pdf
[97] Community
Involvement in Mangrove Restoration, Guyana, South America [Participation
de la Communauté à la restauration des mangroves, le Guyana, en Amérique du
Sud], http://www.mangrovesgy.org/home/images/stories/Documents/MSc%20Dissertation_FINAL_Nov2010.pdf
[98] Mangrove
Forest Guide [Guide de forêt de palétuviers], http://www.mangrovesgy.org/home/images/stories/Documents/Mangrove%20Forest%20Guide.pdf
[99] WHAT
ABOUT the Guyana Mangrove Restoration Project [Qu'est-ce que le projet de
restauration des mangroves du Guyana ?], http://www.mangrovesgy.org/home/images/stories/Documents/Pc_Project%20brochure.pdf
[100] What
Better Ways to Help Protect and Use Mangroves [Quelles sont les meilleures
façons pour aider à protéger et à utiliser les mangroves ?],
http://www.mangrovesgy.org/home/images/stories/Documents/Public%20Awareness/Do%20and%20dont%20with%20pics.pdf
[101]
Ravishankar, T. and R. Ramasubramanian. 2004. Manual
on mangrove nursery techniques. M.S., Swaminathan Research Foundation;
Chennai, India. pp 48. India Canada Environment Facility (ICEF), New Delhi, http://www.drcsc.org/VET/library/Nursery/Mangrove_Nursery_manual_HR.pdf
[102] Ecological Mangrove Rehabilitation - Mangrove Restoration, http://www.mangroverestoration.com/pdfs/Final%20PDF%20-%20Whole%20EMR%20Manual.pdf [manuel d’un niveau plutôt ardu].
Menaces
sur les mangroves :
[103]
Wildlife & biodiversity. Bhitarkanika will die if freshwater extraction
by industries continues: Activist, Ashis Senapati, 03/09/2021, https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/bhitarkanika-will-die-if-freshwater-extraction-by-industries-continues-activist-78828
Bhitarkanika,
the second-largest mangrove forest in India will be destroyed if freshwater
continues to be extracted from the Brahmani river basin.
Base de
données sur les champignons, y compris pour les mycorhizes :
CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, http://www.cbs.knaw.nl/Collections/BioloMICS.aspx?Table=CBS%20strain%20database&Rec=11092&Fields=All
1) Adresse
URL Web de cette Base de données: http://doc-developpement-durable.org/
2) Accès
URL des 38 470 documents (un total de 75 Go), classés en 2 050 thèmes
différents, de cette base : http://doc-developpement-durable.org/file/
3) Possibilité
de télécharger
l’intégralité de cette base de données, une copie de cette base de données étant
stockée dans un partage Web (drive), via Google drive, à cette adresse
URL we : https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja?usp=sharing
4) 250
documents et 60 diaporamas de sensibilisation, rédigés par l’auteur.
La lutte contre la
désertification dans les microprojets de développement dans le Sahel -
Techniques et coûts associés, techniques d'adaptation aux changements
climatiques, B. Reysset & Ph. Zoungrana,
ILSS/IREMLCD-2008, http://www.cilss.bf/publications/upload/techniquesadaptationchangementsclimatiques.pdf
Erosion hydrique,
http://www.ma.auf.org/erosion/chapitre1/VI.Lutte.html
Dimensionnement
d’une noue, http://www.arpentnourricier.org/dimensionnement-dune-noue-swale/
Les techniques
traditionnelles de GCES et de restauration de la productivité des sols au
Rwanda, François Ndayizigiye, https://books.openedition.org/irdeditions/12893?lang=fr
Quelques techniques
antiérosives appropriées aux régions tropicales, ROOSE (E.J.), ORSTOM &
IITA, Labo de pédologie, 4 juillet 1975, https://core.ac.uk/download/pdf/39882097.pdf
Les pratiques
antiérosives, FAO, http://www.fao.org/3/T1765F/t1765f0o.htm
Valorisation des
techniques anti-érosives traditionnelles en milieu sahélien : les
micro-barrages en sacs de sable (Tahoua, Niger) / The development of
traditional anti-erosion techniques in the Sahel : micro-dams made of sand bags
(Tahoua, Niger), Bouzou Moussan Revue de Géographie Alpine, Année 1997, 85-1,
pp. 87-99, https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1997_num_85_1_3902
STRATEGIES ET
TECHNIQUES DE LUTTE ANTIEROSIVE DANS LES MONTAGNES DU PRERIF ORIENTAL (MAROC),
Abdellatif TRIBAK, http://www.beep.ird.fr/collect/bre/index/assoc/HASH0161/1e60eddf.dir/21-045-055.pdf
Lutte antiérosive,
réhabilitation des sols tropicaux et protection contre les pluies exceptionnelles,
Eric ROOSE, Hervé DUCHAUFOUR et Georges DE NONI, IRD, 2012, 758 pages, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers14-01/010055520.pdf
Les techniques de Correction
des ravines et de Stabilisation des Lavaka (Madagascar), BMZ, Solofo
RAHARINAIVO, 2008, https://wocatpedia.net/images/d/d9/Solofo_Raharinaivo_%282008%29_-_Les_techniques_de_Correction_des_ravines_et_de_Stabilisation_des_Lavaka_.pdf
FICHE TECHNIQUE n°
89b LUTTE ANTI–EROSIVE (LAE), http://louvaincooperation.org/sites/default/files/2019-03/89b-Fiche%20Techniques%20Agricole%20%28LUTTE%20ANTI%20%E2%80%93%20EROSIVE-LAE%29.pdf
Apport de la
recherche à la lutte antiérosive. Bilan mitigé et nouvelle approche, E.
Roose, G. de Noni, ORSTOM, 2017, http://www.afes.fr/wp-content/uploads/2017/10/EGS_5_3_ROOSE.pdf
LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'EROSION
DES SOLS, Daniel GAUVIN, 2000, https://www.u-picardie.fr/beauchamp/duee/gauvin/gauvin.htm
Irrigation Water Management:
Irrigation Methods [Irrigation gestion de l'eau: méthodes d'irrigation], http://www.fao.org/docrep/s8684e/s8684e00.htm#Contents
Runoff farming,
vital part of the Tunisian water management system,
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/dry-land-management/runoff-farming-vital-part-of-the-tunisian-water
Les
techniques traditionnelles de gestion de l'eau, de la biomasse et de la
fertilité des sols, Mohamed Sabir, Éric Roose, Jomol Al Karkouri, in Gestion
durable des eaux et des sols au Maroc, IRD, 2010, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-09/010054917.pdf
IL ÉTAIT UNE
FOIS... NOTRE TERRE, L'eau précieuse du Sahel (2009), http://www.dailymotion.com/video/x2vqobj_il-etait-une-fois-notre-terre_tv
Il était une fois
notre Terre. L'Eau précieuse en Inde, http://www.dailymotion.com/video/x1z2kaq_il-etait-une-fois-notre-terre-03-l-eau-precieuse-en-inde_school
Les réseaux d’eau
anciens ressuscitent en Méditerranée, https://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/370-les-reseaux-d-eau-anciens-ressuscitent-en-mediterranee
Les Foggara : "UN SYSTÈME
D’IRRIGATION ORIGINAL: LES FOGGARA" (d'après J.Oliel , "Les juifs
au sahara ; le Touat au moyen-âge" , CNRS-histoire, 1994), http://zoumine.free.fr/tt/sahara/donnees_geo_climatiques/foggaras.html
Khettara, http://www.l-eau-du-desert.com/ledd/khettaras
Système
d'irrigation "Les khettaras", http://www.flowersway.com/article/systeme-d-irrigation-les-khettaras-1443
Qanat, https://fr.wikipedia.org/wiki/Qanat
Comment recueillir
de l’eau là où il ne pleut jamais ? Arbre fontaine, attrape-brouillard et oasis
brumeuses, Alain Gioda -IRD, Lima, Pérou, http://www.clubdesargonautes.org/faq/arbrefontaine.php
EL ARBOL FUENTE, IRD, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_33-34/38215.pdf
Des filets à nuages sur la crête d’El
Tofo (Chili) [un mauvais choix], Stephen Dale, IDRC, http://www.idrc.ca/FR/Resources/Publications/Pages/ArticleDetails.aspx?PublicationID=686
Restauration Des Forêts Tropicales: Un Guide Pratique. Version
papier A4 couleur, Kate Hardwick, David Blakesley, Stephen D. Elliott, Kew
Publishing; French édition, 2013, 264 pages, 48€.
Restaurer les forêts tropicales est un guide pratique basé sur des
techniques éprouvées (dont la technique des arbres clés), permettant aux
lecteurs de prendre les bonnes décisions pour sauver ces précieuses zones. Il
est aussi disponible en anglais et en espagnol.
Note :
Vous pouvez trouver, à télécharger, la version PDF gratuite de ce guide, pour
chacune de ces 3 langues, à cette adresse URL web : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/
Version
française : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/Version-Francaise/
Version
anglaise : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/english-version/
Version
espagnole : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/version-espanola/
Water Harvesting in the Negev, Statler Waldorf, https://www.youtube.com/watch?v=tjBugtV8GHc
Growing Forests in the Desert (Fr), KKLJNFWorldwide, https://www.youtube.com/watch?v=HEOzkiGqK-I
Growing Forests in the Desert (English), KKL JNF, https://www.youtube.com/watch?v=eK0nEV5dWBA
The National Master Plan for Forests and Afforestation, http://www.kkl.org.il/eng/forestry-and-ecology/afforestation-in-israel/national-master-plan-for-forests-and-afforestation/
Plan directeur national (NOP 22), http://www.kkl.org.il/eng/files/forests/tma/TAMA22_eng.pdf
Afforestation in Israel – reclaiming ecosystems and combating
desertification, http://www.kkl.org.il/eng/files/forests/afforestation-israel/UNFF-Afforestation-Israel.pdf
Keren Kayemeth LeIsrael
(KKL), http://www.kkl.org.il/eng/
Permaculture
Greening the Desert, Désert Jordanien, https://www.youtube.com/watch?v=K1rKDXuZ8C0
& http://www.geofflawton.com/fe/62176-desert-oasis
Greening Nuweiba
desert with food [Reverdir le désert à Nuweiba, Sud du Sinaï, Egypte],
https://habibaorganicfarm.wordpress.com/
Landscape
architecture, https://pangeaexpress.wordpress.com/2015/02/13/desert-greening/
This man changed the fortunes of a barren land
using traditional water wisdom, 03/09/2021, https://www.downtoearth.org.in/video/environment/this-man-changed-the-fortunes-of-a-barren-land-using-traditional-water-wisdom-78826
A flood-ravaged desert turned into a home for 120
species of birds, 70 species of native trees and thousands of animals
"Extinction risk of Mesoamerican crop wild
relatives" in "Plants, People, Planet", September 6,
2021, https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppp3.10225
Mesoamerica, origin of several global crops, faces floristic
biodiversity loss: Study [La Méso-Amérique, origine de plusieurs cultures
mondiales, fait face à une perte de biodiversité floristique : étude],
Rajat Ghai, 08/09/2021, https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/mesoamerica-origin-of-several-global-crops-faces-floristic-biodiversity-loss-study-78895
Mesoamerica, origin of several global crops, faces floristic biodiversity
loss: Study [La Méso-Amérique connaît un déclin des espèces sauvages
apparentées aux pommes de terre, aux haricots, aux courges et au maïs en raison
de la perte d'espaces sauvages et de la mécanisation de l'agriculture].
Certains arbres et plantes peuvent être utiles, produire du bois, des
aliments (fruits) et pourtant nous ne les recommandons pas, malgré leurs
qualité, à cause de leur caractère fortement invasif. Voici la liste de
ces plantes :
1.
Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica etc.) (cactée
arbustif).
2.
Oponce stricte (Opuntia stricta)
3.
Agave sisal (Agave sisalana, Agave ixtli etc.) (cactée
arbustif).
4.
Bois de fer des marais (Casuarina glauca) (arbre, buisson).
5.
Filao (Casuarina equisetifolia) (arbre).
6.
Acacia auriculé (Acacia auriculiformis)
(arbre).
7.
Acacia à bois noir ou Mimosa à bois noir (Acacia melanoxylon)
(arbre).
8.
Épine de Jérusalem (Parkinsonia aculeata)
(arbre).
9.
« Mesquite » (Prosopis juliflora) (arbre).
10. Atriplex
sp. (Arbre).
11. Tamarix
sp. (Arbre).
12. Tamaris
d'Afrique (Tamarix africana) (arbre).
13. Tamaris
Athel (Tamarix aphylla ou Tamarix articulata) (arbre).
14. Tamarix
tetandra (arbre).
15. Genêt
blanc ou Retam blanc (Retama monosperma).
16. Massette
- Typha.
17. Kikuyu
grass ou herbe kikuyu (Pennisetum clandestinum)
18.
Texas blueweed (Texas
vipérine) ou yerba parda (Helianthus ciliaris)
Tous les Prosopis (P. alba, P. nigra, P. pallida, P.
chilensis, P. juliflora, P. glandulosa et …) peuvent résister à un niveau
élevé en sel mais possèdent un potentiel invasif. Idem pour tous les Atriplex
(A. halimus, A. semibaccata,
etc.).
Score des risques invasifs pour les oponces :
•
Opuntia
ficus-indica
: ? (Probablement, score : 20).
•
Opuntia
monacantha
: à rejeter, score: 22.
•
Opuntia
stricta
: à rejeter, score: 20.
|
(Famille des Cactaceae).
A rejeter, score: 20.
|
  
|
U ↗↗
|
|

|
·
Le figuier de Barbarie ou Oponce préfère les zones arides sèches
et supporte des périodes de sécheresse longues de 6 à 10 mois et des
précipitations de 100 mm-300 mm.
·
« Il se propage par graines et par voie végétative. Des
fragments de souches délogés prennent facilement racine et régénèrent de
nouvelles plantes. Un segment de tige unique est capable de construire un
fourré dense. Les graines sont dispersées par les animaux ».
·
Espèce invasive : L'invasion la plus spectaculaire à
Madagascar est représentée par plusieurs espèces d'Opuntias, introduites
dès le 18° siècles par les Européens.
·
Opuntia stricta envahit les herbages et les zones
arbustives, les sites perturbés. "La plante se propage rapidement en
de vastes bosquets épineuses, entravant la faune et remplacent la végétation
indigène" (Weber, 2003, P 291).
·
Diverses espèces d’Opuntias sont invasives : O.
ficus-indica,O. stricta …
·
Envahissement des régions arides, par des fourrés épineux d’Opuntia
spp.
·
Usages : Tous les Opuntias produisent
de fruits comestibles (figues de barbarie).
·
Ils sont tous sources d’eau et de nourriture pour les animaux.
·
Ils permettent de construire des haies vives défensives et de
fixer les dunes.
·
Dans le Sud de Madagascar, ses raquettes (son mucilage) sert de
nourriture, durant les période de soudure.
·
On peut fabriquer du cuir végétal à partir de ses raquettes,
Sources :
a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier_de_Barbarie,
b) Weber,
Ewald.
2003. Invasive plants of the World. CABI Publishing, CAB International, Wallingford, UK., page 290 (548
pp.).
c) Évaluation préliminaire des risques d’invasion par les
essences forestières introduites à Madagascar. http://bft.revuesonline.com/gratuit/BFT63_299_3PtsTas299.pdf
d) http://www.hear.org/pier/species/opuntia_stricta.htm,
e) http://www.hear.org/pier/species/opuntia_ficus_indica.htm
f) Evaluation
préliminaire des risques d’invasion par les essences forestières introduites à
Madagascar, Jacques Tassin, Ronald Bellefontaine, Edmond Roger, Christian
Kull, Mars 2009, Bois et Forêts des Tropiques 299(299):27, https://revues.cirad.fr/index.php/BFT/article/view/20420
et https://www.researchgate.net/publication/323213608_Evaluation_preliminaire_des_risques_d'invasion_par_les_essences_forestieres_introduites_a_Madagascar
g) La
valorisation du cactus pour le développement [à Madagascar], https://www.unicef.org/madagascar/media/2721/file/La%20valorisation%20du%20cactus%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement.pdf
h) La disparition des Opuntia et les famines périodiques dans le Sud
de Madagascar, G. Petit, Bulletin de l'Association des Geographes Français,
03/1934, https://arsie.mg/fr/metadata/la-disparition-des-opuntia-et-les-famines-periodiques-dans-le--597732
i) Mexique : 2 entrepreneurs ont mis au point un cuir végétal à base
de cactus, Maxime Delmas, 1 mars 2021, https://creapills.com/cuir-cactus-vegetal-mexique-20210301
|

© J. Tassin.
|


|


Opuntias monacantha.
|
|

Fruits d’Opuntia ficus-indica.
|

Fleurs.
|

Opuntias monacantha.
|
|

Opuntia spp. Dans le sud de Madagascar. © Per
Larsson
|

Opuntias monacantha.
|
|

Opuntia ficus-indica, le figuier de barbarie
inquiéta l'Australie au début du XXème siècle. Un exemple de plante
ornementale et utile dans plusieurs domaines mais qui se révéla fortement
envahissante.
|
|
|
|
|
|
(Famille des Cactaceae).
A rejeter, score: 20.
|
  
|
U ↗↗
|
|

|
Originaire de l'Amérique
centrale et du sud des États-Unis, cette plante grasse, au port buissonnant, est devenue
envahissante en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Calédonie.
Les tiges, charnues et
aplaties, forment des raquettes (cladodes) mesurent moins de 20-25 cm.
Les fleurs sont solitaires, formées par de nombreuses pièces
membraneuses, rougeâtres à jaune clair. Leur diamètre est de 6 à 7 centimètres.
Elles sont éphémères et mellifères.
Les fruits sont plus ou
moins pyriformes, toujours de teinte pourpre. Ils mesurent 4 à 6 centimètres de
longueur et contiennent de 60 à 180 graines (qui peuvent rester viables plus de
10 ans), jaune à marron clair, incorporées dans la pulpe du fruit. Les fruits
étant appréciés par les oiseaux et les mammifères, leurs graines sont
dispersées par zoochorie (par les animaux).
Usages : Ses fruits ont un mauvais goût mais constituent
une nourriture d'appoint en cas de famine, notamment à Madagascar. Le mucilage à l'intérieur des feuilles est utilisé pour soigner les
brûlures et les abcès. Il est comestible au même titre que les fruits. On
peut incorporer ce cactus rouge broyé (Opuntia stricta) dans
l’alimentation des caprins.
Mêmes usages qu'Opuntia ficus-indica.
Espèces envahissantes (invasives) : L'espèce est devenue envahissante dans de nombreuses
zones géographiques, et figure dans la liste de l'IUCN des 100 espèces parmi les plus envahissantes
au monde. En Australie, cette espèce a couvert jusqu'à 24 millions
d'hectares en Australie en 1920. A Madagascar, Cet Opuntia (noms
malgaches raketamena, raketadambo, mavozoloky, raketakendretevo) pose un
problème à Madagascar où il a été introduit et propagé. Il envahit rapidement
les champs abandonnés où il a servi de clôture vivante. Il fait maintenant
l'objet d'un programme d'éradication systématique par des moyens mécaniques. En
Nouvelle-Calédonie, le Code de l'environnement de la Province Sud interdit
l’introduction dans la nature de cette espèce ainsi que sa production, son
transport, son utilisation, son colportage, sa cession, sa mise en vente, sa
vente ou son achat.
Lutte biologique : La lutte biologique
avec la cochenille Cactoblastis cactorum a donné de bons résultats, les larves détruisant
la plante en y creusant des tunnels, ouvrant la voie à des organismes
pathogènes. Dans le Nord de la Nouvelle-Calédonie, la larve d'un
lépidoptère permet de contrôler certains peuplements.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Opuntia_stricta
|

Fruits et raquettes d’Opuntia stricta.
|

Fleur
|
|

Opuntia stricta avec des fruits, Sète, France.
|

Cladodes en train de pourrir à la suite de l'action de Cactoblastis
cactorum.
|

Opuntia stricta.
|
(Famille des Agavaceae).
A rejeter, score: 14.
|
 
|
U ↗↗
|
|

|
Originaire de l'est du Mexique, est une plante
succulente vivace, à rhizome, aimant les endroits secs, désormais présente dans
de nombreux pays tropicaux et subtropicaux.
Usage : De ses feuilles de laquelle est extrait la fibre résistante, nommée sisal,
servant à la fabrication de cordage, de tissus grossiers et
de tapis. Le sisal occupe
la 6e place parmi les plantes à fibres, soit 2% de la
production mondiale de fibres végétales.
Le sisal se multiplie par voie végétative grâce à des bulbilles ou des
drageons.
A. sisalana s'adapte grande variété d'habitats.
Plante invasive : Dans l’état du Queensland, en Australie,
l’A. sisalana est considéré comme l'une des 35 plantes invasives les
plus nuisibles.
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Sisal
b) http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Agave+sisalana+Perrine
c) http://www.cabi.org/isc/datasheet/3855
Note : Agave Vivipara est synonyme d’Agave ixtli.
|
(Famille des Casuarina).
De la même
famille que le Filao (Casuarina equisetifolia).
A rejeter, score: 20.
|
 
|
↗↗
|
|

|
Communément appelé le chêne des marais, chêne gris ou
chêne de rivière, originaire de la côte est de l'Australie,
cette espèce s'est naturalisé dans les Everglades en
Floride, où il est considéré comme une plante invasive.
Il se présente soit sous forme d'arbre, soit sous forme de buisson,
soit sous forme de plante rampante.
Habitat / écologie / Plante invasive : Cette espèce est très
semblable à Casuarina
equisetifolia (Filao). Elle
forme des stolons prolifiques, produisant des peuplements denses. C'est le
« bois de fer » le plus agressif à Hawaii (Smith, 1985, p 187). « Plages
côtières, bancs de sable. Dans la zone d'origine, cet arbre se reproduit dans
les zones salines marécageuses, les plaines inondables des estuaires, les
forêts des zones humides et le long de marais salants. L'arbre fixe l'azote
mais n’est pas si tolérante au sel comme Casuarina equisetifolia. L'arbre
produit une litière épaisse [en grande quantité] qui empêchent la croissance et
la création d'espèces indigènes » (Weber, 2003, p 89).
Ses racines possèdent des nodules fixateurs d'azote (actinorhizes)
qui, en symbiose avec une bactérie du sol (Frankia), assimilent l’azote
de l’air.
Propagation : graines portés par le vent
et stolons à profusion.
|

Invasion de Casuarina glauca à Hawaï.
|

|

|
|

|

|
|
Le Filao ou bois de fer, à cause de la dureté de son
bois difficile à travailler, est un arbre d'origine australienne, présent
également sur les côtes d'Indonésie,
de Malaisie, des îles
du Pacifique et
des Mascareignes ainsi
qu'aux Antilles. On le
trouve aussi au Sénégal,
notamment en bord de mer.
Il peut atteindre plus de trente mètres de hauteur pour les vieux
spécimens.
Le filao est un arbre pionnier, capable de coloniser des sols
très pauvres en éléments minéraux. Dans les zones salines, il évacue le
surplus salé par ses feuilles, rendant le sol à son pied infertile pour les
autres espèces.
Usages : Il est très utilisé comme bois de feu ou pour
fabriquer du charbon de bois. Il est résistant au feu.
Plante invasive : Là où il est invasif, il forme des
peuplements mono-spécifiques, excluant les autres espèces.
Dans les basses terres arides des îles Galápagos « il supprime
la croissance des autres plantes sous son couvert » (Motooka et
al ., 2003) (McMullen, 1999, p 95).
Ses racines possèdent des nodules fixateurs d'azote (actinorhizes) qui,
en symbiose avec une bactérie du sol (Frankia), assimilent l’azote de l’air.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Filao,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Casuarina_equisetifolia
c) http://www.hear.org/pier/species/casuarina_equisetifolia.htm
|
(Famille des Fabaceae).
A rejeter, score: 13.
|
( ) )
|
U ↗↗
|
|

|
Originaire d'Australie,
d’Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, cet
arbre forestier, largement plantée, à croissance rapide, pousse jusqu'à
30m de haut.
Son feuillage dense, vert foncé, qui le reste tout au long de la saison
sèche, en font un excellent arbre d'ombrage.
Il se multiple par semences. Il produit beaucoup de semences. Dans un
kg de graines, il y a ~ 47.000 graines.
Usages : Son bois a une densité élevée (500-650 kg/m³),
un grain fin, un joli poli et finition.
Son bois est largement utilisé pour la pâte à papier.
Son charbon de bois, brulant sans fumée et étincelle, est de bonne
qualité.
Son système racinaire superficiel, dense, étendu, emmêlé, sa croissance
rapide même sur les terres stériles, le rend approprié pour stabiliser les
terres érodées.
Cet arbre améliore la fertilité des sols. Sa germination est réduite
dès que la concentration saline atteint 4,6 g.L-1.
Plante invasive : Il est considéré comme envahissant en
Floride (Hammer, 1996. P 24), à Hawaï, dans les Tonga, Bahamas, au Bangladesh,
Singapour ...
Sources : a) http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_auriculiformis,
b) http://www.cabi.org/isc/datasheet/2157,
c) http://www.hear.org/pier/species/acacia_auriculiformis.htm
(d) Effet des contraintes hydrique et saline sur la germination de
quelques acacias africains, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010016071.pdf
|

|

Fleurs
|

Gousses spiralées (comme celles d’Acacia mangium).
|
|

Acacia auriculiformis devenant envahissant à
Tsarasoa (Andringitra, Fianarantsoa), Madagascar
© Gilles Gautier.
|

© Gilles Gautier.
|
|
|
(Famille des Mimosaceae
ou des Fabaceae selon
la classification phylogénétique).
A rejeter, score: 12.
|
 
|
U ↗↗
|
|

|
Originaire de l'est de l'Australie, c'est un arbre à
croissance rapide, pouvant atteindre 45 mètres de haut. Son tronc droit a une
couronne dense, pyramidale à cylindrique, voire étalée.
Habitat / écologie : Il possède un système radiculaire
superficiel dense. Il s'adapte à de nombreux milieux et de climats, mais il
préfère les climats frais. Il tolère la sécheresse, un mauvais drainage,
tous les sols, l'air salin, les rafales, les vents froids, le
brouillard, les températures extrêmes, le soleil ou l’ombre. Il se
reproduit dans les estuaires, forêts naturelles, plantations forestières,
plages, savanes, prairies, zones humides, riveraines, côtières,
agricoles, urbaines, perturbées …
Plante invasive : Le contrôle de sa prolifération dans les
exploitations forestières est très onéreux,
Usage : mais la valeur de son bois, sa facilité de culture
et de mise en valeur sont, par contre, un avantage important.
Source : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimosa_%C3%A0_bois_noir,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_melanoxylon,
c) http://www.hear.org/pier/species/acacia_melanoxylon.htm
|

|

Fleurs
|


Gousses
|
|
 Tronc Tronc
|

Fleurs
|

Feuilles
|
|
(Famille des Fabaceae).
Risque élevé, score: 17 (source HEAR).
|
 
|
U ↗↗
|
|

|
Acacia saligna est un petit arbre, originaire
d'Australie, au port retombant (pleureur) décoratif et très dense, atteignant
jusqu'à 8 m de hauteur.
Il a une floraison abondante de gros glomérules jaune souffré à orangé.
Multiplication par semis et drageons. Croissance très rapide. Résistant au
calcaire, il supporte très bien la proximité de la mer et des embruns marins.
A la base de chaque phyllode,
il y a un nectaire glande qui
sécrète un liquide sucré, attirant les fourmis.
Le Coojong a tendance à croître partout où le sol a été perturbé, aux côtés de
nouvelles routes … Il est extrêmement vigoureux quand il est jeune, croissant
souvent de plus d'un mètre, par an (jusqu’à 3 m).
Usages : Il a été utilisé pour le tannage, la
végétalisation, le fourrage pour les animaux, la réhabilitation des sites
miniers, le bois de chauffage, le paillis,
l'agroforesterie et comme arbre décoratif. Il a été planté abondamment dans les
zones semi-arides de l'Afrique, l'Amérique du Sud et au Moyen-Orient
comme brise-vent et
pour la stabilisation des dunes de sable ou pour lutter contre l'érosion. Il
fixe l’azote. Il a un système racinaire étendu. Ses semences, très
abondantes, survivent au feu.
Plante invasive : Il est devenu une espèce envahissante,
hors de son aire de répartition naturelle (Afrique du Sud …).
Noms anglais : coojong, golden wreath wattle, orange
wattle, blue-leafed wattle, Western Australian golden wattle, et en
Afrique, Port Jackson willow. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_saligna
|
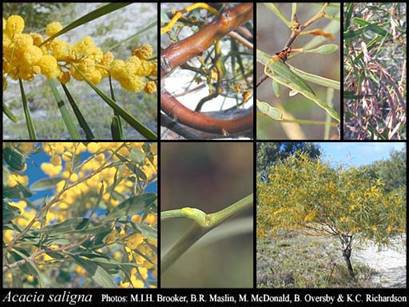
|

Feuilles et fleurs.
|
|
(Famille des Fabaceae).
Risque élevé, score: 15-20 (source HEAR).
|
  
|
U ↗↗
|

|
C’est un petit arbre épineux, de 2 à 8 m (6,6 à 26,2 pi) de
haut, avec une hauteur maximale de 10 mètres (33 pi).
Description :
Palo verde peut avoir des tiges simples ou multiples et de nombreuses branches
avec des feuilles pendantes. Les feuilles et les
tiges sont glabres. Les
feuilles sont alternes et pennées (15 à 20 cm de long). Le pétiole aplati est
bordé par deux rangées de 25 à 30 minuscules folioles ovales ; les
folioles sont rapidement caduques par temps
sec (et pendant l'hiver dans certaines régions) laissant les pétioles verts et
les branches faire la photosynthèse. Les
branches poussent des épines doubles
ou triples de 7 à 12 mm (0,28 à 0,47 po) de long à l'aisselle des
feuilles. Les fleurs sont
jaune-orange et parfumées, 20 mm (0,79 in) de diamètre, poussant à
partir d'une longue tige mince en groupes de huit à dix. Ils ont cinq
sépales et cinq pétales, dont quatre plus clairs et ovales rhomboïdes, le
cinquième allongé, avec des taches jaunes et violettes plus chaudes à la
base. La période de floraison se situe au milieu du printemps (mars-avril
ou septembre-octobre). Les fleurs sont pollinisées par les abeilles. Le fruit est une gousse, d'aspect
coriace, brun clair à maturité.
Habitat : L’arbre
a une grande tolérance à la sécheresse, atteignant simplement une taille plus
petite. Dans les environnements humides et riches en humus, il devient un arbre
d'ombrage plus grand et étalé. Cette plante préfère une exposition au plein
soleil, mais peut pousser sur une large gamme de sols secs (dunes de sable,
sols argileux, alcalins et calcaires, etc.), à une altitude de 0 à 1 500 mètres
(0 à 4 921 pieds) au-dessus du niveau de la mer.
Ecologie / Espèce invasive : Elle prospère dans les zones
tropicales semi-arides à subhumides. Elle est une espèce envahissante majeure
en Australie, dans certaines parties de l'Afrique tropicale, Hawaï et d'autres
îles de l'océan Pacifique telle que la Nouvelle-Calédonie. En
Nouvelle-Calédonie, le Code de l'environnement de la Province Sud interdit l’introduction
dans la nature de cette espèce ainsi que sa production, son transport, son
utilisation, son colportage, sa cession, sa mise en vente, sa vente ou son
achat.
L’Épine de Jérusalem forme des fourrés denses, empêchant l'accès des
cours d'eau aux humains, aux animaux indigènes et au bétail. Le feuillage est
rarement brouté par le bétail en raison des épines. Le gousses flottent
et la plante se propage par la chute des gousses dans l'eau qui s'étalent en
aval lors des inondations saisonnières.
Lutte biologique : Plusieurs méthodes de contrôle sont utilisées pour réduire la population
existante et la propagation de P. aculeata en Australie. Trois
insectes y ont été introduits pour la lutte biologique : les bruches du Parkinsonia : Penthobruchus germaini et Mimosestes ulkei, dont les
larves mangent spécifiquement les graines de Parkinsonia et se révèlent être un
outil de gestion utile, et la punaise des feuilles de Parkinsonia, Rhinacloa callicrate, qui
détruit les tissus photosynthétiques mais n'a aucun impact sur les mauvaises
herbes. Le feu est efficace pour détruire les jeunes arbres ; l'enlèvement
mécanique et les herbicides sont également utilisés.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine_de_J%C3%A9rusalem,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinsonia_aculeata
c) http://www.hear.org/pier/species/parkinsonia_aculeata.htm
|

|

Fleurs, feuilles et gousses
|
|

Gros plan sur les fleurs de Parkinsonia aculeata
|

Parkinsonia aculeata

Fleurs
|

Épines sur Parkinsonia aculeata
|
|

Arbuste.
|

Épines sur Parkinsonia aculeata
|

Feuilles
|

Feuilles
|
|
|
|
|
|
(Famille des Fabaceae ou des Mimosoideae, selon
la classification choisie).
Risque élevé, score: 19 (source HEAR).
|
  
|
U ↗↗
|

|
Arbuste ou arbre épineux, originaire du Mexique, d’Amérique du Sud et
des Caraïbes,
il peut atteindre une hauteur de 12 m et son tronc peut atteindre un diamètre
supérieur à 1,2 m.
Note : Appelé, en espagnol, bayahonda
blanca ou mesquite (nom
pour plusieurs espèces de plantes légumineuses du
genre Prosopis
des zones arides et semi-arides du sud des USA, du Mexique et du sud
et de l’ouest de l’Amérique
du Sud).
Espèce invasive : Il est devenu une plante
envahissante en Afrique, Asie, Australie et
ailleurs.
La prolifération des « mesquites » est accusée de
contribuer à l’abaissement du niveau de la nappe
phréatique. Pour cette raison, un procédé de gestion de la perte de l’eau,
dans les zones arides, est l’élimination des « mesquites ».
Habitat / écologie : Le « mesquite » est
extrêmement robuste. Il est tolérant à la sécheresse,
pouvant tirer l’eau de
la nappe
phréatique (phreatophyte)
grâce à sa longue racine
pivotante (enregistré jusqu’à 58 m de profondeur). Il peut également
utiliser de l’eau dans la partie supérieure du sol, en fonction de sa disponibilité
et peut facilement passer d’une source d’eau à l’autre. « Prairies,
zones arbustives, forêts sèches. Cet arbre, résistant à la sécheresse, aux sols
gorgés d’eau, et au sel, fixe l’azote. Il a des racines profondes. Il forme
rapidement des fourrés épineux denses qui réduisent la richesse des espèces
indigènes. Il envahit les prairies qui sont transformées en forêts et espaces
boisés. La perte de la couverture herbeuse sous son couvert peut favoriser l’érosion
des sols. Il supporte bien les dommages [résiste à la mutilation] »(Weber,
2003, p 344).
« Producteur prolifique de semences, ses graines sont
dispersées par l’eau et les animaux » (Weber, 2003 ; p. 344).
Le verger à graines de Mitsinjo, région Sud-Ouest de Madagascar,
possède du Prosopis juliflora (source : FOFIFA).
Usages : L’espèce est source de fourrage, de bois et
utilisé pour fixer les dunes et fertiliser les sols. Les gousses sucrées sont
comestibles et nutritives, et ont été une source de nourriture pour les peuples
autochtones du Pérou, du Chili et de la Californie. Elles peuvent être stockés,
consommés crus, bouillis ou fermentés pour en faire une boisson légèrement
alcoolisée. Ses fleurs fournissent une source
de nectar avec lequel les abeilles font le miel de mesquite, à
la saveur caractéristique.
Sources :
a) http ://fr.wikipedia.org/wiki/Prosopis_juliflora,
b) http ://en.wikipedia.org/wiki/Prosopis_juliflora,
c) http ://www.fofifa.mg/presentation_drfp.php,
d) http ://www.fao.org/docrep/006/ad317e/AD317E02.htm,
e) http://www.hear.org/pier/species/prosopis_juliflora.htm, f) http://en.wikipedia.org/wiki/Mesquite
Prosopis chilensis, Prosopis juliflora et Prosopis
pallida ont été largement introduit dans les zones arides tropicales,
où ils sont devenus naturalisés et envahissants. Il ne toléré pas bien le gel.
Espèce envahissante : Prosopis chilensis, atteignant
18 m, peut croître de 3 mètres de haut par an et tend à rapidement coloniser
toutes les plaines du Nord au Sud de la Corne de l'Afrique,
menaçant en une vingtaine d'années les activités nomades et maraîchères. Cette espèce
progresse depuis rapidement en Afrique de l'Est, au détriment de l'acacia qui abritait une
partie importante de la biodiversité de
ces régions.
Usages : Certains plants visant à freiner l'avancée du désert
ont été importés du Chili (à Hanlé à Djibouti par exemple). Les
ONG Djibouti
Nature et Decan tentent
d'en abattre de grandes quantités pour en faire du charbon de bois. Il produit
des fruits dans les années de sécheresse. Son fruit est sucré et riche en vitamines, mais n'est pas ou
mal digéré en l'état par les herbivores en raison de sa cuticule résistante. Il
est question d'en faire une farine pour
l'alimentation humaine.
L'Éthiopie envisage
de le tester comme agrocarburant2. Son bois
dense (densité =
0,76), difficile à travailler, est utilisé pour les portes et les planchers. On
fait de farine avec ses fruits. On fait du sirop et des boissons
alcoolisées, avec ses fruits écrasé.
Note : En Amérique du Sud, il est souvent appelé « caroubier »
(algarrobo), en raison de sa ressemblance avec ce dernier, alors que ces deux
espèces sont bien distinctes.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosopis,
b) http://es.wikipedia.org/wiki/Prosopis_chilensis
|
(Famille des Fabaceae ou des Mimosoideae, selon
la classification choisie).
Risque élevé, à rejeter, score: 20.
|
  
|
U ↗↗
|

|
Arbre épineux des zones les plus sèches, proches la côte
Sud-Américaine.
Usages : Prosopis pallida est une bonne plante
apicole. Son bois est utilisable comme matériau, ainsi que dans la fabrication
de charbon de bois. Les fruits très nutritifs et sucrés, permettent la
fabrication d'un sirop, appelé algarrobina, utilisé dans
la cuisine Péruvienne. Son feuillage peut servir de fourrage pour le bétail.
Comme beaucoup d'espèces du genre Prosopis, cette espèce
pousse vite et facilement et peut vivre pendant plus d'un millénaire. Elle
permet de repeupler un milieu. Il fait un bon arbre d'ombrage, et son bois
dur est une source de bois de chauffage et de charbon
de bois. Ses gousses peuvent être utilisés comme fourrage par le bétail,
farine ou être transformées en mélasse ou
utilisés pour faire de la bière. Ses
fleurs jaunes lumineuses attirent les
abeilles, qui produisent un miel blanc
convoité.
Espèce envahissante : "Par ses épines et de ses
branches tombantes, P. pallida peuvent aussi bloquer physiquement le passage
des personnes et des animaux. Ses racines profondes privent d'eau, les plantes
à racines peu profondes" (Motooka et al ., 2003 ).
C’est un producteur prolifique de semences. P. pallida est une plante envahissante,
dans plusieurs endroits dans le monde (en particulier en Afrique).
Autres noms : kiawe commun, caroube
huarango et caroube américain. En Amérique du Sud, il est souvent
appelé « caroubier » (algarrobo), en raison de sa ressemblance avec
ce dernier, alors que ces deux espèces sont bien distinctes.
Sources : a) http://www.hear.org/pier/species/prosopis_pallida.htm
,
b) http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosopis_pallida,
c) http://en.wikipedia.org/wiki/Prosopis_pallida
|

|

|

|
|

|

Grume de P. pallida (Pérou).
|

|

La plupart des espèces d’Atriplex résistent à la sècheresse et à
la salinité, mais beaucoup sont invasives, comme celles-ci-dessous. Et donc
elles ne sont pas ou ne seraient pas à recommander :
Atriplex aucheri
Atriplex centralasiatica
Atriplex dimorphostegia
Atriplex eardleyae
Atriplex fera
Atriplex holocarpa
Atriplex hortense
Atriplex leptocarpa
Atriplex micrantha
Atriplex muelleri
Atriplex oblongifolia
Atriplex patens
Atriplex polonica
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Atriplex pseudocampanulata
Atriplex rosea (arroche rouge).
Atriplex schugnanica
Atriplex semilunaris
Atriplex sibirica
Atriplex sphaeromorpha
Atriplex suberecta (peregrine saltbush)
Atriplex sagittata
Atriplex tatarica
Source : http://www.cabi.org/isc/search/?q=Atriplex&page=3&s0=0&s1=10
Note : Mais l'arroche halime, pourpier de mer ou arroche
marine (Atriplex halimus) et Atriplex lentiformis, que nous avons
décrits, plus haut dans notre ouvrage, comme plantes utiles, ne sont pas
considérées comme envahissantes.
|

Atriplex semibaccata
|

Cuvettes semi-circulaires plantées d’Atriplex halimus.
|
Le genre Tamarix (de tamaris, cèdre
salé) est composé d'environ 50 à 60 espèces de plantes à fleurs de la famille des Tamaricaceae, originaires des régions plus sèches d'Eurasie et d'Afrique. La plupart des espèces de tamaris _ de
petits arbres ou arbustes, souvent décoratifs _ résistent à la sècheresse et à
la salinité, mais beaucoup sont invasives, comme celles-ci-dessous. Et donc
elles ne sont pas ou ne seraient pas à recommander :
•
Tamarix parviflora (tamaris à petite fleur)
•
Tamarix canariensis (tamaris des Iles Canaries)
•
Tamarix gallica (tamaris commun ou tamaris de
France)
•
Tamarix chinensis (tamaris à cinq étamines)
•
Tamarix ramosissima (Saltcedar) (Tamaris d’été).
•
Tamarix aphylla (Athel) (voir ci-dessous).
Source : http://www.cabi.org/isc/search/?q=Tamarix
Notes : a) On peut trouver le Tamarix galica, avec
ses fleurs blanches, au bords des oueds (en Algérie etc.).
b) Les espèces suivantes Tamarix balansae, Tamarix pauciovulata,
Tamarix articulata, Tamarix gallica ssp. nilotica, à l'état adulte, supportent,
sur des sols sableux, des eaux présentant une teneur en Cl correspondant à 10
gr NaCl/litre.
c) les Tamarix génèrent souvent des écosystèmes sources de vie
dans le déserts.
d) Une population de chacune des deux espèces, T. aphylla et T.
meyeri et des plantes provenant de cinq spécimens de T. gallica
réussis ont été comparés. Les taux de croissance et la capacité de survie d'un
clone de Tamarix gallica étaient plus élevés que dans les autres clones
tous testés . La hauteur moyenne des plantes du clone de celle-ci était
d'environ 60% supérieure à celle des autres clones. Tamarix gallica
comprenait également des variétés avec une capacité de survie plus élevé. Trois
ans après la plantation, 73% des plantes de l'un de ses clones ont survécu,
alors que la survie des autres clones tous se situait entre 23,1 et 46,2%.
Source : Biology of halophytes, Yoav Waisel, Academic Press, 1972.
Plante invasive (exemple) : Tamarix
ramosissima, naturalisé et devenu une importante espèce
végétale envahissante dans les habitats riverains spécifiques du sud-ouest
des États-Unis et de la Californie, peut modifier le régime des crues par les grands barrages.
Usages : La plupart des espèces de Tamarix sp. résistent
au vent, brouillard salin, aux tempêtes de sable, et peuvent servir comme
un brise-vent efficace. Source : Biology of halophytes, Yoav
Waisel, Academic Press, 1972.
Ils fournissent un bon bois de feu. Il suffit de les tailler
régulièrement. Il faut une bonne gestion du bois de feu, avec une rotation des
coupes pour faire durer la ressource en bois (et donc la rendre durable).
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarix,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Tamarix,
c) L’utilisation des eaux salées au Sahara, P. Simonneau, G.
Aubert, Ann. agron., 1963, 14 (5), 859-872, page 866, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_08-09/11033.pdf
d) Désert Libyque : Genèse d'un écosystème autour de Tamarix, http://naturnet.free.fr/html/desert/Tamaris.html

Tamarix gallica en fleur, sur des dunes en bord de
mer © Meneerke Bloem.
Taxon à vérifier. Synonyme : Tamarix
gallica ssp. Nilotica (à vérifier).
Poussant jusqu'à 3 m (10 pi)
de haut et de large, c'est un petit arbre à feuilles caduques avec des
branches arquées presque noires et de minuscules feuilles ressemblant à des
écailles disposées le long des branches. Des grappes de fleurs rose pâle
sont produites à la fin du printemps. Cette plante est particulièrement
associée aux zones côtières tempérées, mais peut également être cultivée à
l'intérieur des terres dans une position ensoleillée avec une protection contre
les vents d'hiver. Il supporte le sel, les sols pauvres et sablonneux.
Présent en région PACA, France.
Sources : a) https://en.wikipedia.org/wiki/Tamarix_tetrandra,
b) Tamaris d’Afrique, http://nature.jardin.free.fr/arbuste/ft_tamarix_af.html,
c) Tamaris d’Afrique (Tamarix africana), https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
|

Tamarix africa en fleur.
|

Tamarix africa en fleur (© Nature jardin).
|

Tamarix africa en fleur fleur (© Nature jardin).
|

Tamarix africa (à vérifier ?) situé à Diama à
St-Louis, au Sénégal, sur un milieu aride et sec.
C’est un arbre à feuilles persistantes, à couronne étalée dense, 8 - 12
mètres de haut, voire 18 m. Son tronc peut avoir 60-80 cm de diamètre.
Aire de répartition : Il est répandu en Afrique, dans les
zones plus sèches de la Mauritanie et du Sénégal à travers l'Afrique du Nord à
la Somalie et au Kenya. Mais aussi dans la Péninsule arabique, au Pakistan
et en Inde.
Habitats / écologie : Garrigue côtière dans des sols salins. Oueds
dans les régions désertiques chaudes, dans les habitats salés et
non salés. Sol et dunes de sable, sebkha, canaux, bords de rivières, désert
salé, champs, à des altitudes de 200 à 400 mètres. Un arbre des
régions tropicales et subtropicales arides et semi-arides, où il se trouve
jusqu'à une altitude de 1400 mètres. Il pousse mieux dans les régions où
les températures diurnes annuelles vont de 27 à 40 °C, mais il peut tolérer
8-50 °C. Les jeunes pousses peuvent être gravement endommagé à -1 °C. Il
préfère une pluviométrie annuelle moyenne de l'ordre de 300 - 400 mm, mais
tolère 200 - 500 mm. Il préfère un pH dans la gamme 6.5 à 7.5, mais il tolère 6
à 8,5. Ces arbres produisent un système racinaire profond et étendu, allant
d'environ 10 mètres de profondeur et 34 mètres horizontalement. Il pousse bien
dans les sols argileux lourds ainsi que dans les sables et même dans les
galets. Il pousse plus vigoureusement sur des terres exposées aux inondations
occasionnelles, que sur les terres jamais inondées. Il résiste au feu.
Usages : L’arbre, à l'état sauvage, est récoltée pour la
nourriture, la médecine, les tanins et le bois, utilisés localement. Il
est parfois cultivé pour fournir un abri près de la côte et également comme
plante ornementale. Il peut servir de pare-feu.
Plante invasive : T. aphylla peut produire de
nombreuses graines qui peuvent se propager sur une grande étendue, par le vent
et l'eau. Il peut se propager rapidement et former des fourrés étendus et
denses. Il peut évincer les espèces riveraines indigènes, diminuer l'habitat de
début de succession, et réduire les nappes phréatiques et interférer avec le
processus hydrologique. Il excrète du sel qui élimine les plantes indigènes
sous les peuplements de cet arbre. Très invasif en Australie.
Sources : a) http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Tamarix+aphylla,
b) http://www.cabi.org/isc/datasheet/52483,
c) http://www.hear.org/pier/species/tamarix_aphylla.htm, d) http://en.wikipedia.org/wiki/Tamarix_aphylla
Description : Encore appelé Rtem (en
arabe), c’est un arbuste monoïque pouvant former d'épais buissons et atteindre
6 m de haut. Les jeunes sont soyeux d'un vert argenté à gris argenté. Une
nuée de minuscules fleurs blanches (+ ou -1cm) semblables à des fleurs de pois
sont réparties sur de courts racèmes (grappes). La
floraison est longue : elle va de la fin hiver à début du printemps selon
le climat (et le lieu), très parfumée. Le fruit est un petit légume (une gousse) court, contenant une
graine toxique, parfois deux. Elles contiennent de la cytisine, un alcaloïde toxique.
Plante invasive : Hors de son aire méditerranéenne, c'est
une espèce
envahissante, interdite dans certains pays (Australie, Etats-Unis).
Habitat / écologie : Il affectionne les sols pauvres (grâce
aux nodosités à Rhizobium, il synthétise des composés azotés). Il
demande un sol surtout très bien drainé même sablonneux à forte salinité.
C'est un végétal couramment utilisé pour fixer les dunes. C'est une plante de
soleil, voire de mi-ombre. Cette plante ne tolère pas le gel, sauf de courtes
expositions ne dépassant pas - 6 °C. Ceci l'exclut de la région méditerranéenne
française comme plante fixatrice de dunes de sable.
Usage : Ses belles fleurs blanches en ont fait un arbre
recherché par les fleuristes. Il faut chercher là l'origine de sa dispersion
mondiale et de son introduction comme plante d'ornement. Plante adaptée aux
jardins secs.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Retama_monosperma,
b) https://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret/Visite-virtuelle/Parcours-Plantes-aromatiques/Plantes-a-parfum/Retama-monosperma
La typha est un « roseau » (une massette), jusqu’à 2,5
m de hauteur, poussant en abondance sur les rives de certains fleuves africains.
Typha domingensis (ou Typha autralis) se trouve parfois en tant qu'associé
sous-dominant dans les écosystèmes de mangroves tels que l'écorégion de mangroves
Petenes du Yucatán.
Plusieurs espèces de Typha résistent bien au sel : Typha
angustifolia (Massette à feuilles étroites), Typha latifolia
(massette à large de feuille), Typha domingensis …
Caractère invasif : Le Typha autralis (ou Typha domingensis)
est invasif sur le fleuve Sénégal, en Mauritanie, en Nouvelle-Calédonie
(son introduction y est interdite) etc.
Usage : a) Les massettes sont comestibles, en particulier
son rhizome charnu cru (salade, confit dans le vinaigre) ou cuit après avoir
été pelé, et ses très jeunes pousses.
b) Production de "charbon de typha" : A Saint-Louis, le Bureau
de Recherche et d’Action pour le Développement Solidaire (BRADES),
développe un projet de fabrication de briquettes de biocharbon à partir
de Typha. Celle-ci est ramassé puis brûlé et réduit en poussière de charbon.
Cette poussière de charbon est ensuite mélangée avec un rotor à de l’eau et à
de l’argile, pour en faire un combustible qui ressemble en tous points à du
charbon de bois. Après avoir séché durant deux à trois jours, il est ensuite
vendu par des associations de femmes de Saint-Louis sur les marchés.
A l’achat, ce biocharbon est deux fois moins cher que le charbon de
bois. Il coûte 150 francs CFA, soit 0,23 € le kilo. Sa combustion est plus
longue que celle du charbon conventionnel. Mais la population éprouve encore
quelques réserves sur ce nouveau produit, commercialisé depuis novembre dernier
: plus difficile à allumer que son prédécesseur, le biocharbon ne fait
pas encore l’unanimité. Des campagnes d’informations seront donc lancées au
cours de l’année 2009. c) En plus, le biochar (le charbon vert ou
biocharbon) peut aider à fertiliser les sols (quand il est mélangé à la
terre). d) La typha peut aussi servir de matériau d’isolation. e)
Elle peut servir à la phyto-épuration d’eaux polluées.
f) Elle sert de refuge à un certains animaux (oiseaux …).
Note : Adresse de BRADES, directeur Mr Nthié DIARRA,
Quartier Ndiolofène Sor, Saint- Louis, Tel : 776412149. Email : bradesenegal@yahoo.fr
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Typha,
b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Massette_%C3%A0_larges_feuilles,
c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Massette_%C3%A0_feuilles_%C3%A9troites,
d) https://fr.wikipedia.org/wiki/Typha_domingensis, e) https://en.wikipedia.org/wiki/Typha_domingensis,
f) http://www.transition-energie.com/senegal-du-charbon-vert-a-partir-dun-roseau/,
g) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/09/en-mauritanie-une-plante-nuisible-devient-source-d-energie_4750054_3244.html, h) http://www.agenceecofin.com/innovation/1208-31313-senegal-vers-un-destin-dans-le-batiment-pour-3-milliards-de-tonnes-de-typha,
i) http://www1.rfi.fr/sciencefr/articles/115/article_82336.asp,
j) http://www.peracod.sn/?Le-BRADES-entreprise-basee-a-Saint
k) http://www.nepad.org/system/files/BRADES.pdf
(taille 991 Ko).
l) http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2020/02/2019_rapport_etat-des-lieux_methodes-lutte-typha-dfs-002.pdf
|

Invasion de la Typha, depuis la mise en service,
en 1986, du barrage sur le fleuve Sénégal.
|

Production du biocharbon avec le Rotor Presstype (©
Brades) (un compacteur ou presse).
|
|
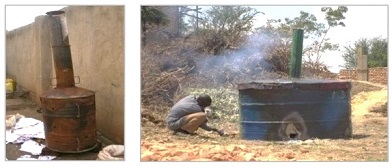
Deux technologies pour la pyrolyse de la Typha. ©
ARTI-TZ.
|

|
|
(Famille des Poaceae).
Risque élevé.
|
 
|
↗
|

|
Cette graminée tropicale vivace est originaire des hautes terres
de l'Afrique
orientale.
Plante invasive : Elle forme un tapis vert, doux et dense.
En raison de sa croissance rapide et de sa nature agressive, elle est classée
comme une mauvaise
herbe nuisible dans certaines régions (Hawaï …). À Hawaii "son
étouffement, sa croissance dense, empêche pratiquement tout nouvel
établissement de semis" (Wagner et al , 1999;. pp. 1578-1579).
Usages : Cependant, elle est aussi populaire pour les pelouses de
jardin en Australie, Afrique
du Sud et en Californie du Sud, car elle est bon marché et tolérant
à la sécheresse. Elle est très utilisée comme gazon dans la région méditerranéenne.
En outre, elle est utile comme fourrage d’excellente qualité pour le bétail et
sert de source de nourriture pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont l’Euplecte à
longue queue.
Description : Les tiges de fleurs sont très courtes et «
cachées » dans les feuilles, ce qui explique qu’on a donné, à cette espèce, son
épithète spécifique (clandestinum). L’important système racinaire
de cette plante, la propagation par ses puissants rhizomes sous terre, en
particulier par de longs stolons sous le sol, et par ses graines la rend très
envahissante, mais très utile pour la fixation des sols et permet aussi le
bouturage. Sa pousse est lente la première année, ce qui favorise le
développement des mauvaises herbes,
mais une fois installée, elle monopolise la totalité du terrain et devient
envahissante, surtout quand elle se plait sur un terrain. Sa dormance hivernale lui
donne une apparence de paille séchée
(jaunit l'hiver). Apparenté au chiendent, il ne pousse que
dans les régions où la température estivale est élevée. Elle s'adapte très bien
en bordure de mer et supporte un environnement salin.
Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pennisetum_clandestinum,
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pennisetum_clandestinum,
c) http://www.cabi.org/isc/datasheet/39765,
d) http://www.hear.org/pier/species/pennisetum_clandestinum.htm,
e) http://agroecologie.cirad.fr/content/download/7957/40543/file/Fiche%20technique%20GSDM%20342%20kikuyu%20v%202012%2004%2025%20finale.pdf
|

|

|

Soja sur couverture vive de kikuyu.
|
Herbacée érigée, vivace, à rhizome, de 0,7 m de haut, avec un feuillage
bleu-vert et racines traçantes. Les nouvelles pousses de bourgeons racinaires [rhizomes]
créent souvent des taches denses de plantes.
Habitats : bords des routes, champs irrigués, cours d’eau,
zones humides, fossés de drainage. Il pousse le mieux sur les sols cultivés et infeste
souvent les sols alcalins ou salins, poussant plus facilement dans les
zones perturbées, sur les terres cultivées, et le long de la route. Il persiste
naturellement en faibles densités dans les prairies indigènes, mais se
développe dans les zones cultivées ou fortement perturbés.
Plante envahissante : C’est souvent une mauvaise herbe nuisible,
un tournesol agressif, même dans une grande partie de son aire d’origine _ les
prairies du centre-sud des États-Unis et nord du Mexique.
La « vipérine texane » [ou herbe bleu texan] est très
concurrentielle de plusieurs cultures et systèmes de culture y compris le
coton, le blé et le sorgho. Elle est une « classe A » de mauvaises
herbes nuisibles en Californie.
Lutte (non biologique) : La lutte contre la plante se fait
souvent avec l'herbicide Dicamba ou le N-nitrosodiméthylamine (NDMA).
Reproduction : Sa stratégie de reproduction est
principalement végétative, par des bourgeons racinaires [rhizomes] sur les
racines latérales. Les études de semences de la « vipérine du Texas »
ont montré moins de 1% du total des graines produites sont viables. Néanmoins,
les semences vipérine ont peut-être atteint la Californie, via des luzernes et
de l’avoine contaminées, cultivées au Texas.
Confusion possible : A ne pas confondre avec le tournesol
de l'Arizona (Helianthus arizonensis), une plante mal connue
(source : https://nmrareplants.unm.edu/node/94).
Sources : a) http ://en.wikipedia.org/wiki/Helianthus_ciliaris,
b) http://www.cdfa.ca.gov/plant/ipc/weedinfo/helianthus.htm,
c) http ://www.cabi.org/isc/datasheet/26715
Fonte des
semis
C’est probablement la maladie de pépinière la plus connue, qui est
causée par plusieurs espèces de champignons, particulièrement le Pythium,
les Rhizoctonia, les Phytophthora et le Fusarium. La fonte
des semis peut apparaître sur la graine avant la germination ou sur les jeunes
plants.
Quand cela se produit, la tige de la plantule est réduite juste
au-dessus de la surface du substrat de germination ; alors, la plantule tombe
et meurt. (Des fois ceci peut se passer sans qu’il y ait présence d’un
champignon, par exemple, avec des températures élevées du milieu de
propagation). Il y a souvent (mais pas toujours) dommage à la plante en dessous
de la surface du sol.
La raison des symptômes apparaissant à la surface du sol n’est pas bien
connue, mais ceci peut être lié au point où les plants commencent à
photosynthétiser ou peut-être dû aux conditions aérobiques et/ou anaérobiques
conduisant aux stages les plus virulents du cycle de vie du champignon.
Les pathogènes qui causent la fonte des semis, particulièrement le Pythium,
les Rhizoctonia et les Phytophthora, peuvent se répandre dans
l’eau d’irrigation. La densité élevée des plantes, l’excès d’arrosage et
l’excès d’ombrage favorisent la propagation de la maladie et doivent être
évités.
Eau d’arrosage
L’eau pour l’arrosage en pépinière vient souvent d’un barrage, un puits
ou une citerne remplie d’eau de pluie. Ces réservoirs où l’eau stagne offrent
des conditions excellentes pour le développement de champignons de moisissure
d’eau, comme les espèces de Pythium et de Phytophthora, qui sont souvent
associées à la fonte des semis.
Une petite quantité de chlore pour obtenir une concentration de 1 ppm
pendant au moins 30 minutes peut être ajoutée à l’eau d’arrosage pour contrôler
les champignons. (L’eau de piscine a une concentration maximale de 8 ppm de
chlore disponible).
|
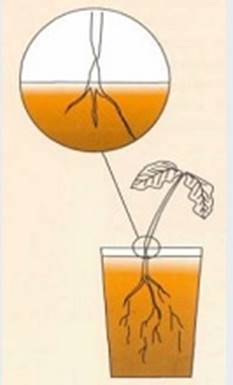
|
Désinfecter l’eau d’arrosage
L’eau de javel a habituellement une concentration de 3,5 %, soit 35
000 ppm de NaOCL. Elle contient 24 000 ppm de chlore (Cl2). Pour
faire 1L de dilution de 1 ppm de Cl2, on a besoin de 0,042 ml (ou
42 ml) d’eau de javel ménagère. Pour un seau de 20 L, il faut 20 x 0, 042 =
0, 84 ml. Une citerne de 10 000 litres aura besoin de 420 ml. Si l’eau
contient beaucoup de sédiments ou d’autres particules sales, on aura besoin
du double d’eau de javel ménagère. Dans tous les cas, la quantité dont on a
besoin pour traiter l’eau d’arrosage pour contrôler les maladies comme la
fonte des semis est très faible, ce qui rend l’hygiène de la pépinière peu
coûteuse et simple.
Source : Bonnes pratiques de culture en pépinière forestière.
Directives pratiques pour les pépinières de recherche. MANUEL
TECHNIQUE n°3, Hannah JAENICKE, WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF), http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/mn14474.pdf
|
Acidiphile : Qualifie une espèce ou une végétation se
développant sur des sols acides.
Allochtone :
désigne des espèces d'origine
étrangère au biome local.
Il s'agit le plus souvent d'organismes introduits par l'homme, soit
volontairement, dans une perspective économique ou esthétique, soit
accidentellement. Terme opposé à celui d'autochtone.
Anémochore : Qualifie un mode de dispersion des graines par le vent (pissenlit …).
Autochtone : Au sens courant, autochtone qualifie ce qui
habite en son lieu d'origine. Il désigne le caractère local d'une espèce
(animale, végétale, fongique…). Equivalent à « indigène ».
Biome : ensemble d'écosystèmes caractéristique
d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et
des espèces animales qui
y prédominent et y sont adaptées. Il est appelé aussi macro-écosystème, aire
biotique, écozone ou écorégion.
Caduc : (Botanique) Se dit d’un organe (feuilles …) se détachant et tombant chaque année.
Calcicole ou calcicline ou calcaricole
: plantes préférant les sols calcaires (Origan …).
Cortège floristique : Ensemble des espèces de plantes
caractérisant un habitat donné.
Décidu : (Botanique) Synonyme de caduc.
Edaphique : ce qui a trait à un facteur écologique lié au
sol (pH, humidité, etc.). Ce qui se rapporte au sol.
Euryèce : plante pouvant supporter d'importantes
variations vis-à-vis de facteurs écologiques, tels que la température (on
dit que l'espèce est eurytherme),
ou la salinité (euryhalin)...
Eutrophe : Milieu riche en éléments nutritifs minéraux.
Exogène : Qui provient de l’extérieur, du dehors
(Wiktionary). Le terme exogène est parfois utilisé dans le langage courant comme
synonyme d'étranger, par opposition à indigène
(Wikipedia).
Halophile: plante tolérante à l'air marin. Qui pousse
naturellement dans les terrains imprégnés de sel.
Héliophile : plante ayant besoin de lumière. Note
: la plupart des plantes invasives sont héliophiles.
Hygrophile : plante se développant de préférence dans des
milieux humides.
Indigène : caractère plus ou moins autochtone ou
non d'une espèce ou d'un taxon (genre, famille…). Selon une définition stricte,
ne seraient pas indigènes toutes les espèces qui n’auraient jamais pu atteindre
la région étudiée, sans les activités humaines (Pyšek, 1995).
Nitrophile : Qualifie une espèce végétale croissant
préférentiellement sur des sols riches en éléments azotés (Ortie …).
Ombrophile : voir sciaphile.
Pionnière (Espèce) : espèce capable de coloniser
un milieu instable, très pauvre en matière organique et aux conditions
édaphiques et climatiques difficiles : sol très fin ou inexistant, absence
d’eau, forte chaleur, etc. Note : Presque toutes les plantes invasives
sont pionnières.
Plante parasitaire non-chlorophyllienne : Qualifie une
plante ne produisant pas sa propre matière organique par le biais de la
photosynthèse mais parasitant d’autres individus pour la lui fournir.
Sempervirent : « à feuillage persistant », qui reste
toujours vert ou toujours fleuri.
Sciaphile : plante qui supportent l'ombre.
Syntaxon : Unité de classification phytosociologique.
Ubiquiste : Se dit des espèces animales et végétales que
l'on rencontre dans des milieux écologiques très différents (Larousse).
Xérophile : plante adaptée à la sécheresse.
Sources : « Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales »,
Jean-Marie Géhu, 2006.
Les sols et l'habitat, les arbres, http://www.lesarbres.fr/sol.php
Alignement de pierres : seule rangée de pierres plantées
dans le sol pour ralentir le ruissellement, piéger des particules (limon et
matière organique) transportées par le ruissellement, ainsi que des sables
éoliens.
Baissière (ou swale ou noue d'infiltration) : sorte de
fossé peu profond et large, végétalisé, tracé le long des courbes de niveau et
qui recueille provisoirement de l’eau. Cet ouvrage permet de capter les eaux de
ruissèlement et de les infiltrer dans le sol progressivement pour les y stocker.
Les talus de celles-ci sont plantés d’arbres (forêt fruitière et même quelques
légumes) qui bénéficient de la présence d’eau quasi-constante en sous-sol.
Source : https://chemincueillant.wordpress.com/tag/fruitiers/
Banquette anti-érosive : très grande demi-lune,
présentant un bourrelet non franchissable, un gradin et un fossé. La banquette
finie mesure 80 ml et 70 cm de profondeur.
Billon (Agriculture) : Ados plus ou moins large et bombé
qu’on forme dans un terrain avec la charrue. Bourrelet de terre.
Citerne : Une citerne est un
aménagement, généralement souterrain, destiné à la collecte des eaux de pluie et à
leur rétention afin d'en permettre une utilisation régulière, quotidienne (bien
souvent domestique à l'origine), ou une exploitation plus exceptionnelle en cas
de sécheresse ou
d'incendie. Lorsqu'il est à l'air libre on parle aussi de réservoir.
Cordons pierreux : petits murets de pierre de 25 cm de
haut construits suivant les courbes de niveau de la parcelle.
Déversoir ou Exutoire : a) Orifice par où s’écoule le trop-plein d’une conduite ou d’un réservoir d’eau. b) Tout dispositif qui sert
à juguler un excédent. c) Ouvrage
au-dessus duquel s'écoulent les eaux d'un canal, d'un cours d'eau, d'un
barrage, etc. (Larousse).
Digues filtrantes : Ouvrage pierreux, poreux, construit
au travers d’une zone de ruissellement fort, permettant l’épandage des crues et
la protection des terres situées en aval.
Demi-lune (demi-cuvette) : diguette en forme de demi-lune
(diamètre de 2 m à 6 m) qui permet de concentrer le ruissellement et sa charge
en suspension sur des arbustes ou des cultures en poquets.
Foggara : canalisation souterraine construite pour
alimenter les jardins dans les palmeraies, lorsqu’il n’est pas possible de
creuser des puits.
Gabions : cages métalliques remplies de pierres. Le but
de cette technique est de combattre l’érosion hydrique en laissant passer à
travers ces structures l’eau tout en retenant les matières contenues dans le
sol. C’est une barrière semi-perméable qui, placée en aval d’une ravine,
empêche l’érosion hydrique. De plus, leur souplesse leur permet d’éviter les
cassures.
Impluvium : système de captage et de stockage des eaux
pluviales, composé d'une aire de captage, d'un système de
transport, d'une « réserve » enterrée ou hors sol (bassin,
réservoir, cuve, citerne, etc.).
Jessour (singulier jesser) : petites digues en
terre (ou en pierre), construites en série dans les vallées secondaires pour
capter le ruissellement et sa charge solide.
Johad : cuvette de stockage des eaux de pluie,
recueillant et stockant l'eau tout au long de l'année, à des fins de
consommation par les humains et le bétail.
Joub : réservoir souterrain.
Lavogne : dépression sur
les terres de causses (au
sens de terres « calcaires ») qui permet de boire aux animaux d'élevage. Ceux-ci ont
aménagé des creux naturels (les sotchs) en les étanchant
par un tapis argileux et en les pavant de pierres calcaires pour capter et
retenir les eaux de ruissellement.
Khettara : ensemble du dispositif de mobilisation des eaux
souterraines (Tunisie …).
Liman (en Israël) : levée (digue) artificielle
de terre, souvent en demi-lune, servant à recueillir les eaux de crue d'un
oued du désert, équipé d’un déversoir ou exutoire et d'une vanne, régulant
le niveau de l'eau.
Mankaa : terrasses de culture.
Meskat : système composée de l'impluvium ou "Meskat",
qui récolte l'eau de pluie, la superficie cultivée ou "Mankaa",
constituées de terrasses, séparées par des barrages en terre avec déversoirs de
pierres.
Mgoud : saignée destinée à détourner tout ou une partie
des eaux de ruissellement d’un bassin versant vers des champs
Murets ou murettes : deux à trois niveaux
de pierres solidaires, de 10 à 50 cm de hauteur, disposés en courbe de niveau
tous les 10 à 50 m.
Negarim : micro-bassins versants, en forme de diamant,
fermés par de petites digues de terre, avec un puits d'infiltration dans le
coin le plus bas.
Noue (ou baissière en québécois)
: sorte de fossé peu
profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement de l'eau, soit pour
l'évacuer via un trop-plein,
soit pour l'évaporer (évapotranspiration)
ou pour l'infiltrer sur place permettant ainsi la reconstitution les nappes phréatiques1.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Noue_%28foss%C3%A9%29
Qanat : ouvrage (de type minier) destiné à la captation
d'une nappe d'eau souterraine et l'adduction d'eau vers l'extérieur.
Retenue ou lac collinaire : Les retenues
collinaires sont des ouvrages de stockage de l'eau qui sont remplies
par les eaux de surface, les eaux de ruissellement. Elles peuvent être
assimilées à des micro-barrages.
Tabia : tout type de diguette en terre, construite soit
sur les versants, soit dans les ravins et les vallées pour capter le
ruissellement et sa charge solide en vue de stabiliser les terres et
d'intensifier la production des cultures. Ou barrage (en général en pierre).
Zaï ou culture en poquets : cuvette (20 cm
à 40 cm de diamètre et 10 cm à 15 cm de profondeur), captant le ruissellement à
partir d’un impluvium de 5 à 20 fois la surface travaillée.
- Acacia
cyanophylla
- Acacia
cyclops
- Acacia
salicina
- Acacia
ligulata
- Acacia
horrida
- Acacia
tortilis
- Lycium
arabicum
- Retama
raetam
- Rhus
tripartitum
- Calligonum
azel
- Prosopis
juliflora (arbre très invasif).
- Parkinsonia
aculeata
- Eucalyptus
occidentallis
- Eucalyptus
torquata
- Eucalyptus
astringina
- Atriplex
halimus (arroche halime)
- Euphorbia
basalmifera
Source : Gestion
durable des terres en Tunisie. Bonnes pratiques agricoles, TAAMALLAH
Houcine, avec la contribution de OULED BELGACEM Azaiez, HAMROUNI Hédi, NAGAZ
Kameleddine, OUCHI Hammouda, LAKHDHAR Hichem, Juin 2010, https://www.wocat.net/fileadmin/user_upload/documents/Books/Best_Practices_Tunisia.pdf

Fixation des dunes avec Euphorbia basalmifera
- Argyrolobium
uniflorum
- Hedysarum
coronarium
- Hedysarum
carnosum
- Stipa
lagascae
- Plantago
albicans (Plantain blanchissant)
- Rhanterium
suaveolens
- Peganum
harmal ? (Harmal ou rue de Syrie).
Note : Peganum harmal est une plante
stupéfiante _ ses graines renferment 3-4 % d'alcaloïdes psychotropes (harmine,
harmol, harmaline et dérivés voisins) _ et pouvant être toxique pour certains
animaux. Info à vérifier (!).
Source : Gestion
durable des terres en Tunisie. Bonnes pratiques agricoles, ibid.
1) Plantes herbacées ayant une résistance élevée au sel,
supportant des concentrations salines comprises entre 6 et 8 g de chlorures
totaux par litre : Aubergine, Artichaut, Carde, Chou, Chou-fleur, Carotte,
Navet, Bette, Épinard, Piment, Poivron, Pomme de terre, Tomate, Maïs, Fève,
Pois chiche.
2) Plantes herbacées très résistantes au sel et tolérantes,
quoiqu’assez mal, à des concentrations salines variant de 9 à 11 g de chlorures
totaux par litre : Asperge, Betterave rouge, Ail, Oignon, Radis, Poireau.
3) Arbres et arbustes résistants au sel :
a) Au Sahara, il semble que les arbres fruitiers puissent être classés
ainsi par ordre décroissant de tolérance aux sels : Palmier-dattier,
Grenadier, Figuier, Olivier ...
En particulier, le palmier-dattier supporte des salures élevées, mais
le rendement et la qualité des fruits — dans le cas de la variété Deglet
Nour — diminuent déjà lorsqu'en terrain sableux il est irrigué avec des
eaux à 5 g de résidu sec ; l'olivier est assez résistant (3 à 5 g de résidu sec
dans la solution du sol en surface, et un peu plus en profondeur).
b) Les espèces introduites Haloxylon aphyllum, Eucalyptus
occidedalis, Eleagnus angustifolius, Salsola Richteri, Parkinsonia aculeata,
expérimentées à Igli et à Adrar, ces essences ont germé et évolué normalement
sur des sols salins sableux irrigués avec des eaux renfermant jusqu’à 7 g de
chlorures par litre (Cl exprimé en NaCl).
4) Résistance au sels de certaines variétés d’acacias :
|
|
Tolérance mesurée
|
|
|
Contrainte
|
Élevée
|
Moyenne
|
Faible
|
|
Sel
|
A. albida
|
A. sieberiana
|
A. nilotica adansonii
|
|
A. dugeoni
|
A. seyal
|
A. nilotica tomentosa
|
|
A. erhenbegiana
|
|
|
|
A. raddiana
|
|
|
|
A. senegal
|
|
|
|
Naturelle (in situ)
|
A. erhenbergiana
|
A. albida
|
A. dudgeoni
|
|
A. raddiana
|
A. nilotica adansonii
|
A. sieberiana
|
|
|
A. nilotica tomentosa
|
|
|
|
A. senegal
|
|
Tableau du classement des différentes espèces d'acacia en fonction de
leur faculté à germer sous une contrainte hydrique ou saline simulée et de leur
écologie (résistance à la sécheresse in situ).
Les espèces d’acacias les plus tolérantes au sel : A. raddiana, A.
senegal et A. sieberiana.
Les espèces de sensibilité intermédiaire : A. albida, A. dudgeoni,
A. erhenbergiana et A. seyal.
Certaines de leurs graines parviennent même à germer en présence d'une
solution saline de concentration proche de celle de l'eau de mer (35 g.1-1,
soit -2,1 MPa) : 1 % des graines d'A. raddiana et 3 % des graines d'A. senegal.
Les valeurs limites sont très supérieures à celles publiées par Totey et
al. (1987) pour Acacia auriculiformis (dont la germination est
réduite dès que la concentration saline atteint 4,6 g.1-1), par
Kayani et al. (1990) pour le jojoba (réduction de 50 % de la capacité
germinative à 5 g.1-1).
Source : Effet des contraintes hydrique et saline sur la
germination de quelques acacias africains, Paul Ndour, Pascal Danthu, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010016071.pdf
5) Céréales résistantes au sel : Observées dans les
cultures locales et dans les Centres d’Etudes d’irrigation, elles ont été
classées ainsi par ordre décroissant de tolérance aux sels : Mélilot (Melilotus
alba amua), Luzerne (Medicago sativa), Cotonnier, Blé, Orge, Sorgho.
Source : L'utilisation des eaux salées au Sahara, P. Simonneau,
G. Aubert, agron., 1963, 14 (5), 859-872, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_08-09/11033.pdf
Agroforesterie : 1) mode d’exploitation des terres
agricoles associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des
pâturages. 2) Association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même
parcelle.
↙ palmiers dattiers ↘
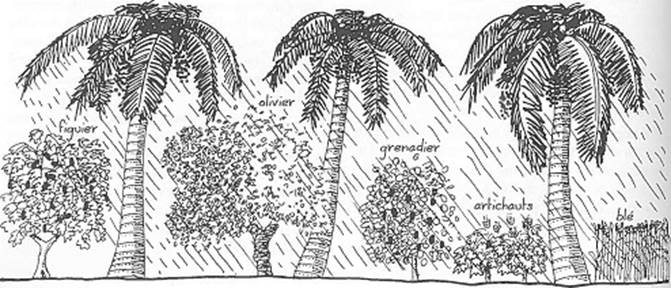
Les palmiers procurent de l'ombre aux autres arbres
(figuier, olivier, grenadier …) et cultures (blé, artichauts …). Source :
Source : Introduction à la permaculture, Bill Mollison, Ed. Passerelle
eco, 2012, page 152.
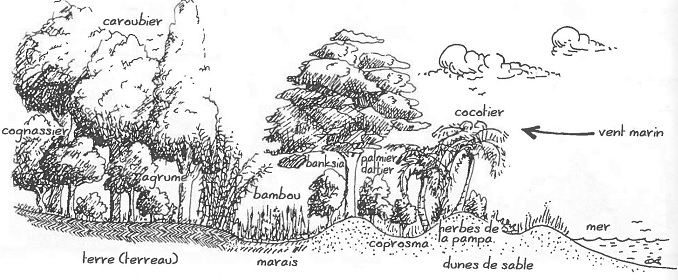
Une suite de plantations sur le littoral [climat
tropical sec à méditerranéen, sans gel]. Source : Source : Introduction
à la permaculture, Bill Mollison, Ed. Passerelle eco, 2012, page 64.
Agroforêt ou « système agroforestier » :
Il s'agit d'une forêt dont
la composition faunistique et floristique sont le fruit
d'une gestion par la ou les populations locales. L'intérêt de ces populations
est la constitution d'un cadre de vie satisfaisant leurs divers besoins, en
termes d'alimentation, de matériaux de construction, d'artisanats variés,
d'énergie, de produits médicinaux, et toutes activités sociales. Les
écosystèmes désignés comme agroforêts sont en général situés en zone
intertropicale.
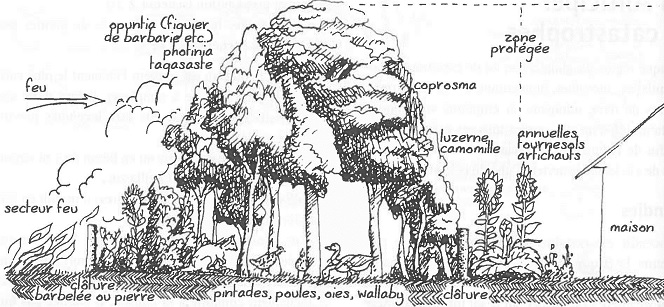
Défense contre les incendies, avec plantations et
animaux, pour petite ville ou hameau. Source : Introduction à la
permaculture, Bill Mollison, Ed. Passerelle eco, 2012, page 82.
Jardin-forêt : Un mélange d’arbres, arbustes,
arbrisseaux, plantes grimpantes, légumes annuels, biannuels et vivaces, de
champignons cultivés, qui produisent fruits, légumes, plantes aromatiques et
médicinales, bois de chauffage etc.
Jardin-verger : endroit créé et préservé par
l’homme, source de vie et de bien-être, et constitué d’un ensemble multi-étagé
d’espèces végétales utiles principalement pour l’alimentation. Il existe
différentes dénominations pour parler de jardin-verger comme jardin-forêt,
forêt-jardin, forêt fruitière, forêt comestible, etc.
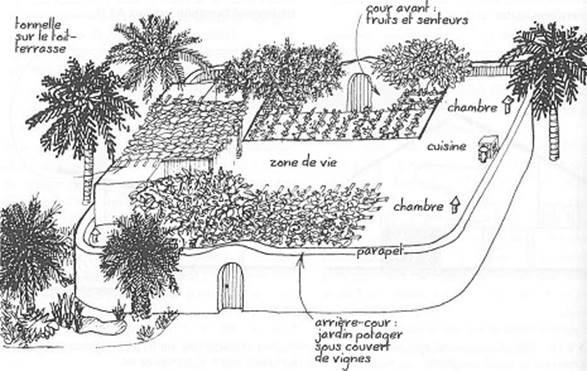
Une maison en climat aride, avec des murs épais, des
cours intérieures et des tonnelles de plantes grimpantes. Source : Introduction
à la permaculture, Bill Mollison, Ed. Passerelle eco, 2012, page 104.
Permaculture : Forme d’agriculture, créée dans
les années soixante-dix en Australie par Bill Molisson et David Holmgren,
nécessitant peu d’entretien,
grâce à l’utilisation de
nombreuses espèces de plantes complémentaires et
à l’aide des animaux sauvages, pour reconstituer un écosystème gérable
à échelle humaine. Elle signifie culture permanente et durable. Elle est un
ensemble de pratiques et de principes visant à créer une production
agricole durable,
prenant en considération la biodiversité des écosystèmes1,2, respectueuse
des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à créer un
écosystème productif en nourriture ainsi qu'en d'autres ressources utiles, tout
en laissant à la nature « sauvage » le plus de place possible.
Il faut un contrôle aux frontières, par les douanes, des importations
des animaleries, pépiniéristes, aquacultures, parc animaliers, zoos, de
particuliers.
Il faut une communication, éducation, sensibilisation, formation face
au problème, en particulier auprès des associations et du grand public.
Conseils à donner au grand public, face aux plantes invasives :
•
Se renseigner avant sur les caractéristiques de ces plantes.
•
Ne pas les acheter.
•
Ne pas les planter : préférer les plantes locales.
•
Les arracher.
•
Les couper régulièrement à la base, les tailler avant floraison.
•
Faire sécher les résidus avant de les incinérer.
•
Ne pas jeter le contenu des aquariums et les déchets verts dans les
milieux naturels pour ne pas les propager.
•
Les déposer en déchèterie.
•
Informer votre entourage des risques liés aux plantes invasives (qui
sont souvent jolies et ornementales).
Source : Je lutte contre les plantes invasives ! http://www.morbihan.fr/userfile/file/a_votre_service/envir/plantes-invas_3mo.pdf
Malheureusement, dans la plupart des pays, « la prévention de
ce problème est encore "insuffisante", que ce soit du fait de manques
de financements, de carence dans la coordination entre la recherche
scientifique et les acteurs de terrain ou le manque de sensibilisation du grand
public. La détection du caractère invasif d’une espèce est souvent trop tardive ».
Source : Anne Lenormand / Localtis, Ibid.
Face à ces plantes, il faut utiliser, auprès du grand public,
l'image d'un feu à combattre (voir image ci-dessous) :
Il faut faire comprendre qu’il faut réagir vite ! A
l'image d'un départ de feu où que tout se joue dans les premières minutes _
pour stopper un incendie, il faut un verre d'eau la première seconde, un seau
la première minute et… une tonne d'eau au-delà de 10 minutes ! _, de même si
l'on tarde à enrayer l'infestation d'une invasive, plus les dégâts _ sur la
nature, les récoltes etc. _ seront considérables et coûteux.
|
Stade
d'invasion
|
Mode
de gestion
|
GRAVITE
|
|
Invasion présentant une
(Distribution ponctuelle, extension
réduite)
|
• Action d’éradication envisageable
• Interventions complémentaires de prévention mises en
place pour éviter son retour
|
Gravité
faible
!
|
|
Invasion localement distribuée
|
• Eradication impossible
• Action de contrôle à privilégier
• Limitation de la progression de l’espèce par un
contrôle des fronts de colonisation
|
Gravité
moyenne
!!
|
|
Invasion largement distribuée
|
• Eradication impossible
• Action de contrôle à privilégier
• Gestion de manière continue de l’espèce
• Réduction des populations à des niveaux de
nuisances acceptables ou non significatifs
• Interventions devant s’intégrer à la gestion courante de
l’espace
• Opération de lutte active sur les sites à enjeux
|
Gravité
forte
!!!
|

Image de l’invasion pour les invasives, en utilisant
l’image choc du feu qui se propage et qu’on ne peut plus éteindre.
Les stratégies de luttes, exposées ci-après, concernent surtout les
plantes aquatiques invasives.
Lutte
chimique
Il n’est plus à démontrer que les herbicides (glyphosate …) ont un
impact non négligeable sur la biodiversité indigène. Et souvent, les plantes
invasives reviennent.
Lutte
biologique
Il existe des obstacles non négligeables à l’utilisation d’agents de
lutte biologique en Europe. Ainsi, une grande majorité des agents de lutte est
originaire des continents origines des espèces invasives, et représente un
risque en termes d’invasion [dans leur nouvel environnement]. Néanmoins,
il ne faut pas exclure que l’utilisation d’un agent de lutte biologique puisse
offrir une solution efficace à l’avenir pour lutter contre certaines espèces.
Lutte
mécanique
L’arrachage mécanique, suivi de plusieurs finitions manuelles, a permis
d’éradiquer certaines espèces. L’application de ce scénario semble relativement
simple, mais les réalités de terrain (inaccessibilité des sites pour les engins
lourds, difficulté d’observer l’espèce) peuvent fortement en compromettre la
faisabilité. Une autre méthode de lutte mécanique a montré un niveau
d’efficacité partiel, il s’agit de l’excavation des berges à l’aide d’une
déplaqueuse de gazon ou « turf cutter ».
Lutte
environnementale
La mise en assec et l’inondation prolongées (5 à 9 mois) ont
montré un niveau d’efficacité total pour certaines plantes aquatiques, mais
dans des conditions difficilement généralisables (assèchement complet des
boues, salinité élevée). Le paillage plastique (bâche en polythène) peut
étouffer la plantes, mais il faut le laisser au moins 10 ans.
Méthodes
de lutte dites « Autres »
Plusieurs méthodes de lutte alternatives _ azote
liquide, H2O2, lance-flamme, Waipuna, vapeur d’eau chaude
_ ont été aussi utilisées mais n’ont donné que des niveaux d’efficacité
modérés sur certaines plantes. Les recherches plus approfondies sont
nécessaires pour connaitre le réel potentiel de ces méthodes.
Combinaison
de méthodes de lutte
Une étude (UNIMA, 2001) rapporte que la combinaison d’un traitement
chimique, d’un arrachage mécanique et d’une finition manuelle est le scénario
de gestion donnant un niveau d’efficacité partiel le plus élevé sur certaines
plantes.
Source : Efficacité
des méthodes de lutte contre le développement de cinq espèces de plantes
invasives amphibies : Crassula helmsii, Hydrocotyle ranunculoides, Ludwigia
grandiflora, Ludwigia peploides et Myriophyllum aquaticum, Emmanuel
Delbart, Grégory Mahy & Arnaud Monty, http://popups.ulg.ac.be/1780-4507/index.php?id=9586#tocto2n8
|

Fauchage de l’Ambroisie
|

Faucardage (avec une faucardeuse) : fauchage ou
arrachage d’une plante aquatique envahissante.
|
|

Désherbage thermique.
|

Désherbage thermique.
|
|

La société Waipuna fabrique et commercialise du
matériel de désherbage à mousse chaude.
|

« Paillage plastique » : Bâche en
polythène utilisé pour le désherbage
|
·
La plante introduite n'est plus, dans
son nouveau milieu, confronté à ses « ennemis » naturels, qui
contrôlaient antérieurement la croissance de sa population ;
·
Beaucoup de plantes sécrètent, par
leurs feuilles et/ou racines ou rhizomes, des composés
organiques dits allélopathiques (molécules ayant
des effets inhibiteurs à franchement phytotoxiques selon les cas) pour les
espèces de la communauté végétale réceptrice (c'est le cas par exemple
pour Artemisia
absinthium ou Centaurea
diffusa qui ne posent pas de problèmes en Eurasie, mais qui sont
devenue envahissante en Amérique du Nord). Des expériences faites sur Centaurea
diffusa laissent penser que cette invasive utilise des composés
chimiques pour inhiber ou éliminer les plantes qui la concurrencent. Ses
voisins eurasiens de longue date s'étaient adaptés à ces molécules au cours
d'une longue convolution, mais de nouveaux
voisins nord-américains, en l'occurrence, de Centaurea diffusa sont très
sensibles à ces molécules, face auxquelles ces plantes locales ne sont pas
armées.
·
Parfois, le climat ou les conditions édaphiques nouvelles peuvent
être plus propices que dans le milieu d'origine ;
·
Chez certaines plantes, on a montré que
la production de molécules allopathiques augmente en période chaude et se
réduit ou perd de son efficacité sous la pluie ou par temps
froid. Le réchauffement
climatique pourrait donc exacerber le caractère allélopathique et
invasif de certaines plantes, introduites et devenues invasives.
Le secret du succès des espèces invasives :
Leurs atouts compétitifs :
- Elles n’ont que peu de prédateurs (dans leur nouvel
environnement).
- Elles sont très adaptables à tout type de sol _ y compris les sols
pauvres, dégradés _, de milieux (arides, salins …), de climats … (voire
elles peuvent évoluer facilement).
- Elles sont hors-compétition pour la nourriture et l'habitat
(souvent, elles n’ont pas de concurrent, dans leur nouveau milieu) .
- Elles sont souvent agressives par rapports aux espèces
autochtones, par les toxines qu’elles libèrent (par leurs effets
allélopathiques) inhibant souvent le développement des autres espèces,
par la grande densité de leur système racinaire …
- Par leurs fourrés très denses, les plantes invasives ont tendance
à étouffer toute la végétation concurrente.
- Elles prospèrent dans les systèmes perturbés. Ce sont souvent des
plantes pionnières.
- Elles se reproduisent rapidement et produisent souvent d’énorme
quantités de graines.
La majorité des plantes mettent plus de 150 ans pour s’acclimater et
devenir autochtone dans leur nouveau milieu (et par exemple, pour quitter et se
propager naturellement à partir du jardin botaniques, où elles étaient en cours
d’acclimatation). Or les plantes invasives mettent souvent moins de 70 ans,
via le même processus.
Source : http://www.invadingspecies.com/invaders/
Les espèces envahissantes sont capables d'être mis en place et se
propager via différents moyens et médias, y compris:
•
Les conteneurs et les navires de la flotte maritimes (via leur ballast,
coque, cale …).
•
La navigation de plaisance et commerciale.
•
Le mouvement et la libération d'appâts vivants.
•
Le commerce des aquariums , des jardins et plantes aquatiques.
•
Le commerce de poissons vivants destiné à l’alimentation.
•
Les introductions non autorisées.
•
Les canaux artificiels.
•
L’horticulture et le jardinage.
•
Les mélanges de semences.
•
La faune, le bétail, les humains et les animaux.
•
L’augmentation du commerce et des voyages internationaux, nationaux et
régionaux.
•
Le bois de chauffage.
Les espèces envahissantes sont souvent extrêmement difficile, voire
impossible à enlever une fois établie dans un nouvel environnement. Il est
important de prévenir l'introduction et / ou la propagation des espèces
envahissantes.
Source : http://www.invadingspecies.com/invaders/
|
Introductions volontaires
|
Introductions accidentelles
|
|
Introductions directes dans l’environnement
|
Introductions après culture ou captivité
|
|
|
Agriculture
|
Evasions de jardins botaniques
|
Fret maritime et aérien
|
|
Foresterie
|
Jardins privés
|
Eaux de ballast
|
|
|
|
|
Horticulture
|
Jardineries
|
Coque des navires
|
|
Elevage
|
Zoos
|
Véhicules personnels
|
|
Lâcher de poissons
|
Elevages d’animaux
|
Engins de transport et de
|
|
Lâcher de mammifères
|
Apiculture
|
Construction.
|
|
Chasse
|
Aquaculture
|
Denrées agricoles
|
|
Contrôle biologique
|
Aquariums
|
Semences
|
|
Amélioration des sols
|
Nouveaux animaux de compagnie
|
Matériaux de construction (terre, gravier, sable...)
|
|
Développement agricole
|
Unités de recherche
|
Bois
|
|
|
Matériaux d’emballage
|
|
|
Courrier postal
|
|
|
Déchets
|
Exemples de voies et de vecteurs d’introduction volontaires et
accidentels. Source : Tableau 2, Espèces exotiques envahissantes dans
les collectivités françaises d’outre-mer. Etat des lieux et recommandations,
Yohann Soubeyran, Planète Nature, Groupe outre-mer, UICN Comité Français,
juillet 2008, http://especes-envahissantes-outremer.fr/pdf/synthese_generale.pdf
Si votre traumatisme est une atteinte, une lésion du lobe frontal,
centre des émotions et de la raison, le problème est quasiment insoluble.
Certains, qui avaient des valeurs morales avant leur trauma, s en ont
conscience et font tout pour agir comme un être sensible auprès de leur
familles et amis.
Nous avons aussi le cas de cette perte de sensibilité, en raison de
syndromes de stress post-traumatiques, liés :
a)
A une enfance dysfonctionnelle (maltraitances psychologiques et carences
affectives graves, comme dans le cas des tueurs en série (à qui l’on n’a pas
fourni de garde-fous moraux). Mais heureusement, tous les enfants maltraités et
carencés et/ou sans garde-fou, ne deviennent pas tueurs en série).
b)
A une guerre, à une agression, à un attentat terroriste. Il y a, dans
ces derniers cas, des possibilités de réparations psychologiques et de
résilience. Une longue thérapie psy et des valeurs morales peuvent y aider.
Pour lutter
contre la corruption, il faut (selon l’auteur) :
1)
L’indépendance de la justice (du pouvoir judiciaire) (par rapport au
pouvoir exécutif, législatif),
2)
L’indépendance de la presse et des médias (par rapport au pouvoir),
3)
Il faut donc la liberté d’expression (garantie par la loi) et une vraie
démocratie pluraliste,
4)
Des journalistes d’investigation,
5)
Il faut la transparence des salaires, des possessions (biens matériels,
financiers …) et des dépenses des députés, visibles, consultables par tous les
électeurs, sur le/un site web du gouvernement,
6)
Une formation de qualité des magistrats au niveau de l’école de la
magistrature (indépendante par rapport au pouvoir). Idem pour les policiers. Il
faut aussi que les magistrats et policiers soient payés en conséquence.
7)
Une formation des enfants, très tôt, dans les écoles à l’esprit civique,
à l’honnêteté, au goût de l’effort.
8)
Il faut favoriser les ONG de lutte contre la corruption : ANTICOR,
Transparency International …
[200] a) World Agroforestry Centre, Kenya, site : https://www.worldagroforestry.org/
b) Projet
Drylands transform [Transformation des terres arides] (Kenya , Ouganda,
01/2020-12/2024), https://www.worldagroforestry.org/project/drylands-transform
[201]a) SOS Sahel, tél : 01 46 88 93 70, site : http://www.sossahel.org
b) SOS Sahel GB
(Sue Cavanna), tél : +44 (0)1865 403305, Courriel : mail@sahel.org.uk, Site : www.sahel.org.uk
[202] a) International Institute for Environment and Development (IIED),
235 High Holborn, Holborn, London WC1V 7DN, UK, Tel: +44 (0)20 3463 7399, site
: www.iied.org
b) Programme
Zones Arides (Ced Hesse), tél : + 44 (0)131 624 7043, courriel : Ced.Hesse@iied.org,
Site : www.iied.org/NR/drylands
[203] Unité de
recherche sur la restauration forestière de l'Université de Chiang Mai,
Thaïlande, FORRU-CMU, https://www.forru.org/
[204] Fond Français pour l'Environnement Mondial (FFEM), AFD, 5
Rue de Roland Barthes, 75598 PARIS CEDEX 12, France, Site : https://www.ffem.fr/
b) https://www.ffem.fr/fr/carte-des-projets/lutte-contre-la-desertification-par-lappui-au-pastoralisme-dans-le-ferlo
[205] WACOMP
(Programme de la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest), 101 Yakubu Gowon
Crescent Asoroko District, P.M.B. 401, Abuja, Nigeria, courriel : info-wacomp@ecowas.int, site : www.wacomp.ecowas.int
[300] Arid Forest Research Institute (AFRI),
http://afri.res.in
[301] Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans
le Sahel (CILSS), http://www.cilss.bf/htm/lcd.htm
[302] Jacob Blaustein Institute for Desert
Research, a) http://in.bgu.ac.il/en/bidr/Pages/default.aspx,
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Blaustein_Institutes_for_Desert_Research
[303] Ben-Gurion University ou BGU (Université
Ben Gourion du Néguev (אוניברסיטת
בן גוריון בנגב)),
a) http://www.bgu.ac.il/ , b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Ben_Gourion_du_N%C3%A9guev
[304] Salt Farm Texel, Hoornderweg
42, 1797RA, Den Hoorn, Pays-Bas (The Netherlands). Contact : Arjen de Vos.
Tél. 0031 (0) 6 513 279 51. Email : info@saltfarmtexel.com, site : http://www.saltfarmtexel.com/
|
Benjamin
LISAN
16 rue de la
Fontaine du But
75018 PARIS,
France.
Tél.:
01.42.62.49.65 / GSM: 06.16.55.09.84
E-mail: benjamin.lisan@free.fr
|

|
•
Site de téléchargement de documents agroécologiques et de
sensibilisation environnementale : http://doc-developpement-durable.org/
•
Base de données documentaire (de téléchargement) de documents
agroécologiques et de sensibilisation environnementale : http://doc-developpement-durable.org/file/
•
Site d’aide aux projets de reforestation : http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/menuReforestation.htm
•
Site d’aide aux projets de développement durable : http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.htm
Vous trouverez :
a) une version électronique PDF gratuite de ce livre, à cette adresse Internet
(17 Mo) :
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.pdf
b) sa version diaporama Powerpoint (18 Mo,
267 pages) : https://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pptx
c) b) sa version diaporama PDF (17
Mo) : https://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pdf
Table des matières
1 Avant-propos. 5
1.1 Partis pris. 5
1.2 Invitation à participer à l’amélioration
de cet ouvrage. 6
2 Introduction. 6
2.1 Le réchauffement climatique permanent de
la Terre, depuis 1850. 6
2.2 Un constat inquiétant sur la
désertification et la salinisation croissante des terres. 7
2.2.1 Augmentation des périodes de sècheresse
et de canicule et aridification des terres. 7
2.2.2 Augmentation des feux de forêts de
grande ampleur dans le monde. 8
2.2.3 Les reculs des glaciers depuis 1850 et
leurs impacts négatifs. 11
2.2.4 Sècheresses accrues dans des régions.
Assèchement des rivières, de lacs et de mers intérieures. 15
2.2.5 L’augmentation des tempêtes de sable. 18
2.2.6 Le rôle croissant des terres arides dans
le monde. 19
2.3 Dégradation et augmentation de l’aridité
des sols. 19
2.3.1 Dégradation des sols, par l’érosion et
la désertification. 19
2.3.2 Les causes des augmentations des
épisodes de sécheresses. 20
2.3.3 Augmentation de la salinisation des sols. 20
2.4 Submersions et transgressions marines. 20
2.5 Le non-contrôle strict de la démographie
mondiale. 22
2.6 Crises économiques, cours des denrées de
base trop hauts, émeutes de la faim.. 23
2.1 Réflexes égoïstes et guerres de l’eau. 24
2.2 Terrorisme. 24
3 Biosécurité. 25
4 Bien réfléchir avant d’introduire une
plante dans une région donnée (le problème des plantes invasives). 25
4.1 L’introduction de l’eucalyptus (réflexions
sur). 25
4.1 L’introduction des plantes invasives. 26
4.1.1 Définition ou caractéristiques des
plantes invasives. 26
4.1.2 Manque de méfiance de tout un chacun
face aux plantes invasives. 26
4.1.3 Coûts économiques et écologiques causées
par les espèces invasives. 26
5 La résistance au stress biotique et
abiotique d’une plante. 27
5.1 Définition stress biotique et abiotique. 27
5.2 Différences de résistances de plantes à
certains stress. 28
6 Signalétique. 28
7 Rêver de reverdir le désert. 29
8 Cartes des zones arides, des sols et de la
pénurie d’eau dans le monde. 34
9 Définitions. 38
10 Introduction sur la salinité des sols. 38
10.1 Exemples de plantes de sols salins. 39
10.1.1 Acanthus ilicifolius. 39
10.1.2 Saligne à balai (Haloxylon scoparium
ou Hammada scoparia). 39
10.1.3 Ficoïde glaciale (Mesembryanthemum
cristallinum) & Orge maritime (Hordeum marinum). 40
10.1.4 Aster maritime ou oreille de cochon (Aster
tripolium). 40
10.1.5 Genres Salicornia, Suaeda,
palétuviers, autres plantes halophytes. 41
11 Arbres et arbustes fruitiers résistants
au sel et/ou à l’aridité. 43
11.1 Jujubier commun (Ziziphus jujuba
ou Ziziphus mauritania) 43
11.2 Jujubier épine du Christ (Ziziphus
spina-christi). 44
11.3 Tamarinier (Tamaridus indica). 46
11.4 Caroubier (Ceratonia siliqua). 47
11.5 Pistachier commun ou pistachier vrai (Pistacia
vera). 48
11.6 Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus). 50
11.7 Pistachier térébinthe (Pistacia
terebinthus) 52
11.8 Grenadier commun (Punica granatum). 53
11.9 Grenadier
de Socotra (Punica protopunica). 54
11.10 Vigne cultivée et sauvage (Vitis
vinifera). 55
11.11 Arganier (Argania spinosa). 58
11.12 Palmier-dattier (Phoenix dactylifera). 59
11.13 Arbre de Josué ou Joshua tree (Yucca
brevifolia). 60
11.14 "Palmier porcelaine" (Yucca
filifera). 61
11.15 Washingtonia sp. 62
11.16 Olivier (Olea europaea). 63
11.17 Amandier (Prunus dulcis). 66
11.18 Figuier commun (Ficus carica). 68
11.19 Figuier sycomore (Ficus sycomorus). 69
11.20 Dattier du désert (Balanites
aegyptiaca) 70
11.21 Madd (Saba senegalensis). 71
11.22 Bungo,
mbungo ou vigne en caoutchouc (Saba comorensis). 72
11.1 Hanza
ou aizen (Boscia senegalensis). 73
11.2 Ditax, ditakh, detar et « arbre à suif » (Detarium
senegalense). 74
11.3 Combretum glutinosum.. 76
12 Arbres utiles pour le fourrage, le bois
et d’autres usages. 77
12.1 Khejri ou Ghaf (Prosopis cineraria). 77
12.2 Callitris tuberculata ou
Callitris preissii 78
12.3 Pterocarpus angolensis. 79
12.4 Lebbeck ou bois noir (Albizia lebbeck). 82
12.5 Cassier (Acacia farnesiana). 83
12.6 Acacia seyal 84
12.7 Faidherbia
albida (Synonyme Acacia albida). 85
12.8 Acacia dudgeoni 87
12.9 Acacia senegal ou Senegalia
senegal 88
12.10 Arbre
Salam (Acacia ehrenbergiana). 89
12.11 Acacia ampliceps. 90
12.12 Bauhinia rufescens. 91
12.13 Arbre pilon ou Casse du Sénégal (Cassia
sieberiana). 93
12.14 Mopane ou Mopani (Colophospermum mopane) 94
12.15 Karanj ou arbre de
pongolote (Millettia pinnata). 95
12.16 Paulownia
hybride (Paulownia elongata x fortunei x elongata). 96
13 Arbustes résistants à la sécheresse
et/ou aux sols salins. 97
13.1 Jojoba (Simmondsia chinensis). 97
13.2 Arroche halime, pourpier de
mer ou arroche marine (Atriplex halimus). 98
13.3 Grande arroche (Atriplex lentiformis). 99
13.4 Atriplex nummularia. 100
13.5 Les soudes (genre Salsola sp.). 102
13.6 Nitres, genre Nitraria sp. 103
13.7 Nitraria retusa. 104
13.8 Saxaoul ou saxaul (Haloxylon
ammodendron). 106
13.9 Taupata ou buisson miroir (Coprosma
repens). 108
13.10 Eleagnus sp. 109
13.11 Lyciets (Lycium sp.). 110
13.12 Neverdier, moringa ou ben ailé (Moringa
oleifera). 111
14 Plantes tropicale poussant dans l’eau
salée. 113
14.1 Badamier (Terminalia catappa). 113
14.2 Mancenillier ou arbre de la Mort (Hippomane
mancinella). 114
14.3 Cocotier (Cocos nucifera). 115
14.4 Raisinier bord de mer (Coccoloba
uvifera). 116
14.5 Cachiman-cochon, Mamain ou Mammier (Annona
glabra) 117
14.6 Nypa buissonnant ou arbustif (Nypa
fruticans). 118
14.7 Mangle médaille, sang-dragon, mangle-rivière
(Pterocarpus officinalis). 119
15 Palétuviers. 120
15.1 Définitions de la Mangrove. 123
15.1 Vocabulaire spécifique aux mangroves. 123
15.2 Caractéristiques et rôles écologiques de la
mangrove. 124
15.3 Zonations. 126
15.4 Usages de la mangrove pour l’homme et la
nature. 128
15.5 Caractéristiques des plantes de la mangrove. 129
15.6 Productivité de l’océan et des mangroves. 129
15.7 Les chaînes alimentaires. 129
15.8 Où sont-elles localisées, dans le monde ?. 130
15.9 Leur résistance au sel 131
15.10 Ecologie de la Mangrove. 131
15.11 Les facteurs physiques influençant la
croissance et le développement des mangroves. 131
15.12 Les facteurs de stress. 131
15.13 Physiologie, reproduction. 132
15.1 Racines aériennes et pneumatophores. 132
15.2 Bilan de l'aménagement forestier des
mangroves. 133
15.3 Menace sur les mangroves. 133
15.4 Palétuvier noir / Palétuvier gris (Avicennia
marina). 135
15.5 Palétuvier orange (Bruguiera gymnorrhiza). 136
15.6 Palétuvier
jaune (Ceriops tagal). 137
15.7 Lumnitzera racemosa. 140
15.8 Palétuvier rouge (Rhizophora mucronata). 141
15.9 Sonneratia alba. 142
15.10 Palétuvier casse-tête (Xylocarpus
granatum) 144
15.11 Palétuvier Toto margot (Heritiera
littoralis). 146
15.12 Techniques de reboisement de la mangrove
[pour Rhizophora sp.]. 147
15.12.1 Etape 1 : Organiser les équipes. 147
15.12.2 Etape 2 : Choisir la zone de reboisement. 148
15.12.3 Etape 3 : Délimiter la zone de
plantation. 149
15.12.4 Etape 4 : Récolter les propagules. 149
15.12.5 Etape 5 : Trier les propagules. 150
15.12.6 Etape 6 : Quadriller / marquer le
terrain. 151
15.12.7 Etape 7 : Planter. 152
15.12.8 Etape 8 : Prendre soin des jeunes plants. 152
15.13 Des projets de reboisement de mangroves
dans le monde, sources d’inspiration. 153
15.14 Technique de culture en pépinière. 154
15.14.1 Soins et entretiens dans une pépinière. 156
16 Plantes halophytes alimentaires du bord
de mer. 160
16.1 Halophyte : définition. 160
16.2 Salicornes (Salicornia sp.). 161
16.3 Salicornes de climats tropicaux. 162
16.4 Salicorne naine (Salicornia bigelovii). 163
17 Plantes herbacées alimentaires pouvant
supporter une certaine dose de sel 164
17.1 Asperge (Asparagus officinalis). 164
17.2 Betterave (Beta vulgaris). 166
17.3 Taro ou oreille d’éléphant (Colocasia
esculenta). 167
17.4 Orge commune (Hordeum vulgare). 169
17.5 Nipa (Distichlis palmeri). 170
17.6 Riz résistant au sel (Oryza sativa x Oryza
coarctata _ cultivar résistant au sel). 171
17.7 Blé dur résistant au sel (Triticum turgidum L. subsp. Durum _ cultivar résistant au
sel). 172
17.8 Pomme de terre, cultivar pour eau salée. 173
17.9 Moutarde d’Abyssinie (Brassica
carinata) 174
17.10 Ficoïde glaciale (Mesembryanthemum
crystallinum ou Cryophytum cristallinum). 175
17.11 Crambé maritime ou chou marin (Crambe
maritima). 176
17.12 Criste marine (Crithmum maritimum). 177
17.1 Elaboration de plantes alimentaires OGM
résistantes au sel 177
18 Plantes alimentaires, pouvant résister à
la sécheresse mais pas au stress salin. 178
18.1 Tournesol (Helianthus annuus) 179
18.2 Millet, Mil, Fonio. 179
18.2.1 Éleusine ou « ragi » (Eleusine coracana). 180
18.2.2 Fonio ou « mil africain ». 180
18.2.3 Millet commun, millet blanc ou millet à
grappes (Panicum miliaceum). 181
18.2.4 Millet des oiseaux, sétaire d'Italie,
panis, petit mil» ou miliade (Setaria italica). 181
18.2.5 Millet indien ou Éleusine des Indes (Panicum
sumatrense ou Eleusine indica). 181
18.2.6 Millet japonais (Echinochloa esculenta
et Echinochloa frumentacea). 182
18.2.7 Millet perle, mil à chandelle, mil
pénicillaire, petit mil ou mil (Pennisetum glaucum) 183
18.2.8 Teff (Eragrostis tef). 183
18.2.9 Coix ou larme de Job (Coix lachryma-jobi). 183
18.2.10 Herbe à épée (Paspalum scrobiculatum) 184
18.3 Sorgo (sorgho) commun, Millet à balai,
« gros mil » ou Sorgho bicolore (Sorghum bicolor). 184
18.4 Lentille cultivée (Lens culinaris (ou
Lens esculenta)). 186
18.5 Niébé (Vigna
unguiculata). 188
18.6 Arachide (Arachis hypogaea) 192
18.7 Gesse commune, Pois carré, Lentille
d'Espagne (Lathyrus sativus) 195
18.1 Quinoa (Chenopodium quinoa). 197
18.2 Aloès commun (Aloe vera). 200
19 Plantes fourragères pouvant supporter
une certaine dose de sel 202
19.1 Mélilot blanc (Melilotus albus ou Melilotus
alba). 202
19.2 Mélilot
jaune (Melilotus indicus). 203
19.3 Luzerne cultivée résistante au sel (Medicago
sativa var Tafilalet et autres cultivars). 204
19.4 Vétiver (Chrysopogon sp.) 205
19.5 Vétiver (Chrysopogon zizanioides) 208
19.6 Vétiver (Chrysopogon nigritanus) 208
19.7 Vétiver (Chrysopogon nemoralis). 209
19.8 Panic érigé (Panicum
virgatum) 210
19.9 Panic amer (Panicum amarum) 211
19.10 Canne de Provence
(Arundo donax). 212
20 Plantes fourragères et pour d’autres
usages, pour zones arides. 213
20.1 Alfa (Stipa tenacissima). 213
21 Plantes herbacées de survie et de famine
de climats secs et régions arides. 214
21.1 "Bec-de-héron velu" (Erodium
crassifolium) 214
21.2 Nara, !nara ou melon du désert (Acanthosicyos
horridus) 215
21.3 Lentille bâtarde, vesce
amère ou ers (Vicia ervilia). 217
22 Algoculture / culture des algues. 218
22.1 Définition. 218
22.2 Importance de l’algoculture dans le monde. 218
22.3 L’importance
écologique de l’algoculture. 219
22.4 La culture d’algues et ses techniques. 219
22.5 Saccharina japonica. 219
22.6 « Wakame » (Undaria pinnatifida). 220
22.7 Gim ou nori (Pyropia tenera ou
Porphyra tenera). 220
22.8 Gusó
(Genre Eucheuma). 221
22.1 Ogonori ou gulaman (genre Gracilaria). 223
22.2 Goémon blanc ou crépu, mousse d'Irlande ou
Carragheen (Chondrus crispus). 223
22.1 Mousse de
mer (Kappaphycus alvarezii). 225
22.2 Spiruline alimentaire (Arthrospira
platensis et Arthrospira maxima) 226
23 Plantes médicinales et aromatiques. 229
23.1 Siwak ou
miswak (Salvadora persica). 229
23.2 Arbre à myrrhe ou balsamier (Commiphora
myrrha). 230
23.3 Mukul, gugulon ou Guggulu (Commiphora
wightii). 232
23.4 Myrrhe africaine (Commiphora africana) 233
23.5 L'arbre à encens (Boswellia sacra). 234
23.6 Salai ou Shallaki (Boswellia serrata). 235
23.7 Griffe du diable ou Harpagophyton (Harpagophytum
procumbens) 237
24 Méthodes d’irrigation, de rétention,
d’économie et de conservation de l’eau. 238
24.1 Liman israélien. 238
24.2 Système Meskat ou Meskal et tabias (Magrehb). 240
24.3 Foggara, khettara, qanat. 244
24.4 Digues filtrantes, lignes de contours. 244
24.5 Bourrelets suivant les courbes de niveau. 245
24.6 Plantation en tranchée. 246
24.7 Système Vallerini ou VALLERANI SYSTEM (VS). 247
24.8 Barrages, Jessours, Tabia. 247
24.9 Lavogne. 253
24.10 Lac ou retenue collinaire. 254
24.11 Déversoirs. 256
24.12 Gabion (fabrication etc.). 257
24.13 Citernes couvertes (matfia, joub ou
notfia). 258
24.14 Cuvettes en demi-lunes. 261
24.15 Negarim.. 262
24.16 Alignement de pierres, cordons pierreux
et murettes. 263
24.17 Zaï ou culture en poquets. 265
24.1 Irrigation. 266
24.2 Economiser l’eau. 269
24.3 Le système d’irrigation goutte à goutte ou
micro-irrigation. 270
24.4 Filets capteur de brouillard (ou filets à
nuages ou à rosée). 275
25 Processus de salinisation des sols. 277
26 Protection des plants, des pépinières,
de la plantation des champs. 279
26.1 Haies vives : protection contre les
vols, le broutage, délimitation de parcelles ….. 279
26.2 La régénération naturelle assistée d'espèces
forestières locales. 283
26.3 L’amélioration de la fertilité des sols par
des moyens naturels. 283
26.3.1 Le compostage organique. 283
26.3.2 Le paillage. 286
26.4 Protection "artificielle" des
plants, des pépinières et de la plantation. 286
26.4.1 Barrière électrique ou simple. 286
26.4.2 Plantation d’une haie vive. 287
26.5 Schéma d'implantation d'une pépinière. 287
26.6 Devis approximatif pépinière (terrain
gratuit) (exemple) 288
26.7 Construction de la pépinière. 289
27 La gestion des pâturages (gestion
pastorale). 290
27.1 Données écologiques sur les zones pastorales. 290
27.2 Les avantages du pastoralisme dans ces zones. 290
27.1 Évolution des transhumances, augmentation de
la distance des parcours. 291
27.2 L’effet pervers des forages pour créer des
points d’eau pour le bétail 291
27.3 Le difficile respect des lois édictées pour
les itinéraires transhumants. 294
27.4 Les avantages réciproques de la coopération éleveurs
agriculteurs. 295
27.5 Les conflits entre cultivateurs et pasteurs. 295
27.5.1 Au sahel 295
27.6 La difficile gestion des prairies et steppes
des zones arides. 297
27.6.1 Constat. 297
27.6.2 Résultats. 297
27.6.3 Quels étaient les buts de la politique des
ZP ?. 298
27.7 Quelles solutions ?. 298
27.1 Solutions pour la bonne gestion des
ressources et des conflits agriculteurs et éleveurs. 299
27.1.1 Faire appel à la science. 299
27.1.2 Suggestions des ONG SOS Sahel, IIED.. 300
27.1.3 Projet de lutte contre la désertification
dans le Ferlo au Sénégal, soutenu par le FFEM... 300
27.1.4 Exemple du Projet de développement rural
intégré (PDRI) de la zone pastorale de Barani 301
27.1.5 L’avis d’une actrice humanitaire. 304
27.1.6 L'élaboration d'un code foncier du Sahel
selon Sall Alioune. 306
27.2 Ressources bibliographiques pour ce chapitre. 306
28 Prévenir les feux de forêt et de brousse
incontrôlés. 307
28.1 Définitions. 307
28.2 Les feux de brousse. 307
28.3 Les feux de forêts. 309
28.4 Solutions / prévention collective (mesures
visant à empêcher les feux de forêt). 310
28.5 Inconvénient des feux contrôlés. 310
28.6 Des solutions récentes pour pays riches
(hors des moyens des pays en voie de développement) 312
28.6.1 Solution Pyro. 312
28.6.2 Un drone du type "canadair". 313
28.7 Développement d'une culture de la prévention. 313
28.8 Apprendre les bons gestes. 314
28.9 La loi 314
28.10 Actions durant le feu. 314
28.11 Remise en état de la forêt après un
incendie. 315
28.12 Pare-feu (coupe-feu) 315
28.13 Valorisation des coupe-feux. 315
28.14 Réservoirs. 315
29 Travail de sensibilisation. 316
30 Création d’une banque de graines /
semences. 317
30.1 Où se procurer les jeunes pousses ou les
graines ?. 317
30.2 Comment conserver les graines ?. 317
30.3 Critères de qualité des semences. 317
30.4 Les opérations pouvant être effectuées pour
la conservation des semences. 317
30.5 Semences orthodoxes et récalcitrantes (voir
ci-après). 317
30.6 Exemple de la « semence-othèque »
du Jardin des fraternités ouvrières de Mouscron (ASBL, Belgique). 318
31 Projets de lutte contre la
désertification (contre l’avancée des déserts) 321
31.1 Solution aux blizzards noirs, dans les
grandes plaines, aux USA, dans les années 30. 321
1.1 Grande muraille verte (Afrique). 322
31.1.1 Les controverses concernant ce projet. 324
31.1.2 Remise en cause du concept de
désertification. 324
31.1.3 Difficultés de mise en œuvre dans les
régions instables (en guerre). 324
1.2 Le barrage vert en Algérie. 325
31.2 Le Mouvement
de la ceinture verte (Green Belt Movement ou GBM). 325
31.2.1 Le brise-vent des Trois-Nord ou la Grande
muraille verte (en Chine). 326
31.2.2 Problèmes environnementaux. 326
31.2.3 Solutions innovantes pour le contrôle et
fixation des déplacements du sable. 327
31.3 Projet
Watershed Organization Trust (WOTR) (Inde). 328
31.4 Création de variétés alimentaires
résistantes au sels. 331
31.5 Utilisation de la bactérie Pseudomonas
extremorientalis pour améliorer la résistance des plantes au sel 332
31.6 Les échecs dans le monde. 333
31.6.1 En Chine. 333
31.7 En Turquie. 333
31.7.1 Raisons de ces échecs. 333
32 Les défis démographiques (en particulier
au Sahel). 334
32.1 Problèmes
pratiques pour l’implantation des centres de planning familial 335
32.2 Ralentir
l’accroissement rapide de population, par l'éducation. 335
32.3 Faire participer
les autorités religieuses locales à la promotion de la contraception. 336
33 Problèmes posé par les discours
populistes incitant à la guerre et au terrorisme. 337
33.1 Nature des discours populistes, extrémistes,
incitant au terrorisme et à la guerre. 337
33.2 Analyse et réfutation du discours présentant
la guerre comme héroïque. 337
33.3 Le cas extrême du désir de vengeance extrême
et inextinguible. 338
33.4 En conclusion partielle. 339
33.5 Guerres, conflits, problèmes sécuritaires et
conséquences. 339
33.5.1 Au Sahel 339
34 Accaparement des terres et de l’eau sans
retombée pour les habitants locaux. 340
35 Souveraineté alimentaire et économique. 343
35.1 Reconquérir sa souveraineté économique. 343
35.1.1 Le Programme de la Compétitivité de
l’Afrique de l’Ouest (WACOMP). 344
35.2 Reconquérir sa souveraineté alimentaire
(exemple) 345
35.3 Conclusion partielle sur ce chapitre. 346
36 L’importance des femmes dans les projets
de développement. 347
37 Conclusion générale. 348
37.1 Préservation de l’environnement. 349
37.2 Lutte contre les maux endémiques en Afrique
et certains pays en voie de développement. 349
38 Bibliographie. 350
38.1 Le réchauffement climatique. 350
38.2 Salinisation des sols et augmentation du
niveau des mers. 350
38.3 Destruction des forêts et des mangroves. 351
38.4 Sècheresses et assèchement de rivières et de
lacs. 351
38.5 Recul des glaciers. 352
38.6 Feux de forêts. 352
38.7 Projets de reforestation et jardins
botaniques. 352
38.8 Espèces de climats arides, résistantes à la
sècheresse et au sel 353
38.8.1 Plantes halophytes. 354
38.8.2 Plantes xérophytes, de déserts. 354
38.8.3 Les techniques de culture de la
salicorne et autres infos sur la plante. 354
38.9 Etudes sur la résistance des plantes au sel 354
38.9.1 Utilisation de la bactérie « Pseudomonas
extremorientalis ». 356
38.9.2 Résistance au sel de l'Orge (Hordeum
vulgare). 356
38.10 Algoculture. 356
38.11 Mangroves et palétuviers. 356
38.12 Champignons,
mycorrhyse et Mycorrhysation. 357
38.13 Base de données documentaire pour le
développement durable de pays en voie de développement. 357
38.14 Techniques
anti-érosives. 358
38.15 Méthodes d’irrigation et économie de
l’eau. 358
38.15.1 Sensibilisation à l’économie de l’eau. 359
38.15.2 Les réseaux d’eau anciens. 359
38.15.3 Filets capteurs de brouillard (de
nuages, de rosée). 359
38.16 Techniques et projets de reforestations,
dans le monde. 359
38.16.1 Techniques de reforestation. 359
38.16.2 Projets et solutions israéliennes. 359
38.16.3 Projets et solutions dans d’autres
déserts. 360
38.17 Menaces sur la biodiversité. 360
39 Annexe : Arbres et plantes
invasives, surtout à ne pas planter. 360
39.1 Figuier de Barbarie ou cactus raquette (Opuntia
ficus-indica etc.). 361
39.2 Oponce stricte (Opuntia stricta). 363
39.3 Agave
sisal (Agave sisalana, Agave ixtli etc.). 364
39.4 Bois de fer des marais (Casuarina glauca). 365
39.5 Filao (Casuarina equisetifolia). 366
39.1 Acacia auriculé (Acacia auriculiformis). 367
39.2 Acacia à bois noir ou Mimosa à bois noir (Acacia
melanoxylon) 368
39.3 Coojong (Acacia saligna). 369
39.4 Épine
de Jérusalem ou Palo verde (Parkinsonia aculeata) 370
39.5 « Mesquite » (Prosopis
juliflora). 372
39.6 Prosopis
chilensis. 374
39.7 Prosopis
pallida. 374
39.8 Atriplex
sp. 375
39.9 Tamarix sp. 376
39.10 Tamaris d'Afrique ou Tamaris de printemps
(Tamarix africana ou Tamarix tetrandra) 378
39.11 Tamaris Athel (Tamarix aphylla
ou Tamarix articulata). 379
39.12 Genêt blanc ou Retam blanc (Retama
monosperma) 380
39.13 Typha ou massette (Typha sp.). 381
39.1 Kikuyu grass ou herbe kikuyu (Pennisetum
clandestinum). 382
39.1 Texas
blueweed ou yerba parda (Helianthus ciliaris). 383
40 Annexe : Maladies fongiques liées à
l’arrosage. 385
41 Annexe : Lexique botanique. 386
42 Annexe : Glossaire sur l'irrigation et
le stockage de l’eau. 387
43 Annexe : Plantes recommandées pour la
fixation des dunes mobiles. 388
44 Annexe : Espèces pastorales recommandées
pour le rétablissement des parcours en milieux arides. 389
45 Annexe : Niveaux de résistance au
sel de certaines plantes. 389
46 Annexe : Dispositions agroforestières. 390
47 Annexe : Stratégies préventives de lutte
contre les plantes invasives. 393
47.1 Contrôle aux frontières. 393
47.2 Campagnes de sensibilisation. 393
48 Annexe : Stratégies palliatives de lutte
contre les plantes invasives. 394
49 Annexe : Mécanismes intrinsèques
des plantes invasives, expliquant leur invasivité. 396
50 Annexe : Modes de propagation des
espèces invasives. 397
51 Annexe : Que faire quand vous
devenez insensible moralement, en raison de traumatismes ?. 398
52 Annexe : Préconisations pour lutter
contre la corruption. 398
53 Associations, organisations, ONG.. 399
54 Instituts spécialisés et contacts. 399
55 Contact pour plus d’informations. 400
55.1 Sites Internet de l’auteur. 400


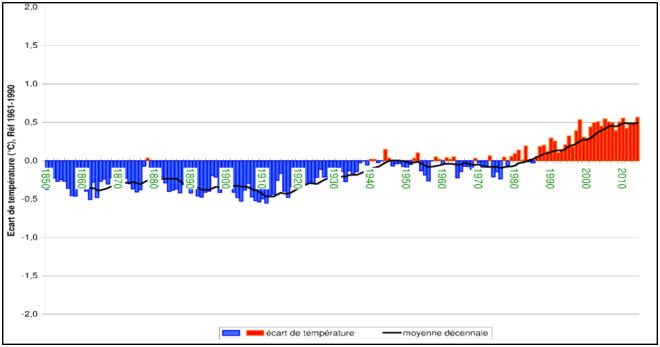
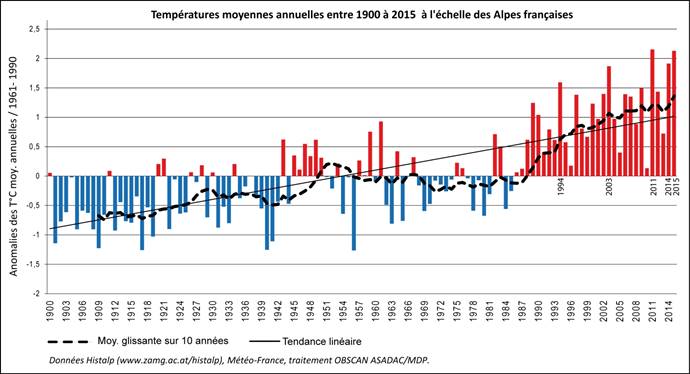
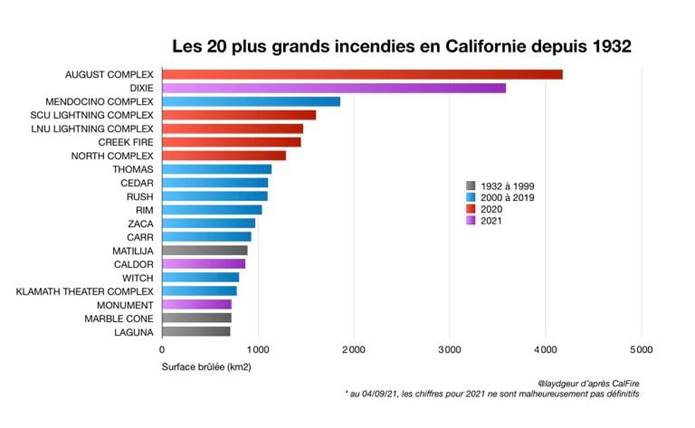
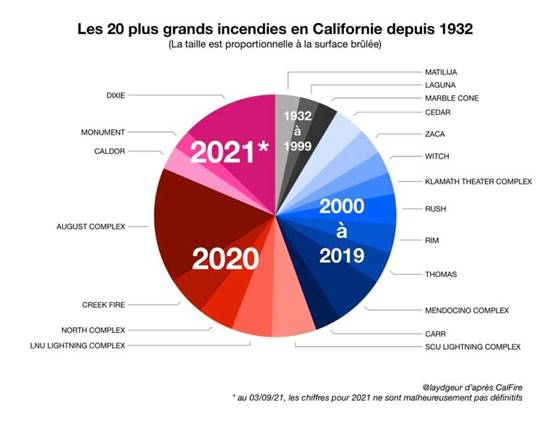

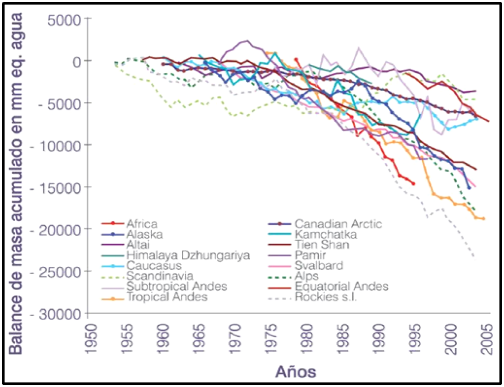
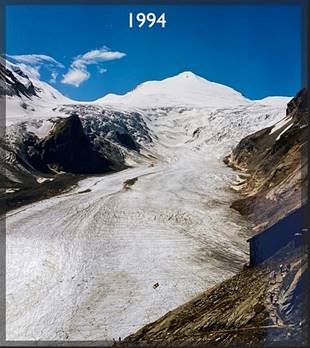
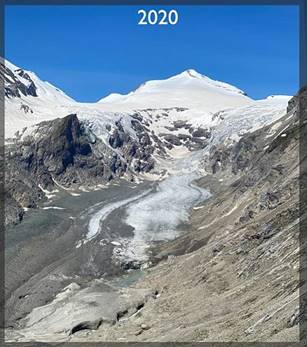




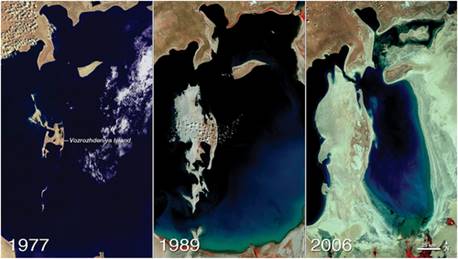
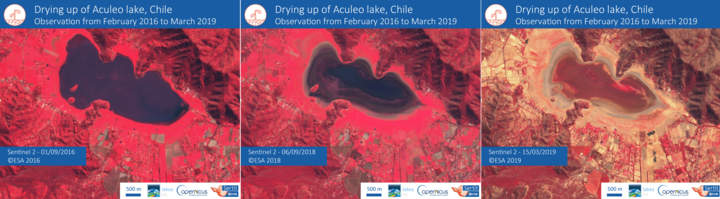
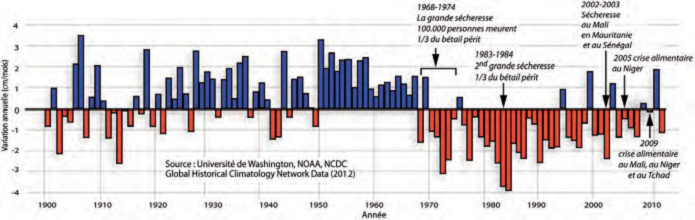
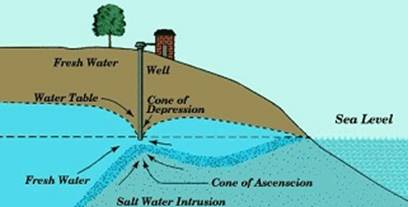
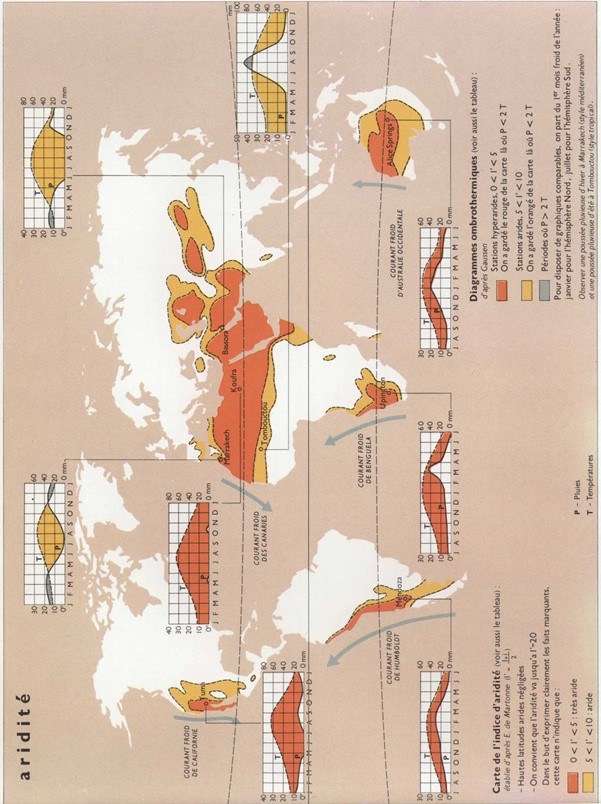
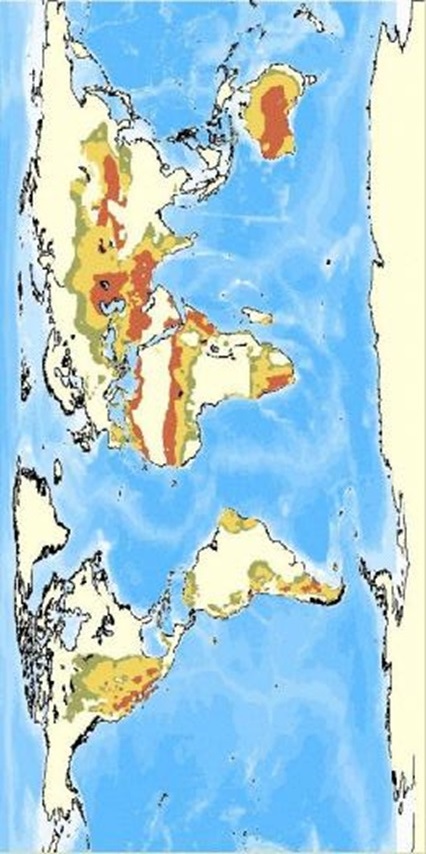
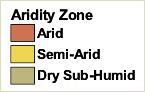
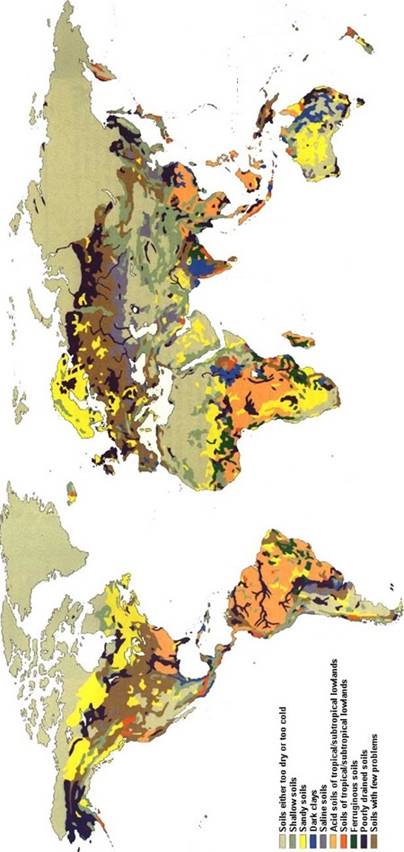
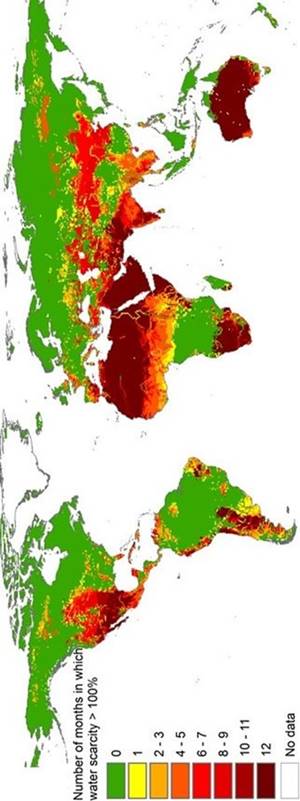
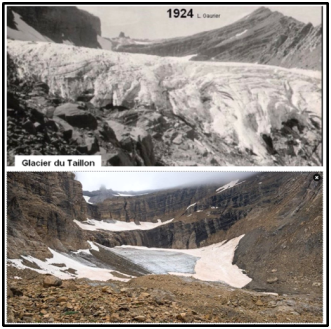
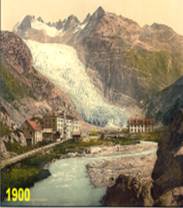

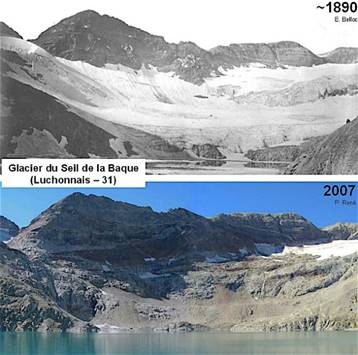
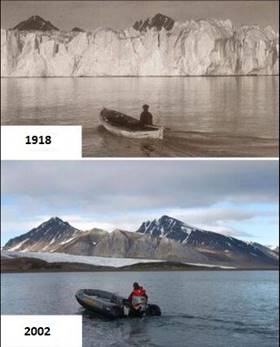
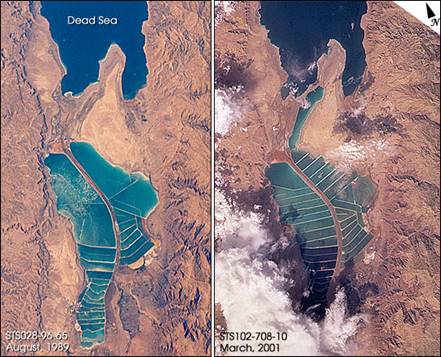

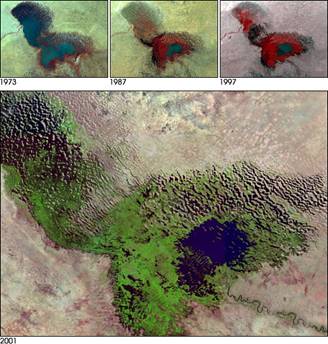
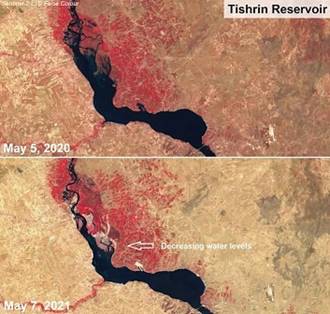


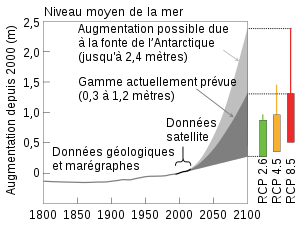
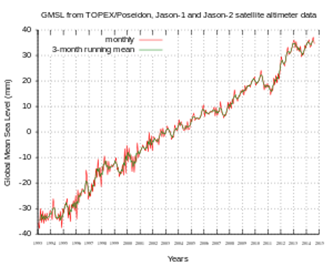
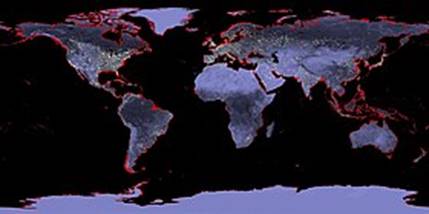






























































































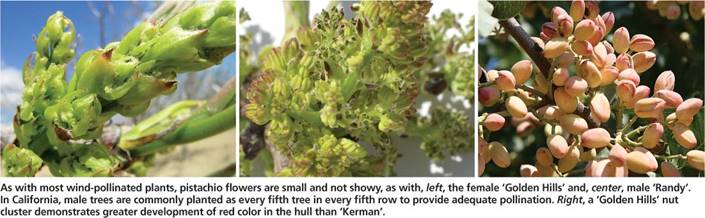












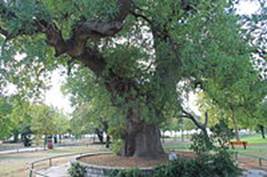

















 (b)
(b)
 (a)
(a) (a)
(a)






























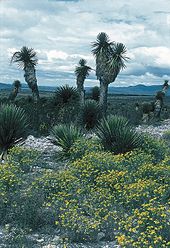





































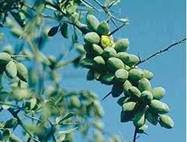































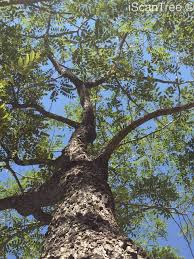






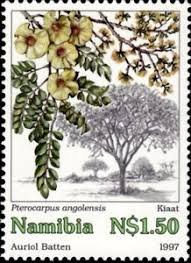
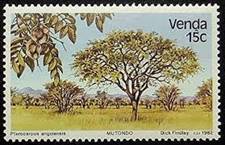
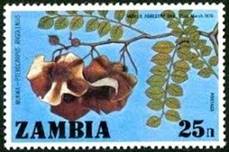





























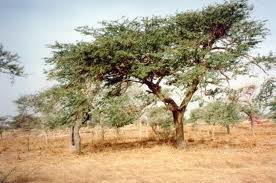































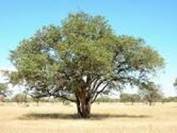













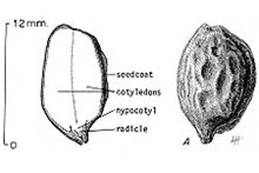


































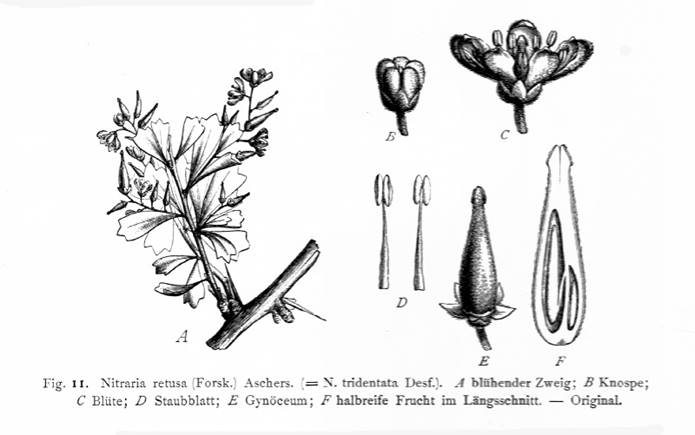




































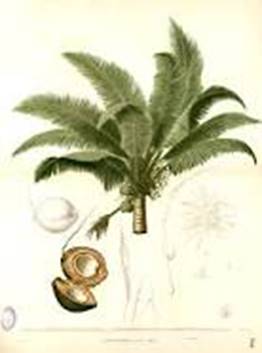




















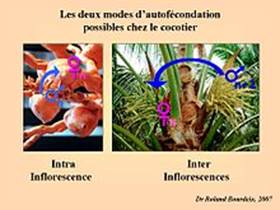



















 bois
bois



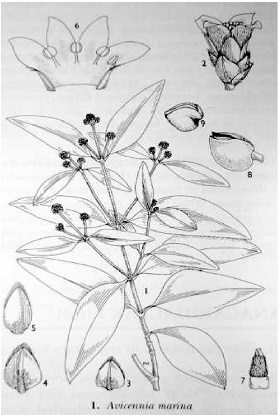




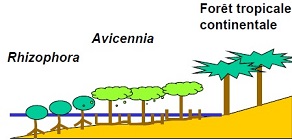

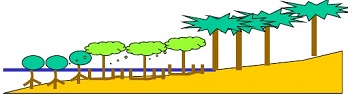
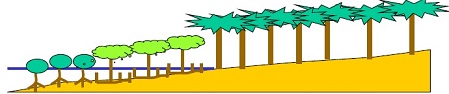
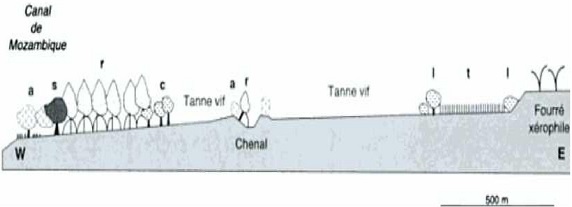
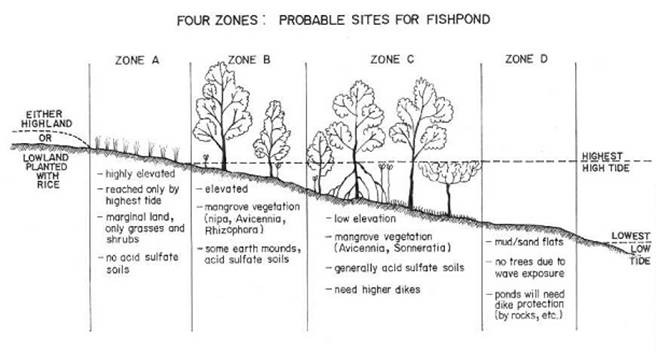
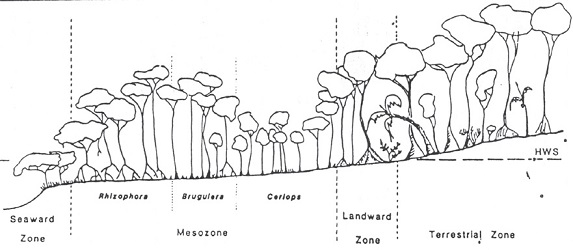
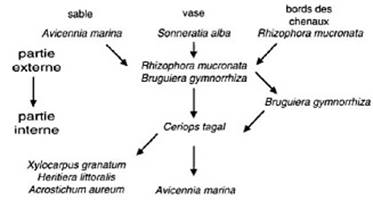
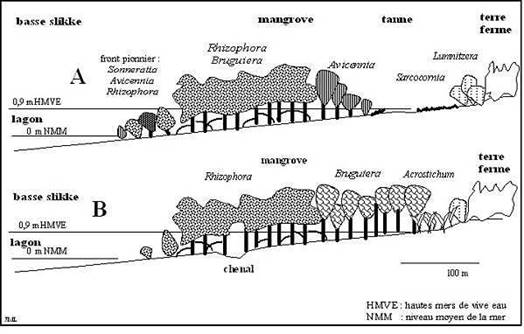








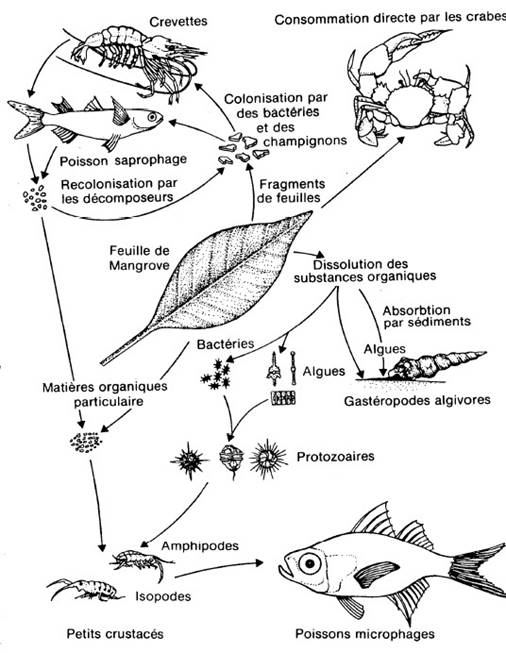
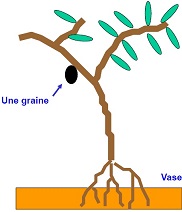
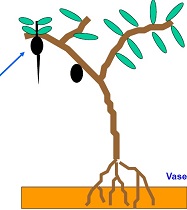
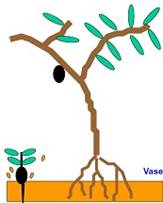

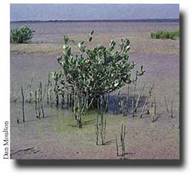










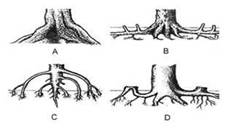










































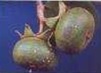
















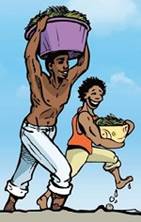



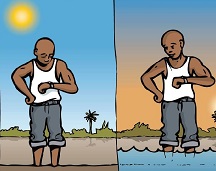



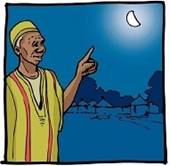




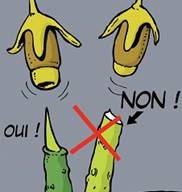

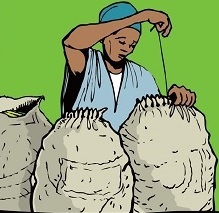
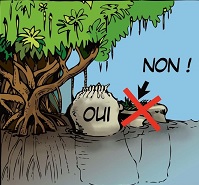




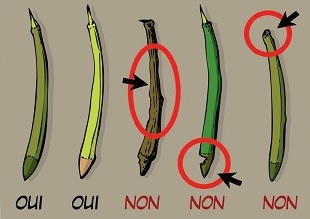
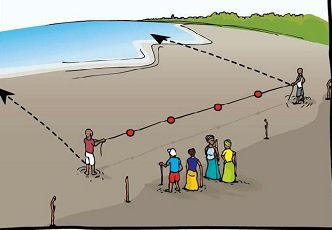





















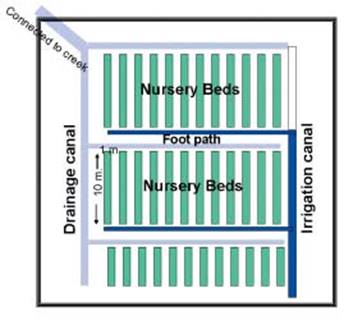



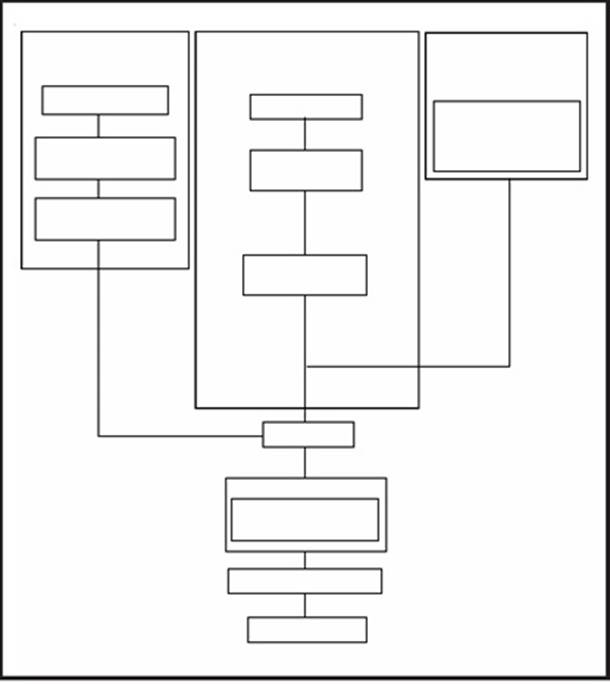
















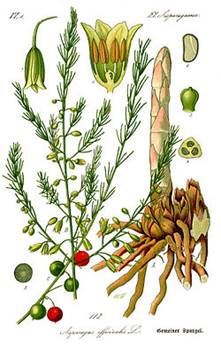





















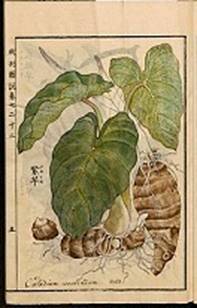














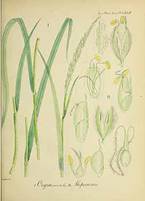
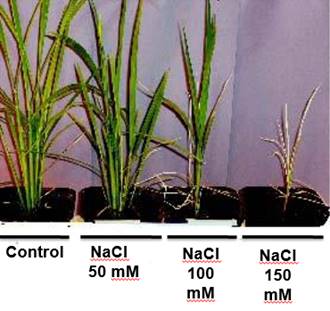














































































































































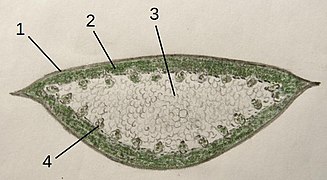




















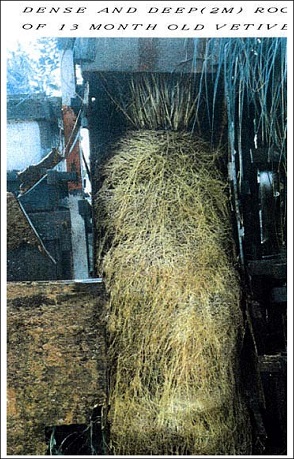
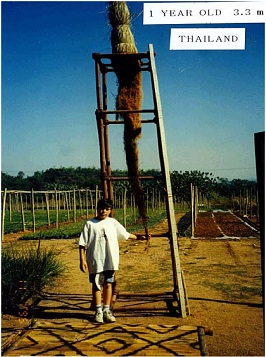






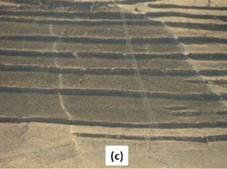



























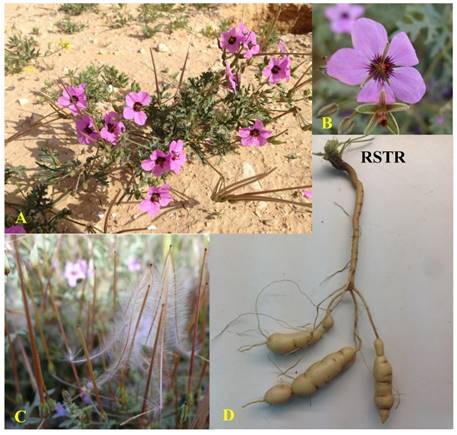
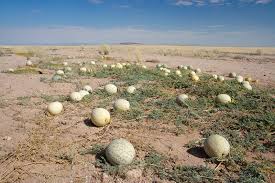



























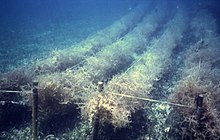




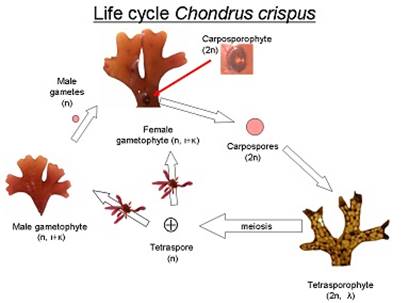

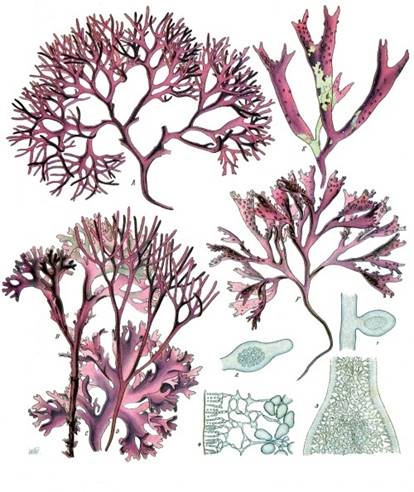










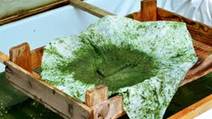










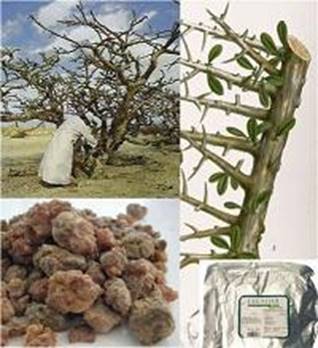







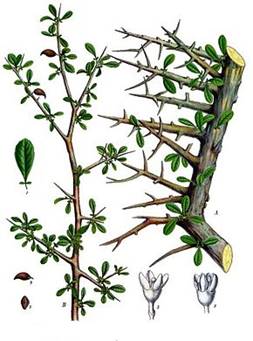























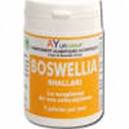



 Source
image
Source
image








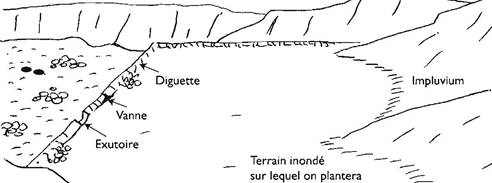


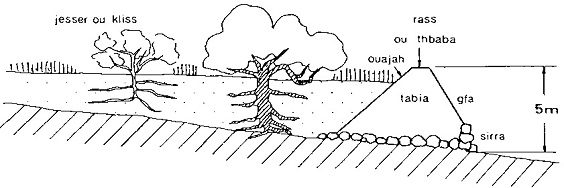
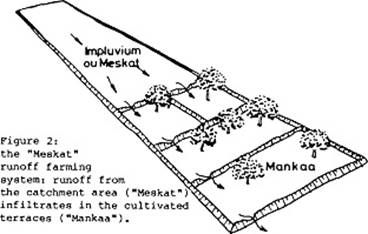
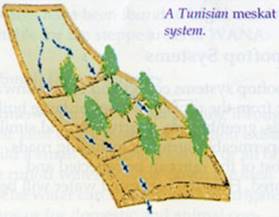
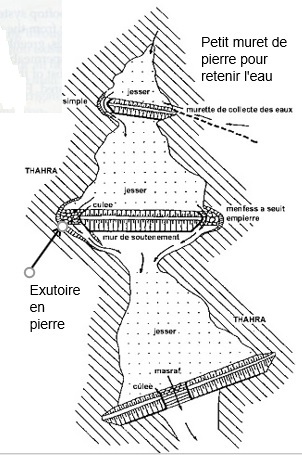
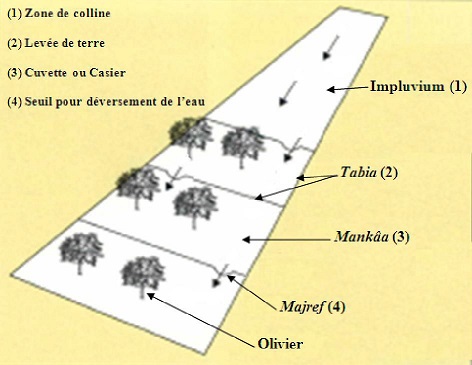
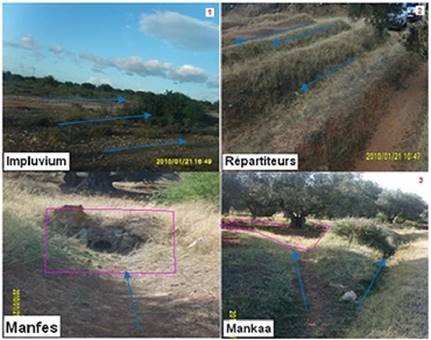

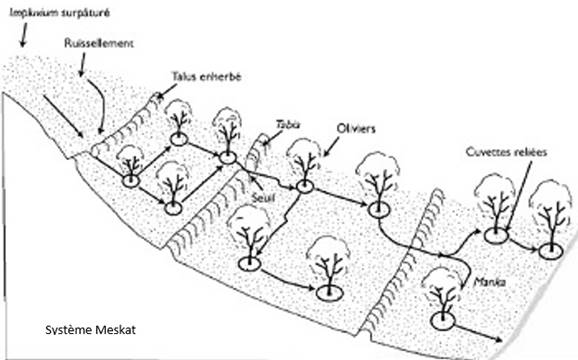
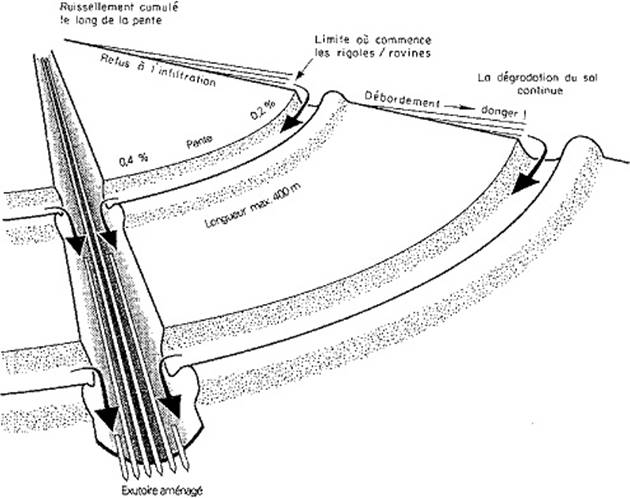
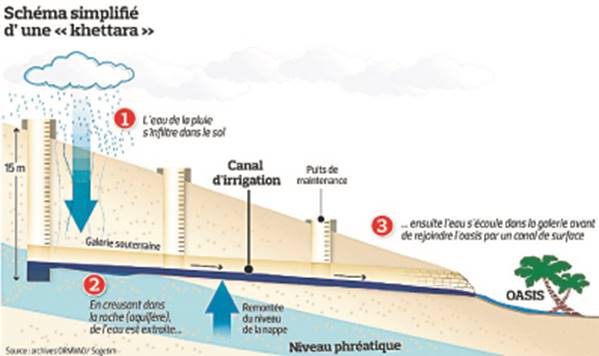







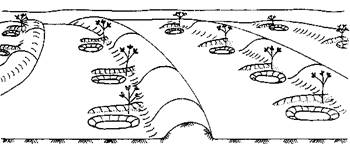

















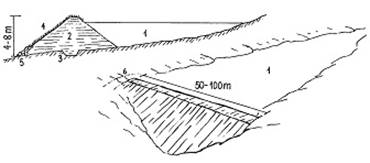






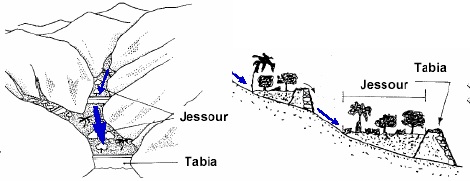


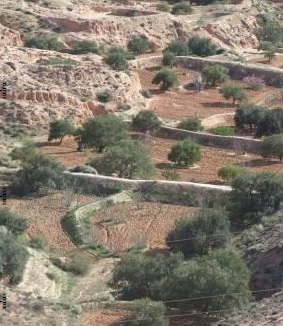







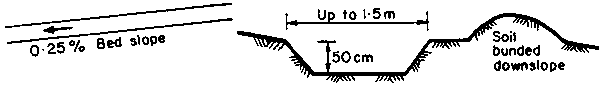
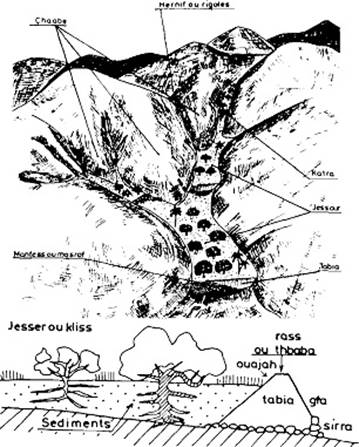
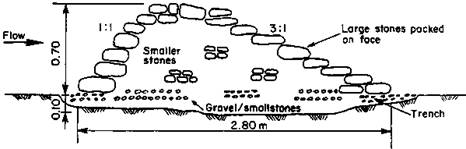
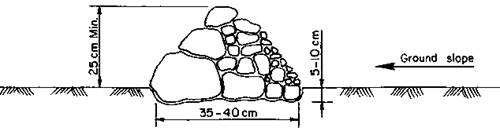






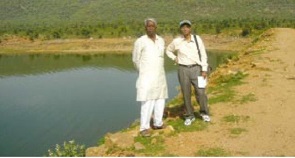

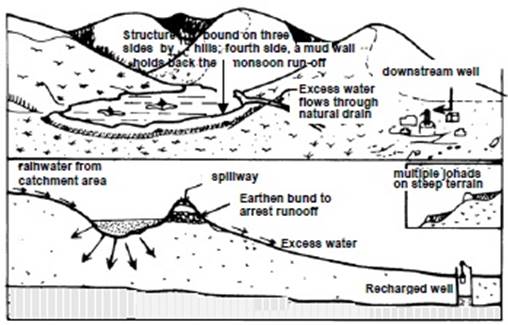















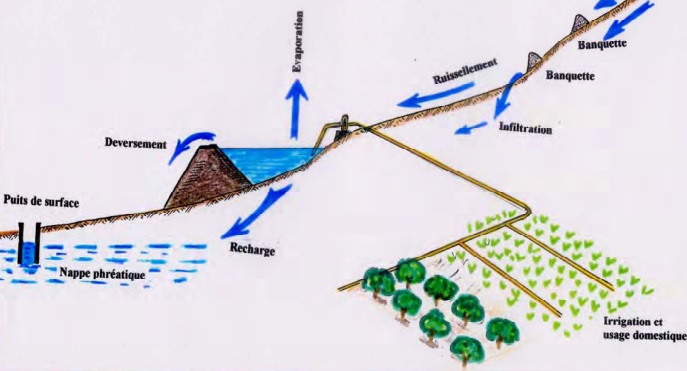


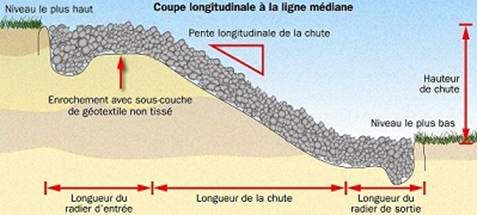
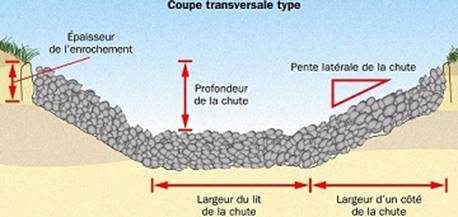







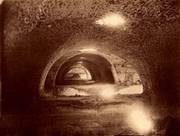
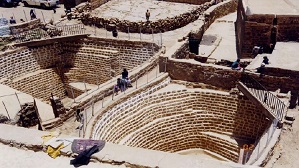

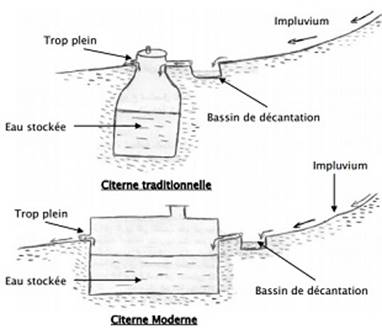

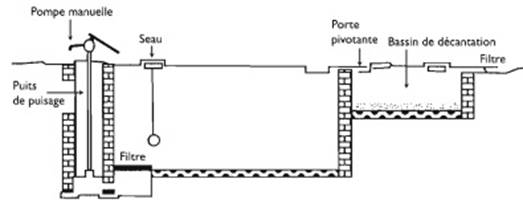

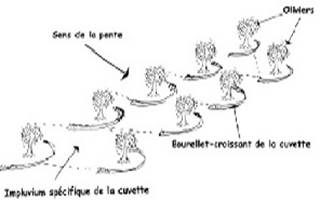









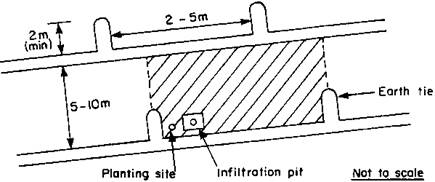
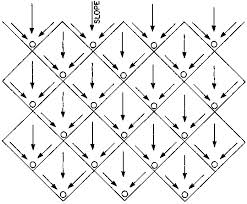
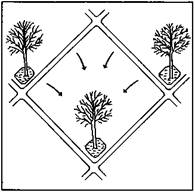



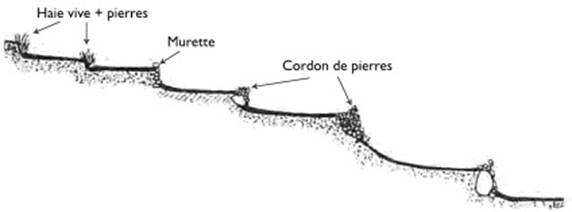
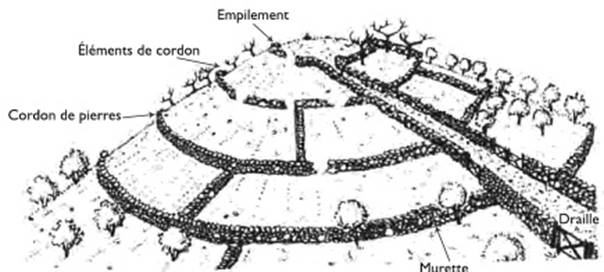




















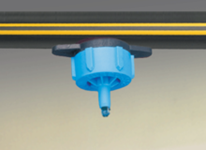









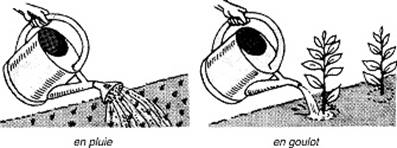




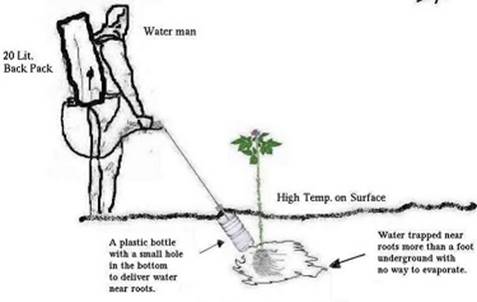




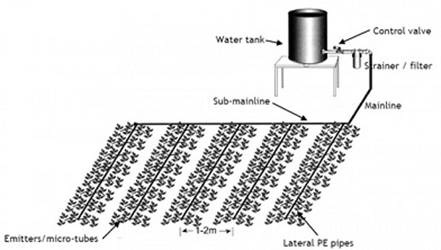
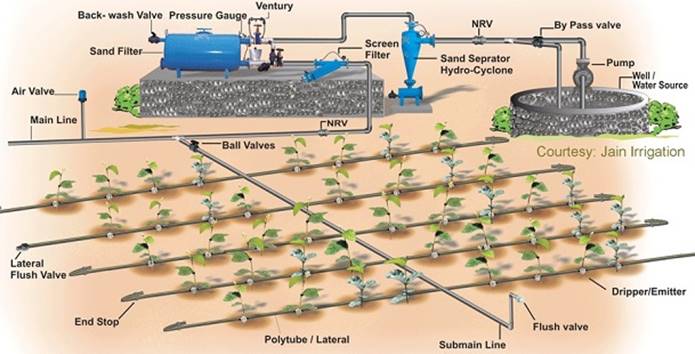

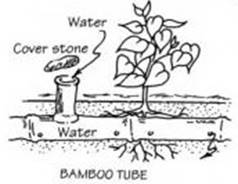

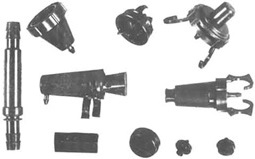

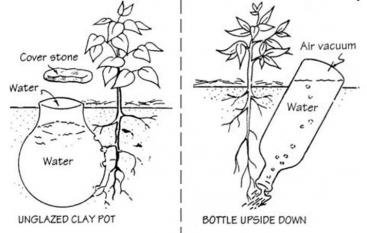
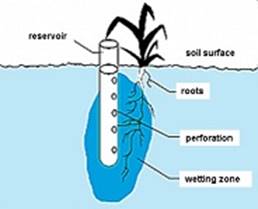














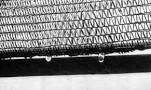









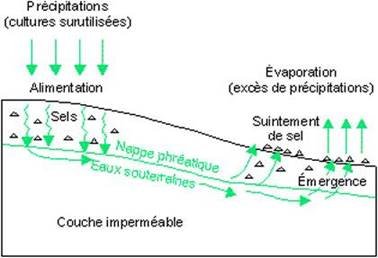



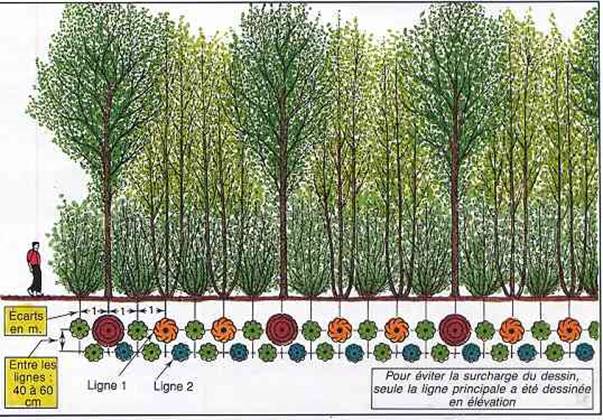
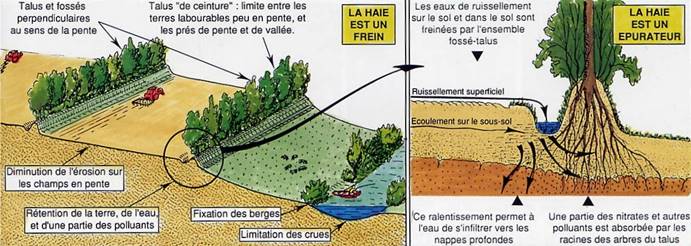
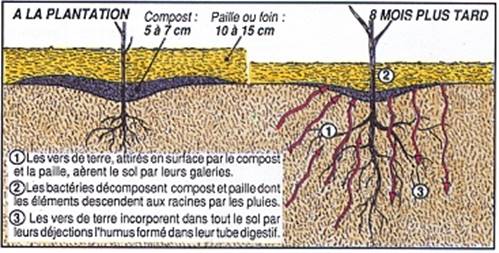






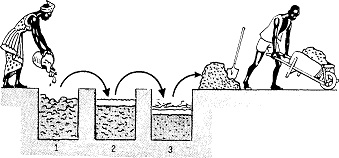


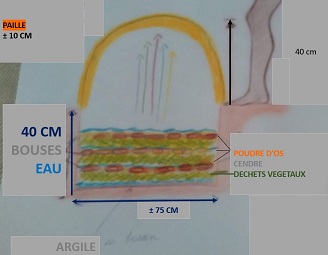
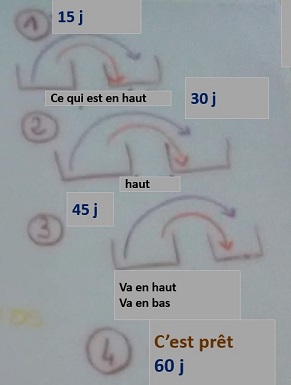

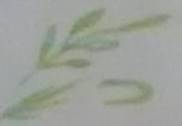
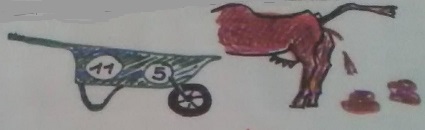
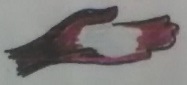


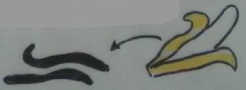
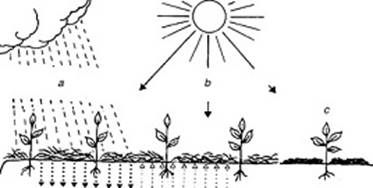
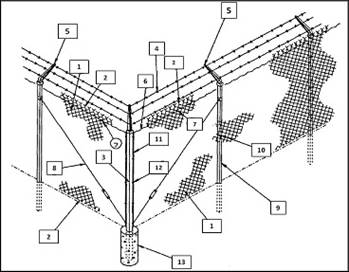




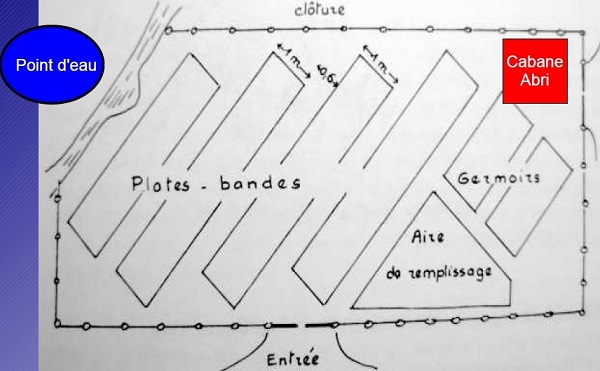
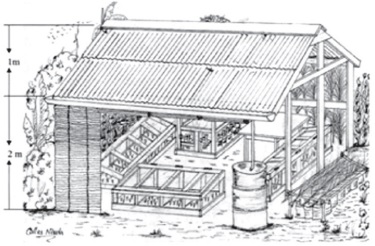






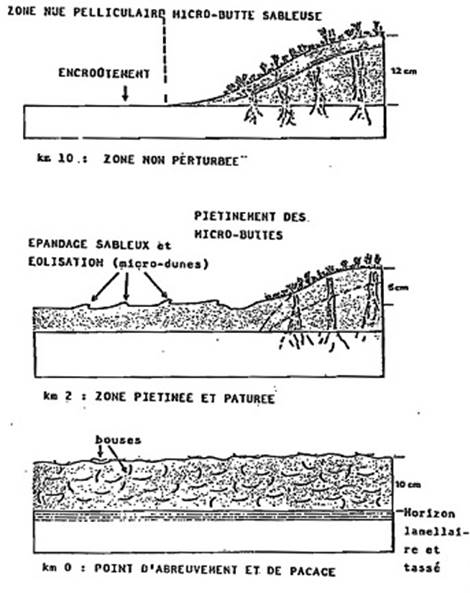












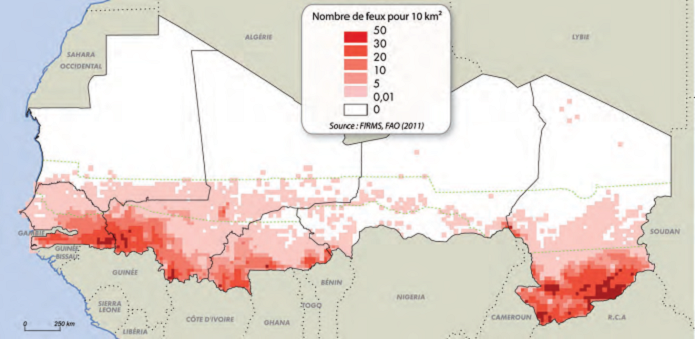














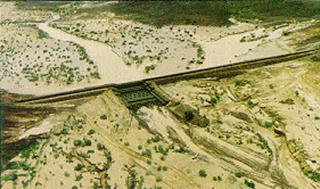


















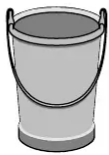




















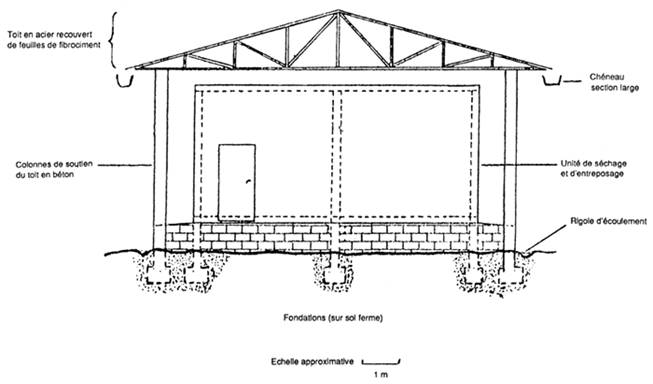





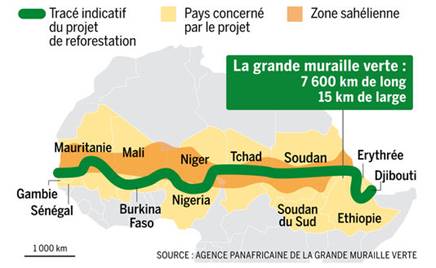

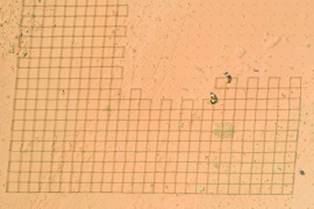


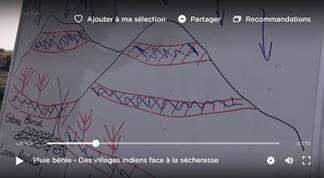
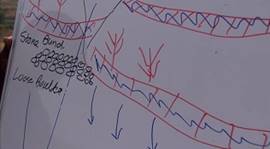


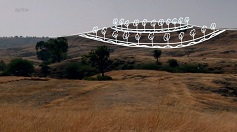
















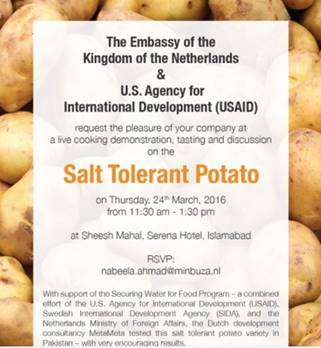





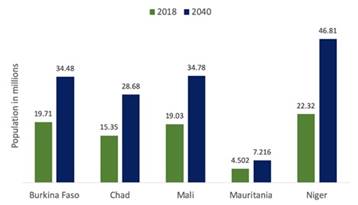


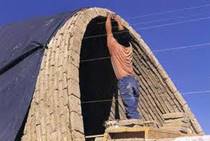






































 Tronc
Tronc